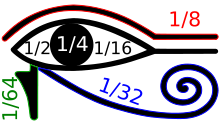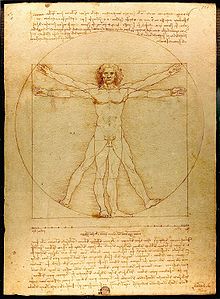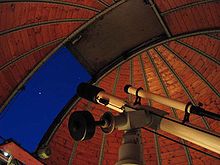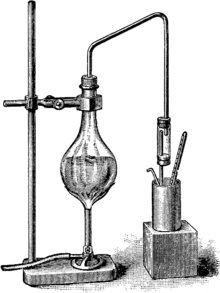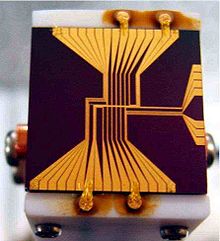- Science
-
 Pour les articles homonymes, voir Science (homonymie).
Pour les articles homonymes, voir Science (homonymie).La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondées sur des relations objectives vérifiables [sens restreint] »[1].
La volonté de la communauté scientifique, garante des sciences, est de produire des « connaissances scientifiques » à partir de méthodes d'investigation rigoureuses, vérifiables et reproductibles. Quant aux « méthodes scientifiques » et aux « valeurs scientifiques », elles sont à la fois le produit et l'outil de production de ces connaissances et se caractérisent par leur but, qui consiste à permettre de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes de la manière la plus élémentaire possible — c'est-à-dire de produire des connaissances se rapprochant le plus possible des faits observables. À la différence des dogmes, qui prétendent également dire le vrai, la science est ouverte à la critique et les connaissances scientifiques, ainsi que les méthodes, sont toujours ouvertes à la révision[réf. nécessaire]. De plus, les sciences ont pour but de comprendre les phénomènes, et d'en tirer des prévisions justes et des applications fonctionnelles ; leurs résultats sont sans cesse confrontés à la réalité. Ces connaissances sont à la base de nombreux développements techniques ayant de forts impacts sur la société.
La science est historiquement liée à la philosophie. Dominique Lecourt écrit ainsi qu'il existe « un lien constitutif [unissant] aux sciences ce mode particulier de penser qu'est la philosophie. C'est bien en effet parce que quelques penseurs en Ionie dès le VIIe siècle av. J.‑C. eurent l'idée que l'on pouvait expliquer les phénomènes naturels par des causes naturelles qu'ont été produites les premières connaissances scientifiques »[2]. Dominique Lecourt explique ainsi que les premiers philosophes ont été amenés à faire de la science (sans que les deux ne soient confondues).
La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur un domaine particulier du savoir scientifique. Il s'agit par exemple des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la biologie, de la mécanique, de l'optique, de la pharmacie, de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la sociologie, etc. Cette catégorisation n'est ni fixe, ni unique, et les disciplines scientifiques peuvent elles-mêmes être découpées en sous-disciplines, également de manière plus ou moins conventionnelle. Chacune de ces disciplines constitue une science particulière.
Étymologie : de la « connaissance » à la « recherche »
L'étymologie de « science » vient du latin, « scientia » (« connaissance »), lui-même du verbe « scire » (« savoir ») qui désigne à l'origine la faculté mentale propre à la connaissance[3]. Cette acception se retrouve par exemple dans l'expression de François Rabelais : « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il s'agissait ainsi d'une notion philosophique (la connaissance pure, au sens de « savoir »), qui devint ensuite une notion religieuse, sous l'influence du christianisme. La « docte science » concernait alors la connaissance des canons religieux, de l'exégèse et des écritures, paraphrase pour la théologie, première science instituée.
La racine « science » se retrouve dans d'autres termes tels la « conscience » (étymologiquement, « avec la connaissance »), la « prescience » (« la connaissance du futur »), l'« omniscience » (« la connaissance de tout »), par exemple.
Un terme générique
Définition large
Le mot science est un polysème, recouvrant principalement trois acceptions[4] :
- Savoir, connaissance de certaines choses qui servent à la conduite de la vie ou à celle des affaires.
- Ensemble des connaissances acquises par l’étude ou la pratique.
- Hiérarchisation, organisation et synthèse des connaissances au travers de principes généraux (théories, lois, etc.)
Définition stricte
D'après Michel Blay[5], la science est « la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. »
Cette définition permet de distinguer les trois types de science :
- les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les « sciences mathématisées » comme la physique théorique ;
- les sciences physico-chimiques et expérimentales (sciences de la nature et de la matière, biologie, médecine) ;
- les sciences humaines, qui concernent l'Homme, son histoire, son comportement, la langue, le social, le psychologique, le politique.
Néanmoins, leurs limites sont floues ; en d'autres termes il n'existe pas de catégorisation systématique des types de science, ce qui constitue par ailleurs l'un des questionnements de l'épistémologie. Dominique Pestre explique ainsi que « ce que nous mettons sous le vocable « science » n’est en rien un objet circonscrit et stable dans le temps qu’il s’agirait de simplement décrire »[6].
Principe de l'acquisition scientifique
Article détaillé : Évaluation de la recherche scientifique.L'acquisition de connaissances reconnues comme scientifiques passent par une suite de mécanismes. Francis Bacon en a décrit le mécanisme qui peut être simplifié comme suit :
- observation, expérimentation et vérification
- théorisation
- prévision
Les méthodes scientifiques permettent de procéder à des expérimentations rigoureuses, reconnues comme telles par la communauté de scientifiques. Les données recueillies permettent une théorisation, la théorisation permet de faire des prévisions qui doivent ensuite être vérifiées par l'expérimentation et l'observation. Une théorie est rejetée lorsque ces prévisions ne cadrent pas à l'expérimentation. Le chercheur ayant fait ces vérifications doit, pour que la connaissance scientifique progresse, faire connaitre ces travaux aux autres scientifiques qui valideront ou non son travail au cours d'une procédure d'évaluation.
Pluralisme des définitions
Le mot « science », dans son sens strict, s'oppose à l'opinion (« doxa » en grec), c'est-à-dire au dogme, assertion par nature arbitraire[7]. Néanmoins le rapport entre l'opinion d'une part et la science d'autre part n'est pas aussi systématique ; l'historien des sciences Pierre Duhem pense en effet que la science s'ancre dans le sens commun, qu'elle doit « sauver les apparences ».
Le discours scientifique s'oppose à la superstition et à l'obscurantisme. Dans le cas de la superstition, il s'agit d'une opposition, la science niant les phénomènes surnaturels. Cependant, l'opinion peut se transformer en un objet de science, voire en une discipline scientifique à part. La sociologie des sciences analyse notamment cette articulation entre science et opinion. Dans le langage commun, la science s'oppose à la croyance, par extension les sciences sont souvent considérées comme contraires aux religions. Cette considération est toutefois souvent plus nuancée tant par des scientifiques que des religieux[note 1],[note 2].
L’idée même d’une production de connaissance est problématique : nombre de domaines reconnus comme scientifiques n’ont pas pour objet la production de connaissances, mais celle d’instruments, de machines, de dispositifs techniques. Terry Shinn a ainsi proposé la notion de « recherche technico-instrumentale »[8]. Ses travaux avec Bernward Joerges à propos de l’« instrumentation »[9] ont ainsi permis de mettre en évidence que le critère de « scientificité » n'est pas dévolu à des sciences de la connaissance seules.
Le mot « science » définit aux XXe et XXIe siècles l'institution de la science, c'est-à-dire l'ensemble des communautés scientifiques travaillant à l'amélioration du savoir humain et de la technologie, dans sa dimension internationale, méthodologique, éthique et politique. On parle alors de « la science ».
La notion ne possède néanmoins pas de définition consensuelle. L'épistémologue André Pichot écrit ainsi qu'il est « utopique de vouloir donner une définition a priori de la science »[10]. L'historien des sciences Robert Nadeau explique pour sa part qu'il est « impossible de passer ici en revue l'ensemble des critères de démarcation proposés depuis cent ans par les épistémologues, [et qu'on] ne peut apparemment formuler un critère qui exclut tout ce qu'on veut exclure, et conserve tout ce qu'on veut conserver »[11]. La physicienne et philosophe des sciences Léna Soler, dans son manuel d'épistémologie, commence également par souligner « les limites de l'opération de définition »[12]. Les dictionnaires en proposent certes quelques-unes. Mais, comme le rappelle Léna Soler, ces définitions ne sont pas satisfaisantes. Les notions d'« universalité », d'« objectivité » ou de « méthode scientifique » (surtout lorsque cette dernière est conçue comme étant l'unique notion en vigueur) sont l'objet de trop nombreuses controverses pour qu'elles puissent constituer le socle d'une définition acceptable. Il faut donc tenir compte de ces difficultés pour décrire la science. Et cette description reste possible en tolérant un certain « flou » épistémologique.
Histoire de la science
Article principal : Histoire des sciences.L'histoire des sciences est intimement liée à l'histoire des sociétés et des civilisations[13]. D'abord confondue avec l'investigation philosophique, dans l'Antiquité, puis religieuse, du Moyen Âge jusqu'au Siècle des Lumières, la science possède une histoire complexe. L'histoire de la science et des sciences peut se dérouler selon deux axes comportant de nombreux embranchements[note 3]:
- l'histoire des découvertes scientifiques d'une part,
- l'histoire de la pensée scientifique d'autre part, formant pour partie l'objet d'étude de l'épistémologie.
 Allégorie de la Science[note 4].
Allégorie de la Science[note 4].
Bien que très liées, ces deux histoires ne doivent pas être confondues. Bien plutôt, il s'agit d'une interrogation sur la production et la recherche de savoir. Michel Blay fait même de la notion de « savoir » la véritable clé de voûte d'une histoire des sciences et de la science cohérente :
« Repenser la science classique exige de saisir l'émergence des territoires et des champs du savoir au moment même de leur constitution, pour en retrouver les questionnements fondamentaux[14]. »
De manière générale, l'histoire des sciences n'est ni linéaire, ni réductible aux schémas causaux simplistes. L'épistémologue Thomas Samuel Kuhn parle ainsi, bien plutôt, des « paradigmes de la science » comme des renversements de représentations, tout au long de l'histoire des sciences. Kuhn énumère ainsi un nombre de « révolutions scientifiques »[15]. André Pichot distingue ainsi entre l’histoire des connaissances scientifiques et celle de la pensée scientifique[16]. Une histoire de la science et des sciences distingueraient de même, et également, entre les institutions scientifiques, les conceptions de la science, ou celle des disciplines.
Premières traces : Préhistoire et Antiquité
Article détaillé : Histoire des sciences#Antiquité.Préhistoire
Article détaillé : ergologie.La technique précède la science dans les premiers temps de l'humanité. En s'appuyant sur une démarche empirique, l'homme développe ses outils (travail de la pierre puis de l'os, propulseur) et découvre l'usage du feu dès le Paléolithique inférieur. La plupart des préhistoriens s'accordent pour penser que le feu est utilisé depuis 250 000 ans ou 300 000 ans. Les techniques du feu utilisées se ramènent soit à la percussion (acier contre silex[réf. nécessaire] ou silex contre marcassite) soit par friction de deux morceaux de bois (par sciage, par rainurage par giration). Durant cette période, on admet généralement que l'explication magique des phénomènes était la règle. Cependant, pour de nombreux paléontologues et préhistoriens comme Jean Clottes, l'art pariétal montre que l'homme d'alors possédait les mêmes facultés cognitives que l'homme moderne[note 5].
Ainsi, l'homme préhistorique savait, intuitivement, calculer ou déduire des comportements de l'observation de son environnement, base du raisonnement scientifique. Certaines « proto-sciences » comme le calcul ou la géométrie en particulier apparaissent, pour des raisons de comptage agricole notamment. L'astronomie permet, dans ces premiers temps, de constituer une cosmogonie. Les travaux du français André Leroi-Gourhan, spécialiste de la technique, explorent les évolutions à la fois biopsychiques et techniques de l'homme préhistorique. Selon lui, « les techniques s'enlèvent dans un mouvement ascensionnel foudroyant »[17], dès l'acquisition de la station verticale, en somme très tôt dans l'histoire de l'homme.
Mésopotamie
Article détaillé : Sciences mésopotamienne et babylonienne.Les premières traces d'activités scientifiques datent des civilisations humaines du néolithique où se développent commerce et urbanisation[18]. Ainsi, pour André Pichot, dans La Naissance de la science[19], la science naît en Mésopotamie, vers - 3500, principalement dans les villes de Sumer et d'Élam. Les premières interrogations sur la matière, avec les expériences d'alchimie, sont liées aux découvertes des techniques métallurgiques qui caractérisent cette période. La fabrication d'émaux date ainsi de - 2000. Mais l'innovation la plus importante provient de l'invention de l'écriture cunéiforme (en forme de clous), qui, par les pictogrammes, permet la reproduction de textes, la manipulation abstraite de concepts également[note 6]. La numération est ainsi la première méthode scientifique à voir le jour, sur une base 60 (« gesh » en mésopotamien), permettant de réaliser des calculs de plus en plus complexes, et ce même si elle reposait sur des moyens matériels rudimentaires[20]. L'écriture se perfectionnant (période dite « akadienne »), les sumériens découvrent les fractions ainsi que la numération dite « de position », permettant le calcul de grands nombres. Le système décimal apparaît également, via le pictogramme du zéro initial, ayant la valeur d'une virgule, pour noter les fractions[21]. La civilisation mésopotamienne aboutit ainsi à la constitution des premières sciences telles : la métrologie, très adaptée à la pratique[22], l'algèbre (découvertes de planches à calculs permettant les opérations de multiplication et de division, ou « tables d'inverses » pour cette dernière[23] ; mais aussi des puissances, racines carrées, cubiques ainsi que les équations du premier degré, à une et deux inconnues), la géométrie (calculs de surfaces, théorèmes[24]), l'astronomie enfin (calculs de mécanique céleste, prévisions des équinoxes, constellations, dénomination des astres). La médecine a un statut particulier ; elle est la première science « pratique », héritée d'un savoir-faire tâtonnant[25].
Les sciences étaient alors le fait des scribes, qui, note André Pichot, se livraient à de nombreux « jeux numériques »[26] qui permettaient de lister les problèmes. Cependant, les sumériens ne pratiquaient pas la démonstration. Dès le début, les sciences mésopotamiennes sont assimilées à des croyances, comme l'astrologie ou la mystique des nombres, qui deviendront des pseudo-sciences ultérieurement. L'histoire de la science étant très liée à celle des techniques, les premières inventions témoignent de l'apparition d'une pensée scientifique abstraite. La Mésopotamie crée ainsi les premiers instruments de mesure, du temps et de l'espace (comme les gnomon, clepsydre, et polos). Si cette civilisation a joué un rôle majeur, elle n'a pas cependant connu la rationalité puisque celle-ci « n'a pas encore été élevée au rang de principal critère de vérité, ni dans l'organisation de la pensée et de l'action, ni a fortiori, dans l'organisation du monde »[27].
Égypte pharaonique
Article détaillé : Sciences dans l'Égypte antique.L'Égypte antique va développer l'héritage pré-scientifique mésopotamien. Cependant, en raison de son unité culturelle spécifique, la civilisation égyptienne conserve « une certaine continuité dans la tradition [scientifique] »[28] au sein de laquelle les éléments anciens restent très présents. L'écriture des hiéroglyphes permet la représentation plus précise de concepts ; on parle alors d'une écriture idéographique. La numération est décimale mais les Égyptiens ne connaissent pas le zéro. Contrairement à la numération sumérienne, la numération égyptienne évolue vers un système d'écriture des grands nombres (entre 2000 et 1600 av. J.-C.) par « numération de juxtaposition »[note 8]. La géométrie fit principalement un bond en avant. Les Égyptiens bâtissaient des monuments grandioses en ne recourant qu'au système des fractions symbolisé par l'œil d'Horus, dont chaque élément représentait une fraction.
Dès 2600 av. J.-C., les Égyptiens calculaient correctement la surface d'un rectangle et d'un triangle. Il ne reste que peu de documents attestant l'ampleur des mathématiques égyptiennes ; seuls les papyri de Rhind, (datant de 1800 av. J.-C.), de Kahun, de Moscou et du Rouleau de cuir[29] éclairent les innovations de cette civilisation qui sont avant tout celles des problèmes algébriques (de division, de progression arithmétique, géométrique). Les Égyptiens approchent également la valeur du nombre Pi, en élevant au carré les 8/9es du diamètre, découvrant un nombre équivalant à ≈ 3,1605 (au lieu de ≈ 3,1416). Les problèmes de volume (de pyramide, de cylindre à grains) sont résolus aisément. L'astronomie progresse également : le calendrier égyptien compte 365 jours, le temps est mesuré à partir d'une « horloge stellaire » et les étoiles visibles sont dénombrées. En médecine, la chirurgie fait son apparition. Une théorie médicale se met en place, avec l'analyse des symptômes et des traitements et ce dès 2300 avant J.-C. (le Papyrus Ebers est ainsi un véritable traité médical).
Pour André Pichot, la science égyptienne, comme celle de Mésopotamie avant elle, « est encore engagée dans ce qu'on a appelé « la voie des objets », c'est-à-dire que les différentes disciplines sont déjà ébauchées, mais qu'aucune d'entre elles ne possède un esprit réellement scientifique, c'est-à-dire d'organisation rationnelle reconnue en tant que telle[30]. »
Chine de l'Antiquité
Article détaillé : Histoire des sciences et techniques en Chine.Les Chinois découvrent également le théorème de Pythagore (que les Babyloniens connaissaient quinze siècles avant l'ère chrétienne). En astronomie, ils identifient la comète de Halley et comprennent la périodicité des éclipses. Ils inventent par ailleurs la fonte du fer. Durant la période des Royaumes combattants, apparaît l'arbalète. En -104, est promulgué le calendrier « Taichu », premier véritable calendrier chinois. En mathématiques, les chinois inventent, vers le IIe siècle av. J.‑C., la numération à bâtons. Il s'agit d'une notation positionnelle à base 10 comportant dix-huit symboles, avec un vide pour représenter le zéro, c'est-à-dire la dizaine, centaine, etc. dans ce système de numérotation.
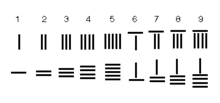 La « numération en bâtons » chinoise.
La « numération en bâtons » chinoise.
En 132, Zhang Heng invente le premier sismographe pour la mesure des tremblements de terre et est la première personne en Chine à construire un globe céleste rotatif. Il invente aussi l'odomètre. La médecine progresse sous les Han orientaux avec Zhang Zhongjing et Hua Tuo, à qui l'on doit en particulier la première anesthésie générale.
En mathématique, Sun Zi et Qin Jiushao étudient les systèmes linéaires et les congruences (leurs apports sont généralement considérés comme majeurs). De manière générale, l'influence des sciences chinoises fut considérable, sur l'Inde et sur les arabes.
Science en Inde
Article détaillé : Mathématiques indiennes.La civilisation dite de la vallée de l'Indus (-3300 à -1500) est surtout connue en histoire des sciences en raison de l'émergence des mathématiques complexes (ou « ganita »). La numération décimale de position et les symboles numéraux indiens, qui deviendront les chiffres arabes, vont influencer considérablement l'Occident via les arabes et les chinois. Les grands livres indiens sont ainsi traduits au IXe siècle dans les « maisons du savoir » par élèves d'Al-Khawarizmi, père arabe de l'algorithme. Les Indiens ont également maîtrisé le zéro, les nombres négatifs, les fonctions trigonométriques ainsi que le calcul différentiel et intégral, les limites et séries. Les « Siddhânta » sont le nom générique donné aux ouvrages scientifiques sanskrits.
On distingue habituellement deux périodes de découvertes abstraites et d'innovations technologiques dans l'Inde de l'Antiquité : les mathématiques de l'époque védique (-1500 à -400) et les mathématiques de l'époque jaïniste (- 400 à 200)[note 9].
« Logos » grec : les prémisses philosophiques de la science
Article détaillé : sciences grecques.Présocratiques
Pour l'épistémologue Geoffrey Ernest Richard Lloyd[31], la méthode scientifique fait son apparition dans la Grèce du VIIe siècle av. J.‑C. ; ainsi Aristote est l'un des premiers savants à manipuler des démonstrations scientifiques. Cependant, les philosophes dits « pré-socratiques » sont les premiers à s'être interrogés sur les phénomènes naturels. Appelés les « physiologoï » par Aristote parce qu'ils tiennent un discours rationnel sur la nature, ils enquêtent sur les causes naturelles des phénomènes qui deviennent les premiers objets de méthode. Thalès de Milet (v. 625-547 av. J.-C.) et Pythagore (v. 570-480 av. J.-C.) contribuent principalement à la naissance des premières sciences comme les mathématiques, la géométrie (théorème de Pythagore), l'astronomie ou encore la musique. Ces premières recherches sont marquées par la volonté d'imputer la constitution du monde (ou « cosmos ») à un principe naturel unique (le feu pour Héraclite par exemple) ou divin (l'« Un » pour Anaximandre). Les pré-socratiques mettent en avant des principes constitutifs des phénomènes, les « archè ».
Les présocratiques initient également une réflexion sur la théorie de la connaissance. Constatant que la raison d'une part et les sens d'autre part conduisent à des conclusions contradictoires, Parménide opte pour la raison et estime qu'elle seule peut mener à la connaissance, alors que nos sens nous trompent. Ceux-ci, par exemple, nous enseignent que le mouvement existe, alors que la raison nous enseigne qu'il n'existe pas. Cet exemple est illustré par les célèbres paradoxes de son disciple Zénon. Si Héraclite est d'un avis opposé concernant le mouvement, il partage l'idée que les sens sont trompeurs. De telles conceptions favorisent la réflexion mathématique. Par contre, elles sont un obstacle au développement des autres sciences et singulièrement des sciences expérimentales. Sur cette question, ce courant de pensée se prolonge, quoique de manière plus nuancée, jusque Platon, pour qui les sens ne révèlent qu'une image imparfaite et déformée des Idées, qui sont la vraie réalité (allégorie de la caverne).
À ces philosophes, s'oppose le courant épicurien. Initié par Démocrite, contemporain de Socrate, il sera développé, bien évidemment, par Épicure et magnifiquement exposé par le Romain Lucrèce dans De rerum natura. Pour eux, les sens nous donnent à connaître la réalité. Leur théorie atomiste affirme que la matière est formée d'entités dénombrables et insécables, les atomes. Ceux-ci s'assemblent pour former la matière comme les lettres s'assemblent pour former les mots. Tout est constitué d'atomes, y compris les dieux. Ceux-ci ne s'intéressent nullement aux hommes, et il n'y a donc pas lieu de les craindre. On trouve donc dans l'épicurisme la première formulation claire de la séparation entre le savoir et la religion, même si, de manière moins explicite, l'ensemble des présocratiques se caractérise par le refus de laisser les mythes expliquer les phénomènes naturels, comme les éclipses.
Il faudra attendre Aristote pour aplanir l'opposition entre les deux courants de pensée mentionnés plus haut.
La méthode pré-socratique est également fondée dans son discours, s'appuyant sur les éléments de la rhétorique : les démonstrations procèdent par une argumentation logique et par la manipulation de concepts abstraits, bien que génériques.
Par ailleurs, les Grecs établissent que la terre est sphérique, et en calculent la circonférence.
Platon et la dialectique
Article détaillé : dialectique.Avec Socrate et Platon, qui en rapporte les paroles et les dialogues, la raison : logos, et la connaissance deviennent intimement liés. Le raisonnement abstrait et construit apparaît. Pour Platon, les « Formes » sont le modèle de tout ce qui est sensible, ce sensible étant un ensemble de combinaisons géométriques d'éléments. Platon ouvre ainsi la voie à la « mathématisation » des phénomènes. Les sciences mettent sur la voie de la philosophie, au sens de « discours sur la sagesse » ; inversement, la philosophie procure aux sciences un fondement assuré. L'utilisation de la dialectique, qui est l'essence même de la science complète alors la philosophie, qui a, elle, la primauté de la connaissance discursive (par le discours), ou « dianoia » en grec. Pour Michel Blay : « La méthode dialectique est la seule qui, rejetant successivement les hypothèses, s'élève jusqu'au principe même pour assurer solidement ses conclusions ». Socrate en expose les principes dans le Théétète[32]. Pour Platon, la recherche de la vérité et de la sagesse (la philosophie) est indissociable de la dialectique scientifique, c'est en effet le sens de l'inscription figurant sur le fronton de l'Académie, à Athènes : « Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre »[note 11].
Aristote et la physique
C'est surtout avec Aristote, qui fonde la physique et la zoologie, que la science acquiert une méthode, basée sur la déduction. On lui doit la première formulation du syllogisme et de l'induction[33]. Les notions de « matière », de « forme », de « puissance » et d'« acte » deviennent les premiers concepts de manipulation abstraite[note 12]. Pour Aristote, la science est subordonnée à la philosophie (c'est une « philosophie seconde » dit-il) et elle a pour objet la recherche des premiers principes et des premières causes, ce que le discours scientifique appellera le causalisme et que la philosophie nomme l' « aristotélisme ». Néanmoins, dans le domaine particulier de l'astronomie, Aristote est à l'origine d'un recul de la pensée par rapport à certains pré-socratiques[réf. nécessaire] quant à la place de la terre dans l'espace. À la suite d'Eudoxe de Cnide, il imagine un système géocentrique et considère que le cosmos est fini. Il sera suivi en cela par ses successeurs en matière d'astronomie, jusqu'à Copernic, à l'exception d'Aristarque, qui proposera un système héliocentrique. Il détermine par ailleurs que le vivant est ordonné selon une chaîne hiérarchisée mais sa théorie est avant tout fixiste. Il pose l'existence des premiers principes indémontrables, ancêtres des conjectures mathématiques et logiques. Il décompose les propositions en nom et verbe, base de la science linguistique[33].
Période alexandrine et Alexandrie à l'époque romaine
Article détaillé : sciences grecques.La période dite « alexandrine » (de -323 à -30) et son prolongement à l'époque romaine sont marqués par des progrès significatifs en astronomie et en mathématiques ainsi que par quelques avancées en physique. La ville égyptienne d'Alexandrie en est le centre intellectuel et les savants d'alors y sont grecs.
Les travaux d'Archimède (-292 à -212) sur sa poussée correspond à la première loi physique connue alors que ceux d'Ératosthène (-276 à -194) sur la circonférence de la terre ou ceux d'Aristarque de Samos (-310 à -240) sur les distances terre-lune et terre-soleil témoignent d'une grande ingéniosité. Apollonius de Perga modélise les mouvements des planètes à l'aide d'orbites excentriques.
Hipparque de Nicée (-194 à -120) perfectionne les instruments d’observation comme le dioptre, le gnomon et l'astrolabe. En algèbre et géométrie, il divise le cercle en 360 °, et crée même le premier globe céleste (ou orbe). Hipparque rédige également un traité en 12 livres sur le calcul des cordes (nommé aujourd'hui la trigonométrie). En astronomie, il propose une « théorie des épicycles » qui permettra à son tour l'établissement de tables astronomiques très précises. L'ensemble se révèlera largement fonctionnel, permettant par exemple de calculer pour la première fois des éclipses lunaires et solaires.
Ptolémée d’Alexandrie (85 après J-C. à 165) prolonge les travaux d'Hipparque et d'Aristote sur les orbites planétaires et aboutit à un système géocentrique du système solaire, qui fut accepté dans les mondes occidental et arabe pendant plus de mille trois cents ans, jusqu'au modèle de Nicolas Copernic. Ptolémée fut l’auteur de plusieurs traités scientifiques, dont deux ont exercé par la suite une très grande influence sur les sciences islamique et européenne. L’un est le traité d’astronomie, qui est aujourd’hui connu sous le nom de l’Almageste ; l’autre est la Géographie, qui est une discussion approfondie sur les connaissances géographiques du monde gréco-romain.
 Un fragment des Éléments d'Euclide trouvé à Oxyrhynque.
Un fragment des Éléments d'Euclide trouvé à Oxyrhynque.
Euclide (-325 à -265) est l'auteur des Éléments, qui sont considérés comme l'un des textes fondateurs des mathématiques modernes. Ces postulats, comme celui nommé le « postulat d'Euclide », que l'on exprime de nos jours en affirmant que « par un point pris hors d'une droite il passe une et une seule parallèle à cette droite » sont à la base de la géométrie systématisée.
Ingénierie et technologie romaines
Article détaillé : Technologie de la Rome antique.La technologie romaine est un des aspects les plus importants de la civilisation romaine. Cette technologie, en partie liée à la technique de la voute, probablement empruntée aux Étrusques, a été certainement la plus avancée de l'Antiquité. Elle permit la domestication de l'environnement, notamment par les routes et aqueducs. Cependant, le lien entre prospérité économique de l'Empire romain et niveau technologique est discuté par les spécialistes : certains, comme Emilio Gabba, historien italien, spécialiste de l'histoire économique et sociale de la République romaine, considèrent que les dépenses militaires ont freiné le progrès scientifique et technique, pourtant riche[note 13]. Pour J. Kolendo, le progrès technique romain serait lié à une crise de la main-d'œuvre, due à la rupture dans la « fourniture » d'esclaves non qualifiés, sous l'empereur Auguste. Les romains aurait ainsi été capables de développer des techniques alternatives. Pour L. Cracco Ruggini, la technologie traduit la volonté de prestige des couches dominantes[34].
Cependant, la philosophie, la médecine et les mathématiques sont d'origine grecque, ainsi que certaines techniques agricoles. La période pendant laquelle la technologie romaine est la plus foisonnante est le IIe siècle av. J.‑C. et le Ier siècle av. J.‑C., et surtout à l'époque d'Auguste. La technologie romaine a atteint son apogée au Ier siècle avec le ciment, la plomberie, les grues, machines, dômes, arches. Pour l'agriculture, les Romains développent le moulin à eau. Néanmoins, les savants romains furent peu nombreux et le discours scientifique abstrait progressa peu pendant la Rome antique : « les Romains, en faisant prévaloir les « humanités », la réflexion sur l'homme et l'expression écrite et orale, ont sans doute occulté pour l'avenir des « realita » scientifiques et techniques »[35], mis à part quelques grands penseurs, comme Vitruve ou Apollodore de Damas, souvent d'origine étrangère d'ailleurs. Les romains apportèrent surtout le système de numération romain pour les Unités de mesure romaines en utilisant l'abaque romain, ce qui permet d'homogénéiser le comptage des poids et des distances.
Science au Moyen Âge
Articles détaillés : Science du Moyen Âge et Sciences et techniques dans l'Empire byzantin.Bien que cette période s'apparente généralement à l'histoire européenne, les avancées technologiques et les évolutions de la pensée scientifique du monde oriental (civilisation arabo-musulmane) et, en premier lieu, celles de l'empire byzantin, qui hérite du savoir latin, et où puisera le monde arabo-musulman, enfin celles de la Chine sont décisives dans la constitution de la « science moderne », internationale, institutionnelle et se fondant sur une méthodologie. La période du Moyen Âge s'étend ainsi de 512 à 1492 ; elle connaît le développement sans précédent des techniques et des disciplines, en dépit d'une image obscurantiste, propagée par les manuels scolaires.
En Europe
Les byzantins maîtrisaient l'architecture urbaine et l'admission d'eau ; ils perfectionnèrent également les horloges à eau et les grandes norias pour l'irrigation ; technologies hydrauliques dont la civilisation arabe a hérité et qu'elle a transmis à son tour. L'hygiène et la médecine firent également des progrès[note 14]. Les Universités byzantines ainsi que les bibliothèques compilèrent de nombreux traités et ouvrages d'étude sur la philosophie et le savoir scientifique de l'époque[note 15].
L'Europe occidentale, après une période de repli durant le Haut Moyen Âge, retrouve un élan culturel et technique qui culmine au XIIe siècle. Néanmoins, du VIIIe siècle au Xe siècle la période dite, en France, de la Renaissance carolingienne permit, principalement par la scolarisation, le renouveau de la pensée scientifique. La scolastique, au XIe siècle préconise un système cohérent de pensée proche de ce que sera l'empirisme. La philosophie naturelle se donne comme objectif la description de la nature, perçue comme un système cohérent de phénomènes (ou pragmata), mûs par des «lois »[note 16]. Le Bas Moyen Âge voit la logique faire son apparition — avec l'académie de Port-Royal-des-Champs — et diverses méthodes scientifiques se développer ainsi qu'un effort pour élaborer des modèles mathématiques ou médicaux qui jouera « un rôle majeur dans l'évolution des différentes conceptions du statut des sciences »[36]. D'autre part le monde médiéval occidental voit apparaître une « laïcisation du savoir », concomitant à l'« autonomisation des sciences ».
Dans le monde arabo-musulman
Article détaillé : Sciences et techniques islamiques.Le monde arabo-musulman est à son apogée intellectuelle du VIIIe au XIVe siècle ce qui permet le développement d'une culture scientifique spécifique, d'abord à Damas sous les derniers Omeyyades, puis à Bagdad sous les premiers Abbassides. La science arabo-musulmane est fondée sur la traduction et la lecture critique des ouvrages de l'Antiquité[note 17]. L'étendue du savoir arabo-musulman est étroitement liée aux guerres de conquête de l'Islam qui permettent aux Arabes d'entrer en contact avec les civilisations indienne et chinoise. Le papier, emprunté aux Chinois remplace rapidement le parchemin dans le monde musulman. Le Calife Harun ar-Rachid, féru d'astronomie, crée en 829 à Bagdad le premier observatoire permanent, permettant à ses astronomes de réaliser leurs propres études du mouvement des astres. Abu Raihan al-Biruni, reprenant les écrits d'Eratosthène d'Alexandrie (IIIe siècle av. J.‑C.), calcule le diamètre de la Terre et affirme que la Terre tournerait sur elle-même, bien avant Galilée. En 832 sont fondées les Maisons de la sagesse (Baït al-hikma), lieux de partage et de diffusion du savoir.
En médecine, Avicenne (980-1037) rédige une monumentale encyclopédie, le Qanûn. Ibn Nafis décrit la circulation sanguine pulmonaire, et al-Razi recommande l'usage de l'alcool en médecine. Au XIe siècle, Abu-l-Qasim az-Zahrawi (appelé Abulcassis en Occident) écrit un ouvrage de référence pour l'époque, sur la chirurgie.
En mathématiques l'héritage antique est sauvegardé et approfondi permettant la naissance de l'algèbre. L'utilisation des chiffres arabes et du zéro rend possible des avancées en analyse combinatoire et en trigonométrie.
Enfin, la théologie motazilite se développe sur la logique et le rationalisme, inspirés de la philosophie grecque et de la raison (logos), qu'elle cherche à rendre compatible avec les doctrines islamiques.
Sciences en Chine médiévale
Article détaillé : Histoire des sciences et techniques en Chine.La Chine de l'Antiquité a surtout contribué à l'innovation technique, avec les trois inventions principales[note 18] qui sont : la papier (daté du IIe siècle av. J.‑C.), la poudre (la première trace écrite attestée semble être le Wujing Zongyao qui daterait des alentours de 1044) et la boussole, utilisée dès le XIe siècle, dans la géomancie. Le scientifique chinois Shen Kuo (1031-1095) de la Dynastie Song décrit la boussole magnétique comme instrument de navigation.
 Maquette d'une cuillère indiquant le sud (appelée sinan) du temps des Han (206 avant J.-C. - 220 après J.-C.).
Maquette d'une cuillère indiquant le sud (appelée sinan) du temps des Han (206 avant J.-C. - 220 après J.-C.).
Pour l'historien Joseph Needham, dans Science et civilisation en Chine[note 19], vaste étude de dix-sept volumes, la société chinoise a su mettre en place une science innovante, dès ses débuts. Needham en vient même à relativiser la conception selon laquelle la science doit tout à l'Occident. Pour lui, la Chine était même animée d'une ambition de collecter de manière désintéressée le savoir, avant même les universités occidentales[note 20].
Les traités de mathématiques et de démonstration abondent comme Les Neuf chapitres (qui présentent près de 246 problèmes) transmis par Liu Hui (IIIe siècle) et par Li Chunfeng (VIIe siècle) ou encore les Reflets des mesures du cercles sur la mer de Li Ye datant de 1248 étudiés par Karine Chemla et qui abordent les notions arithmétique des fractions, d'extraction de racines carrée et cubique, le calcul de l'aire du cercle et du volume de la pyramide entre autres[37]. Karine Chelma a ainsi démontré que l'opinion répandue selon laquelle la démonstration mathématique serait d'origine grecque était partiellement fausse, les chinois s'étant posés les mêmes problèmes à leur époque ; elle dira ainsi : on ne peut rester occidentalo-centré, l'histoire des sciences exige une mise en perspective internationale des savoirs[38]. romain reglad good
Inde des mathématiques médiévales
Les mathématiques indiennes sont particulièrement abstraites et ne sont pas orientées vers la pratique, au contraire de celles des Égyptiens par exemple. C'est avec Brahmagupta (598 - 668) et son ouvrage célèbre, le Brahmasphutasiddhanta, particulièrement complexe et novateur, que les différentes facettes du zéro, chiffre et nombre, sont parfaitement comprises et que la construction du système de numération décimal de position est parachevée. L'ouvrage explore également ce que les mathématiciens européens du XVIIe siècle ont nommé la « méthode chakravala », qui est un algorithme pour résoudre les équations diophantiennes. Les nombres négatifs sont également introduits, ainsi que les racines carrées. La période s'achève avec le mathématicien Bhaskara II (1114 - 1185) qui écrivit plusieurs traités importants. À l'instar de Nasir ad-Din at-Tusi (1201 - 1274) il développe en effet la dérivation[réf. nécessaire]. On y trouve des équations polynomiales, des formules de trigonométrie, dont les formules d'addition. Bhaskara est ainsi l'un des pères de l'analyse puisqu'il introduit plusieurs éléments relevant du calcul différentiel : le nombre dérivé, la différentiation et l'application aux extrema, et même une première forme du théorème de Rolle[réf. nécessaire].
Mais c'est surtout avec Âryabhata (476 - 550), dont le traité d’astronomie porte le nom, l’Aryabatîya, écrit en vers vers 499 avant J.-C. que les mathématiques indiennes se révèlent[note 21]. Il s'agit d'un court traité d'astronomie présentant 66 théorèmes d'arithmétique, d'algèbre, ou de trigonométrie plane et sphérique. Aryabhata invente par ailleurs un système de représentation des nombres fondé sur les signes consonantiques de l'alphasyllabaire sanskrit.
Ces percées seront reprises et amplifiées par les mathématiciens et astronomes de l'école du Kerala, parmi lesquels : Madhava de Sangamagrama, Nilakantha Somayaji, Parameswara, Jyeshtadeva, ou Achyuta Panikkar, pendant la période médiévale du Ve siècle au XVe siècle. Ainsi, le Yuktibhasa ou Ganita Yuktibhasa est un traité de mathématiques et d'astronomie, écrit par l'astronome indien Jyesthadeva, membre de l'école mathématique du Kerala en 1530[39]. Jyesthadeva a ainsi devancé de trois siècles la découverte du calcul infinitésimal par les occidentaux.
Fondements de la science moderne en Europe
Science institutionnalisée
C'est au tournant du XIIe siècle, et notamment avec la création des premières universités de Paris (1170) et Oxford (1220) que la science en Europe s'institutionnalisa, en dépit[non neutre] d'une affiliation intellectuelle avec la sphère religieuse. La traduction et la redécouverte des textes antiques grecs, et en premier lieu les Éléments d'Euclide ainsi que les textes d'Aristote, grâce à la civilisation arabo-musulmane, firent de cette période une renaissance des disciplines scientifiques, classées dans le quadrivium (parmi les Arts Libéraux). Les Européens découvrirent ainsi l'avancée des Arabes, notamment les traités mathématiques : Algèbre d'Al-Khwarizmi, Optique d'Ibn al-Haytham ainsi que la somme médicale d'Avicenne. En s'institutionnalisant, la science devint plus ouverte et plus fondamentale, même si elle restait assujettie aux dogmes religieux et qu'elle n'était qu'une branche encore de la philosophie et de l'astrologie. Aux côtés de Roger Bacon, la période fut marquée par quatre autres personnalités qui jetèrent, en Europe chrétienne, les fondements de la science moderne :
Roger Bacon (1214 - 1294) est philosophe et moine anglais. Il jeta les bases de la méthode expérimentale. Roger Bacon admet trois voies de connaissance : l'autorité, le raisonnement et l'expérience. Il rejette donc l'autorité de l'évidence, qui s'appuie sur des raisons extérieures et promeut « L'argument [qui] conclut et nous fait concéder la conclusion, mais il ne certifie pas et il n'éloigne pas le doute au point que l'âme se repose dans l'intuition de la vérité, car cela n'est possible que s'il la trouve par la voie de l'expérience »[40]. Les œuvres de Bacon ont pour but l'intuition de la vérité, c'est-à-dire la certitude scientifique, et cette vérité à atteindre est pour lui le salut. La science procédant de l'âme est donc indispensable.
Robert Grosseteste (env. 1168 - 1253) étudia Aristote et posa les prémices des sciences expérimentales, en explicitant le schéma : observations, déductions de la cause et des principes, formation d'hypothèse(s), nouvelles observations réfutant ou vérifiant les hypothèses enfin[note 22]. Il développa les techniques d'optique et en fit même la science physique fondamentale (il étudia le comportement des rayons lumineux et formule même la première description de principe du miroir réfléchissant, principe qui permettra l'invention du télescope).
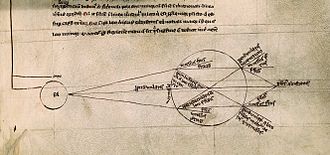 « Réfraction de la lumière » par Robert Grosseteste De natura locorum (XIIIe siècle).
« Réfraction de la lumière » par Robert Grosseteste De natura locorum (XIIIe siècle).
Albert le Grand (1193-1280) fut considéré par les historiens comme un alchimiste et magicien, néanmoins ses études biologiques permirent de jeter les fondations des disciplines des sciences de la vie. Il mena ainsi l'étude du développement du poulet en observant le contenu d'œufs pondus dans le temps et commenta le premier le phénomène de la nutrition du fœtus. Il établit également une classification systématique des végétaux, ancêtre de la taxonomie. Il décrit également les premières expériences de chimie[note 23].
L'Europe sortait ainsi d'une léthargie intellectuelle, initiée par l'Église, qui interdit jusqu'en 1234 les ouvrages d'Aristote, accusé de paganisme[réf. nécessaire]. Les premiers savants chrétiens, en étudiant Aristote, firent donc, au début, acte d'hérésie ; ce n'est qu'avec Saint Thomas d'Aquin que la doctrine aristotélicienne fut acceptée par les papes.
Saint Thomas d'Aquin, théologien, permit de redécouvrir, par le monde arabe, les textes d'Aristote et des autres philosophes grecs, qu'il étudia à Naples, à l'université dominicaine[note 24]. Cependant, il est surtout connu pour son principe dit de l'autonomie respective de la raison et de la foi. Saint Thomas d'Aquin fut en effet le premier théologien à distinguer, dans sa Somme théologique (1266-1273) la raison (faculté naturelle de penser, propre à l'homme) et la foi (adhésion au dogme de la Révélation)[41]. Celle-ci est indémontrable, alors que la science est explicable par l'étude des phénomènes et des causes. L'une et l'autre enfin ne peuvent s'éclairer mutuellement.
Guillaume d'Occam (v. 1285- v. 1349) permit une avancée sur le plan de la méthode. En énonçant son principe de parcimonie, appelé aussi « rasoir d'Occam », il procure à la science un cadre épistémologique fondé sur l'économie des arguments. Empiriste avant l'heure, Occam postule que : « Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem », littéralement « Les entités ne doivent pas être multipliées par delà ce qui est nécessaire ». Il explique par là qu'il est inutile d'avancer sans preuves et de forger des concepts illusoires permettant de justifier n'importe quoi[42].
Renaissance et la « science classique »
Article détaillé : Sciences et techniques de la Renaissance.La Renaissance est une période qui se situe en Europe à la fin du Moyen Âge et au début des Temps modernes. Dans le courant du XVe siècle et au XVIe siècle, cette période permit à l'Europe de se lancer dans des expéditions maritimes d'envergure mondiale, connues sous le nom de grandes découvertes ; de nombreuses innovations furent popularisées, comme la boussole ou le sextant ; la cartographie se développa, ainsi que la médecine, grâce notamment au courant de l'humanisme. Selon l'historien anglais John Hale, ce fut à cette époque que le mot Europe entra dans le langage courant et fut doté d'un cadre de référence solidement appuyé sur des cartes et d'un ensemble d'images affirmant son identité visuelle et culturelle. La science comme discipline de la connaissance acquit ainsi son autonomie et ses premiers grands systèmes théoriques à tel point que Michel Blay parle du « chantier de la science classique »[note 25]. Cette période est abondante en descriptions, inventions, applications et en représentations du monde, qu'il importe de décomposer afin de rendre une image fidèle de cette phase historique :
Naissance de la méthode scientifique : Francis Bacon
Francis Bacon (1561 - 1626) est le père de l'empirisme. Il pose le premiers les fondements de la science et de ses méthodes[note 26]. Dans son étude des faux raisonnements, sa meilleure contribution a été dans la doctrine des idoles. D'ailleurs, il écrit dans le Novum Organum (ou « nouvelle logique » par opposition à celle d’Aristote) que la connaissance nous vient sous forme d'objets de la nature, mais que l'on impose nos propres interprétations sur ces objets.
D'après Bacon, nos théories scientifiques sont construites en fonction de la façon dont nous voyons les objets ; l'être humain est donc biaisé dans sa déclaration d'hypothèses. Pour Bacon, « la science véritable est la science des causes ». S’opposant à la logique aristotélicienne[note 27] qui établit un lien entre les principes généraux et les faits particuliers, il abandonne la pensée déductive, qui procède à partir des principes admis par l’autorité des Anciens, au profit de l’« interprétation de la nature », où l’expérience enrichit réellement le savoir[note 28]. En somme, Bacon préconise un raisonnement et une méthode fondés sur le raisonnement expérimental :
« L'empirique, semblable à la fourmi, se contente d'amasser et de consommer ensuite ses provisions. Le dogmatique, telle l'araignée ourdit des toiles dont la matière est extraite de sa propre substance. L'abeille garde le milieu ; elle tire la matière première des fleurs des champs, puis, par un art qui lui est propre, elle la travaille et la digère. (...) Notre plus grande ressource, celle dont nous devons tout espérer, c'est l'étroite alliance de ses deux facultés : l'expérimentale et la rationnelle, union qui n'a point encore était formée[43] »
.
Pour Bacon, comme plus tard pour les scientifiques, la science améliore la condition humaine. Il expose ainsi une utopie scientifique, dans la Nouvelle Atlantide (1627), qui repose sur une société dirigée par « un collège universel » composé de savants et de praticiens.
De l'« imago mundi » à l'astronomie
Article détaillé : Révolution copernicienne.et
Article détaillé : Histoire de l'astronomie.Directement permise par les mathématiques de la Renaissance, l'astronomie s'émancipe de la mécanique aristotélicienne, retravaillée par Hipparque et Ptolémée. La théologie médiévale se fonde quant à elle, d'une part sur le modèle d'Aristote, d'autre part sur le dogme de la création biblique du monde. C'est surtout Nicolas Copernic, avec son ouvrage De revolutionibus (1543) qui met fin au modèle aristotélicien de l'immuabilité de la Terre. Sa doctrine a permis l'instauration de l'héliocentrisme : « avec Copernic, et avec lui seul, s'amorce un bouleversement dont sortiront l'astronomie et la physique modernes » explique Jean-Pierre Verdet, Docteur ès sciences[44]. Repris et développé par Georg Joachim Rheticus, l'héliocentrisme sera confirmé par des observations[note 29], en particulier celles des phases de Vénus et de Jupiter par Galileo Galilei (1564 - 1642), qui met par ailleurs au point une des premières lunettes astronomiques, qu'il nomme « télescope ». Dans cette période, et avant que Galilée n'intervienne, la théorie de Copernic reste confinée à quelques spécialistes, de sorte qu'elle ne rencontre que des oppositions ponctuelles de la part des théologiens, les astronomes restant le plus souvent favorables à la thèse géocentrique. Néanmoins, en 1616, le Saint-Office publie un décret condamnant le système de Copernic et mettant son ouvrage à l'index. En dépit de cette interdiction, « Galilé adoptera donc la cosmologie de Copernic et construira une nouvelle physique avec le succès et les conséquences que l'on sait »[45], c'est-à-dire qu'il permettra la diffusion des thèses héliocentriques. Kepler dégagera les lois empiriques des mouvements célestes alors que Huygens décrira la force centrifuge. Newton unifiera ces approches en découvrant la gravitation universelle.
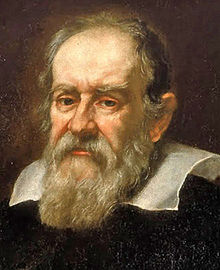 Portrait de Galileo Galilei.
Portrait de Galileo Galilei.
Le danois Tycho Brahe observera de nombreux phénomènes astronomiques comme une nova et fondera le premier observatoire astronomique, « Uraniborg »[46]. Il y fit l'observation d'une comète en 1577. Johannes Kepler, l'élève de Brahe, qu'il rencontre en 1600, va quant à lui initier les premiers calculs à des fins astronomiques, en calculant un lever de Terre sur la Lune, et en énonçant ses « trois lois » établies de 1609 à 16l9[note 30]. Avec Huygens la géométrie devient la partie centrale de la science astronomique, faisant écho aux mots de Gallilée se paraphrasant par l'expression : « le livre du monde est écrit en mathématique »[47].
Avec tous ces astronomes, et en l'espace d'un siècle et demi (jusqu'aux Principia de Newton en 1687), la représentation de l'univers passe d'un « monde clos à un monde infini » selon l'expression d'Alexandre Koyré[note 31].
De l'alchimie à la chimie
Articles détaillés : Alchimie et Histoire de la chimie.Art ésotérique depuis l'Antiquité, l'alchimie est l'ancêtre de la physique au sens d'observation de la matière. Selon Serge Hutin, docteur ès Lettres spécialiste de l'alchimie, les « rêveries des occultistes » bloquèrent néanmoins le progrès scientifique, surtout au XVIe siècle et au XVIIe siècle[48]. Il retient néanmoins que ces mirages qui nourrirent l'allégorie alchimique ont considérablement influencé la pensée scientifique. L'expérimentation doit ainsi beaucoup aux laboratoires des alchimistes, qui découvrirent de nombreux corps que répertoriés plus tard par la chimie : l'antimoine, l'acide sulfurique ou le phosphore par exemple. Les instruments des alchimistes furent ceux des chimistes modernes, l'alambic par exemple. Selon Serge Hutin, c'est surtout sur la médecine que l'alchimie eut une influence notable, par l'apport de médications minérales et par l'élargissement de la pharmacopée[49].
En dépit de ces faits historiques, le passage de l'alchimie à la chimie demeure complexe. Pour le chimiste Jean-Baptiste Dumas : « La chimie pratique a pris naissance dans les ateliers du forgeron, du potier, du verrier et dans la boutique du parfumeur »[50]. « L'alchimie n'a donc pas joué le rôle unique dans la formation de la chimie ; il n'en reste pas moins que ce rôle a été capital ». Pour la conscience populaire, ce sont les premiers chimistes modernes — comme Antoine Laurent de Lavoisier surtout, au XVIIIe siècle, qui pèse et mesure les éléments chimiques — qui consomment le divorce entre chimie et alchimie. De nombreux philosophes et savants sont ainsi soit à l'origine des alchimistes (Roger Bacon ou Paracelse), soit s'y intéressent, tels Francis Bacon[51] et même, plus tard Isaac Newton. Or, « c'est une erreur de confondre l'alchimie avec la chimie. La chimie moderne est une science qui s'occupe uniquement des formes extérieures dans lesquelles l'élément de la matière se manifeste [alors que] (...) L'alchimie ne mélange ou ne compose rien » selon F. Hartmann, pour qui elle est davantage comparable à la botanique[52]. En somme, bien que les deux disciplines soient liées, par l'histoire et leurs acteurs, la différence réside dans la représentation de la matière : combinaisons chimiques pour la chimie, manifestations du monde inanimé comme phénomènes biologiques pour l'alchimie. Pour Bernard Vidal, l'alchimie a surtout « permis d'amasser une connaissance manipulatoire, pratique, de l'objet chimique (...) L'alchimiste a ainsi commencé à débroussailler le champ d'expériences qui sera nécessaire aux chimistes des siècles futurs »[53].
La chimie naît ainsi comme discipline scientifique avec Andreas Libavius (1550 - 1616) qui publie le premier recueil de chimie, en lien avec la médecine et la pharmacie (il classifie les composés chimiques et donne les méthodes pour les préparer) alors que plus tard Nicolas Lémery (1645 - 1715) publiera le premier traité de chimie faisant autorité avec son Cours de chimie, contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine, par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opération, pour l’instruction de ceux qui veulent s’appliquer à cette science en 1675. Johann Rudolph Glauber (1604 - 1668) ou Robert Boyle apportent quant à eux de considérables expérimentations portant sur les éléments chimiques[54].
Émergence de la physiologie moderne
Article détaillé : Histoire de la biologie#La renaissance.Les découvertes médicales et les progrès effectués dans la connaissance de l’anatomie, en particulier après la première traduction de nombreuses œuvres antiques d’Hippocrate et de Galien aux XVe siècle et XVIe siècle permettent des avancées en matière d'hygiène et de lutte contre la mortalité. André Vésale jette ainsi les bases de l'anatomie moderne alors que le fonctionnement de la circulation sanguine est découverte par Michel Servet et les premières ligatures des artères sont réalisées par Ambroise Paré.
Diffusion du savoir
Le domaine des techniques progresse considérablement grâce à l’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle, invention qui bouleverse la transmission du savoir. Le nombre de livres publiés devient ainsi exponentiel, la scolarisation de masse est possible, par ailleurs les savants peuvent débattre par l'intermédiaire des comptes-rendus de leurs expérimentations. La science devient ainsi une communauté de savants. Les académies des sciences surgissent, à Londres, Paris, Saint-Petersbourg et Berlin.
Les journaux et périodiques prolifèrent, tels le Journal des sçavans, Acta Eruditorum, Mémoires de Trevoux etc. mais les domaines du savoir y sont encore mêlés et ne constituent pas encore totalement des disciplines. La science, bien que s'institutionnalisant, fait encore partie du champ de l'investigation philosophique. Michel Blay dit ainsi : « il est très surprenant et finalement très anachronique de séparer, pour la période classique, l'histoire des sciences de l'histoire de la philosophie, et aussi de ce que l'on appelle l'histoire littéraire. »[55]
Au final la Renaissance permet, pour les disciplines scientifiques de la matière, la création de disciplines et d'épistémologies distinctes mais réunies par la scientificité, elle-même permise par les mathématiques, car, selon l'expression de Pascal Brioist : « la mathématisation d’une pratique conduit à lui donner le titre spécifique de science »[56]. Michel Blay voit ainsi dans les débats autour de concepts clés, comme ceux d'absolu ou de mouvement, de temps et d'espace, les éléments d'une science classique.
Les « Lumières » et les grands systèmes scientifiques
Au XVIIe siècle, la « révolution scientifique »[57] est permise par la mathématisation de la science. Les universités occidentales avaient commencé à apparaître au XIe siècle, mais ce n'est qu'au cours du XVIIe siècle qu'apparaissent les autres institutions scientifiques, notamment l'Accademia dei Lincei, fondée en 1603 (ancêtre de l'Académie pontificale des sciences), les académies des sciences, les sociétés savantes. Les sciences naturelles et la médecine surtout se développèrent durant cette période[58].
L'Encyclopédie
Un second changement important dans le mouvement des Lumières par rapport au siècle précédent trouve son origine en France, avec les Encyclopédistes. Ce mouvement intellectuel défend l’idée qu’il existe une architecture scientifique et morale du savoir. Le philosophe Denis Diderot et le mathématicien d’Alembert publient en 1751 l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers qui permet de faire le point sur l'état du savoir de l'époque. L'Encyclopédie devient ainsi un hymne au progrès scientifique[note 32].
Avec l'Encyclopédie naît également la conception classique que la science doit son apparition à la découverte de la méthode expérimentale. Jean le Rond D'Alembert explique ainsi, dans le Discours préliminaire de l'Encyclopédie (1759) que :
« Ce n'est point par des hypothèses vagues et arbitraires que nous pouvons espérer de connaître la nature, c'est (...) par l'art de réduire autant qu'il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul qui puisse en être regardé comme le principe (...). Cette réduction constitue le véritable esprit systématique, qu'il faut bien se garder de prendre pour l'esprit de système[59] »
Rationalisme et science moderne
Article détaillé : Rationalisme.La période dite des Lumières initia la montée du courant rationaliste, provenant de René Descartes puis des philosophes anglais, comme Thomas Hobbes et David Hume, qui adoptèrent une démarche empirique[note 33], mettant l’accent sur les sens et l’expérience dans l’acquisition des connaissances, au détriment de la raison pure. Des penseurs, également scientifiques (comme Gottfried Wilhelm von Leibniz, qui développa les mathématiques et le calcul infinitésimal, ou Emmanuel Kant, le baron d'Holbach, dans son Système de la nature, dans lequel il soutient l’athéisme contre toute conception religieuse ou déiste, le matérialisme et le fatalisme c'est-à-dire le déterminisme scientifique, ou encore Pierre Bayle avec ses Pensées diverses sur la comète[note 34]) firent de la Raison (avec une majuscule) un culte au progrès et au développement social. Les découvertes d'Isaac Newton, sa capacité à confronter et à assembler les preuves axiomatiques et les observations physiques en un système cohérent donnèrent le ton de tout ce qui allait suivre son exemplaire Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En énonçant en effet la théorie de la gravitation universelle, Newton inaugura l'idée d'une science comme discours tendant à expliquer le monde, considéré comme rationnel car ordonné par des lois reproductibles.
L'avènement du sujet pensant, en tant qu'individu qui peut décider par son raisonnement propre et non plus sous le seul joug des us et coutumes, avec John Locke, permet la naissance des sciences humaines, comme l'économie, la démographie, la géographie ou encore la psychologie.
Naissance des grandes disciplines scientifiques
La majorité des disciplines majeures de la science se consolident, dans leurs épistémologies et leurs méthodes, au XVIIIe siècle. La botanique apparaît avec Carl von Linné qui publie en 1753 Species plantarum, point du départ du système du binôme linnéen et de la nomenclature botanique[note 35]. La chimie naît par ailleurs avec Antoine Laurent de Lavoisier qui énonce en 1778 la loi de conservation de la matière, identifie et baptise l'oxygène. Les sciences de la terre font aussi leur apparition. Comme discipline, la médecine progresse également avec la constitution des examens cliniques et les premières classification des maladies par William Cullen et François Boissier de Sauvages de Lacroix.
XIXe siècle
La biologie connaît au XIXe siècle de profonds bouleversements avec la naissance de la génétique, suite aux travaux de Gregor Mendel, le développement de la physiologie, l'abandon du vitalisme suite à la synthèse de l'urée qui démontre que les composés organiques obéissent aux mêmes lois physico-chimique que les composés inorganiques. L'opposition entre science et religion se renforce avec la parution de L'Origine des espèces en 1859 de Charles Darwin. Les sciences humaines naissent, la sociologie avec Auguste Comte, la psychologie avec Charcot et Wilhelm Maximilian Wundt.
Claude Bernard et la méthode expérimentale
Claude Bernard (1813-1878) est un médecin et physiologiste, connu pour l'étude du syndrome de Claude Bernard-Horner. Il est considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale[note 36]. Il rédige la première méthode expérimentale, considérée comme le modèle à suivre de la pratique scientifique. Il énonce ainsi les axiomes de la méthode médicale dans son Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (1865) et en premier lieu l'idée que l'observation doit réfuter ou valider la théorie :
« La théorie est l’hypothèse vérifiée après qu’elle a été soumise au contrôle du raisonnement et de la critique. Une théorie, pour rester bonne, doit toujours se modifier avec le progrès de la science et demeurer constamment soumise à la vérification et la critique des faits nouveaux qui apparaissent. Si l’on considérait une théorie comme parfaite, et si on cessait de la vérifier par l’expérience scientifique, elle deviendrait une doctrine[60] »
.
Révolution Industrielle
Article détaillé : Révolution industrielle.Les Première et Seconde Révolutions Industrielles sont marquées par de profonds bouleversements économiques et sociaux, permis par les innovations et découvertes scientifiques et techniques. La vapeur puis l'électricité comptent parmi ces progrès notables qui ont permis l'amélioration des transports et de la production. Les instruments scientifiques sont plus nombreux et plus sûrs, tels le microscope (à l'aide duquel Louis Pasteur découvre les microbes) ou le télescope se perfectionnent. La physique acquiert ses principales lois, notamment avec James Clerk Maxwell qui, énonce les principes de la théorie cinétique des gaz ainsi que l'équation d'onde fondant l'électromagnétisme. Ces deux découvertes permirent d'importants travaux ultérieurs notamment en relativité restreinte et en mécanique quantique. Il esquisse ainsi les fondements des sciences du XXe siècle, notamment les principes de la physique des particules, à propos de la nature de la lumière.
Une science « post-industrielle »
Tout comme le XIXe siècle, le XXe siècle connaît une accélération importante des découvertes scientifiques. On note l'amélioration de la précision des instruments, qui eux-mêmes reposent sur les avancées les plus récentes de la science ; l'informatique qui se développe à partir des années 1950 et permet un meilleur traitement d'une masse d'informations toujours plus importante et aboutit à révolutionner la pratique de la recherche, est un de ces instruments.
Les échanges internationaux des connaissances scientifiques sont de plus en plus rapides et faciles (ce qui se traduit par des enjeux linguistiques) ; toutefois, les découvertes les plus connues du XXe siècle précèdent la véritable mondialisation et l'uniformisation linguistique des publications scientifiques. En 1971 la firme Intel met au point le premier micro-processeur et en 1976 Apple commercialise le premier ordinateur de bureau. Dans La Société post-industrielle. Naissance d'une société d'Alain Touraine, le sociologue présente les caractéristique d'une science au service de l'économie et de la prospérité matérielle.
Complexification des sciences
De « révolutions scientifiques »[61] en révolutions scientifiques, la science vit ses disciplines se spécialiser. La complexification des sciences explosa au XXe siècle, conjointement à la multiplication des champs d'étude. Parallèlement, les sciences viennent à se rapprocher voire à travailler ensemble. C'est ainsi que, par exemple, la biologie fait appel à la chimie et à la physique, tandis que cette dernière utilise l'astronomie pour confirmer ou infirmer ses théories (c'est l'astrophysique). Les mathématiques deviennent le « langage » commun des sciences ; les applications étant multiples. Le cas de la biologie est exemplaire. Elle s'est divisée en effet en de nombreuses branches : en biologie moléculaire, biochimie, biologie génétique, agrobiologie, etc.
 L'informatique, l'innovation majeure du XXe siècle, a apporté une précieuse assistance aux travaux de recherche.
L'informatique, l'innovation majeure du XXe siècle, a apporté une précieuse assistance aux travaux de recherche.
La somme des connaissances devient telle qu'il est impossible pour un scientifique de connaître parfaitement plusieurs branches de la science. C'est ainsi qu'ils se spécialisent de plus en plus et pour contrebalancer cela, le travail en équipe devient la norme. Cette complexification rend la science de plus en plus abstraite pour ceux qui ne participent pas aux découvertes scientifiques, en dépit de programmes nationaux et internationaux (sous l'égide de l'ONU, avec l'UNESCO - pour United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) de vulgarisation des savoirs.
Développement des sciences humaines
Le siècle est également marqué par le développement des sciences humaines[62]. Institutionnalisées dans la séparation que l'université française fait entre les facultés de sciences et médecine d'une part, et celles de lettres, droit et sciences humaines d'autre part, les sciences humaines comportent de nombreuses disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, l'ethnologie, l'histoire, la psychologie, la biologie, la linguistique, la morale, l'archéologie, l'économie entre autres.
Les sciences cognitives proposent un modèle expliquant les facultés mentales ainsi que le comportement humain. La psychanalyse et les autres pratiques thérapeutiques naissent des grands courants théoriques.
Éthique et science : l'avenir de la science au XXIe siècle
Le XXIe siècle est caractérisé par une accélération des découvertes de pointe, comme la nanotechnologie. Par ailleurs, au sein des sciences naturelles, la génétique promet des changements sociaux ou biologiques sans précédents. L'informatique est par ailleurs à la fois une science et un instrument de recherche puisque la simulation informatique permet d'expérimenter des modèles toujours plus complexes et gourmands en termes de puissance de calcul. La science se démocratise d'une part : des projets internationaux voient le jour (lutte contre le SIDA et le cancer, programme SETI, astronomie, détecteurs de particules etc.) ; d'autre part la vulgarisation scientifique permet de faire accéder toujours plus de personnes au raisonnement et à la curiosité scientifique.
L'éthique devient une notion concomitante à celle de science. Les nanotechnologies et la génétique surtout posent les problèmes de société futurs, à savoir, respectivement, les dangers des innovations pour la santé, et la manipulation du patrimoine héréditaire de l'homme. Les pays avancés technologiquement créent ainsi des organes institutionnels chargé d'examiner le bien-fondé des applications scientifiques. Par exemple, des lois bioéthiques se mettent en place à travers le monde, mais pas partout de la même manière, étant très liées aux droits locaux. En France, le Comité Consultatif National d'Éthique est chargé de donner un cadre légal aux découvertes scientifiques[note 37].
Classification des sciences
On distingue les sciences humaines et sociales des sciences de la nature. Les premières, comme la sociologie, portent sur l'étude des phénomènes liés à l'action humaine, les secondes, comme la physique, portent sur l'étude des phénomènes naturels. Plus récemment, quelques auteurs, comme Herbert Simon[note 38], ont évoqué l'apparition d'une catégorie intermédiaire, celle des sciences de l'artificiel, qui portent sur l'étude de systèmes créés par l'homme - artificiels - mais qui présentent un comportement indépendant ou relativement de l'action humaine. Il s'agit par exemple des sciences de l'ingénieur. On peut également distinguer les sciences empiriques, qui portent sur l'étude des phénomènes accessibles par l'observation et l'expérimentation, des sciences logico-formelles, comme la logique ou les mathématiques, qui portent sur des entités purement abstraites. Une autre manière de catégoriser les sciences consiste à distinguer les sciences fondamentales, dont le but premier est de produire des connaissances, des sciences appliquées, qui visent avant tout à appliquer ces connaissances à la résolution de problèmes concrets. D'autres catégorisations existent, notamment la notion de science exacte ou de science dure. Ces dernières catégorisations, bien que très courantes, sont beaucoup plus discutables que les autres, car elles sont porteuses d'un jugement (certaines sciences seraient plus exactes que d'autres, certaines sciences seraient « molles », c'est-à-dire sans véritable consistance, ...). Il existe aussi une Classification des sciences en poupées russes.
De manière générale, aucune catégorisation n'est complètement exacte ni entièrement justifiable, et les zones épistémologiques entre elles demeurent floues[note 39]. Pour Robert Nadeau : « on reconnaît généralement qu’on peut classer [les sciences] selon leur objet (...), selon leur méthode (...), et selon leur but »[63].
Sciences fondamentales et appliquées
Articles détaillés : Science fondamentale et Sciences appliquées.Les « sciences fondamentales » visent prioritairement l'acquisition de connaissances nouvelles. Cette classification première repose sur la notion d'utilité : certaines sciences produisent des connaissances en sorte d’agir sur le monde (les sciences appliquées), c’est-à-dire dans la perspective d’un objectif pratique, tandis que d'autres (les sciences fondamentales) visent prioritairement l’acquisition de connaissances nouvelles abstraites. Néanmoins, cette limite est floue. Les mathématiques, la physique ou la biologie peuvent ainsi aussi bien être fondamentales qu'appliquées, selon le contexte. Les sciences appliquées (qu'il ne faut pas confondre avec la technique en tant qu'application de connaissances empiriques) produisent des connaissances en sorte d'agir sur le monde, c'est-à-dire dans la perspective d'un objectif pratique, économique ou industriel.
Certaines disciplines restent cependant plus ancrées dans un domaine que dans un autre. La cosmologie est par exemple une science exclusivement fondamentale. L'astronomie est également une discipline qui relève dans une grande mesure de la science fondamentale. La médecine, la pédagogie ou l'ingénierie sont au contraire des sciences essentiellement appliquées (mais pas exclusivement). Sciences appliquées et sciences fondamentales ne sont pas cloisonnées. Les découvertes issues de la science fondamentale trouvent des fins utiles (exemple : le laser et son application au son numérique sur CD-ROM). De même, certains problèmes techniques mènent parfois à de nouvelles découvertes en science fondamentale. Ainsi, les laboratoires de recherche et les chercheurs peuvent faire parallèlement de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Par ailleurs, la recherche en sciences fondamentales utilise les technologies issues de la science appliquée, comme la microscopie, les possibilités de calcul des ordinateurs par la simulation numérique, par exemple.
Par ailleurs, les mathématiques sont souvent considérées comme autre chose qu'une science, en partie parce que la vérité mathématique n'a rien à voir avec la vérité des autres sciences. L'objet des mathématiques est en effet interne à cette discipline. Ainsi, sur cette base, les mathématiques appliquées souvent perçus davantage comme une branche mathématique au service d'autres sciences (comme le démontrent les travaux du mathématicien Jacques-Louis Lions qui explique : « Ce que j'aime dans les mathématiques appliquées, c'est qu'elles ont pour ambition de donner du monde des systèmes une représentation qui permette de comprendre et d'agir ») seraient bien plutôt sans finalité pratique. A contrario, les mathématiques possèdent un nombre important de branches, d'abord abstraites, s'étant développées au contact avec d'autres disciplines comme les statistiques, la théorie des jeux, la logique combinatoire, la théorie de l'information, la théorie des graphes entre autres exemples, autant de branches qui ne sont pas catalogués dans les mathématiques appliquées mais qui pourtant irriguent d'autres branches scientifiques.
Sciences nomothétiques et idiographiques
Un classement des sciences peut s'appuyer sur les méthodes mise en œuvre. Une première distinction de cet ordre peut être faite entre les sciences nomothétiques et les sciences idiographiques :
- les sciences nomothétiques cherchent à établir des lois générales pour des phénomènes susceptibles de se reproduire. On y retrouve la physique et la biologie, mais également des sciences humaines ou sociales comme l'économie, la psychologie ou même la sociologie.
- les sciences idiographiques s'occupent au contraire du singulier, de l'unique, du non récurrent. L'exemple de l'histoire montre qu'il n'est pas absurde de considérer que le singulier peut être justiciable d'une approche scientifique.
C'est à Wilhelm Windelband, philosophe allemande du XIXe siècle que l'on doit la première ébauche de cette distinction, la réflexion de Windelband portant sur la nature des sciences sociales. Dans son Histoire et science de la nature (1894), il soutient que l'opposition entre sciences de la nature et de l'esprit repose sur une distinction de méthode et de « formes d'objectivation »[64].
Sciences empiriques et logico-formelles
Articles détaillés : Science empirique et Science formelle.Une catégorisation a été proposé par l'épistémologie, distinguant les « sciences empiriques » et les « sciences logico-formelles ». Leur point commun reste les mathématiques et leur usage dans les disciplines liées ; cependant, selon les mots de Gilles-Gaston Granger, « la réalité n'est pas aussi simple. Car, d'une part, c'est souvent à propos de questions posées par l'observation empirique que des concepts mathématiques ont été dégagés ; d'autre part, si la mathématique n'est pas une science de la nature, elle n'en a pas moins de véritables objets »[65]. Selon Léna Soler, dans son Introduction à l’épistémologie, distingue d’une part les sciences formelles des sciences empiriques, d’autre part les sciences de la natures des sciences humaines et sociale[66].
- les sciences dites empiriques portent sur le monde empiriquement accessible, sensible (accessible par les sens donc). Elles regroupent : les sciences de la nature, qui ont pour objet d'étude les phénomènes naturels ; les sciences humaines, qui ont pour objet d'étude l'Homme et ses comportements individuels et collectifs, passés et présents;
- de leur côté, les sciences logico-formelles (ou sciences formelles) explorent par la déduction, selon des règles de formation et de démonstration, des systèmes axiomatiques. Il s'agit par exemple des mathématiques ou de la logique[note 40]
Sciences de la nature et sciences humaines et sociales
Articles détaillés : Sciences de la nature et Sciences humaines et sociales.Selon Gilles-Gaston Granger, il existe une autre sorte d'opposition épistémologique, distinguant d'une part les sciences de la nature, qui ont des objets émanant du monde sensible, mesurables et classables ; d'autre part les sciences de l'homme aussi dites sciences humaines, pour lesquelles l'objet est abstrait. Gilles-Gaston Granger récuse par ailleurs de faire de l'étude du phénomène humain une science proprement dite[67].
- les sciences humaines et sociales sont celles qui ont pour objet d'étude les hommes, les sociétés, leur histoire, leurs cultures, leurs réalisations et leurs comportements ;
- les sciences de la nature, ou sciences naturelles (« Natural science » en anglais) ont pour objet le monde naturel, la Terre et l'Univers.
L'opposition traditionnelle entre sciences humaines et sciences naturelles repose sur celle entre nature et culture.
Disciplines scientifiques
Article détaillé : Liste des disciplines scientifiques.La sciences peut être organisée en grandes disciplines scientifiques, notamment : mathématiques, chimie, biologie, physique, mécanique, optique, pharmacie, médecine, astronomie, archéologie, économie, sociologie. Les disciplines ne se distinguent pas seulement par leurs méthodes ou leurs objets, mais aussi par leurs institutions : revues, sociétés savantes, chaires d'enseignement, ou même leurs diplômes.
La pratique retient néanmoins trois classements :
- les sciences formelles (ou Sciences logico-formelles) ;
- les sciences naturelles ;
- les sciences humaines et sociales.
Le sens commun associe une discipline à un objet. Par exemple la sociologie s’occupe de la société, la psychologie de la pensée, la physique s’occupe de phénomènes mécaniques, thermiques, la chimie s’occupe des réactions de la matière. La recherche moderne montre néanmoins l’absence de frontière et la nécessité de développer des transversalités ; par exemple, pour certaines disciplines on parle de « physico-chimique » ou de « chimio-biologique », expressions qui permettent de montrer les liens forts des spécialités entre elles. Une discipline est au final définie par l’ensemble des référentiels qu’elle utilise pour étudier un ensemble d’objets, ce qui forme sa scientificité. Néanmoins, ce critère n'est pas absolu.
Pour le sociologue Raymond Boudon, il n'existe pas une scientificité unique et transdisciplinaire. Il s’appuie ainsi sur la notion d’« airs de famille », notion déjà théorisée par le philosophe Ludwig Wittgenstein selon laquelle il n'existe que des ressemblances formelles entre les sciences, sans pour autant en tirer une règle générale permettant de dire ce qu'est « la science ». Raymond Boudon, dans L’art de se persuader des idées douteuses, fragiles ou fausses[68] explique que le relativisme "s'il est une idée reçue bien installée […], repose sur des bases fragiles" et que, contrairement à ce que prêche Feyerabend, "il n'y a pas lieu de congédier la raison".
Raisonnement scientifique
Type formel pur
Article détaillé : Logique.Selon Emmanuel Kant la logique formelle est « science qui expose dans le détail et prouve de manière stricte, uniquement les règles formelles de toute pensée ». Les mathématiques et la logique formalisées composent ce type de raisonnement. Cette classe se fonde par ailleurs sur deux principes constitutifs des systèmes formels : l'axiome et les règles de déduction ainsi que sur la notion de syllogisme, exprimée par Aristote le premier[69] et liée au « raisonnement déductif » (on parle aussi de raisonnement « hypothético-déductif »), qu'il expose dans ses Topiques[70] et dans son traité sur la logique : Les Analytiques. Il s'agit également du type qui est le plus adéquat à la réalité, celui qui a fait le plus ses preuves, par la technique notamment. Le maître-mot du type formel pur est la démonstration logique et non-contradictoire (entendu comme la démonstration qu'on ne pourra dériver dans le système étudié n'importe quelle proposition)[71]. En d'autres termes, il ne s'agit pas à proprement parler d'un raisonnement sur l'objet mais bien plutôt d'une méthode pour traiter les faits au sein des démonstrations scientifiques et portant sur les propositions et les postulats.
On distingue ainsi dans ce type deux disciplines fondamentales :
- la logique de la déduction naturelle;
- la logique combinatoire.
Le type formel fut particulièrement développée au XXe siècle, avec le logicisme et la philosophie analytique. Bertrand Russell développe en effet une « méthode atomique » (ou atomisme logique) qui s’efforce de diviser le langage en ses parties élémentaires, ses structures minimales, la phrase simple en somme. Wittgenstein projetait en effet d’élaborer un langage formel commun à toutes les sciences permettant d'éviter le recours au langage naturel, et dont le calcul propositionnel représente l'aboutissement. Cependant, en dépit d'une stabilité épistémologique propre, a contrario des autres types, le type formel pur est également largement tributaire de l'historicité des sciences[72]
Type empirico-formel
Le modèle de ce type, fondé sur l'empirisme, est la physique. L'objet est ici concret et extérieur, non construit par la discipline (comme dans le cas du type formel pur). Ce type est en fait la réunion de deux composantes :
- d'une part il se fonde sur la théorique formelle, les mathématiques (la physique fondamentale par exemple);
- d'autre part la dimension expérimentale est complémentaire (la méthode scientifique).
Le type empirico-formel progresse ainsi de la théorie — donnée comme a priori — à l'empirie, puis revient sur la première via un raisonnement circulaire destiné à confirmer ou réfuter les axiomes. Le « modèle » est alors l'intermédiaire entre la théorie et la pratique. Il s'agit d'une schématisation permettant d'éprouver ponctuellement la théorie. La notion de « théorie » est depuis longtemps centrale en philosophie des sciences, mais elle est remplacée, sous l'impulsion empiriste, par celle de modèle, dès le milieu du XXe siècle[note 41]. L'expérience (au sens de mise en pratique) est ici centrale, selon l'expression de Karl Popper : « Un système faisant partie de la science empirique doit pouvoir être réfuté par l'expérience »[73].
Parmi les sciences empiriques, on distingue deux grandes familles de sciences : les sciences de la nature et les sciences humaines. Néanmoins, l'empirisme seul ne permet pas, en se coupant de l'imagination, d'élaborer des théories novatrices, fondées sur l'intuition du scientifique, permettant de dépasser des contradictions que la simple observation des faits ne pourrait résoudre[note 42].
Il existe néanmoins des débats quant à la nature empirique de certaines sciences humains, comme l'économie[note 43] ou l'histoire, qui ne reposent pas sur une méthode totalement empirique, l'objet étant virtuel dans les deux disciplines.
Type herméneutique
Articles détaillés : Herméneutique et Phénoménologie.Les sciences herméneutiques (du grec hermeneutikè, « art d'interpréter ») décodent les signes naturels et établissent des interprétations. Ce type de discours scientifique est caractéristique des sciences humaines, où l'objet est l'homme. Dans la méthode herméneutique, les effets visibles sont considérés comme un texte à décoder, à la signification cachée. La phénoménologie est ainsi l'explication philosophique la plus proche de ce type[74], qui regroupe, entre autres, la sociologie, la linguistique, l'économie, l'ethnologie, la théorie des jeux, etc. Il peut s'agir dès lors de deux catégories de discours :
- l'intention première est alors l'objet de la recherche herméneutique, exemple : dans la psychologie ;
- l'interprétation est aussi possible : la théorie prévoit les phénomènes, simule les relations et les effets mais l'objet reste invisible (cas de la psychanalyse).
Par rapport aux deux autres types formels, le statut scientifique du type herméneutique est contesté par les tenants d'une science mathématique, dite « dure ».
À la conception de l’unité de la science postulée par le positivisme tout un courant de pensée va, à la suite de Wilhelm Dilthey (1833-1911), affirmer l’existence d’une coupure radicale entre les sciences de la nature et les sciences de l’esprit. Les sciences de la nature ne cherchent qu'à expliquer leur objet, tandis que les sciences de l'homme, et l'histoire en particulier, demandent également à comprendre de l'intérieur et donc à prendre en considération le vécu. Ces dernières ne doivent pas adopter la méthode en usage dans les sciences de la nature car elles ont un objet qui lui est totalement différent. Les sciences sociales doivent être l'objet d'une introspection, ce que Wilhelm Dilthey appelle une « démarche herméneutique », c’est-à-dire une démarche d’interprétation des manifestations concrets de l’esprit humain. Le type herméneutique marque le XXe siècle, avec des auteurs comme Hans-Georg Gadamer qui publia en 1960, Vérité et Méthode qui, s'opposant à l'empirisme tout-puissant, affirme que « la méthode ne suffit pas »[note 44].
Scientificité
La scientificité est la qualité des pratiques et des théories qui cherchent à établir des régularités reproductibles, mesurables et réfutables dans les phénomènes par le moyen de la mesure expérimentale, et à en fournir une représentation explicite.
Plus généralement, c'est le « caractère de ce qui répond aux critères de la science »[75]. De manière générale à toutes les sciences, la méthode scientifique repose sur quatre critères :
- elle est systématique (le protocole doit s'appliquer à tous les cas, de la même façon) ;
- elle fait preuve d'objectivité (c'est le principe du « double-aveugle » : les données doivent être contrôlées par des collègues chercheurs - c'est le rôle de la publication) ;
- elle est rigoureuse, testable (par l'expérimentation et les modèles scientifiques) ;
- et enfin, elle doit être cohérente (les théories ne doivent pas se contredire, dans une même discipline).
Néanmoins, chacun de ces points est problématique, et les questionnements de l'épistémologie portent principalement sur les critères de scientificité. Ainsi, concernant la cohérence interne aux disciplines, l'épistémologue Thomas Samuel Kuhn bat en brèche ce critère de scientificité, en posant que les paradigmes subissent des « révolutions scientifiques » : un modèle n'est valable tant qu'il n'est pas remis en cause. Le principe d'objectivité, qui est souvent présenté comme l'apanage de la science, est, de même, source d'interrogations, surtout au sein des sciences humaines. La psychanalyse par exemple n'est ainsi pas acceptée comme science pour les tenants de la scientificité. Karl Popper comme Ludwig Wittgenstein lui ont refusé ce statut en raison de son caractère non réfutable par l'expérience. Popper ajoute, dans La Logique de la découverte scientifique (1934) que « l'attitude scientifique [est] l'attitude critique », ce qui forme le noyau de la scientificité.
Pour le sociologue de la science Roberto Miguelez : « Il semble bien que l'idée de la science suppose, premièrement, celle d'une logique de l'activité scientifique ; deuxièmement, celle d'une syntaxe du discours scientifique. En d'autres termes, il semble bien que, pour pouvoir parler de la science, il faut postuler l'existence d'un ensemble de règles - et d'un seul - pour le traitement des problèmes scientifiques - ce qu'on appellera alors « la méthode scientifique » -, et d'un ensemble de règles - et d'un seul - pour la construction d'un discours scientifique »[76]. La sociologie des sciences étudie en effet de plus en plus les critères de scientificité, au sein de l'espace social scientifique, passant d'une vision interne, celle de l'épistémologie, à une vision davantage globale.
Scientifique et méthode scientifique
Articles détaillés : Méthode scientifique et Évaluation de la recherche scientifique.La « méthode scientifique » (grec ancien méthodos, « poursuite, recherche, plan ») est « l'ensemble des procédés raisonnés pour atteindre un but ; celui-ci peut être de conduire un raisonnement selon des règles de rectitude logique, de résoudre un problème de mathématique, de mener une expérimentation pour tester une hypothèse scientifique. »[77]. Elle est étroitement liée à l'histoire des sciences[note 45]. La méthode scientifique suit par ailleurs quatre opérations distinctes :
Expérimentation
Article détaillé : Expérimentation.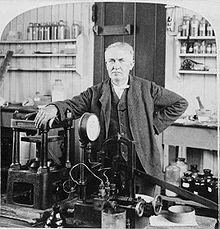 Thomas Edison dans son laboratoire (1901).
Thomas Edison dans son laboratoire (1901).
L'« expérimentation » est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner. Elle repose sur des protocoles expérimentaux permettant de normaliser la démarche. La physique ou la biologie reposent sur une démarche active du scientifique qui construit et contrôle un dispositif expérimental reproduisant certains aspects des phénomènes naturels étudiés. La plupart des sciences emploient ainsi la méthode expérimentale, dont le protocole est adapté à son objet et à sa scientificité. De manière générale, une expérience doit apporter des précisions quantifiées (ou statistiques) permettant de réfuter ou étayer le modèle. Les résultats des expériences ne sont pas toujours quantifiables, comme dans les sciences humaines. L'expérience doit ainsi pouvoir réfuter les modèles théoriques.
L'expérimentation a été mise en avant par le courant de l'empirisme. Néanmoins, l'épistémologue Karl Popper lui oppose l'abduction (ou méthode par conjecture et réfutation). L'abduction (ou conjecture) est ainsi un procédé consistant à introduire une règle à titre d’hypothèse afin de considérer ce résultat comme un cas particulier tombant sous cette règle. Elle consiste en l'invention a priori d'une conjecture précédant l'expérience. En somme, cela signifie que l'induction fournit directement la théorie, alors que dans le processus abductif la théorie est inventée avant l'expérience et cette dernière ne fait que répondre par l'affirmative ou par la négative à l'hypothèse.
Observation
Article détaillé : Observation.L’« observation » est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Les scientifiques y ont recours principalement lorsqu'ils suivent une méthode empirique. C'est par exemple le cas en astronomie ou en physique. Il s'agit d'observer le phénomène ou l'objet sans le dénaturer, ou même interférer avec sa réalité. Certaines sciences, comme la physique quantique ou la psychologie, prennent en compte l'observation comme un paradigme explicatif à part entière, influant le comportement de l'objet observé. La philosophe Catherine Chevalley résume ainsi ce nouveau statut de l'observation : « Le propre de la théorie quantique est de rendre caduque la situation classique d’un « objet » existant indépendamment de l’observation qui en est faite ».
La science définit la notion d’observation dans le cadre de l’approche objective de la connaissance, observation permise par une mesure et suivant un protocole fixé d'avance.
Théorie et modèle
Une « théorie » (du grec theoria soit « vision du monde ») est un modèle ou un cadre de travail pour la compréhension de la nature et de l'humain. En physique, le terme de théorie désigne généralement le support mathématique, dérivé d'un petit ensemble de principes de base et d'équations, permettant de produire des prévisions expérimentales pour une catégorie donnée de systèmes physiques. Un exemple est la « théorie électromagnétique », habituellement confondue avec l'électromagnétisme classique, et dont les résultats spécifiques sont obtenus à partir des équations de Maxwell. L’adjectif « théorique » adjoint à la description d'un phénomène indique souvent qu'un résultat particulier a été prédit par une théorie mais qu'il n'a pas encore été observé. La théorie est ainsi bien souvent plus un modèle entre l'expérimentation et l'observation qui reste à confirmer.
La conception scientifique de la théorie devient ainsi une phase provisoire de la méthode expérimentale. Claude Bernard, dans son Introduction à la médecine expérimentale appuie sur le rôle clé des questions et sur l'importance de l'imagination dans la construction des hypothèses, sorte de théories en voie de développement. Le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux explique ainsi :
« Le scientifique construit des « modèles » qu'il confronte au réel. Il les projette sur le monde ou les rejette en fonction de leur adéquation avec celui-ci sans toutefois prétendre l'épuiser. La démarche du scientifique est débat critique, « improvisation déconcertante », hésitation, toujours consciente de ses limites[78] »
En effet, si l'expérimentation est prépondérante, elle ne suffit pas, conformément à la maxime de Claude Bernard : « La méthode expérimentale ne donnera pas d'idée neuve à ceux qui n'en n'ont pas. », la théorie et le modèle permettant d'éprouver la réalité a priori.
Simulation
Articles détaillés : Simulation de phénomènes et modélisation.La « simulation » est la « reproduction artificielle du fonctionnement d'un appareil, d'une machine, d'un système, d'un phénomène, à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique, à des fins d'étude, de démonstration ou d'explication »[79]. Elle est directement liée à l'utilisation de l'informatique au XXe siècle. Il existe deux types de simulations :
- La modélisation physique consiste spécifiquement à utiliser un autre phénomène physique que celui observé, mais en y appliquant des lois ayant les mêmes propriétés et les mêmes équations. Un modèle mathématique est ainsi une traduction de la réalité pour pouvoir lui appliquer les outils, les techniques et les théories mathématiques. Il y a alors deux types de modélisations : les modèles prédictifs (qui anticipent des événements ou des situations, comme ceux qui prévoient le temps avec la météorologie) et les modèles descriptifs (qui représentent des données historiques).
- La simulation numérique utilise elle un programme spécifique ou éventuellement un progiciel plus général, qui génère davantage de souplesse et de puissance de calcul. Les simulateurs de vol d’avions par exemple permet d'entraîner les pilotes. En recherche fondamentale les simulations que l'on nomme aussi « modélisations numériques » permettent de reproduire des phénomènes complexes, souvent invisibles ou trop ténus, comme la collision de particules.
Publication et littérature scientifique
Articles détaillés : Publication scientifique et Scientométrie.Le terme de « publication scientifique » regroupe plusieurs types de communications que les chercheurs font de leurs travaux en direction d'un public de spécialistes, et ayant subi une forme d'examen de la rigueur de la méthode scientifique employée pour ces travaux, comme l'examen par un comité de lecture indépendant par exemple. La publication scientifique est donc la validation de travaux par la communauté scientifique. C'est aussi le lieu de débats contradictoires à propos de sujets polémiques ou de discussions de méthodes.
Il existe ainsi plusieurs modes de publications :
- les revues scientifiques à comité de lecture ;
- les comptes-rendus de congrès scientifique à comité de lecture ;
- des ouvrages collectifs rassemblant des articles de revue ou de recherche autour d'un thème donné, coordonnés par un ou plusieurs chercheurs appelés éditeurs ;
- des monographies sur un thème de recherche.
Les publications qui entrent dans un des cadres ci-dessus sont généralement les seules considérées pour l'évaluation des chercheurs et les études bibliométriques, à tel point que l'adage « publish or perish » (publier ou périr) est fondé. La scientométrie est en effet une méthode statistique appliquée aux publications scientifiques. Elle est utilisée par les organismes finançant la recherche comme outil d'évaluation. En France, ces indicateurs, tel le facteur d'impact, occupent ainsi une place importante dans la LOLF (pour : Loi Organique relative aux Lois de Finances)[note 46]. Les politiques budgétaires dévolues aux laboratoires et aux unités de recherche dépendent ainsi souvent de ces indicateurs scientométriques.
Épistémologie : le discours sur la science
Épistémologie ou philosophie des sciences ?
Article détaillé : épistémologie.Le vocable d'« épistémologie » remplace celui de philosophie des sciences au début du XXe siècle[80]. Il s'agit d'un néologisme construit par James Frederick Ferrier, dans son ouvrage Institutes of metaphysics (1854). Le mot est composé sur la racine grecque επιστήμη signifiant « science au sens de savoir et de connaissance » et sur le suffixe λόγος signifiant « le discours ». Ferrier l'oppose au concept antagoniste de l'« agnoiology », ou théorie de l'ignorance. Le philosophe analytique Bertrand Russell l'emploie ensuite, dans son Essai sur les fondements de la géométrie en 1901, sous la définition d'analyse rigoureuse des discours scientifiques, pour examiner les modes de raisonnement qu'ils mettent en œuvre et décrire la structure formelle de leurs théories[81]. En d'autres mots, les « épistémologues » se concentrent sur la démarche de la connaissance, sur les modèles et les théories scientifiques, qu'ils présentent comme autonomes par rapport à la philosophie[note 47].
Jean Piaget[82] proposait de définir l’épistémologie « en première approximation comme l’étude de la constitution des connaissances valables », dénomination qui, selon Jean-Louis Le Moigne, permet de poser les trois grandes questions de la discipline :
- Qu’est ce que la connaissance et quel est son mode d'investigation (c'est la question « gnoséologique ») ?
- Comment la connaissance est-elle constituée ou engendrée (c'est la question méthodologique) ?
- Comment apprécier sa valeur ou sa validité (question de sa scientificité) ?
Avant ces investigations, la science était conçue comme un corpus de connaissances et de méthodes, objet d’étude de la Philosophie des sciences, qui étudiait le discours scientifique relativement à des postulats ontologiques ou philosophiques, c'est-à-dire non-autonomes en soi. L'épistémologie permettra la reconnaissance de la science et des sciences comme disciplines autonomes par rapport à la philosophie. Les analyses de la science (l'expression de « métascience » est parfois employée) ont tout d’abord porté sur la science comme corpus de connaissance, et ont longtemps relevé de la philosophie. C'est le cas d'Aristote, de Francis Bacon, de René Descartes, de Gaston Bachelard, du cercle de Vienne, puis de Popper, Quine, Lakatos enfin, parmi les plus importants. L’épistémologie, au contraire, s'appuie sur l'analyse de chaque discipline particulière relevant des épistémologies dites « régionales ». Aurel David explique ainsi que « La science est parvenue à se fermer chez elle. Elle aborde ses nouvelles difficultés par ses propres moyens et ne s'aide en rien des productions les plus élevées et les plus récentes de la pensée métascientifique »[83].
Pour le prix Nobel de physique Steven Weinberg, auteur de Le Rêve d'une théorie ultime (1997)[84]la philosophie des sciences est inutile car elle n'a jamais aidé la connaissance scientifique à avancer.
Science au service de l'humanité : le progrès
Articles détaillés : Progrès scientifique et Progrès technique.Le terme de progrès vient du latin « progressus » qui signifie l'action d'avancer. Selon cette étymologie le progrès désigne un passage à un degré supérieur, c'est-à-dire à un état meilleur, participant à l'effort économique[note 48]. La civilisation se fonde ainsi, dans son développement, sur une série de progrès dont le progrès scientifique. La science serait avant tout un moyen de faire le bonheur de l'humanité, en étant le moteur du progrès matériel et moral. Cette identification de la science au progrès est très ancienne et remonte aux fondements philosophiques de la science[note 49]. Cette thèse est distincte de celle de la science dite pure (en elle-même), et pose le problème de l'autonomie de la science, en particulier dans son rapport au pouvoir politique[note 50]. Les question éthiques également limitent cette définition de la science comme un progrès[note 51]. Certaines découvertes scientifiques ont des applications militaires ou même peuvent être létales en dépit d'un usage premier bénéfique[note 52].
 Albert Einstein et Robert Oppenheimer. L'utilisation militaire de la technologie nucléaire a posé un dilemme aux deux scientifiques.
Albert Einstein et Robert Oppenheimer. L'utilisation militaire de la technologie nucléaire a posé un dilemme aux deux scientifiques.
Selon les tenants de la science comme moyen d'amélioration de la société, dont Ernest Renan ou Auguste Comte sont parmi les plus représentatifs, le progrès offre :
- une explication du fonctionnement du monde : il est donc vu comme un pouvoir explicatif réel et illimité ;
- des applications technologiques toujours plus utiles permettant de transformer l'environnement afin de rendre la vie plus facile.
La thèse de la science pure pose, quant à elle, que la science est avant tout le propre de l'humain, ce qui fait de l'homme un animal différent des autres. Dans une lettre du 2 juillet 1830 adressée à Legendre, le mathématicien Charles Gustave Jacob Jacobi écrit ainsi, à propos du physicien Joseph Fourier : « Mr. Fourier avait l’opinion que le but principal des mathématiques était l’utilité publique et l’explication des phénomènes naturels ; mais un philosophe comme lui aurait dû savoir que le but unique de la science, c’est l’honneur de l’esprit humain, et que sous ce titre, une question de nombres vaut autant qu’une question du système du monde. »[85]. D'autres courants de pensée comme le scientisme envisagent le progrès sous un angle plus utilitariste.
Enfin des courants plus radicaux posent que la science et la technique permettront de dépasser la condition ontologique et biologique de l'homme. Le transhumanisme ou l'extropisme sont par exemple des courants de pensée stipulant que le but de l'humanité est de dépasser les injustices biologiques (comme les maladies génétiques, grâce au génie génétique) et sociales (par le rationalisme), et que la science est le seul moyen à sa portée. À l'opposé, les courants technophobes refusent l'idée d'une science salvatrice, et pointent au contraire les inégalités sociales et écologiques, entre autres, que la science génère.
Interrogations de l'épistémologie
Article détaillé : épistémologie#Les questions épistémologiques.Liée à la théorie de la connaissance, l'épistémologie tente d'expliquer et de rationaliser un ensemble de questions philosophiques. La science progressant de manière fondamentalement discontinue, les renversements des représentations des savants, ou appelées également « paradigmes scientifiques » selon l'expression de Thomas Samuel Kuhn, sont également au cœur des interrogations épistémologiques. Parmi ces questions centrales de l'épistémologie on distingue :
- la nature de la production des connaissances scientifiques (par exemple les types de raisonnements sont-ils fondés) ;
- la nature des connaissances en elles-mêmes (l'objectivité est-elle toujours possible par exemple). Ce problème d'épistémologie concerne plus directement la question de savoir comment identifier ou démarquer les théories scientifiques des théories métaphysiques ;
- l'organisation des connaissances scientifiques (notions de théories, de modèles, d'hypothèses, de lois) ;
- l'évolution des connaissances scientifiques (quel mécanisme meut la science et les disciplines scientifiques).
Nombre de philosophes ou d'épistémologues ont ainsi interrogé la nature de la science et en premier lieu le thèse de son unicité. L'épistémologue Paul Feyerabend, dans « Contre la méthode », est l'un des premiers, dans les années soixante-dix, à se révolter contre les idées reçues à l'égard de la science et à relativiser l'idée trop simple de « méthode scientifique ». Il expose une théorie anarchiste de la connaissance plaidant pour la diversité des raisons et des opinions, et explique en effet que « la science est beaucoup plus proche du mythe qu’une philosophie scientifique n’est prête à l’admettre »[86]. Le philosophe Louis Althusser, qui a produit un cours sur cette question dans une perspective marxiste : « tout scientifique est affecté d’une idéologie ou d’une philosophie scientifique »[87] qu’il appelle « Philosophie Spontanée des Savants » (« P.S.S »[note 53]). Dominique Pestre s'attache lui à montrer l'inutilité d'une distinction entre « rationalistes » et « relativistes », dans Introduction aux Sciences Studies.
Grands modèles épistémologiques
L'histoire des sciences et de la philosophie a produit de nombreuses théories quant à la nature et à la portée du phénomène scientifique. Il existe ainsi un ensemble de grands modèles épistémologiques qui prétendent expliquer la spécificité de la science. Le XXe siècle a marqué un tournant radical. Très schématiquement, aux premières réflexions purement philosophique et souvent normatives sont venus s’ajouter des réflexions plus sociologiques et psychologiques, puis des approches sociologiques et anthropologiques dans les années 1980, puis enfin des approches fondamentalement hétérogènes à partir des années 1990 avec les Science studies. Le discours sera également interrogé par la psychologie avec le courant du constructivisme. Enfin, l'épistémologie s'intéresse à la « science en action » (expression de Bruno Latour), c'est-à-dire à sa mise en œuvre au quotidien et plus seulement à la nature des questions théoriques qu'elle produit.
Cartésianisme et rationalisme
Article détaillé : Rationalisme.Le rationalisme est un courant épistémologique né au XVIIe siècle et pour lequel « toute connaissance valide provient soit exclusivement, soit essentiellement de l'usage de la raison »[88]. Des auteurs comme René Descartes (on parle alors du cartésianisme), ou Leibniz fondent les bases conceptuelles de ce mouvement qui met en avant le raisonnement en général et plus particulièrement le raisonnement déductif dit aussi analytique. Il s'agit donc d'une théorie de la connaissance qui postule le primat de l'intellect. L'expérimentation y a un statut particulier : elle ne sert qu'à valider ou réfuter les hypothèses. En d'autres mots, la raison seule suffit pour départager le vrai du faux dans le raisonnement rationaliste. Les rationalistes prennent ainsi comme exemple le célèbre passage du dialogue de Platon, dans le Ménon, où Socrate prouve qu'un jeune esclave illettré, étape par étape et sans son aide, peut refaire et redémontrer le théorème de Pythagore.
Le rationalisme, surtout moderne, prône la toute puissance des mathématiques sur les autres sciences. Les mathématiques représentent en effet le moyen intellectuel démontrant que l'intellect et la raison peuvent se passer de l'observation et de l'expérience. Déjà Galilée expliquait dans son ouvrage L'essayeur — qui est également une démonstration de logique — en 1623, que
« Le grand livre de l'Univers est écrit dans le langage des mathématiques. On ne peut comprendre ce livre que si on en apprend tout d'abord le langage, et l'alphabet dans lequel il est rédigé. Les caractères en sont les triangles et les cercles, ainsi que les autres figures géométriques sans lesquelles il est humainement impossible d'en déchiffrer le moindre mot »
.
Empirisme
Article détaillé : Empirisme.L'empirisme postule que toute connaissance provient essentiellement de l'expérience. Représenté par les philosophes anglais Roger Bacon, John Locke et George Berkeley, ce courant postule que la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, dont on peut extraire des lois par un raisonnement inductif (dit aussi synthétique), allant par conséquent du concret à l'abstrait. L'induction consiste, selon Hume en la généralisation de données de l'expérience pure[89], appelée « empirie » (ensemble des données de l'expérience), qui est ainsi l'objet sur lequel porte la méthode. Néanmoins, Bertrand Russell mentionne dans son ouvrage Science et religion ce qu’il nomme le « scandale de l’induction », cette méthode de raisonnement n'a rien d'universel, en effet, selon lui les lois admises comme générales par l'induction n'ont été cependant vérifiées que pour un certain nombre de cas expérimentaux. Dans l'empirisme, le raisonnement est secondaire alors que l'observation est première[note 54]. Les travaux d'Isaac Newton témoignent d'une méthode empirique dans la formalisation de la loi gravitationnelle.
L'empirisme se décompose lui-même en sous-courants[90] :
- le matérialisme qui explique que seule l'expérience sensible existe;
- le sensualisme qui considère que les connaissances proviennent des sensations (c'est la position de Condillac par exemple);
- l'instrumentalisme, qui voit dans la théorie un outil abstrait ne reflétant pas la réalité.
Enfin, l'empirisme aurait percé dans le champ scientifique, selon Robert King Merton (dans Éléments de théorie et de méthode sociologique, 1965) grâce à ses liens étroits avec l'éthique protestante et puritaine. Le développement de la Royal Society de Londres, fondée en 1660 par des protestants, en est ainsi l'expression aboutie : « la combinaison de la rationalité et de l'empirisme, si évidente dans l'éthique puritaine, forme l'essence de la science moderne. » explique Merton.
Positivisme d'Auguste Comte
Article détaillé : Positivisme.Auguste Comte distingue trois états historiques : dans l'état théologique, l'esprit de l'homme cherche à expliquer les phénomènes naturels par des agents surnaturels. Dans l'état métaphysique, l'explication se fonde sur des forces naturelles mais encore personnifiées (la théorie de l'éther par exemple). Avec l'état positif, l'esprit ne cherche plus à expliquer les phénomènes par leurs causes, mais il s'édifie sur des faits constatables et mesurables. Le personnage de Newton est, pour Comte, révélateur de cette « marche progressive de l'esprit humain »[91]. La science doit ainsi mettre en œuvre des hypothèses, permettant de se passer de l'expérience, et aboutissant à la formation de lois non contradictoires. Comte cite ainsi, comme exemple, la théorie de la chaleur de Joseph Fourier, qui la bâtit sans avoir à observer la nature du phénomène. Le positivisme met en avant la qualité prédictive de la science, qui permet de « voir pour prévoir » selon les mots de Comte, dans ses Discours sur l'ensemble du positivisme (1843). Néanmoins, la méthode scientifique culmine dans la mise en pratique, dans l'action, ce que le discours moderne appellera l'application scientifique. L'ingénierie est ainsi la main de la science, caractérisée par le savoir-faire. La science est avec Comte indissociable de l'action :
« Science, d'où prévoyance ; prévoyance d'où action »
Critique de l'induction de Mach
Inventeur de la mesure de la vitesse de propagation du son, Ernest Mach développa une pensée épistémologique qui influença notamment Albert Einstein. Dans La Mécanique, exposé historique et critique de son développement[92] Mach dévoile la conception mythologique qui sous tend les représentations mécanistes de son époque, qui aboutissent au conflit des spiritualistes et des matérialistes. Mais la critique de Mach porte surtout sur la méthode de l'induction, pendant de la déduction. Dans La Connaissance et l'erreur (1905), Mach explique que le travail du savant porte avant tout sur les relations des objets étudiés entre eux, et non sur leur classement. La démarche de recherche est avant tout mentale conclut Mach : « Avant de comprendre la nature, il faut l'appréhender dans l'imagination, pour donner aux concepts un contenu intuitif vivant »[93]. Par ailleurs, Mach défend l'idée que la science est symbolique, thèse qu'il reprend chez Karl Pearson dans la Grammaire de la science (1892)[note 55] et qui explique que la science est « une sténographie conceptuelle ». Mach annonce que seule la méthode empirique est scientifique :
« Nous devons limiter notre science physique à l'expression des faits observables, sans construire d'hypothèses derrière ces faits, où plus rien n'existe qui puisse être conçu ou prouvé[94] »
Réfutabilité de Karl Popper et les « programmes de recherche scientifique » de Irme Lakatos
Le philosophe autrichien Karl Popper (1902 - 1994) bouleverse l'épistémologie classique en proposant une nouvelle théorie de la connaissance, dès 1959 avec la Logique de la découverte scientifique. Il donne à l'épistémologie de nouveaux concepts et outils d'examen, comme la falsifiabilité (capacité d'une théorie scientifique de se soumettre à une méthode critique sévère) ou l' infaillibilité (qui définit a contrario les théories métaphysiques, psychanalytiques, marxistes, astrologiques). Il propose ainsi de voir dans la réfutabilité le critère permettant de distinguer la science de la non-science. Un énoncé est ainsi « empiriquement informatif, si et seulement s'il est testable ou falsifiable, c'est-à-dire s'il est possible, au moins en principe, que certains faits puissent le contredire »[95]. Néanmoins, Popper admet que les énoncés non réfutables peuvent être heuristiques et avoir un sens (c'est le cas des sciences humaines).
Popper émet par ailleurs une critique de la thèse de l'unicité de la science, notamment dans son ouvrage La logique de la découverte scientifique. L'idée d'un système de connaissance est futile selon lui : « nous ne savons pas, nous ne faisons que conjecturer. » L’idéal d’une connaissance absolument certaine et démontrable s’est révélé être une idole.Selon lui enfin, l'induction n'a aucune valeur scientifique :
« Il n'y a pas d'induction parce que les théories universelles ne sont pas déductibles d'énoncés singuliers[96]. »
La pensée d'Imre Lakatos(1922 - 1974) est en droite file de celle de Popper. Il est le créateur de la notion de « programmes de recherche scientifique » (P.R.S) qui est un corpus d'hypothèses théoriques lié à un plan de recherche au sein d'un domaine particulier (un « paradigme ») comme la métaphysique cartésienne par exemple. Lakatos, bien qu'étant l'élève de Karl Popper s'en oppose sur le point de la réfutabilité. Un programme de recherche est selon lui caractérisé à la fois par une heuristique positive (ce qu'il faut chercher et à l'aide de quelle méthode) et une heuristique négative (les hypothèses sont inviolables).
« Science normale » de Thomas Kuhn
Les travaux de Thomas Samuel Kuhn vont marquer une rupture fondamentale en philosophie, en histoire et en sociologie des sciences[note 56]. Il va historiciser la science, et rejeter une conception fixiste de la science. Son ouvrage principal en la matière, la Structure des Révolutions Scientifiques (1962) pose qu'« il est ainsi difficile de considérer le développement scientifique comme un processus d’accumulation, car il est difficile d’isoler les découvertes et les inventions individuelles ».
« Lorsque les scientifiques ne peuvent plus ignorer plus longtemps des anomalies qui renversent la situation établie dans la pratique scientifique, alors commencent les investigations extraordinaires qui les conduisent finalement à un nouvel ensemble de convictions, sur une nouvelle base pour la pratique de la science » ajoute-t-il, qualifiant ces bases pratiques de paradigmes scientifiques (comme par exemple la lumière considérée comme un corpuscule, puis comme une onde, puis enfin comme une particule). Ces « épisodes extraordinaires » sont comme des « révolutions scientifiques » (ainsi celles apportées par Isaac Newton, Nicolas Copernic, Lavoisier, ou encore Einstein) : toutes viennent renverser un paradigme dominant. L'état d'une science, des connaissances et du paradigme, à une période donnée constitue la « science normale » qui est selon Kuhn
« une recherche fermement accréditée par une plusieurs découvertes scientifiques passées, découvertes que tel ou tel groupe scientifique [a considérées] comme suffisantes pour devenir le point de départ d’autres travaux. »
Constructivisme
Article détaillé : Constructivisme (épistémologie).Le terme constructivisme est né au début du XXe siècle avec le mathématicien hollandais Brouwer qui l'utilisa pour caractériser sa position sur la question des fondements en mathématiques comme discipline maîtresse. Mais c'est surtout Jean Piaget qui a su apporter au constructivisme ses lettres de noblesse : avec la publication en 1967 de l'encyclopédie de la Pléiade et notamment de l’article Logique et connaissance scientifique, il opère selon Jean-Louis Le Moigne une « renaissance du constructivisme épistémologique, notamment à partir des travaux de Bachelard »[97], . Toutefois, selon Ian Hacking, c'est Kant qui fut le « grand pionnier de la construction »[98].
L'école constructiviste n'accepte comme vrai que ce que le scientifique peut construire, à partir d'idées et d'hypothèses que l'intuition (comme fondement des mathématiques) accepte comme vraies, et qui sont représentables. Le psychologue et épistémologue Jean Piaget expliquera ainsi que le « fait est (…) toujours le produit de la composition, entre une part fournie par les objets, et une autre construite par le sujet »[99]. L'expérimentation ne sert alors qu'à vérifier la cohérence interne de la construction (c'est la notion de modèle épistémologique). Piaget étendra cependant le cadre constructiviste à ce qu'il nomme l'« épistémologie génétique » qui étudie les conditions de la connaissance et les lois de son accroissement, en lien avec le développement neurologique de l'intelligence. Pour lui, l'épistémologie englobe la théorie de la connaissance et la philosophe des sciences (ce qu'il nomme le « cercle des sciences » : chaque science renforce l'édifice des autres sciences). Autrement dit, « la succession des sciences dans l'histoire obéit à la même logique que l'ontogénèse des connaissances »[100]. Sans parler de ressemblance totale, les mécanismes, de l'individu au groupe de chercheurs et donc, aux disciplines scientifiques, sont communs (Piaget cite ainsi l'« abstraction réfléchissante »).
Refusant l'empirisme, l'épistémologie constructiviste pose que la connaissance se fait au moyen d'une dialectique, du sujet à l'objet et de l'objet au sujet, par un aller-et-retour expérimental.
Science et société
Science et pseudo-sciences
Article détaillé : Pseudo-science.Une « pseudo-science » (grec ancien pseudês, « faux ») est une démarche prétendument scientifique qui ne respecte pas les canons de la méthode scientifique, dont celui de réfutabilité.
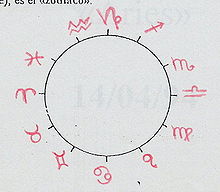 L'astrologie est considérée comme une pseudo-science.
L'astrologie est considérée comme une pseudo-science.
Ce terme, de connotation normative, est utilisé dans le but de dénoncer certaines disciplines en les démarquant des démarches au caractère scientifique reconnu. C'est au XIXe siècle (sous l'influence du positivisme d'Auguste Comte, du scientisme et du matérialisme) que fut exclu du domaine de la science tout ce qui n'est pas vérifiable par la méthode expérimentale. Un ensemble de critères explique en quoi une théorie peut être classée comme pseudo-science. Karl Popper relègue ainsi la psychanalyse au rang de pseudo-science, au même titre que, par exemple, l'astrologie, la phrénologie ou la divination[note 57]. Le critère de Popper est cependant contesté pour certaines disciplines ; pour la psychanalyse, parce que la psychanalyse ne prétend pas être une science exacte. De plus, Popper a été assez ambigu sur le statut de la théorie de l'évolution dans son système.
Les sceptiques, comme Richard Dawkins, Mario Bunge, Carl Sagan, Richard Feynman ou encore James Randi considèrent toute pseudo-science comme dangereuse. Le mouvement zététique œuvre quant à lui principalement à mettre à l'épreuve ceux qui affirment réaliser des actions scientifiquement inexplicables.
Science et protoscience
Si le terme normatif pseudoscience démarque les vraies sciences des fausses sciences, le terme protoscience (du grec πρῶτος, protos : premier, initial) inscrit les champs de recherche dans un continuum temporel : est protoscientifique ce qui pourrait, dans l'avenir, être intégré dans la science, ou ne pas l'être.
Science ou technique ?
Articles détaillés : Technique et Connaissance technique.La technique (grec ancien τέχνη, « technê », soit « art, métier savoir-faire ») « concerne les applications de la science, de la connaissance scientifique ou théorique, dans les réalisations pratiques, les productions industrielles et économiques »[101]. La technique couvre ainsi l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance, de gestion, de recyclage et, même d'élimination des déchets, qui utilisent des méthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des méthodes dictées par la pratique de certains métiers et l'innovation empirique. On peut alors parler d'art, dans son sens premier, ou de « science appliquée ». La science est elle autre chose, une étude plus abstraite. Ainsi l'épistémologie examine entre autres les rapports entre la science et la technique, comme l'articulation entre l'abstrait et le savoir-faire. Néanmoins, historiquement, la technique est première. « L’homme a été homo-faber, avant d’être homo-sapiens », explique le philosophe Bergson. Contrairement à la science, la technique n’a pas pour vocation d’interpréter le monde, elle est là pour le transformer, sa vocation est pratique et non théorique.
La technique est souvent considérée comme faisant partie intégrante de l’histoire des idées ou à l'histoire des sciences. Pourtant il faut bien admettre la possibilité d’une technique « a-scientifique », c'est-à-dire évoluant en dehors de tout corpus scientifique et que résume les paroles de Bertrand Gille : « le progrès technique s'est fait par une somme d'échecs que vinrent corriger quelques spectaculaires réussites ». La technique au sens de connaissance intuitive et empirique de la matière et des lois naturelles est ainsi la seule forme de connaissance pratique, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, époque où se développeront les théories et avec elles de nouvelles formes de connaissance axiomatisées.
Arts et science
Article détaillé : Arts scientifiques.Hervé Fischer parle, dans La société sur le divan, publié en 2007, d'un nouveau courant artistique prenant la science et ses découvertes comme inspiration et utilisant les technologies telles que les bio-technologies, les manipulations génétiques, l'intelligence artificielle, la robotique, qui inspirent de plus en plus d'artistes. Par ailleurs, le thème de la science a été souvent à l'origine de tableaux ou de sculptures. Le mouvement du futurisme par exemple considère que le champ social et culturel doit se rationaliser. Enfin, les découvertes scientifiques aident les experts en Art[102]. Le connaissance de la désintégration du carbone 14 par exemple permet de dater les œuvres. Le laser permet de restaurer, sans abimer les surfaces, les monuments. Le principe de la synthèse additive des couleurs restaure les autochromes. Les techniques d'analyse physico-chimiques permettent d'expliquer la composition des tableaux, voire de découvrir des palimpsestes. La radiographie permet de sonder l'intérieur d'objets ou de pièces sans polluer le milieu. La spectrographie est utilisée enfin pour dater et restaurer les vitraux[note 59].
Vulgarisation scientifique
La vulgarisation est le fait de rendre accessible les découvertes ainsi que le monde scientifique à tous et dans un langage adapté.
La compréhension de la science par le grand public est l’objet d’études à part entière ; les auteurs parlent de « Public Understanding of Science » (expression consacrée en Grande-Bretagne, « science literacy » aux États-Unis) et de « culture scientifique » en France. Il s'agit du principal vecteur de la démocratisation et de la généralisation du savoir selon les sénateurs français Marie-Christine Blandin et Ivan Renard[103].
Dans nombre de démocraties, la vulgarisation de la science est au cœur de projets mêlant différents acteurs économiques, institutionnels et politiques. En France, l'Éducation nationale a ainsi pour mission de sensibiliser l'élève à la curiosité scientifique, au travers de conférences, de visites régulières ou d'ateliers d'expérimentation. La Cité des sciences et de l'industrie met à disposition de tous des expositions sur les découvertes scientifiques alors que les quelques trente[104] centres de culture scientifique, technique et industrielle ont « pour mission de favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le public. Cette mission s'inscrit dans une démarche de partage des savoirs, de citoyenneté active, permettant à chacun d'aborder les nouveaux enjeux liés à l'accroissement des connaissances »[105].
Le Futuroscope ou Vulcania ou le Palais de la découverte sont d'autres exemples de mise à disposition de tous des savoirs scientifiques. Les États-Unis possèdent également des institutions telles que l'Exploratorium[106] de San Francisco, qui se veulent plus près d'une expérience accessible par les sens et où les enfants peuvent expérimenter. Le Québec a développé quant à lui le Centre des sciences de Montréal.
La vulgarisation se concrétise donc au travers d'institutions, de musées, mais aussi d'animations publiques comme la Nuit des étoiles par exemple, de revues, et de personnalités (Hubert Reeves pour l'astronomie), qu'énumère Bernard Schiele dans Les territoires de la culture scientifique[107].
Science et idéologie
Article détaillé : Technocratie.Scientisme ou « religion » de la science
Article détaillé : scientisme.Le scientisme est une idéologie apparue au XVIIIe siècle, selon laquelle la connaissance scientifique permettrait d'échapper à l'ignorance dans tous les domaines et donc, selon la formule d'Ernest Renan dans « l'Avenir de la science », d'« organiser scientifiquement l'humanité ».
Il s'agit donc d'une foi dans l'application des principes de la science dans tous les domaines. Nombre de détracteurs[note 60] y voient une véritable religion de la science, particulièrement en Occident. Sous des acceptions moins techniques, le scientisme peut être associé à l'idée que seules les connaissances scientifiquement établies sont vraies. Il peut aussi renvoyer à un certain excès de confiance en la science qui se transformerait en dogme. Le courant zététique, qui s'inspire du scepticisme philosophique, essaye d'appréhender efficacement la réalité par le biais d'enquêtes et d'expériences s'appuyant sur la méthode scientifique et a pour objectif de contribuer à la formation chez chaque individu d'une capacité d'appropriation critique du savoir humain, est en ce sens une forme de scientisme.
Pour certains épistémologues, le scientisme prend de toutes autres formes. Robert Nadeau, en s’appuyant sur une étude réalisée en 1984[108], considère que la culture scolaire est constituée de « clichés épistémologiques » qui formeraient une sorte de « mythologie des temps nouveaux » qui ne serait pas sans rapport avec une sorte de scientisme[109]. Ces clichés tiennent soit à l'histoire de la science, résumée et réduite à des découvertes qui jalonnent le développement de la société, soit à des idées comme celles qui met en avant que les lois, et plus généralement les connaissances scientifiques, sont des vérités absolues et dernières, et que les preuves scientifiques sont non moins absolues et définitives alors que, selon les mots de Thomas Samuel Kuhn, elles ne cessent de subir révolutions et renversements.
Enfin, c'est surtout la sociologie de la connaissance, dans les années 1940 à 1970, qui a mis fin à l'hégémonie du scientisme. Les travaux de Ludwig Wittgenstein, Alexandre Koyré et Thomas Samuel Kuhn surtout ont démontré l'incohérence du positivisme. Les expériences ne constituent pas, en effet, des preuves absolues des théories et les paradigmes sont amenés à disparaître.
Science au service de la guerre
 Le laser est à l'origine une découverte militaire.
Le laser est à l'origine une découverte militaire.
Pendant la Première Guerre mondiale, les sciences ont été utilisées par l'État afin de développer de nouvelles armes chimiques et de développer des études balistiques. C'est la naissance de l'économie de guerre, qui s'appuie sur des méthodes scientifiques. L'« OST », ou Organisation Scientifique du Travail de Frederick Winslow Taylor est ainsi un effort d'améliorer la productivité industrielle grâce à l'ordonnancement des tâches, permis notamment par le chronométrage. Néanmoins, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la science est le plus utilisée à des fins militaires. Les armes secrètes de l'Allemagne nazie comme les V2 sont au centre des découvertes de cette époque.
Toutes les disciplines scientifiques sont ainsi dignes d'intérêt pour les gouvernements. Le kidnapping de scientifiques allemands à la fin de la guerre, soit par les soviétiques, soit par les américains, fait naître la notion de « guerre des cerveaux », qui culminera avec la course à l'armement de la Guerre froide. Cette période est en effet celle qui a le plus compté sur les découvertes scientifiques, notamment la bombe atomique, puis la bombe à hydrogène. De nombreuses disciplines naissent d'abord dans le domaine militaire, telle la cryptographie informatique ou la bactériologie, pour la guerre biologique. Amy Dahan et Dominique Pestre[110] expliquent ainsi, à propos de cette période de recherches effrénées, qu'il s'agit d'un régime épistémologique particulier. Commentant leur livre, Loïc Petitgirard explique : « Ce nouveau régime de science se caractérise par la multiplication des nouvelles pratiques et des relations toujours plus étroites entre science, État et société. »[111] La conception de ce qu'on nomme alors le complexe militaro-industriel apparaît, en lien très intime avec le politique[note 61].
Dès 1945, avec la constatation de la montée des tensions due à l'opposition des blocs capitalistes et communistes, la guerre devient en elle-même l'objet d'une science : la polémologie. Le sociologue français Gaston Bouthoul (1896-1980), dans « le Phénomène guerre », en fonde les principes.
Enfin, si la science est par définition neutre, elle reste l'affaire d'hommes, sujets aux idéologies dominantes. Ainsi, selon les sociologues relativistes Barry Barnes et David Bloor de l'Université d'Édimbourg, les théories sont d'abord acceptées au sein du pouvoir politique[note 62]. Une théorie s'imposerait alors non parce qu'elle est vraie mais parce qu'elle est défendue par les plus forts. En d'autres termes, la science serait, sinon une expression élististe, une opinion majoritaire reconnue comme une vérité scientifique et le fait d'un groupe, ce que démontrent les travaux d'Harry Collins. La sociologie des sciences s'est ainsi beaucoup intéressée, dès les années 1970, à l'influence du contexte macro-social sur l'espace scientifique. Robert King Merton a montré, dans « Éléments de théorie et de méthode sociologique » (1965) les liens étroits entre le développement de la Royal Society de Londres, fondée en 1660, et l'éthique puritaine de ses acteurs. Pour lui, la vision du monde des protestants de l'époque a permis l'accroissement du champ scientifique.
Science et religion
Article détaillé : Relation entre science et religion.Historiquement, la science et la religion ont longtemps été apparentées. Dans « Les Formes élémentaires de la vie religieuse » (1912), Émile Durkheim montre que les cadres de pensée scientifique comme la logique ou les notions de temps et d'espace trouvent leur origine dans les pensées religieuses et mythologiques.
Le non-recouvrement
La philosophie des sciences moderne a abouti à la nécessité pour la science et la religion de marquer leurs territoires. Le principe aujourd'hui largement accepté est celui du non-recouvrement des magistères. Selon ce principe, la pensée religieuse et la pensée scientifiques doivent poursuivre des buts différents pour cohabiter. La science explique le fonctionnement de l'univers (le « comment ») tandis que la religion propose des croyances qui donnent un sens à l'univers (le « pourquoi »). En grande partie, cette division est un corollaire du critère de réfutabilité de Karl Popper : la science propose des énoncés qui peuvent être mis à l'épreuve des faits, et doivent l'être pour être acceptés ou refusés. La religion propose des énoncés qui doivent être crus sans pouvoir être vérifiés.
Les conflits entre la science et la religion se produisent dès lors que l'une des deux prétend répondre à la question dévolue à l'autre.
Cette violation peut se produire dans les deux sens. La religion empiète sur la science quand des personnes prétendent déduire des textes religieux des informations sur le fonctionnement du monde. Le conflit de ce type le plus évident est celui du créationnisme face à la théorie de l'évolution. Scientifiquement, la création de l'ensemble des êtres vivants en six jours n'est pas tenable. Mais différents courants religieux radicaux défendent l'exactitude du récit de la Genèse (depuis, l'Église catholique, par exemple, a résolu la contradiction apparente en déclarant que ce récit est métaphorique, ce qui assure de ne pas empiéter sur le domaine scientifique).
L'autre cas de violation est celui où on extrapole à partir de données scientifiques une vision du monde tout à fait irréfutable (au sens de Popper), empiétant sur le domaine du religieux. D'ailleurs, les propositions scientifiques doivent rester compatibles avec toutes les croyances religieuses (sauf celles qui violent elles-mêmes la démarcation). Albert Einstein et Paul Dirac utilisent le concept de Dieu en commentant la physique quantique, mais les résultats qu'ils établissent ne dépendent pas de son existence. À l'opposé, la démarche de Richard Dawkins, qui affirme que la science réfute l'existence de Dieu, viole la démarcation.
Histoire
Au sein du christianisme, le procès de Galileo Galilei (Galilée), en 1633, marque le divorce de la pensée scientifique et de la pensée religieuse[note 63], pourtant initiée par l'exécution de Giordano Bruno en 1600[112]. Le Concile de Nicée de 325 avait instauré dans l' Église l'argument dogmatique selon lequel Dieu avait créé le ciel et la terre en sept jours. Cependant, des explications scientifiques furent possible dès ce credo, qui ne se prononçait pas sur l'engendrement du monde, œuvre du Christ. Cette lacune théologique permit une certaine activité scientifique au Moyen Âge, dont, en premier lieu, l'astronomie. Le Concile de Trente (1545-1563) autorisa les communautés religieuses à mener des recherches scientifiques. Si le premier pas en faveur de l'héliocentrisme (qui place la Terre en rotation autour du Soleil) est fait par le chanoine Nicolas Copernic, Galilée se heurte à la position de l'Église en faveur d'Aristote, et donc du géocentrisme. Il fallut attendre que Johannes Kepler prolonge les travaux de Galilée et de Tycho Brahe pour faire accepter le mouvement de la Terre. Le procès de Galilée devint le symbole d'une science devenant indépendante de la religion, voire opposée à elle. Cette séparation est définitivement consommée au XVIIIe siècle, pendant les « Lumières ».
Dans la majorité des autres religions, la science n'est pas aussi opposée à la religion dominante. Dans l'islam, la science est favorisée car il n'existe pas de clergé institué ; par ailleurs, le monde est vu comme un code à déchiffrer pour comprendre les messages divins. Ainsi, au Moyen Âge, la science arabo-musulmane prospéra et développa la médecine, les mathématiques et l'astronomie surtout.
Au XIXe siècle, les scientismes posent que la science seule peut expliquer l'univers et que la religion est l'« opium du peuple » comme dira plus tard Karl Marx qui fonde la vision matérialiste de l'histoire. Les réussites scientifiques et techniques, qui améliorent la civilisation et la qualité de vie, le progrès scientifique en somme, bat en brèche les dogmes religieux dans leur totalité, et quelle que soit la confession. Les théories modernes de la physique (la théorie des quanta notamment) et de la biologie (avec Charles Darwin et l'évolution), les découvertes de la psychologie, pour laquelle le sentiment religieux demeure un phénomène intérieur voire neurologique, supplantent les explications mystiques et spirituelles. Cependant, nombre de religieux tentent, comme Pierre Teilhard de Chardin ou Georges Lemaître, d'allier explication scientifique et ontologie religieuse. L'encyclique de 1993, Fides et ratio, de Jean-Paul II reconnaît que religion chrétienne et science sont deux voies vers l'explication du monde.
Au XXe siècle, l'affrontement des partisans de la théorie de l'évolution et des créationnistes, souvent issus des courants religieux radicaux, cristallise le dialogue difficile de la foi et de la raison. Le « procès du singe » (à propos de l'« ascendance » simiesque de l'homme) illustre ainsi un débat permanent au sein de la société civile[note 64]. Enfin, nombre de philosophes ou d'épistémologue se sont interrogés sur la nature de la relation entre les deux institutions. Le paléontologue Stephen Jay Gould dans « Que Darwin soit! » parle de deux magistères, chacun restant maître de son territoire mais ne s'empiétant pas, alors que Bertrand Russell mentionne dans son ouvrage « Science et religion » les conflits les opposant.
Communauté scientifique internationale
« Toute science est essentiellement un moyen vers un but. Le moyen est la connaissance. Le but est le contrôle. Au delà de ceci demeure une seule question: Qui sera le bénéficiaire ? »
Article détaillé : communauté scientifique.Du savant au chercheur
Si la science est avant tout une affaire de méthode, elle dépend aussi beaucoup du statut de ceux qui la font. L'ancêtre du chercheur reste, dans l'Antiquité, le scribe. Le terme de « savant » n'apparaît qu'au XVIIe siècle ; se distinguant du clerc et de l'humaniste. Au XIXe siècle cette figure s'estompe et laisse place à celle du « scientifique universitaire » et du « chercheur spécialisé » aux côtés desquels évoluent le « chercheur industriel » et le « chercheur fonctionnaire ». Aujourd'hui c'est la figure du « chercheur entrepreneur » qui domine selon les auteurs Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges, dans leur « Du scribe au savant. Les porteurs du savoir, de l'Antiquité à la Révolution industrielle[note 65] ». C'est la création d'institutions comme le Jardin royal des plantes médicinales ou l'Académie royale des sciences de Paris qui marquent l'avènement du statut de chercheur spécialisé au XIXe siècle. Elles fournissent en effet des revenus et un cadre de recherche exceptionnels. C'est en Allemagne, avec Wilhelm von Humboldt, en 1809, que la recherche est affiliée aux Universités. Dès lors commence l'industrialisation de la production de chercheurs, qui accéléra la spécialisation du savoir. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux qui dominent, à travers la figure du chercheur fonctionnaire.
Les sociologues et anthropologues Bruno Latour[113], Steve Woolgar, Karin Knorr-Cetina ou encore Michael Lynch ont étudié l'espace scientifique, les laboratoires et les chercheurs. Latour s'est en particulier intéressé à la production du discours scientifique, qui semble suivre un processus de stabilisations progressives, ce qui permet aux énoncés d'acquérir de la crédibilité au fur et à mesure alors que Jean-François Sabouret et Paul Caro, dans « Chercher. Jours après jours, les aventuriers du savoir » présentent des portraits de chercheurs venant de tous les domaines et travaillant au quotidien[114],[115].
Des communautés scientifiques
La communauté scientifique désigne, dans un sens assez large, l'ensemble des chercheurs et autres personnalités dont les travaux ont pour objet les sciences et la recherche scientifique, selon des méthodes scientifiques. Parfois cette expression se réduit à un domaine scientifique particulier : la communauté des astrophysiciens pour l'astrophysique, par exemple. La sociologie des sciences s'intéresse à cette communauté, à la façon dont elle fonctionne et s'inscrit dans la société.
 Le physicien Hans Bethe recevant le prix Nobel en 1967, pour sa contribution à la théorie des réactions nucléaires.
Le physicien Hans Bethe recevant le prix Nobel en 1967, pour sa contribution à la théorie des réactions nucléaires.
On peut parler de « société savante » lorsqu'il s'agit d'une association d’érudits et de savants. Elle leur permet de se rencontrer, de partager, confronter et exposer le résultat de leurs recherches, de se confronter avec leurs pairs d'autres sociétés du même type ou du monde universitaire, spécialistes du même domaine, et le cas échéant, de diffuser leurs travaux via une revue, des conférences, séminaires, colloques, expositions et autres réunions scientifiques. Un congrès ou conférence scientifique est un événement qui vise à rassembler des chercheurs et ingénieurs d'un domaine pour faire état de leurs avancées. Cela permet également à des collègues géographiquement éloignés de nouer et d'entretenir des contacts. Les congrès se répètent généralement avec une périodicité fixée, le plus souvent annuelle.
La collaboration est de mise au sein de la communauté scientifique, en dépit de guerres internes et transnationales. Ansi, l'outil du peer review (aussi appelé « arbitrage » dans certains domaines universitaires) consiste à soumettre l’ouvrage ou les idées d’un auteur à l’analyse de confrères experts en la matière, permettant par là aux chercheurs d’accéder au niveau requis par leur discipline en partageant leur travail avec une personne bénéficiant d’une maîtrise dans le domaine.
Recherche
Article détaillé : Recherche scientifique. Le Fermilab, à Batavia près de Chicago.
Le Fermilab, à Batavia près de Chicago.
La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre social, économique, institutionnel et juridique de ces actions. Dans la majorité des pays finançant la recherche, elle est une institution à part entière, voire une instance ministérielle (comme en France, où elle fait partie du Ministère de l'Éducation Nationale et de la Recherche) car elle constitue un avantage géopolitique et social important pour un pays. Le prix Nobel (il en existe un pour chaque discipline scientifique promue) récompense ainsi la personnalité scientifique qui a le plus contribué, par ses recherches et celles de son équipe, au développement des connaissances.
Les « Science studies » sont un courant récent regroupant des études interdisciplinaires des sciences, au croisement de la sociologie, de l’anthropologie, de la philosophie ou de l’économie. Cette discipline s'occupe principalement de la science comme institution, orientant le débat vers une « épistémologie sociale ».
Sociologie du champ scientifique
Article détaillé : Sociologie des sciences.La sociologie des sciences vise à comprendre les logiques d'ordre sociologique à l'œuvre dans la production des connaissances scientifiques[116]. Néanmoins, il s'agit d'une discipline encore récente et évoluant au sein de multiples positions épistémologiques ; Olivier Martin dit qu'« elle est loin de disposer d'un paradigme unique : c'est d'ailleurs une des raisons de sa vivacité »[117]. Dans les années 1960 et 1970, une grande part de ces études s’inscrivait dans le courant structuraliste. Mais, depuis le début des années 1980, les sciences sociales cherchent à dépasser l’étude de l’institution « science » pour aborder l’analyse du contenu scientifique. La sociologie du « champ scientifique », concept crée par Pierre Bourdieu, porte ainsi une attention particulière aux institutions scientifiques, au travail concret des chercheurs, à la structuration des communautés scientifiques, aux normes et règles guidant l'activité scientifique surtout. Il ne faut cependant pas la confondre avec l'étude des relations entre science et société, quand bien même ces relations peuvent être un objet d'étude des sociologues des sciences. Elle est en effet plus proche de l'épistémologie.
Le « père » de la sociologie des sciences est Robert K. Merton qui, le premier, vers 1940, considère la science comme une « structure sociale normée » formant un ensemble qu'il appelle l'« èthos de la science » (les principes moraux dirigeant le savant) et dont les règles sont censées guider les pratiques des individus et assurer à la communauté son autonomie (Merton la dit égalitaire, libérale et démocratique). Dans un article de 1942, intitulé The Normative Structure of Science, il cite quatre normes régissant la sociologie de la science : l' universalisme, le communalisme, le désintéressement, le scepticisme organisé. Ce que cherche Merton, c'est analyser les conditions de production de discours scientifiques, alors que d'autres sociologues, après lui, vont viser à expliquer sociologiquement le contenu de la science. Pierre Duhem s'attacha lui à analyser le champ scientifique du point de vue constructiviste. À la suite des travaux de Thomas Samuel Kuhn, les sociologues dénoncèrent la distinction portant sur la méthode mise en œuvre et firent porter leurs investigation sur le processus de production des connaissances lui-même.
Si la philosophie des sciences se fonde en grande partie sur le discours et la démonstration scientifique d'une part, sur son historicité d'autre part, pour Ian Hacking, elle doit étudier aussi le style du laboratoire. Dans « Concevoir et expérimenter », il estime que la philosophie des sciences, loin de se cantonner aux théories qui représentent le monde, doit aussi analyser les pratiques scientifiques qui le transforment. Le sociologue américain Joseph Ben David a ainsi étudié la sociologie de la connaissance (« sociology of scientific knowledge ») dans ses « Éléments d'une sociologie historique des sciences » (1997).
Applications, inventions, innovations et économie de la science
Articles détaillés : Innovation et Invention (technique).L’« application » d’une science à une autre est l'usage qu’on fait des principes ou des procédés d’une science pour étendre et perfectionner une autre science. L'« invention » est d'abord une méthode, une technique, un moyen nouveau par lequel il est possible de résoudre un problème pratique donné. Le concept est très proche de celui d'une innovation. Par exemple, Alastair Pilkington a inventé le procédé de fabrication du verre plat sur bain d'étain dont on dit qu'il s'agit d'une innovation technologique majeure.
Une « innovation » se distingue d'une invention ou d'une découverte dans la mesure où elle s'inscrit dans une perspective applicative. L'une et l'autre posent des enjeux majeurs à l'économie. Dans les pays développés, les guerres économiques reposent sur la capacité à prévoir, gérer, susciter et conserver les applications et les innovations, par le brevet notamment. Pour les économistes classiques, l'innovation est réputée être l'un des moyens d'acquérir un avantage compétitif en répondant aux besoins du marché et à la stratégie d'entreprise. Innover, c'est par exemple être plus efficient, et/ou créer de nouveaux produits ou service, ou de nouveaux moyens d'y accéder[note 66].
Ce sont tout d'abord les sociologues de la science Norman Storer et Warren Hagstrom, aux États-Unis, puis Gérard Lemaine et Benjamin Matalon en France, qui proposent une grille de lecture pour le champ économique des disciplines scientifiques. Ils envisagent en effet la science comme un système d'échange semblable à un marché sauf que la nature des biens échangés est du domaine du savoir et de la connaissance. Il y existe même une sorte de loi de la concurrence car si le scientifique ne publie pas, il ne peut prétendre voir ses fonds de recherche être reconduits l'année suivante. Cet esprit de compétition, selon Olivier Martin « stimule les chercheurs et constitue le moteur de la science »[118]. Mais c'est surtout le sociologue Pierre Bourdieu qui a su analyser l'économie du champ scientifique. Dans son article intitulé « le champ scientifique », dans les Actes de la recherche en sciences sociales[119], il indique que la science obéit aux lois du marché économique sauf que le capital est dit « symbolique » (ce sont les titres, les diplômes, les postes ou les subventions par exemple). Par ailleurs, ce capital symbolique dépend de l'intérêt général et institutionnel : ainsi toutes les recherches se valent mais les plus en vue sont favorisées. Enfin, le milieu scientifique est dominé par des relations de pouvoir, politique et communautaire.
Notes et références
Références
- Dictionnaire Le Robert, édition de 1995, p. 2051.
- Dominique Lecourt, p. 6
- Dictionnaire étymologique de la langue française, sous la direction de Oscar Bloch, Walther von Wartburg, 2008.
- D'après le Trésor Informatisé de la Langue Française ; voir aussi le schéma proxémique sur le Centre National de Ressources Textuel et Lexical.
- Michel Blay, p. 734
- Dominique Pestre, p. 104
- Michel Blay, p. 734-735
- Terry Shinn, « Formes de division du travail scientifique et convergence intellectuelle. La recherche technico-instrumentale », Revue française de sociologie, n° 41 (3), pp. 447-73, 2000.
- Bernward Joerges et Terry Shinn, Instrumentation between Science, State and Industry, Kluwer Academic Press, Dordrecht, 2001.
- André Pichot, p. 7.
- Robert Nadeau, p. 126
- Léna Soler, p. 13.
- René Taton.
- Michel Blay, entrée science classique, citée dans « La science classique en chantier », in magazine Sciences Humaines, hors-série, Histoire et philosophie des sciences', no 31, décembre-janvier 2000-2001, p. 14.
- Bruno Jarrosson, p. 170 résumé le modèle de Kuhn ainsi : « pré-science - science normale - crise - révolution - nouvelle science normale - nouvelle crise »
- André Pichot, introduction
- André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, Albin Michel, 1962, p. 152.
- (en) Russell M. Lawson, (sous la direction de), Science in the ancient world - An Encyclopedia, ABC-CLIO, 2004, p. 149.
- André Pichot, p. 3.
- André Pichot explique ainsi qu' « avec deux roseaux de diamètres différents, on pouvait écrire tous les nombres » [sur des tablettes d'argile].
- André Pichot, p. 73.
- André Pichot, p. 75 « Il faudra l'invention du système métrique pour en trouver l'équivalent »
- André Pichot, p. 81 cite l'exemple d'une table de multiplication par 25 provenant de Suse et datant du IIe millénaire av. J.-C.
- André Pichot, p. 110-111 évoque des tablettes où les sumériens ont anticipé les théorèmes fondamentaux de Thalès et de Pythagore, sur la géométrie du triangle.
- André Pichot, p. 169 : « Comparativement aux disciplines précédemment exposées, la médecine à ceci de particulier qu'elle ressortit plus à la technique (voire à l'art) qu'à la science proprement dite, du moins en ce qui concerne ses formes primitives »
- André Pichot, p. 116.
- André Pichot, p. 191.
- André Pichot, p. 199.
- « Mathématiques égyptiennes », Instituts de recherche sur l’enseignement des mathématiques.
- André Pichot, p. 311.
- 1970 Early Greek science. Thales to Aristotle, Londres, Chatto & Windus. Trad. fr. Les débuts de la science grecque. De Thalès à Aristote, Paris, Maspero, 1974.
- Platon, 189e-190a
- Emmanuel Renault, p. 75
- Raymond Chevallier, p. 108-110
- Raymond Chevallier, p. 114
- Ouvrage collectif, Christophe Grellard (éditeur), Méthode et statut des sciences à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires du Septentrion, 2004, (ISBN 2-85939-839-2), pp. 8-9.
- K. Chemla & Guo Shuchun, Les neuf chapitres. Le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires, Dunod, 2004, Paris, (ISBN 2100495895)
- Voir la présentation, sur le site du CNRS, de Karine Chelma [PDF].
- (en) K. V. Sharma et S. Hariharan, Yuktibhasa of Jyesthadeva
- Roger Bacon, Opus majus, tome II, p. 177.
- Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte, p. 383
- Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte, p. 167
- Bacon, Novum organum, Livre I, 95, chapitre « la fourmi, l'araignée, l'abeille »
- Jean-Pierre Verdet, p. 86
- Jean-Pierre Verdet, p. 99
- Jean-Pierre Verdet, p. 9133
- Titre d'un chapitre de Jean-Pierre Verdet, p. 170. Galilée explique ainsi dans la Saggiatore que la nature a pour langage les mathématiques.
- Serge Hutin, p. 109.
- Serge Hutin, p. 110.
- Cité par Serge Hutin, p. 120.
- Voir notamment : Francis Bacon réformateur de l'alchimie : tradition alchimique et invention scientifique au début du XVIIe siècle sur CAT.INIST.
- Cité par Serge Hutin, p. 78-79.
- Bernard Vidal, p. 32.
- Pour plus de détails concernant les savants auteurs de découvertes dans les premiers temps de l'alchimie, voir l'ouvrage de Bernard Vidal et le site La Ligne du Temps de la Chimie.
- Michel Blay, entrée science classique, citée dans « La science classiqe en chantier », in magazine Sciences Humaines, hors-série, Histoire et philosophie des sciences', n° 31, décembre-janvier 2000-2001, p. 14.
- Evelyne Barbin.
- « Cette notion apparaît avec l'histoire des sciences elle-même, au XVIIIe siècle. (...) Le mot se répand très vite pour parler de l'œuvre de Newton, et se banalise dans l'Encyclopédie ».Dominique Lecourt, p. 840
- Sciences naturelles et Médecine au siècle des Lumières, ressources scientifiques en ligne pour l'enseignement des sciences.
- Jean le Rond D'Alembert, Discours préliminaire de l'Encyclopédie, Vrin, Paris, 1984, p. 30.
- Claude Bernard, Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, Garnier-Flammarion, 1966, p. 176.
- Selon l'expression de Thomas Samuel Kuhn, dans La Structure des révolutions scientifiques.
- Jean-François Dortier
- Robert Nadeau, p. 636
- Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Le dictionnaire des sciences humaines, entrée « Wilhelm Windelband ».
- Gilles-Gaston Granger, p. 59
- Léna Soler, p. 21-22.
- Il dit ainsi : « Appliquer le qualificatif de « sciences » à la connaissance des faits humains sera du reste considéré par certains comme un abus de langage. Il est assez clair en effet que ni les savoirs sociologiques ou psychologiques, économiques ou linguistiques ne peuvent prétendre, dans leur état présent et passé à la solidité et à la fécondité des savoirs physico-chimiques, ou même biologiques. » Gilles-Gaston Granger, p. 85
- Raymond Boudon, L’art de se persuader des idées douteuses, fragiles ou fausses, Fayard, coll. « Points Essais », Paris, 1990, p. 367.
- Voir sur ce point l'ouvrage de Robert Blanché et Jacques Dubucs, La logique et son histoire : d'Aristote à Bertrand Russell, Paris, Armand Colin, 1996.
- Aristote, Topiques, Tome 1, Livre I-IV, texte traduit par J. Brunschwig, Les Belles Lettres, Paris, 1967.
- Michel Blay, entrée « science formelle ».
- Jean Ladrière dit ainsi : « 'Il n'y a pas un critère absolu de validité, posé une fois pour toutes, mais une sorte d'épuration progressive des critères, qui va de pair avec l'extension du champ mathématique et la découverte des domaines nouveaux », in Encyclopædia Universalis, Tome 21, Entrée « Sciences - Sciences et discours rationnel », p. 775.
- Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte, entrée « Karl Popper ».
- In Encyclopedia Universalis, Tome 21, entrée « Science - Sciences et discours rationnel », p. 775.
- Entrée « Scientificité », dans le Trésor de la Langue Française Informatisée.
- Science, valeur et rationalité, Éditions de l’Université d’Ottawa, Coll. Sciences Sociales, 1984, p. 15.
- Michel Blay, p. 518.
- Jean-Pierre Changeux, Raison et plaisir, Odile Jacob, 1994.
- Définition de simulation dans le Trésor de la Langue Française Informatisée.
- Dominique Lecourt, p. 15
- Dominique Lecourt, p. 16
- Cité par le professeur des universités Jean-Louis Le Moigne dans Les Épistémologies Constructivistes, PUF, coll. Que sais-je ?, 1995, (ISBN 2-1-046943-3), p. 3. Piaget utilise cette expression dans l'introduction de Logique et connaissance scientifique, 1967.
- Aurel David, p. 22.
- Steven Weinberg, Le Rêve d'une théorie ultime, 1997, Odile Jacob.
- C.G.J. Jacobi, letter to Legendre, July 2, 1830, in Gesammelte Werke, Vol. I, Berlin (1881), p. 454.
- Paul Feyerabend, p. 33
- Louis Althusser, p. 76
- Renald Legendre, p. 1003
- Enquête sur l'entendement humain, sections IV et V.
- Dominique Lecourt, entrée « Empirisme »
- Cours de philosophie positive, Ire leçon, p. 22.
- Ernest Mach, La Mécanique, exposé historique et critique de son développement, Paris, Hermann, 1904.
- Mach, opcit, p. 113
- Mach, in La Mécanique, opcit, introduction.
- Michel Blay, p. 705.
- Karl Popper, in La Quête inachevée.
- Jean-Louis Le Moigne, Le Constructivisme, tome 1.
- Ian Hacking cité dans Léna Soler, p. 65.
- Jean Piaget et Rolando Garcia, Psychogenèse et histoire des sciences, Paris, Groupe Flammarion, 1983 (ISBN 2082111377) [lire en ligne], p. 30
- Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte, p. 292
- Entrée « Technique », dans le 'Trésor Informatisé de la Langue Française.
- Jean Pierre Mohen
- Rapport d'information n° 392 auprès du Sénat (2002-2003) intitulé La diffusion de la culture scientifique.
- Réunion des CCSTI
- Charte nationale des Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle
- Site de l'Exploratorium
- Bernard Schiele, Les territoires de la culture scientifique, Presses Universitaires de Montréal, 2003.
- Robert Nadeau et Jacques Désautels, dans Épistémologie et Didactique des sciences en donnent la synthèse. il s'agissait d'une étude statistique et qualitative menée au Canada.]
- Robert Nadeau, « Contre le scientisme. Pour l’ouverture d’un nouveau front », revue Philosophiques, XIII (2), 1986.
- Amy Dahan et Dominique Pestre
- Amy Dahan et Dominique Pestre, p. 16
- G.L Bruno avait postulé et prouvé le pluralisme des mondes possibles, c'est-à-dire l'existence d'autres terres dans l'univers, notamment avec son ouvrage De l’infinito universo et Mondi (De l’infini, l'univers et les mondes).
- Bruno Latour
- Jean-François Sabouret et Paul Caro, Chercher. Jours après jours, les aventuriers du savoir, Autrement 2000
- Voir aussi Georges Chapouthier, Qu’est-ce qu’un biologiste aujourd’hui ?, Pour la Science, 2008, 366, pp 30-33
- Michel Dubois.
- Olivier Martin, maître de conférence en sociologie à la Sorbonne, citée dans « La construction sociale des sciences », in magazine Sciences Humaines, hors-série, Histoire et philosophie des sciences', n° 31, décembre-janvier 2000-2001, p. 36.
- Olivier Martin, maître de conférence en sociologie à la Sorbonne, citée dans « La construction sociale des sciences », in magazine Sciences Humaines, hors-série, Histoire et philosophie des sciences', n° 31, décembre-janvier 2000-2001, p. 37.
- Actes de la recherche en sciences sociales, n° 2/3, 1976, pp. 88-104, consultable en ligne.
Notes
- Encyclique du Pape Jean-Paul II, Fides et ratio (1998) redéfinissant le rapport science-religion ainsi : « La foi et la raison sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité »
- Albert Einstein : « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. »
- Michel Serres, p. 16 nomme ces embranchements les « bifurcations », sachant que « Loin de dessiner une suite alignée d'acquis continus et croissants ou une même séquence de soudaines coupures, découvertes, inventions ou révolutions précipitant dans l'oubli un passé tout à coup révolu, l'histoire des sciences court et fluctue sur un réseau multiple et complexe de chemins qui se chevauchent »
- Détail d'un cycle d'allégories réalisées pour le hall d'exposition du bâtiment Postberardine de Varsovie, Pologne (1870).
- Dans leur ouvrage, Les Chamanes de la Préhistoire, Jean Clottes et David Lewis-Williams (professeur d'archéologie cognitive) développent la thèse selon laquelle l'homme préhistorique possédait les mêmes facultés cognitives que l'homme moderne
- Il est important de noter que les notions mathématiques employés ci-après ne reflètent pas à proprement parler les emplois faits lors de l'époque mésopotamienne. Celle de « démonstration mathématique » par exemple est un abus de langage, employé dans le but de faire comprendre au lecteur moderne à quoi se rapporterait l'usage que le mésopotamien fait de son objet mathématique, de manière intuitive. Ainsi, les mésopotamiens « démontrent » vraiment que la solution d'un problème donné est la bonne, en revanche, ils ne démontrent pas de théorème. De même certains termes sont anachroniques : il n'existe pas de théorème chez eux, pas plus qu'il n'existe d'équation (l'invention de l'inconnue est en effet plus tardive). Leur langage mathématique n'est ainsi pas adapté aux notions modernes.
- Contrat archaïque sumérien concernant la vente d'un champ et d'une maison. Shuruppak, v. 2600 av. J.-C., inscription pré-cunéiforme. Musée du Louvre, Paris, Département des Antiquités Orientales, Richelieu, rez-de-chaussée, chambre 1a.
- L'écriture d'un nombre se fait en répétant les signes des unités, dizaines, centaines, autant de fois qu'il compte d'unités, chacun de ces nombres d'unités étant inférieurs à 10.
- Même si : « Vers 500 avant J.–C. naissent de nouvelles religions en réaction au védisme, il s’agit notamment du Bouddhisme et du Jaïnisme. Leurs premiers textes ne seront pas en Sanskrit, mais dans des langues régionales, « vernaculaires », le pali et le prakrit. En particulier les textes canoniques jaïns composé en prakrit recèlent des trésors de pensée mathématique. » explique Agathe Keller, du CNRS dans Textes écrits, textes dits dans la tradition mathématique de l’Inde médiévale sur le site CultureMath.
- Mosaïque représentant l'Académie de Platon, maison de Siminius Stephanus, Pompéï.
- « la dialectique platonicienne consistera à prendre appui sur les hypothèses mathématiques pour s'élever jusqu'au principe et dériver ensuite les conséquences du principe. En ce qu'elle explique la dépendance des conséquences à l'égard d'un terme unique, la dialectique est connaissance intégrale, « vue synoptique » de l'ensemble des savoirs et de la totalité du réel. », in Emmanuel Renault, p. 308 qui cite alors le dialogue La République, dans lequel Platon expose cette thèse, au passage 537c.
- Voir notamment : L. Couloubaritsis, La Physique d'Aristote : l'avènement de la science physique, 2e édition, Vrin, Paris, 2000.
- Pour plus de détails, voir : Technologie, économie et société dans le monde romain, Congrès de Côme des 27 et 29 septembre 1979, Jean-Pierre Vallat, in Dialogues d’histoire ancienne, 1980, Volume 6, Numéro 6, pp. 351-356, [en ligne.
- Voir notamment l'étude de Jean Théodoridès, Les Sciences biologiques et médicales à Byzance, Centre national de la recherche scientifique, Centre de documentation Sciences humaines, 1977, Paris.
- Voir Philosophie et sciences à Byzance de 1204 à 1453 par Michel Cacouros et Marie-Hélène Congourdeau consultable en ligne.
- Le terme de « loi » est néanmoins anachronique;à l'époque de la naissance des premières grandes universités d'occident, le mot « loi » avait une signification exclusivement juridique.
- Certains ouvrages des mécaniciens d'Alexandrie, comme le livre des appareils pneumatiques de Philon de Byzance, ne sont connus aujourd'hui que par l'intermédiaire de la civilisation islamique.
- Francis Bacon considérait que trois grandes inventions avaient changé le monde : la poudre à canon, le compas magnétique et l’imprimerie.
- Joseph Needham, Science et civilisation en Chine, Picquier Philippe, 1998, (ISBN 9782877302470), (version abrégée des deux premiers tomes).
- Pour une analyse de l'ouvrage de Needham, voir l'article compte-rendu : Joseph Needham : The grand Filtration. Science and Society in East and in West par P. Huard, Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, 1971, n° 58, pp. 367-371, consultable en ligne.
- Exemple de problème d'extraction de racine carrée et photographies des manuscrits dans l' Aryabatîya sur CultureMath.
- oir à ce sujet : (en) Crombie, A. C. Alistair Cameron, Robert Grosseteste and the origins of experimental science, 1100-1700, Oxford : Clarendon Press, 1971.
- Voir par exemple Ferdinand Hoefer, Histoire de la physique et de la chimie : depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, Paris, Hachette, 1872, (ISBN 2-04-017396-X).
- L'ordre des Dominicains allait ainsi être à l'origine du renouveau intellectuel de l'Église, à l'origine même de l'acceptation des positions scientifiques.
- Se référer à l'ouvrage de Michel Blay, Dictionnaire critique de la science classique, Flammarion, 1988. Cette période fut également reconnue comme fondatrice de la science classique et institutionnelle par les Actes du Congrès International d'Histoire des Sciences, tenus à Liège en 1997.
- Pour plus de détails, voir Francis Bacon, science et méthode par Michel Malherbe, Jean-Marie Pousseur consultable en ligne.
- Francis Bacon la fustige à travers cette célèbre déclaration, tirée du Novum Organum : « La science doit être tirée de la lumière de la nature, elle ne doit pas être retirée de l’obscurité de l’antiquité. »
- « ce ne sont pas des ailes qu’il faut à notre esprit, mais des semelles de plomb. ») explique-t-il, afin de montrer la prépondérance de l'expérience sur l'abstraction.
- « Le mouvement de la terre autour du soleil ouvre une stratégie nouvelle à la pratique astronomique », in Jean-Pierre Verdet, p. 98
- Sur les « trois lois de Kepler », voir les explications en ligne.
- Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini, trad. Raïssa Tarr. Paris : Gallimard ; 2003, 1957, 350p., (ISBN 2-07-071278-8).
- Voir sur ce point : Pierre Astruc [et al.], L'Encyclopédie et le progrès des sciences et des techniques, Centre International de synthèse. Section d'Histoire des Sciences, 1952, (Articles parus précédemment dans la Revue d'histoire des Sciences et de leurs applications et réunis à l'occasion du bicentenaire de l'Encyclopédie).
- Sur l'empirisme en philosophie, notamment chez Hume voir le site de Yann Ollivier.
- Pierre Bayle, Pensées diverses sur la comète, GF-Flammarion, édition de Joyce et Hubert Bost, 512 p., (ISBN 9782081207127).
- Concernant les apports de Linné à la botanique voir le site de l'Université de Namur.
- Henri Bergson, La pensée et le mouvant : Articles et conférences datant de 1903 à 1923, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Bibliothèque de philosophie contemporaine », 1969, 294 p. [lire en ligne], p. L'Introduction à l'étude de la Médecine expérimentale est un peu pour nous ce que fut pour le XVIIe siècle et leXVIIIe siècle le discours de la Méthode Dans. Dans un cas comme dans l'autre nous nous trouvons devant un homme de génie qui a commencé par faire de grandes découvertes, et qui s'est demandé ensuite comment il fallait s'y prendre pour les faire : marche paradoxale en apparence et pourtant seule naturelle, la manière inverse de procéder ayant été tentée beaucoup plus souvent et n’ayant jamais réussi. Deux fois seulement dans l'histoire de la science moderne, et pour les deux formes principales que notre connaissance de la nature a prises, l'esprit d'invention s'est replié sur lui-même pour s'analyser et pour déterminer ainsi les conditions générales de la découverte scientifique. Cet heureux mélange de spontanéité et de réflexion, de science et de philosophie, s'est produit les deux fois en France.
- Le site du Comité Consultatif National d'Éthique
- Voir The science of the artificial, (1969), MIT Press. Voir aussi Jean-Louis Le Moigne (dir), Les nouvelles sciences : comprendre les sciences de l’artificiel, avec le Pr H. A. Simon
- Voir ainsi : Globot - Essai sur la classification des sciences - (1898) sur le site philagora.
- Certaines approches de l'économie appartiennent également à cette catégorie (voir École autrichienne d'économie).
- Jean-Marie Legay et Anne-Françoise Schmidt, dans Question d’épistémologie. Modélisation des objets complexes et interdisciplinarité, une collaboration entre un biologiste et une philosophe étudient le passage de la théorie au modèle.
- Voir à ce sujet la critique de sur le site de Gilles Guérin, philosophe.
- Voir sur ce point : L’économique est-elle une science empirique ? de Robert Nadeau, Département de philosophie, Université du Québec à Montréal [pdf].
- Pour une étude des apports de Gadamer à l'herméneutique, et notamment en réaction au positivisme, voir l'essai de Christian Ruby, Hans-Georg Gadamer. L'herméneutique : description, fondation et éthique, in EspacesTemps.net Textuel, 16.10.2002.
- Voir : Nicolle, Jean-Marie, Histoire des méthodes scientifiques : du théorème de Thalès au clonage.
- Que disent les indicateurs ?, entretien avec Jean-Pierre Merlet, animateur du groupe de réflexion sur les indicateurs de la commission d’évaluation de l’INRIA, Lettre d'information de l'INRIA, n°59, mai 2007.
- Pour une définition de l'épistémologie, ainsi que les questions clés qui y sont liées, voir : L'épistémologie, par Jean-Claude Simard, du Cégep de Rimouski.
- Voir notamment Nicolas Rescher, Le progrès scientifique : un essai philosophique sur l'économie de la recherche dans les sciences de la nature.
- Voir Pierre-André Taguieff. Du progrès. Biographie d'une utopie moderne, Librio, 2001 ; Le Sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Flammarion, 2004
- Voir, par exemple, Éthique, science et droits de l’homme, entretien avec Nicole Questiaux
- Voir les rapports de l'humanisme et des biotechnologies sur le site de l'INRA : Humanisme, biotechnologie et éthique de la science, contribution initiale de Pietro Rotili.
- Le double usage de la fission nucléaire - l'arme atomique d'une part, le nucléaire civil d'autre part - illustre l'ambivalence des découvertes scientifiques.
- Voir pour plus de détails l'article « Althusser et le concept de Philosophie Spontanée des Savants », in Groupe d'études La philosophie au sens large, animé par Pierre Macherey, consultable en ligne.
- Y compris en mathématique, où on parle de quasi-empirisme : [http://peccatte.karefil.com/quasi/QuasiEmpirisme.html Philosophie et mathématiques : sur le quasi-empirisme de Patrick Peccatte.
- Karl Pearson, Grammaire de la science, traduction française, March, Paris, Alcan, 1912.
- Voir pour une analyse de la théorie épistémologique de Thomas Kuhn la fiche de lecture de Delphine Montazeaud en ligne.
- Voir pour une étude complète de leur différence l'article « Science and Pseudo-Science » sur le site Stanford Encyclopedia of Philosophy (en).
- Tableau peint en 1425 (finition en 1428), altéré en 1680, et restauré en 1980.
- Le CNRS propose une exposition sur le thème art et science, présentant les différentes techniques au service de la conservation des ouvrages d'art.
- Voir : Scientisme et occident. Essais d'épistémologie critique de Jean-Paul Charrier.
- Voir : François d'Aubert, Le savant et le politique aujourd'hui (colloque de La Villette), 1996.
- Barnes et Bloor sont à l'origine du « programme fort » qui, en sociologie de la connaissance cherche à expliquer les origines de la connaissance scientifique par des facteurs exclusivement sociaux et culturels.
- Voir pour plus d'informations : Le procès de Galilée sur le site Astrosurf.
- Voir sur ce point : Golding, Gordon, Le procès du singe : la Bible contre Darwin, éditions Complexes, Coll. Historiques, 2006, (ISBN 2-8048-0085-7).
- Yves Gingras, Peter Keating et Camille Limoges, Du scribe au savant. Les porteurs du savoir, de l'Antiquité à la Révolution industrielle, PUF, Coll. Science, savoir et société, 2000, (ISBN 978-2-13-050319-4).
- Voir Patrice Flichy, L'innovation technique : récents développements en sciences sociales : vers une nouvelle théorie de l'innovation.
Voir aussi
Wikisource
- Science et méthode d'Henri Poincaré (1908)
- La Science et l'hypothèse d'Henri Poincaré (1902)
- Les Valeurs de la science d'Henri Poincaré (1902)
- Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences (1637) de René Descartes
Liens externes
- (fr) Science.gouv.fr le portail des sciences du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche
- (fr) Cours d'épistémologie de Paris IV-Sorbonne
- (fr) Futura-science, magazine sur l'actualité scientifique
- (fr) La Cité des sciences, Paris
- (fr) Espace des sciences. Conférences, expositions, dossiers
- (fr) Science décision, rapport de la science à la société
- (fr) Le site de la Fête de la science
- (fr) Persée.Site de numérisation rétrospective de revues françaises en sciences humaines et sociales
Bibliographie
Ouvrages utilisés
- Jean-Pierre Verdet, Une Histoire de l'astronomie, Paris, Seuil, coll. « Points », 1990 (ISBN 2-02-011557-3)
- Bernard Vidal, Histoire de la chimie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? n° 35 », 1985 (ISBN 2-13-048353-4)
- Serge Hutin, L'alchimie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? n° », 2005 (ISBN 2-13-054917-9)
- Michel Dubois, Introduction à la sociologie des sciences, PUF, coll. « Premier Cycle », 1999 (ISBN 978-2-13-048425-7).
329
- Aurel David (préf. Louis Couffignal), La cybernétique et l'humain, Gallimard, coll. « Idées », 1965 (ISBN 9782070350674)
- Louis Althusser, Philosophie et philosophie spontanée des savants, François Maspero, 1967, 160 p.
- Paul Feyerabend, Contre la méthode, esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Seuil, coll. « Points Sciences », 1988, 349 p. (ISBN 978-2020099950)
- Dominique Pestre, Introduction aux Science Studies, La Découverte, coll. « Repère », 2006, 122 p. (ISBN 978-2707145963)
- Amy Dahan et Dominique Pestre, Les sciences pour la guerre. 1940 - 1960, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, coll. « Civilisations Et Sociétés, numéro 120 », 2004, 402 p. (ISBN 2713220157)
- Renald Legendre, Dictionnaire actuel de l'éducation, Canada, Guérin, coll. « Le defi éducatif », 2006, 1584 p. (ISBN 978-2760168510)
- Jean-François Dortier, Une histoire des sciences humaines, Sciences Humaines Eds, 2006, 400 p. (ISBN 2912601363)
- Evelyne Barbin (dir.), Arts et sciences à la Renaissance, Ellipses, 2007 (ISBN 978-2-7298-3676-4)
- Bruno Jarrosson, Invitation à la philosophie des sciences, Seuil, coll. « Points Sciences », 1992 p. (ISBN 2-02-013315-6)
- Platon, Théétète, Paris, GF-Flammarion, 1995 (réimpr. 2ème éd. corrigée)
trad. intro. et notes par M. Narcy
- Robert Nadeau, Vocabulaire technique et analytique de l'épistémologie, PUF, coll. « Premier cycle », 1999, 904 p. (ISBN 978-2130491095)
- Raymond Chevallier, Sciences et techniques à Rome, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1993, 128 p. (ISBN 2-13-045538-7)
- Dominique Lecourt (sous sa direction), Dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1999, 1031 p. (ISBN 213052866X)
- Léna Soler, Introduction à l’épistémologie, Ellipses, 2000 (ISBN 9782729842604)
- Noëlla Baraquin et Jacqueline Laffitte, Dictionnaire des philosophes, Paris, Armand Colin, 2008, 404 p. (ISBN 978-2-2003-46478).
Deuxième édition
- Maurice Gagnon et Daniel Hébert, En quête de science. Introduction à l'épistémologie, Canada, Fides, 2000, 305 p. (ISBN 2-7621-2143-4)
- Dominique Lecourt, La philosophie des sciences, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 2001, 127 p. (ISBN 2-13-052072-3)
- Ahmed Djebbar, L'âge d'or des sciences arabes, Paris, Seuil, coll. « Points sciences », 2001 (ISBN 2746502585)
- Michel Blay, Dictionnaire des concepts philosophiques, Paris, Larousse, coll. « CNRS éditions », 2005, 880 p. (ISBN 2-03-582657-9)
- Gaston Bachelard, La Formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, coll. « Biblio textes philosophiques », 1993, 256 p. (ISBN 2711611507)
- Michel Serres, Éléments d'histoire des sciences, Paris, Bordas, coll. « Référents », 2003 (ISBN 2047298334)
- André Pichot, La Naissance de la science. Tome 1 : Mésopotamie, Égypte, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1991 (ISBN 2-07-032603-9)
- Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1993 (ISBN 2-08-081115-0)
- Gilles-Gaston Granger, La science et les sciences, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 1993 (ISBN 2-13-0450776)
- Geoffrey Ernest Richard Lloyd, Une histoire de la science grecque, La Découverte, coll. « Points Science », 1990
- Hervé Barreau, L'épistémologie, PUF, coll. « Que sais je? », 2008 (ISBN 978-2-13-056648-9)
- René Taton (dir.), Histoire générale des Sciences (t. 1 : La Science antique et médiévale; t. II : La Science moderne), PUF, 1957
Généralités sur la science
- Alan Chalmers, Qu'est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Le Livre de Poche, 1990 (ISBN 9782253055068)
- Bruno Latour, La science en action. Introduction à la sociologie des sciences, La Découverte, 2005, 664 p. (ISBN 978-2707145468)
- Ahmed Moulaye et Salah Ould, De Thalès à Einstein, l'histoire de la science à travers ses grands hommes, 2007 (ISBN 978-2-7590-0251-1)
- Jean-François Dortier (dir.), Une histoire des sciences humaines, Sciences Humaines éditions, 2006 (ISBN 2-912601-36-3)
- Jean-Marie Nicolle, Histoire des méthodes scientifiques : du théorème de Thalès au clonage, Rosny, Bréal, 2006 (ISBN 2-7495-0649-2)
- Jean-Paul Charrier, Scientisme et Occident : essais d'épistémologie critique, Paris, Connaissances et Savoirs, 2005 (ISBN 2-7539-0061-2)
- Maurice Gagnon et Daniel Hébert, En quête de science : introduction à l'épistémologie, Fides, 2000 (ISBN 2-7621-2143-4)
- Jean-Pierre Mohen, L'art et la science : l'esprit des chefs-d'œuvre, Gallimard, coll. « Sciences », 1998 (ISBN 2-07-059413-0)
- Le savant et le politique aujourd'hui : colloque de La Villette, Albin Michel, coll. « Bibliothèque des Idées », 7 juin 1996 (ISBN 2-226-08825-3).
organisé par la Cité des sciences et de l'industrie et Le Monde
- Patrice Flichy, L'innovation technique : récents développements en sciences sociales : vers une nouvelle théorie de l'innovation, La découverte, coll. « Sciences et société », 2003 (ISBN 2-7071-4000-7)
- Nicholas Rescher, Le progrès scientifique : un essai philosophique sur l'économie de la recherche dans les sciences de la nature, PUF, coll. « Sciences, modernités, philosophie », 1993 (ISBN 2-13-045764-9).
trad. de l'américain par Irène et Michel Rosier
- Robert Oppenheimer, La science et le bon sens, Paris, Gallimard, coll. « NRF Idées », 1972, 200 p. (ISBN 2-7605-1243-6).
- Paul Feyerabend, Écrits philosophiques, volume 1 : Réalisme, rationalisme et méthode scientifique, Dianoia, coll. « Fondements de la philosophie contemporaine des sciences », 2005 (ISBN 2-913126-05-7)
References
Wikimedia Foundation. 2010.