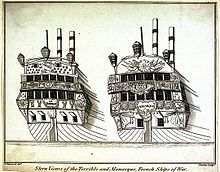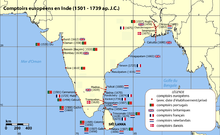- Pierre André de Suffren
-
 Pour les articles homonymes, voir Suffren.
Pour les articles homonymes, voir Suffren.Pierre André de Suffren, dit « le bailli de Suffren », également connu sous le nom de « Suffren de Saint-Tropez », né le 17 juillet 1729 au château de Saint-Cannat, près d’Aix-en-Provence et mort le 8 décembre 1788 à Paris, était un vice-amiral français, bailli et commandeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Suffren est à l’étranger le plus connu des marins français. Pour les auteurs anglo-saxons, Suffren est pratiquement le seul amiral français digne de figurer parmi les plus grands marins. De son vivant déjà, Suffren fait l’admiration de ses confrères anglais qui finissent par le surnommer « l’amiral Satan ». Clerk of Eldin, penseur naval britannique de la fin du XVIIIe siècle, vante son « mérite, sa bravoure, ses talents militaires » pour bâtir des théories navales dont se serait inspiré Nelson[1]. À la fin du XIXe siècle, Mahan, le principal stratège américain fait de lui un éloge appuyé. En 1942, l’amiral King, alors à la tête de la marine américaine, dresse la liste des cinq plus fameux amiraux du passé. Il nomme John Jervis, Horatio Nelson, Maarten Tromp, Suffren et David Farragut. Selon lui, Suffren possédait « l’art de tirer le meilleur parti des moyens disponibles accompagné d’un instinct de l’offensive et de la volonté de la mener à bien »[2].
En France, le jugement le plus célèbre est celui de Napoléon : « Oh ! pourquoi cet homme [Suffren] n’a-t-il pas vécu jusqu’à moi, ou pourquoi n’en ai-je pas trouvé un de sa trempe, j’en eusse fait notre Nelson, et les affaires eussent pris une autre tournure, mais j’ai passé tout mon temps à chercher l’homme de la marine sans avoir pu le rencontrer... ». Ces paroles, de nombreuses fois citées, nous sont rapportées par Emmanuel de Las Cases dans le Mémorial de Sainte-Hélène. Elles témoignent de l’immense prestige dont jouissait le héros de la campagne des Indes et des regrets de Napoléon. Pourtant, Suffren a toujours fait en France l’objet de commentaires contrastés. Le même Las Cases se fait l’écho des nombreux officiers de marine qui détestaient Suffren et surnommaient ce dernier le « gros calfat »[3] en raison de son physique, mais aussi de son comportement[4].
Au début du XXe siècle, l’amiral Raoul Castex, le principal stratège maritime français lui rend un hommage appuyé en parlant de « l’un des trois noms immortels qui jalonnent la marine à voile » avec Michiel de Ruyter et Horatio Nelson[5]. Mais tous les officiers historiens ne partagent pas cet avis. En 1996, l’amiral François Caron qui étudie les campagnes du bailli lâche contre lui une bordée de boulets rouges en concluant que « si le chevalier de Suffren manifesta un indiscutable courage, eut un coup d’œil tactique incomparable, son action, tous bilans faits, reste d’une grande banalité et est très décevante ». L'engouement de certains à son égard, estimant François Caron, n'étant pas justifié au vu de ses résultats réels[6]. Un jugement très sévère vis-à-vis de celui qui a donné son nom depuis la Révolution à sept vaisseaux de la marine française[7].
Plus de deux cents ans après sa mort, le célèbre bailli reste donc un sujet d’étude et de polémique pour les historiens. C’est d’ailleurs le marin français sur lequel ont été publiées le plus de biographies et d’articles. Au-delà des commentaires sur la portée de ses campagnes, on fait le constat d’une vie particulièrement remplie et mouvementée. Suffren traverse trois guerres navales franco-anglaises au milieu de ce très long conflit que certains historiens appellent aujourd’hui la « Seconde Guerre de Cent Ans » (1689–1815). La troisième — la plus commentée — lui apporte la gloire. Les deux premières — souvent négligées par les biographes — lui permettent de mener une double carrière en gravissant peu à peu tous les échelons de la Marine royale et ceux de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
La maison de Suffren
La lente ascension d’une famille provençale
Pierre-André de Suffren nait le 17 juillet 1729 au château de Saint-Cannat en Provence, entre Salon et Aix. Pierre-André est le douzième des quatorze enfants de Paul de Suffren et Hiéronyme de Bruny (sept garçons et sept filles, dont neuf parviendront à l’âge adulte). C’est une famille dont l’ascension sociale a été continue depuis le XVIe siècle. Dans la fratrie du futur amiral, les quatre garçons seront, officier général de l’armée de terre pour l’aîné, évêque pour le deuxième, et bailli de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem pour les deux derniers. Deux des filles se marieront avec des gentilshommes provençaux et deux autres entreront au couvent[8].
C’est dans la ville de Salon, au XVe siècle, qu’on trouve mention pour la première fois de la famille des « Suffrendi ». Elle serait originaire, d’après la tradition, d’Italie où elle aurait fui les guerres entre les guelfes et les gibelins. Il semble cependant que l’hypothèse d’une famille locale soit plus crédible. L’étude des patronymes locaux et de la religiosité médiévale nous montre que Suffren est le nom de deux saints provençaux très populaires, l’un à Marseille, fêté le 13 décembre, et l’autre à Carpentras, où il est fêté le 27 novembre[9]. Suffren est un prénom relativement répandu au XIVe – XVe siècle, avant de devenir, selon un processus assez classique le patronyme de plusieurs familles provençales[10]. Le subterfuge qui consiste à se donner une lointaine descendance italienne n'est d'ailleurs pas propre aux Suffren, puisqu'on le trouve chez nombre de familles provençales aspirantes à la noblesse. Toutes se disent venues de Gênes ou de Florence lors des guerres civiles italiennes, et toutes déclarent avoir « perdu leurs archives » (et pour cause) au cours des « malheurs des temps », ou encore « lors des troubles de la Ligue. »[11] Il s'agit bien sûr de vanités destinées à se glisser dans la noblesse, en attendant que le roi de France accorde d'authentiques lettres d'anoblissement.
La Provence compte aussi une forte communauté juive qui a traversé tout le moyen Âge, mais dont une petite partie s’est convertie au christianisme, condition d’ailleurs souvent nécessaire pour les familles hébraïques aisées désirant accéder à de hautes responsabilités. C’est ainsi que toute une partie de la noblesse de robe provençale est d’origine juive, comme semble-t-il la famille Suffren. Lors de leur conversion au christianisme, ces familles adoptaient souvent comme patronyme le nom du saint choisi pour le baptême de leur premier converti, ou bien encore le nom du saint patron de l’église dans laquelle le baptême avait lieu. La cathédrale de Carpentras, dédiée à saint Suffren a sans doute joué ce rôle dans une ville où la communauté juive a toujours été importante[11].
Quoi qu’il en soit, la filiation la plus ancienne, connue et prouvée du bailli remonte à Hugon de Suffren, qui occupe à l’Hôtel de ville de Salon-de-Provence la charge de trésorier en 1528 et 1529[12]. Son fils, Jean, est deuxième consul de Salon en 1539, capitaine en 1542 et obtient en 1557 des lettres patentes d’anoblissement pour les bons services qu’il a rendu en temps de guerre « par terre et par mer et autrement »[13]. C’est donc le premier noble de la lignée. Ses successeurs abandonnent pendant quelques générations la carrière militaire pour la vocation juridique ou religieuse. Antoine, son fils, devient conseiller au parlement de Provence, et ferme partisan d’Henri IV pendant les guerres de religion. Son demi-frère, Jean, entré en religion est un jésuite célèbre pour ses talents de prédicateur et qui devient confesseur de Marie de Médicis (puis de Louis XIII pour une brève période). La troisième génération noble compte deux frères qui vont faire souche : Palamède (1576–1623), qui aura une nombreuse descendance (elle s’éteindra en 1974), et Jean-Baptiste de Suffren (1582–1647), le cadet de Palamède, fondateur de la branche dont sera issue le bailli.
Jean-Baptiste de Suffren poursuit la carrière juridique familiale en devenant docteur en droit, juge de la ville de Salon et avocat à la cour. L’ascension sociale se poursuit aussi : les Suffren obtiennent le droit de rendre la basse justice dans leurs domaines[14]. Louis (?–1695), le fils de Jean-Baptiste, est premier consul de Salon en 1648 puis conseiller au Parlement de Provence. Son fils, Joseph (1651–1737), le grand-père du bailli, succède à son père dans sa charge de conseiller au parlement, dont il devient le doyen. Joseph élève encore sa famille en ayant recours — stratégie là aussi très classique — au mariage, en épousant Geneviève de Castellane, issue de la vieille noblesse immémoriale et chevaleresque. La mariée apporte en dot les seigneuries de La Môle et de Saint-Tropez. Les Suffren renouent donc avec l’épée et vont pouvoir faire entrer leurs garçons dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, privilège hautement nobiliaire en Provence (nous y reviendrons plus loin).
Paul de Suffren (1679–1756), fils ainé de Joseph et père du bailli, est maire-consul de Salon en 1713 et premier consul d’Aix en 1725. Il exerce aussi à Nice la fonction de procureur général au sénat, la principale cour de justice du comté. Comme son père, il contracte un habile mariage, célébré à Marseille en 1711. La mariée, Hiéronyme de Bruny complète la noblesse des Suffren en y apportant la fortune. Jean-Baptiste de Bruny (1665–1723), père de la mariée, grand-père maternel du bailli, passe pour l’homme le plus riche de Marseille. C’est un touche à tout qui a fait fortune dans le commerce maritime en étant à la fois importateur et exportateur, armateur fréteur, assureur maritime et banquier[15]. Déjà anobli par l’achat de l’une des 300 très coûteuses charges de secrétaire du roi, il a fait en 1715 l’acquisition de la seigneurie de Saint-Cannat, puis en 1719 de la baronnie de la Tour-d’Aigues, et enfin de la terre et du château de Lourmarin. Lorsqu’il meut en 1723, le grand-père maternel du bailli laisse une fortune estimée à 2 243 000 livres. Hiéronyme hérite de la terre de Saint-Cannat et d’une somme de 186 000 livres. Fort de cette fortune, Paul de Suffren fait élever en marquisat la propriété de sa femme, lettres d’érection signées en 1725 par Louis XV à Fontainebleau[16]. Le titre de marquis de Saint-Cannat ne sera cependant guère porté par la famille, ses détenteurs lui préférant celui de marquis de Saint-Tropez qui devait sans doute mieux sonner aux oreilles des contemporains.
Une enfance sur laquelle on sait peu de choses
 C’est sur les barques des pêcheurs de Saint-Tropez que le jeune Pierre-André est initié à la navigation. (Dessin de N. Ozanne)
C’est sur les barques des pêcheurs de Saint-Tropez que le jeune Pierre-André est initié à la navigation. (Dessin de N. Ozanne)
Sur l’enfance de Pierre-André, passée pour l’essentiel à Saint-Cannat, mais sans doute aussi dans les autres résidences familiales, au château de Richebois (à 4 km de Salon) et à Aix-en-Provence (dans l’Hôtel particulier, cours Mirabeau), on dispose de peu d’éléments. On ne sait rien des relations entre les parents de Pierre-André et leurs très nombreux enfants, sachant que l’usage, dans la noblesse, veut que les nouveau-nés soient confiés à une nourrice qui les élève parfois pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, les parents ont d’autres enfants et s’occupent des aînés lorsqu’ils reviennent sous le toit familial. Suffren se montre très attaché à sa nourrice qu’il appelle Babeou[17] et à qui il rend une ultime visite en 1784, au sommet de sa gloire, à son retour des Indes. Les naissances s’étalent sur une vingtaine d’années. Pierre-André, le douzième à venir au monde sur les quatorze enfants de la fratrie, n’est pas élevé avec ses ainés qu’il ne connaîtra guère, à commencer par son premier frère, destiné par son père à faire une carrière dans l’armée de terre. Il a sans doute peu cohabité aussi avec Louis-Jérôme, de huit ans sont aîné, et qui quitte tôt la maison pour l’Église (il deviendra évêque de Sisteron)[18]. Sa sœur ainée, Marie-Geneviève, née en 1713, épouse le baron de Vitrolles alors qu’il n’a que quatre ans. C’est avec Élisabeth-Dorothée, de un an son aînée, et avec Paul-Julien, de un an son cadet, que Pierre-André passe l’essentiel de son enfance. Pierre-André semble avoir été très attaché à sa famille et montrera une réelle affection pour ses frères et sœurs, ainsi que plus tard pour ses neveux (dont deux serviront sous ses ordres) et nièces.
Les deux frères sont associés très tôt semble-t-il par leurs parents pour partager l’engagement dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il s’agit là d’une pure stratégie familiale. Les aînés étant « casés », pour reprendre une expression actuelle, les derniers nés sont — comme souvent à cette époque dans la noblesse —&nbps;destinés à l’Église pour ne pas avoir à disperser l’héritage par le mariage. Dans le cas des deux frères, l’entrée dans l’Ordre permet de combiner l’épée et la religion, puisque les chevaliers doivent faire vœux de célibat et de pauvreté. Il n’y a donc au départ aucun choix personnel du jeune Suffren pour la carrière navale, même si la vocation et le talent de Pierre-André vont se révéler peu à peu. Il semble par ailleurs que le jeune homme ait connu la mer assez tôt, à bord des bateaux de pêche de Saint-Tropez où il a fait l’apprentissage des premières manœuvres et des jurons habituels de la profession qu’il va conserver toute sa vie[19].
On ne sait pas quelles études a suivi le jeune homme. Il est possible, comme il était d’usage dans les familles fortunées, qu’il ait eu un précepteur dans sa tendre enfance, avant de passer au collège. Seule sa présence au collège des Jésuites de Toulon est attestée en 1743, au moment de son entrée dans la marine[20]. On constatera par la suite que Suffren a des goûts littéraires, avec un fort intérêt pour l’histoire, une réelle sensibilité artistique, notamment pour la musique et pour les arts plastiques, ce qui semble prouver une éducation de qualité. Éducation qui n’empêche pas Pierre-André de parler avec un terrible accent provençal qu’il gardera toute sa vie[21]. Le jeune homme devait se présenter sans doute sous le nom de « Suffreing », ce qui correspond d'ailleurs à la continuité de prononciation dans la Marine nationale où l'on a toujours dit « Suffrin », et non « Suffrène » à la façon parisienne, comme on l'entend souvent. Pierre-André est inscrit à l’école des gardes de la marine le 30 octobre 1743. Il a 14 ans et 3 mois. Il va passer peu de temps sur les bancs de la compagnie des gardes. La guerre, qui reprend entre la France et l’Angleterre va le mettre rapidement à l’école du feu.
Les premiers combats pendant la guerre de Succession d’Autriche (1740–1748)
 Louis XV, contrairement à une légende tenace, ne se désintéresse pas des questions navales, mais il privilégie une politique de paix avec l’Angleterre.
Louis XV, contrairement à une légende tenace, ne se désintéresse pas des questions navales, mais il privilégie une politique de paix avec l’Angleterre.
Portrait de Louis XV en buste par Quentin de La Tour. Paris, Musée du LouvreLa rivalité navale et coloniale franco-anglaise, en sommeil depuis la mort de Louis XIV reprenait forme au tournant des années 1740. Il est vrai que l’empire colonial français, étendu du Canada aux Antilles (Saint-Domingue) en passant par la Louisiane, les comptoirs africains et l’essentiel de l’Inde du sud (le Dekkan) jouissait d’une grande prospérité qui exaspérait les Anglais[22]. Les marchands londoniens ne cessaient de se plaindre et les rapports entre les deux capitales se dégradaient, d’autant que l’Angleterre était en guerre avec l’Espagne depuis 1739[23], ce qui mettait Versailles dans l’embarras car les couronnes françaises et espagnoles étaient cousines (un petit-fils de Louis XIV, Philippe V d’Espagne régnait à Madrid depuis 1700). Une flotte espagnole trouvait refuge à Toulon, poursuivie par la Royal Navy. De plus en plus inquiets, le gouvernement de Louis XV décidait de déployer deux grandes escadres aux Antilles et reprenaient la tactique habituelle du soutien au prétendant Charles Édouard Stuart : aider ce dernier à reconquérir la couronne perdue par son aïeul en 1688. De plus en plus nerveuse, la Royal Navy canonnait régulièrement des vaisseaux français en faisant mine de croire qu'ils étaient espagnols. On préparait une armée et une flotte pour débarquer en Angleterre alors que la guerre n’était pas même déclarée[24].
Les enjeux de cette nouvelle guerre navale franco-anglaise sont considérables. Côté anglais on est déterminé à briser l’expansion maritime et coloniale de la France. La Royal Navy dont les effectifs sont très supérieurs[25] à ceux de la marine française doit rapidement surclasser les escadres françaises, assurer le blocus des ports militaires et commerciaux, et pour finir s’emparer des possessions coloniales françaises[26]. Côté français, contrairement à une légende tenace, Louis XV ne se désintéresse pas des affaires maritimes, mais on est conscient à Versailles que l’on a tout à perdre dans des grandes batailles navales d’escadres où les Anglais auraient toujours l’avantage numérique. Maurepas, avec l’accord de son souverain décide donc d’utiliser les vaisseaux à une tâche précise, la conquête d’une île ou d’un port, et la protection des convois[27]. Ce dernier point est très important. Il s’agit de protéger les nombreux navires de commerce français qui croisent entre les « isles » et les ports de l’Atlantique en organisant de grands convois escortés par des frégates ou des vaisseaux de premier rang. C’est dans ce contexte que le jeune Pierre-André va faire l’apprentissage de ses premiers combats navals, huit mois après avoir fait ses classes à Toulon puis Brest[28].
La bataille du cap Sicié, un baptême du feu à quinze ans
 La bataille du cap Sicié (22 février 1744), vue par l’illustrateur espagnol Diego De Mesa. Ce combat, appelé « bataille de Toulon » par les Anglais et les Espagnols, voit le premier engagement naval de Suffren. Il n’a pas encore 15 ans.
La bataille du cap Sicié (22 février 1744), vue par l’illustrateur espagnol Diego De Mesa. Ce combat, appelé « bataille de Toulon » par les Anglais et les Espagnols, voit le premier engagement naval de Suffren. Il n’a pas encore 15 ans.
L’escadre espagnole de Don Juan José Navarro, destinée à transporter à Gènes un corps expéditionnaire restait réfugiée depuis 1742 à Toulon. C’était une situation humiliante pour le roi d’Espagne, mais aussi pour la France, dont le grand port de guerre de Méditerranée subissait le blocus anglais depuis deux ans à partir des îles d’Hyères où la Navy s'était installée. Il n’était plus possible de reculer.
Le gouvernement français décide donc de fournir à son allié la protection d’une escadre pour forcer le blocus et lui permettre de regagner Barcelone. Suffren se retrouve embarqué sur le Solide, un vaisseau de 64 canons déjà ancien puisque lancé en 1722. Après trente années de paix il est difficile de réunir les équipages et de retrouver un minimum de discipline. Une forte pagaille règne dans le port, au dire même de l’intendant de marine, M. de Villeblanche. C’est le vénérable lieutenant général Court La Bruyère, 77 ans, qui se retrouve aux commandes des seize vaisseaux français alors qu’il n’a plus navigué depuis 1715[29]. L’historien ne peut que s’interroger sur un tel choix, mais il remarque que du côté de la Royal Navy ce n’est guère mieux. Même si le vice-amiral Thomas Matthew (en) est un peu plus jeune (68 ans), la Navy est aussi en crise. Enferrée depuis 1739 dans cette guerre contre l’Espagne qu’elle ne parvient pas à gagner, le moral et la discipline sont au plus bas[30]. Quant à la marine espagnole, elle manque cruellement de personnel. Madrid a bien tenté de faire venir 2 000 soldats d’Espagne par voie de terre pour renforcer son escadre, mais 1 000 d’entre eux ont déserté en cours de route.
Quoi qu’il en soit, après plusieurs exercices d’entrainement dans la rade, l’escadre combinée sort de Toulon, les Français occupant l’avant-garde et le centre (où se trouve intégré le Solide), les Espagnols en arrière-garde. Les Français, qui ne sont toujours pas en guerre avec l’Angleterre, ont pour consigne de ne pas tirer les premiers alors que Matthews doit prendre ou détruire les navires espagnols sous escorte française. C’est dans cette situation politico-militaire compliquée que les 28 navires franco-espagnols se retrouvent engagés par les 32 vaisseaux de l’escadre anglaise. Le combat se déroule selon la classique manœuvre de la ligne de file. Matthew, qui a pris l’avantage du vent, remonte la ligne alliée et cherche à concentrer son attaque sur l’arrière garde où se trouvent les Espagnols. Le centre n’est que partiellement engagé dans une canonnade assez lointaine. Le jeune Suffren y connaît son baptême du feu dans les échanges de tir entre le Solide et le Northumberland. Le combat se fixe sur l’affrontement des deux avant-garde, les vaisseaux français se montrant supérieurs en artillerie et en manœuvrabilité. La bataille tourne finalement à l’avantage des franco-espagnols lorsque l’amiral anglais est abandonné par une partie de ses capitaines qui lui désobéissent. Les Espagnols, moins manœuvrant ont perdu un petit navire, le Poder, mais ont pu contenir la Royal Navy qui a trois vaisseaux forts abimés et doit se retirer sur Gibraltar et Port-Mahon pour réparer[31].
Ce combat naval aujourd’hui oublié eut à l’époque un immense retentissement et fut clairement interprété comme une défaite anglaise[32] : deux amiraux et onze commandants anglais allaient passer en conseil de guerre, le blocus était levé et la flotte espagnole regagnait ses ports. Le ministre de la marine, Maurepas y voyait la victoire de sa conception des vaisseaux neufs qu’il avait favorisé pour faire face à la Royal Navy[33]. En Espagne l’évènement fût fêté comme une grande victoire, ce qui n’empêcha pas une violente polémique d’éclater, les Espagnols accusant les Français de leur avoir laissé supporter le plus gros du combat et d’avoir tardé à les secourir[34].
L’escadre française, après avoir escorté les vaisseaux rescapés de don Navarro rentre sans encombre à Toulon. Suffren débarque le 30 juin et passe le mois de juillet en instruction à terre. Ce sera la fin de sa formation théorique. Le 1er août 1744 il embarque à bord du Trident, un 64 canons. Son instruction dans la compagnie des gardes de Toulon a duré en tout moins de quatre mois. Suffren va donc bénéficier d’une formation « à l’anglaise », c’est-à-dire pratique, en mer[35]. Le 15 mars 1744, Louis XV avait enfin déclaré la guerre à l’Angleterre. Le jeune Pierre-André se retrouvait à bonne école pour progresser rapidement dans le conflit franco-anglais qui s’annonçait long et qui n’était pas joué d’avance.
Les premières responsabilités et l’expérience de l’échec (1745)
 Jeunes officiers dans leur cabine. Suffren a du mal à se faire obéir lorsqu'il exerce à 16 ans ses premières responsabilités, sur la corvette la Palme.
Jeunes officiers dans leur cabine. Suffren a du mal à se faire obéir lorsqu'il exerce à 16 ans ses premières responsabilités, sur la corvette la Palme.
Suffren découvre la navigation hors de Méditerranée lorsque le Trident passe aux Antilles en l’été 1744. Le navire ne participe à aucun engagement naval. Au retour en 1745, Pierre-André embarque à Brest sur la Palme, une corvette de douze canons. C’est un univers nouveau que découvre le jeune provençal de 16 ans. Il a jusque-là servi sur deux grandes unités avec des états-majors nombreux où il ne figurait qu’au bout du dernier rang. Il n’a pu occuper que des fonctions en sous-ordre, étroitement surveillé par un officier plus ancien. Tout change sur la Palme, petit navire qui n’a que quelques dizaines d’hommes d’équipage, commandé par un simple enseigne de vaisseau, M. de Breugnon. En l’absence de tout autre officier embarqué, Pierre-André se retrouve investi de lourdes responsabilités. Il doit pour la première fois assurer le quart en chef, exercer les fonctions du second, veiller à la bonne tenue matérielle du bâtiment comme au comportement de l’équipage. Rude tâche sur un navire où presque tous les matelots ne parlent qu’en breton, langue que ne comprend pas Suffren.
La mission de la Palme consiste en patrouilles le long des côtes de la Manche pour protéger les pêcheurs et les caboteurs contre les corsaires britanniques. Le 29 décembre 1745, le navire se trouve au large de Calais. La corvette engage le combat contre deux corsaires anglais, mais celui-ci tourne au fiasco. Une large partie de l’équipage refuse d’obéir lorsque l’ordre d’abordage est donné. Les deux corsaires anglais réussissent à s’enfuir en s’emparant au passage d’un petit navire corsaire français.
L’enquête qui suit ne permet pas de désigner les hommes d’équipage qui ont failli et coûte au final son commandement à M. de Breugnon, alors que Suffren doit reconnaitre qu’il n’a pas réussi à se faire obéir[36]. « Le jeune enseigne de vaisseau commandant la corvette et son beaucoup trop jeune second ont été incapable de maîtriser une situation difficile et n’ont pu imposer leur volonté à un équipage qu’ils dirigeaient pourtant depuis trois mois et demi » juge Rémi Monaque[37]. Il ne suffit pas seulement d’être courageux, commander et un art qui s’apprend. Suffren va retenir cette rude leçon et va désormais chercher à établir des relations de confiance avec les équipages. Esprit pratique, Pierre-André va aussi apprendre le breton, comme il apprendra plus tard l’anglais et l’italien.
La dramatique expédition de Louisbourg (1746)
 L’Acadie en 1754. En 1745 les Anglais s’emparent de Louisbourg qui défend l’entrée de la Nouvelle France. Suffren participe en 1746 à la dramatique tentative de reprise de la place.
L’Acadie en 1754. En 1745 les Anglais s’emparent de Louisbourg qui défend l’entrée de la Nouvelle France. Suffren participe en 1746 à la dramatique tentative de reprise de la place.
En 1746, Suffren embarque de nouveau sur le Trident (64). Le navire est requis pour faire partie de l’expédition confiée au duc d’Anville en vue de la reprise de Louisbourg. L’année précédente, la grande forteresse chargée de défendre l’entrée du Canada sur l’île du Cap-Breton avait été prise presque sans combat. La place, mal défendue par 1 500 hommes en révolte, s’était laissée surprendre par un débarquement improvisé de 4 000 hommes monté depuis la Nouvelle-Angleterre. C’était une lourde défaite qui ouvrait les portes du Saint-Laurent aux Anglais[38].
Le ministre de la Marine, Maurepas décide aussitôt d’envoyer une puissante escadre reprendre Louisbourg, soit 55 (ou 60) bâtiments portant 3 500 hommes de troupe escortés par 10 vaisseaux, 3 frégates et 3 navires à bombarde, commandés par le duc d’Anville. Le plan, très ambitieux, prévoit aussi de reprendre Port-Royal, l’ancienne capitale de l'Acadie devenue Annapolis, et rien moins que de détruire en représailles la ville de Boston d'où était partie l'attaque l'année précédente.
Mais Brest, qui n’a pas retrouvé le rythme du temps de guerre, a beaucoup de mal à armer cette grande escadre et l'opération va de retard en déconvenues. Le convoi se rassemble lentement à l'île d'Aix au large de Rochefort (à partir du 12 mai) où se déclare une épidémie de typhoïde. Puis il part très tard dans la saison (22 juin) et se traine dans une interminable traversée de l’Atlantique. L’expédition n’arrive que le 12 septembre 1746, retard largement imputable aux navires marchands, puis elle est bousculée par une terrible tempête qui force plusieurs bâtiments, très abimés, à rentrer sur la France. L’expédition tourne finalement à la catastrophe sanitaire. Le scorbut, puis une toxicose liée à la mauvaise qualité des vivres se déclare et décime les équipages : 800 soldats et 1 500 matelots décèdent en quelques jours. D’Anville, emporté par une crise d’apoplexie s’écroule sur le gaillard d’arrière de son navire amiral (le Northumberland). Il est remplacé par M. d’Estourmelles qui tombe à son tour malade, puis tente de se suicider. La Jonquière, qui reprend le commandement, fait une ultime tentative avec quatre vaisseaux et ce qui reste du convoi contre la ville d'Annapolis. Mais la tempête s’en mêle à nouveau alors que l’épidémie poursuit ses ravages. La Jonquière décide de rentrer. Les vaisseaux, réduits à l’état d’hôpitaux flottants reviennent en ordre dispersé, l’un d’entre eux étant capturé. L’escadre a été vaincue par la maladie sans même avoir livré bataille. Louisbourg restera entre les mains des Anglais jusqu’à la fin de la guerre[38].
Les qualités de Suffren commencent à être remarquées : le capitaine du Solide rend un rapport élogieux sur la conduite du jeune homme pendant l’expédition, mais l’essentiel est ailleurs. Pierre-André, qui a 17 ans, a sans doute été très fortement marqué par cette expérience : durant toute sa carrière il accordera un soin particulier au ravitaillement de ses vaisseaux et à la santé de ses hommes[39].
La guerre des convois et ses enjeux
Malgré le lourd échec de Louisbourg, l’étude attentive de cette nouvelle guerre franco-anglaise montre que les choix stratégiques du ministre Maurepas se révèlent judicieux, en tout cas pour les trois premières années de la guerre. De 1744 à 1747, le commerce naval français fonctionne sous forme de gigantesques convois – dont certains font plusieurs centaines de navires – escortés par des petites ou moyennes escadres dans l’Atlantique et dans une moindre mesure l’océan Indien. Après des débuts difficiles le système fonctionne de façon très satisfaisante. « Contrairement à ce qui a souvent été écrit, les meilleurs officiers de la Marine sont affectés à ces escortes dont ils se sont parfaitement acquittés, et les chambres de commerce des ports leurs adressent des félicitations » note Patrick Villiers[40]. Ces missions obscures, oubliées pendant longtemps des historiens, assurent tant bien que mal la liberté des mers pour les Français.
Constat que fait aussi la Royal Navy en 1747 et qui la pousse à changer de stratégie. Les Anglais se rendent compte d’abord qu’ils ont commis une lourde erreur en s’engageant dans la guerre continentale contre la France. Outre que l’armée anglaise est régulièrement écrasée aux Pays-Bas autrichiens[41], cet engagement nécessite de mobiliser une importante escadre de la Navy dans la Manche alors que la Marine française, après avoir renoncé à ses projets de débarquement, a pratiquement déserté ces eaux... Escadre qui manque ailleurs et profite à la France, d’autant que les forces anglaises brillent par la médiocrité de leurs chefs. En dépit de sa supériorité en nombre de navires, la Navy est incapable d’obtenir une réelle maîtrise de la mer. Cruelle révélation qui suscite un vigoureux changement de stratégie avec l’arrivée de nouveaux amiraux. Ils décident de serrer la côte française au plus près avec une puissante escadre (le Western Squadron) chargée de guetter l’arrivée ou le départ des convois (souvent prévenus aussi, par un service d’espionnage renforcé)[42]. Cette politique de blocus provoque la reprise des grands affrontements navals sur la façade atlantique. Une première bataille oppose les deux marines au cap Ortegal le 14 mai 1747. Un terrible combat où l’escorte française se sacrifie pour sauver, en partie, le convoi à destination du Canada[43].
Articles principaux : Guerre de Succession d'Autriche et Histoire de la marine française.La bataille du cap Finisterre, sacrifice des escorteurs
Suffren n’est pas présent au cap Ortegal, mais se retrouve engagé dans la bataille du cap Finisterre[44], le 25 octobre 1747. Bien renseignés, les Anglais de Hawke guettent le départ du grand convoi français pour les Antilles : 252 navires de commerce, accompagnés d’une mince escorte de huit vaisseaux sous les ordres du marquis de Létanduère[45]. Hawke dispose de quatorze vaisseaux pour se saisir de cette proie de choix apparemment mal défendue. La prise de ce convoi porterait un coup terrible au commerce colonial français, avec la faillite de dizaine d’armateurs et négociants. Côté anglais, la priorité est à la saisie du convoi, quitte à laisser de côté l’escorte (qui devrait normalement s’enfuir vu sa grande infériorité...). Côté français, les ordres sont tout aussi clairs : le convoi doit passer coûte que coûte, au besoin en sacrifiant l’escorte. Létanduère engage donc le combat à pratiquement un contre deux. Pierre-André est embarqué sur le Monarque, un vaisseau de 74 canons tout neuf et qui vient juste de sortir des chantiers de Brest. Il est commandé par le capitaine La Bédoyère, sous lequel Pierre-André a déjà servi sur le Trident[46].
La bataille commence vers 11 h 30 et prend un tour rapidement acharné. Les vaisseaux anglais, plus nombreux, réussissent à envelopper l’escorte française qui doit combattre sur les deux bords. Le Monarque, accablé par le feu de quatre puis cinq vaisseaux anglais, se retrouve presque démâté, donnant fortement de la bande avec une quarantaine de coups reçus au niveau de la ligne de flottaison. Son capitaine est tué ainsi que plus de 130 membres d’équipage (sur 233 hommes hors de combat). Le second du Monarque, M. de Saint-André doit se résoudre à baisser pavillon, après sept heures de lutte, bientôt suivi par cinq autres vaisseaux, qui succombent les uns après les autres (après avoir démâté ou épuisé leurs munitions). Pierre-André, dont le nom est cité dans le rapport de Saint-André se retrouve donc prisonnier[47]... et spectateur de la suite de la bataille, qui redouble d’intensité sur la fin de l’après-midi. Le Tonnant (80 canons), partiellement démâté, combat encore à un contre cinq sous voiles basses, de même que l’Intrépide (74) qui réussit à se tirer des griffes des vaisseaux anglais. Son capitaine, Vaudreuil[48] traverse l’escadre anglaise et vient se porter au secours de son chef sous les yeux médusés des équipages qui se sont rendus.
La nuit tombe. Les deux vaisseaux français réussissent à se dégager. Les Anglais, encombrés par leurs six prises et dont cinq vaisseaux sont à peu près dans le même état que les vaincus sont épuisés. Ils tentent cependant de donner la poursuite avec 3 vaisseaux. En vain. La nuit couvre les fuyards. À l’aube, l'Intrépide réussit à prendre en remorque le Tonnant, et rentre à Brest le 9 novembre 1747. Le convoi était passé, l’escorte avait donc rempli sa mission[49]. Quant à Suffren, il gardera toute sa vie un souvenir mémorable de cette bataille, où l’habileté manœuvrière l’a disputé au courage. C’est aussi pour lui une épreuve décisive dans laquelle se sont révélés son courage et sa capacité à combattre dans les circonstances les plus terribles. Beaucoup plus tard, lors des campagnes en Inde, il se plaira à raconter dans le plus grand détail ce fait d’armes, qu’il considérait comme un des plus glorieux qui se fussent livrés sur mer[50].
Dans l’immédiat la guerre est terminée pour le jeune homme qui se retrouve prisonnier en Angleterre avec les autres équipages. Hawke exhibe en triomphe sur la Tamise les six vaisseaux capturés. Moment douloureux pour Suffren qui en gardera toute sa vie un virulent sentiment anti-anglais. Le jeune homme ne se laisse cependant pas aveugler par un quelconque esprit de haine puisqu’il en profite pour apprendre les premiers rudiments de l’anglais, langue qu’il maîtrisera plus tard convenablement[51]. Suffren est relâché en 1748, avec la signature du traité de paix d’Aix-la-Chapelle. Le jeune homme qui a maintenant 19 ans et qui vient d’obtenir son grade d’enseigne de vaisseau sollicite un congé pour rejoindre Malte afin de faire ses classes dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Article principal : Bataille du cap Finisterre (octobre 1747).D’une guerre à l'autre (1748–1755)
Les premiers pas à Malte (1748–1751)
 Le port de La Valette à la fin du XVIIIe siècle. Suffren y débarque en 1748 pour y faire son apprentissage de chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Le port de La Valette à la fin du XVIIIe siècle. Suffren y débarque en 1748 pour y faire son apprentissage de chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
La décision de faire entrer dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem Pierre-André et son frère Paul-Julien, de un an son cadet, est prise très tôt par leur père, alors que les deux enfants ont respectivement 8 et 7 ans. Dès le mois de septembre 1737, le pape Clément XII publie les brefs qui autorisent les deux garçons à entrer dans l’Ordre, avec grâce de minorité et dispense de la preuve de noblesse des quatre quartiers maternels[52]. On peut s’étonner d’une démarche qui décide très tôt du sort des deux frères. Elle est cependant conforme aux traditions nobiliaires de l’époque, ou le placement des enfants répond à une stratégie très précise qu’on peut résumer en deux mots : renforcer la puissance de la famille par de bons mariages, mais aussi ne pas disperser l’héritage par trop de mariages. Les ainés profitent donc du premier point de la stratégie familiale en convolant avec le conjoint choisi par les parents, les derniers nés sont donc plutôt destinés à l’Église, c'est-à-dire le couvent pour les filles et la carrière ecclésiastique pour les garçons. Trois des frères Suffren au total feront une carrière religieuse, si l’on tient compte du frère ainé qui deviendra évêque, alors que les deux benjamins partiront pour Malte en faisant vœux de chasteté et de pauvreté au service de l’Ordre hospitalier de Saint-Jean.
Les formalités d’entrée dans l’institution sont longues et couteuses. Ordre religieux au recrutement que l’on dirait aujourd’hui élitiste, les prétendants doivent se soumettre à une enquête pointilleuse pour apporter toutes les preuves nécessaires « sur la noblesse, la légitimité et autres qualités requises. »[53] Le prieuré de Saint-Gilles désigne un chevalier et un commandeur de l’Ordre pour éplucher tous les documents familiaux (extraits de baptême, de mariage[54], bulles et bref pontificaux, preuves de noblesse, arbres généalogiques...), vérifier que le père des deux prétendants a bien acquitté le droit de passage de 6 350 livres (par enfant) avec une pension mensuelle de 300 livres destinée à faire vivre le novice jusqu’à ce qu’il devienne titulaire d’une commanderie[55], interroger des témoins de moralité (le curé de Saint-Cannat, le doyen du parlement d’Aix) en posant pour finir les questions rituelles : dans toutes « tiges et races » de la famille Suffren y a-t-il jamais eu « aucun juif, marrane, mahométan ou infidèle » ? Dernière question qui fait sourire l’historien quant on sait que bon nombre de familles de la noblesse de robe provençale ont des origines juives, ce qui ne les empêchent pas de fournir depuis près de deux siècles de nombreux chevaliers à l’Ordre[56]. Quoi qu’il en soit, les deux enquêteurs, satisfaits de leurs démarches et investigations procèdent le 22 mars à la clôture de l’enquête : « Donnant notre avis et sentiment, disons que les dites preuves sont bonnes et valables et le dit prétendant devoir être reçu au rang de chevalier de justice de notre ordre. »[57]
C’est semble-t-il au mois de septembre 1748 que Pierre-André débarque pour la première fois à Malte, en compagnie de son frère. Il a 19 ans. Contrairement à son frère qui va faire toute sa carrière dans l’Ordre, Pierre-André ne sera présent à Malte que dans les intervalles laissés libres par sa carrière dans la Marine royale. La légende veut, que dès son arrivée, Pierre-André se soit battu en duel avec un chevalier breton qui l’aurait traité de "marchand d’olives". L’anecdote semble crédible car les duels étaient fréquents entre tous ces jeunes gens au sang chaud, vivant dans un espace et dans un milieu confiné[58]. On ne connait pas les détails de l’affaire, mais Suffren parvient selon Rémi Monaque à préserver sa vie et celle de son insulteur, son honneur et sa liberté[59].
Institution pluriséculaire en Méditerranée depuis la lointaine époque des croisades, l’Ordre a pour mission de lutter contre les Turcs[60] et les corsaires d’Afrique du Nord, en escortant les convois commerciaux, en menant des opérations de représailles contre les villes « barbaresques », ou en rachetant des captifs chrétiens. L’Ordre s'appuie sur les imposantes fortifications du port de La Valette et dispose pour ses missions des traditionnelles galères, auxquelles s'ajoutent depuis 1701 des frégates et d’autres petits voiliers. Curieusement, il n’y a pas d’école navale à Malte, les jeunes chevaliers faisant leurs classes sur le tas, c'est-à-dire au fil des embarquements. L’Ordre se distingue aussi par sa vocation hospitalière. Il y a à La Valette un grand hôpital qui passe à l’époque pour être à la pointe de l’art médical, et tous les chevaliers doivent consacrer une journée par semaine à la visite des malades et à leurs soins[60]. Suffren fera montre dans toute sa carrière d’un souci constant de la santé de ses équipages et d’une attention vigilante aux soins apportés aux malades et blessés. C’est peut-être une conséquence de son éducation maltaise.
Les chevaliers sont aussi soumis à une formation religieuse intense, destinée à faire d’eux d’ardents moines soldats au service de la Catholicité en Méditerranée. « Il [le chevalier de Malte] se dévoue également aux armes et à l’hospitalité, à la défense de la foi et au service des pauvres. Il est tout ensemble soldat, mais soldat de Jésus-Christ, hospitalier et religieux. (...) Le chevalier doit conserver l’épée au côté en toutes circonstances et même pendant la communion car il a fait vœu de combattre et de mourir pour le service du Seigneur et son épée est bénie » explique à ses frères le chevalier de Cany en 1689[61]. Un idéal de vie marqué du sceau de la Réforme Catholique, ardemment vécu au XVIIe siècle, mais dont on est maintenant loin vers 1750. Il n’y a plus guère de vocation réelle chez la plupart des compagnons de Pierre-André. Ils sont à Malte pour faire une carrière honorable, exercer le noble métier des armes, obtenir une commanderie et vivre agréablement sans trop de risques. Les mœurs se relâchent, à commencer par celles des Grands Maîtres, Pinto, Ximenes et Rohan qui oublient largement leurs vœux de pauvreté et de chasteté. Doublet, secrétaire de Rohan décrit dans ses Mémoires le mode de vie des jeunes chevaliers : « Mais, au milieu de cette étude qui, sous tous les rapports leur aurait été si salutaire, à quoi s’occupait cette jeunesse, soit à bord pendant leurs caravanes, soit à terre dans les intervalles des trois diverses époques d’embarquement ? A baguenauder sur les places ou dans les cafés, ou jouer au billard ou aux cartes, à chasser, ou à altérer leurs mœurs ou leur santé avec des femmes perdues, et souvent l’un et l’autre, heureux encore quand ils ne s’avilissaient pas, ou par des dettes énormes, ou par de crapuleuses liaisons de débauche, dont plusieurs n’ont été que trop souvent victimes à la fleur de l’âge. »[62] En 1770, un voyageur anglais remarque, au moment du départ de l’escadre maltaise, qu’une foule de chevaliers font des signaux à leurs maîtresses qui pleurent bruyamment sur les bastions du fort... Des incidents sont même signalés avec le clergé de l’île, dont la rigueur religieuse ne s’est, elle, pas émoussée[63].
Hormis l’affaire du duel, on ne sait rien de la vie de Suffren pendant ce premier séjour à Malte, ni l’enseignement qu’il a pu en tirer alors qu’il disposait déjà d’une solide expérience de la navigation et du combat dans la Marine royale. Au mois de mars 1751 Pierre-André est de retour sur le sol français pour ré-embarquer sur les navires du roi.
Article principal : Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.On ne sait pas grand chose non plus de la vie de Pierre-André à propos des quelques années qui suivent son retour de Malte. Il semble que le jeune enseigne de vaisseau ait passé toute l'année 1751 à terre, à Marseille et Toulon. En 1752, il embarque sur la galère royale la Hardie, l'une des dernières unités en service dans la marine, puisque le corps des galères a été supprimé en 1748. En 1753, Suffren ne navigue pas non plus, et passe encore une fois l'année à terre, entre Marseille et Toulon, sans doute immobilisé par le transfert des activités militaires de la cité phocéenne vers Toulon. En 1754, Suffren embarque à Toulon sur la frégate la Rose (30 canons), fraichement entrée en service, et fait à son bord une grosse croisière en Méditerranée, du printemps à l'automne. On retrouve Pierre-André en 1755 sur le Dauphin Royal (70 canons).
Pendant ces quelques années, la France et l’Angleterre reprenaient leur souffle et recommençaient à accumuler les sujets de tension. La rivalité amorcée depuis les années 1680 entre les deux pays paraissait inépuisable, d’autant que la paix d’Aix-la-Chapelle n’avait réglé aucun problème. Sur ce traité planait même comme un parfum de victoire française puisque l’empire colonial de Louis XV était resté intact et que la marine française avait même réussit l’exploit de maintenir ouvertes les routes maritimes malgré les lourdes pertes des deux dernières années de guerre (voir plus haut)[64].
À Londres, on paraît dans un premier temps satisfait d’être sorti de cette guerre interminable et ruineuse[65], mais la détente ne dure guère. La rivalité reprend de plus belle à peine le traité signé. En Amérique du nord, l'immense domaine colonial français, étendu du Saint-Laurent au delta du Mississippi en englobant les Grands Lacs, donne aux Anglais l'impression que leurs colonies de la côte atlantique sont encerclées. Au Canada, où sont regroupés l'essentiel des 60 000 colons français, on livre une guérilla quasi permanente aux 2 millions de colons américains qui veulent encore s'étendre vers l'Ouest, et qui multiplient les pressions pour que Londres les soutienne avec des renforts. En Inde, Dupleix qui a pris la tête de la Compagnie des Indes françaises, reprend sa marche pour tenter de concrétiser son projet de créer un royaume français (dans le Dekkan et le Carnatic) dont il serait le vice-roi... À cela s’ajoute une féroce rivalité commerciale où les Français semblent triompher. Le commerce colonial connaît un boom spectaculaire après le retour de la paix, puisque les exportations du royaume auraient doublé entre 1740 et 1755[66]. La paix semble donc profiter plus à la France qu’à l’Angleterre alors que l'opinion publique s'agite et s'affirme de plus en plus anti-française, le cabinet britannique d’abord prudent, évolue peu à peu vers la guerre, sous la pression d'hommes comme William Pitt, porte-parole du lobby colonial à la Chambre des communes.
Côté français, contrairement à une légende tenace on n'est pas resté inactif, même si Louis XV, prince d’éducation et de tempérament pacifique, fait preuve de beaucoup de prudence (au point d’avoir été mal compris et taxé de faiblesse ou de désintérêt pour les affaires navales et coloniales). En 1749, Maurepas tire un bilan lucide de la guerre, constatant que l’innovation technique ne peut à elle seule combler le déséquilibre numérique devenu trop important avec la Navy. Il propose au roi de porter la flotte à 60 vaisseaux[67]. Un important effort de construction est consenti pour remplacer les vaisseaux qui ont été perdus et on met au rebut ceux devenus obsolètes. Il se fait à crédits presque constants, ce qui fait que le nombre de vaisseaux n’augmente que très lentement d’autant et que l'on rogne sur l'entraînement pour faire des économies. Il faut noter, à la décharge du roi, que la guerre précédente a été fort coûteuse pour la France, et que Louis XV est soumis en permanence à un puissant « lobby continental » qui estime que l’armée de terre et la diplomatie en Europe sont plus importants que l’aventure coloniale[68]. Mais la menace de guerre se précisant, les crédits progressent, ce qui permet de pousser les mises en chantier. En 1753, les effectifs flirtent avec les 60 vaisseaux de ligne, ce qui correspond à l'objectif affiché en 1749. On dispose donc d'à peu près 82 navires au total en y ajoutant les 22 frégates[69]. L’étude attentive du comportement du roi montre cependant qu’il n’a qu’une confiance incertaine dans sa marine et qu’il cherche à tout prix à préserver la paix.
Côté anglais, la Royal Navy avait terminé la guerre sur un sentiment de semi-échec. La qualité des vaisseaux français capturés lors des victoire de 1747 (voir plus haut) avait laissé pantois les amiraux anglais : « Je puis seulement vous dire que l’Invincible surpasse toute la flotte anglaise. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est une honte pour les Anglais qui font toujours grand cas de leur marine » déclarait Augustus Keppel après inspection du vaisseau français. De ce malaise étaient sorties des réformes profondes. La Royal Navy s'était mise à l'école française en copiant les vaisseaux capturés et en développant une véritable infanterie de marine embarquée[70]. L'amirauté anglaise innovait aussi en développant outre-mer des bases avec des arsenaux et des hôpitaux bien équipés, ce dont ne disposait pas sa consœur française. Elle mettait même en place un système de ravitaillement en mer pour lutter contre le scorbut. Outre le rajeunissement et l'épuration du corps des officiers, l'amirauté s'assurait un meilleur recrutement des équipages par des rémunérations supérieures et des primes. La discipline, déjà sévère, était encore renforcée par un code pénal très dur qui privait les marins du bénéfice du jury[71]. Un comble, au pays de l'Habeas Corpus, mais qui montrait la détermination du Parlement, comme des amiraux, à reprendre la main contre les Français. En 1754, la Royal Navy est prête a engager les hostilités. Au printemps 1755, le Parlement anglais vote les crédits de guerre[72]. Louis XV, inquiet, augmente aussi les sommes dévolues à sa Marine[73]. Mais il est bien tard, d'autant que Londres décide d'attaquer sans déclaration de guerre.
Suffren dans les épreuves de la guerre de Sept Ans (1755–1763)
 Capture des flûtes le Lys et l’Alcide devant Terre-Neuve. En 1755, l'Angleterre attaque par ruse l'expédition de Dubois de La Motte qui porte des renforts au Canada. Suffren, sur le Dauphin Royal, échappe de peu à la capture.
Capture des flûtes le Lys et l’Alcide devant Terre-Neuve. En 1755, l'Angleterre attaque par ruse l'expédition de Dubois de La Motte qui porte des renforts au Canada. Suffren, sur le Dauphin Royal, échappe de peu à la capture.
À Londres, on multiplie les déclarations de bonnes intentions pour endormir les Français, mais on prépare une grande invasion du Canada français. À Versailles, où l’on est au courant de ce projet, on décide de maintenir le dialogue tout en prenant ses précautions : une flotte de 20 bâtiments commandés par Dubois de La Motte doit acheminer 3 000 soldats au Canada[74]. Le Dauphin Royal, sur lequel embarque Suffren fait partie de l’expédition. C’est une flotte vulnérable car 17 vaisseaux sont armés en flûte : on a déposé presque toute l’artillerie pour pouvoir embarquer les troupes. Chaque vaisseau n’a gardé qu’une vingtaine de canons. La guerre, il est vrai n’est pas déclarée. Le Dauphin Royal, qui fait partie des escorteurs, a cependant conservé ses 70 canons[75].
Le 3 mai 1755, l’escadre quitte Brest. À Londres, l’armement de cette flotte suscite un vif émoi et on décide de l'intercepter. Boscawen, parfaitement renseigné, guette l’escadre française devant Terre-Neuve. Le brouillard s’en mêle, et le 10 juin l’Alcyde, le Lys et le Dauphin Royal se retrouvent séparés du reste de l’escadre, face à Boscawen qui fait mine de s’approcher sans intentions belliqueuses. « Sommes-nous en paix ? » demande par porte-voix le commandant de l’Alcide. « La paix, la paix » répond l’Anglais qui ordonne aussitôt de tirer[76]. Cette fourberie permet aux Anglais de se saisir de l’Alcyde et du Lys, mais le Dauphin Royal (70), navire bon marcheur, réussit à s’échapper et à se réfugier dans le port de Louisbourg. Suffren échappe à la captivité, le Dauphin Royal réussissant ensuite à rentrer à Brest.
Cette interception était cependant un quasi-échec car 17 vaisseaux (sur 20) étaient arrivés au Canada. Bien mieux, l’attaque terrestre sur le Canada était un fiasco complet : l'armée anglaise était lourdement défaite et son chef tué à la bataille de la Monongahela (9 juillet). À Versailles c’est cependant le choc, doublé d’un effondrement boursier à Paris[77]. Louis XV rappelle ses ambassadeurs (juillet 1755), mais maintient le contact en espérant qu’à la cession d’automne le Parlement anglais se montre plus accommodant. En réalité, les jeux sont faits et le gouvernement anglais engage la guerre à outrance.
L’Acadie en fait l’expérience immédiatement : l’armée anglaise y mène un véritable nettoyage ethnique[78]. Les colons français qui refusent de prêter serment au roi d’Angleterre sont chassés de leurs terres, leurs villages brûlés, leurs biens confisqués. 10 000 personnes sont déportées, dispersées dans des conditions épouvantables[79]. On n’avait pas oublié, à Londres, la qualité des vaisseaux français et la combativité de leurs équipages lors du précédent conflit. L’amirauté anglaise décide donc, pour éviter des grandes batailles incertaines, de s’en prendre à la marine marchande française qui forme le réservoir à matelots de la Marine de guerre[80]. La guerre n’étant pas déclarée, c’est une véritable razzia qui s’abat sur les bâtiments français sans protection dans l’Atlantique. De septembre à novembre 1755, la Navy s’empare de plus de 300 navires, revendus à Londres pour 30 millions de l.t. (livres tournois). 6 000 matelots et officiers capturés prennent le chemin des sinistres prisons flottantes du sud de l’Angleterre.
La Royal Navy, sûre d’elle et de ses instructions qui lui assurent une totale impunité, s’en prend aussi aux vaisseaux français près des côtes. L’Espérance, un 74 canons de l’escadre de Brest, mais qui, armé en flûte n’en porte que 22, est assailli dans le Golfe de Gascogne, et doit se rendre après un combat de plus de cinq heures[81]. En représailles, la division navale de Du Guay saisit au large de Brest la frégate anglaise qui porte en Amérique le gouverneur de la Caroline du Sud. Louis XV ordonne de relâcher celle-ci, alors que les navires de commerce anglais continuent à fréquenter les ports français impunément[82]. La situation en 1755 semble irréelle : le parti de la guerre triomphe à Londres et celui de la paix à Versailles.
1756 : La surprise de Port-Mahon
 Le départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon le 10 avril 1756. Suffren participe à la bataille navale devant Port-Mahon sur l'Orphée. (Nicolas Ozanne)
Le départ de la flotte française pour l'expédition de Port-Mahon le 10 avril 1756. Suffren participe à la bataille navale devant Port-Mahon sur l'Orphée. (Nicolas Ozanne)
 The Shooting of Admiral Byng : "L'exécution de l'amiral Byng", sur le pont du HMS Monarque. (National Maritime Museum, auteur inconnu).
The Shooting of Admiral Byng : "L'exécution de l'amiral Byng", sur le pont du HMS Monarque. (National Maritime Museum, auteur inconnu).
Il faut attendre le mois de décembre 1755 pour qu'on ouvre enfin les yeux à Versailles sur la réalité de cette guerre ouverte par l'Angleterre depuis près d'un an et non encore officiellement déclarée. Le 21 décembre, Louis XV adresse à Londres un ultimatum pour réclamer la restitution des prises. Son rejet, le 13 janvier 1756, signifie l'instauration de l'état de guerre entre les deux États. La guerre est officiellement déclarée par Londres le 13 mai 1756 et par Versailles le 9 juin. A cette date, les opérations sont déjà engagées depuis plusieurs semaines avec l'attaque contre Minorque.
Suffren, qui vient d’être nommé lieutenant de vaisseau au mois de mai, rejoint Toulon et embarque sur l’Orphée (64 canons), navire requis pour faire partie de l’expédition sur Minorque. Cette île de l'archipel des Baléares était devenue lors de la guerre de Succession d’Espagne une grande base navale anglaise qui permettait à la Royal Navy de surveiller les côtes de Provence et d’Espagne, comme lors du précédent conflit. Le Conseil du roi décide de s’en emparer par une attaque surprise, la base pouvant aussi servir de monnaie d'échange en cas de conquête anglaise dans les colonies françaises. Le secret réussit à être conservé et se double d’une imposante opération d’intoxication, puisqu’une armée de diversion fait mine de préparer une opération de débarquement dans la Manche. L'amirauté anglaise tombe dans le piège et retient ses escadres qui se retrouvent à surveiller du mauvais côté, laissant le champ libre aux Français.
L’escadre de La Galissonnière sort sans encombre de Toulon le 10 avril 1756 et arrive devant Port-Mahon quelques jours plus tard : 12 vaisseaux de ligne, 5 frégates, 176 navires de transport pour convoyer les 12 000 soldats du maréchal de Richelieu. C’est un plein succès : le débarquement se déroule sans encombre (18 avril) et on commence presque aussitôt le siège de la citadelle Saint-Philippe (23 avril)[83]. La Galissonnière, qui couvre l’attaque depuis le large, laisse cependant s’enfuir 5 vaisseaux anglais.
Le 19 mai, arrive l’escadre de Gibraltar conduite par l’amiral Byng avec 13 vaisseaux, 4 frégates et une corvette escortant des renforts pour la citadelle. Elle compte un trois-ponts, et il n'y a aucune unité de moins de 64 canons. Cette force est donc nettement supérieure à l’escadre française qui ne possède aucun trois-ponts et dont deux des 12 vaisseaux sont des unités de 50 canons. La situation va-t-elle se retourner ? Mais La Galissonnière fait face. Dans matinée du 20, il déploie son escadre en ligne de file. Byng engage le combat vers 13h00 alors que le vent a tourné en sa faveur. Mais la ligne française tient bon et le centre anglais n'est pas loin de se disloquer. L’Orphée, sur lequel se trouve Suffren, est engagé sur l’avant-garde et participe activement à la canonnade qui cesse vers 16h00. Plusieurs vaisseaux sont abimés des deux côtés, mais les pertes humaines sont assez légères[84].
Byng, qui n’a avec lui que 4 000 hommes de troupes n'est guère en mesure de faire cesser le siège, même s’il bat la flotte française et réussit à débarquer. Le 23 mai, l’escadre anglaise se replie sur Gibraltar pour réparer et attendre des renforts. La citadelle et ses 4 000 défenseurs capitule un mois plus tard (29 juin). C’est la victoire côté français, et elle aurait pu être encore plus éclatante si La Galissonnière avait poursuivi Byng en retraite vers Gibraltar. Mais l’amiral français, tenu par des ordres très stricts (la couverture du siège est prioritaire) et dont la santé décline, préfère rentrer sur Toulon où il arrive le 16 juillet. Le vieux chef y est accueilli par des arcs de triomphe de fleurs, cette victoire étant considérée comme une juste revanche face aux rafles anglaises sur les navires civils. On ne sait pas grand-chose du comportement de Suffren lors de ce combat, mais il est mentionné par La Galissonnière dans un groupe de sept lieutenants de vaisseaux qui semblent posséder « quelques connaissances ou dispositions pour le métier »[85].
À Londres, c’est la consternation, d’autant que les nouvelles du Canada ne sont pas bonnes non plus : les Français se sont emparés le 14 août du fort Oswego, principal point d’appui des Anglais sur le lac Ontario[86]. La victoire française à Minorque risquait aussi de pousser l’Espagne à sortir de sa neutralité et à se rapprocher de Versailles. Louis XV en profitait même pour débarquer des troupes en Corse, avec l’accord de la République de Gênes (propriétaire de la Corse) pour y devancer toute tentative anglaise. Il fallait trouver un responsable, ou plutôt un bouc émissaire à ces défaites : ce fut le malheureux amiral Byng qui fut traîné en cour martiale, condamné à mort pour « manquement à n'avoir pas fait l'impossible » (« He had failed to do his utmost ») pour soulager le siège de Minorque, et fusillé sur le pont d’un vaisseau de guerre[87]. La défaite provoquait aussi la chute du gouvernement anglais et la formation d’un nouveau cabinet mené par William Pitt, représentant du lobby colonial et marchand, nationaliste ardent et passionnément anti-français. Pitt impose aussitôt un colossal effort de guerre contre la France[88].
Article principal : Bataille de Minorque (1756). La capture du Foudroyant par le HMS Monmouth, le 28 février 1758. Suffren assiste impuissant à la prise des vaisseaux venus secourir l'escadre réfugiée à Carthagène. (Tableau de F. Swaine)
La capture du Foudroyant par le HMS Monmouth, le 28 février 1758. Suffren assiste impuissant à la prise des vaisseaux venus secourir l'escadre réfugiée à Carthagène. (Tableau de F. Swaine)
En 1757, Suffren passe sur la Pléiade à Toulon, alors que s’arme une escadre pour Saint-Domingue et le Canada. Mais les rafles anglaises sur les matelots français commencent à faire sentir leur effet[89]. Il faut six mois au chef de l’escadre La Clue pour armer une petite division de 6 vaisseaux et 2 frégates. Facteur aggravant, les équipages provençaux, qui n’ont pas reçu leur solde depuis plus d’un an désertent en masse. C'est dans ces conditions que Suffren quitte la Pléiade pour embarquer sur le navire amiral, l’Océan, un vaisseau neuf de 80 canons. La division part enfin de Toulon en décembre, pour se heurter devant Gibraltar à 16 vaisseaux anglais qui lui barrent le passage. La Clue n’ose pas tenter de passer en force et se réfugie dans le port de Carthagène le 7 décembre, poursuivi par la Royal Navy qui entame aussitôt le blocus du port malgré la neutralité espagnole. L’escadre doit hiverner en Espagne. Suffren assiste le 28 février 1758 à la saisie de deux vaisseaux venus de Toulon en renfort, le Foudroyant (80 canons) et l’Orphée (64). Les deux navires livrent un long combat devant le port, sous les yeux de la population et des équipages. En raison de vents contraires, La Clue n’a rien pu faire pour secourir les deux bâtiments[90]. L’escadre française rentre sans gloire sur Toulon en mai 1758, poursuivie par les forces de Boscawen.
La Marine entrait dans l’ère des défaites, même si l’année 1757 faisait encore illusion avec la défense victorieuse de Louisbourg par l’escadre de Dubois de La Motte[91]. En 1758, les liaisons avec les Antilles, le Canada, l’océan Indien étaient presque rompues. Les renforts n'atteignent plus la Nouvelle-France et les Antilles qu'au compte-gouttes. Toulon, en panne de matelots restait inactive alors que Brest était ravagée par une épidémie de typhus qui rendait impossible tout armement dans le port breton[92]. La Royal Navy insultait les côtes françaises avec ses tentatives de débarquement, ses bombardements, ses destructions massives[93], et s’arrogeait pour finir le droit de contrôler tout navire en mer, y compris neutre pour en saisir sa cargaison si elle était française. Laissée sans secours, la forteresse de Louisbourg capitulait le 26 juillet 1758, ouvrant les portes du Canada aux Anglais et les comptoirs français du Sénégal étaient pris en décembre. Le pire restait pourtant à venir.
Article principal : Bataille de Carthagène (1758).1759, l'année des défaites
 La bataille de Lagos, le 18-19 août 1759. L'escadre de La Clue se disloque après le passage de Gibraltar. Malgré la neutralité portugaise, les vaisseaux français réfugiés à Lagos sont pris ou incendiés par les Anglais. Pour Suffren, c'est la deuxième captivité en Angleterre qui commence.
La bataille de Lagos, le 18-19 août 1759. L'escadre de La Clue se disloque après le passage de Gibraltar. Malgré la neutralité portugaise, les vaisseaux français réfugiés à Lagos sont pris ou incendiés par les Anglais. Pour Suffren, c'est la deuxième captivité en Angleterre qui commence.
En 1759, on décide à Versailles de laver toutes ces insultes en frappant un grand coup : envahir l’Angleterre en y débarquant une forte armée. Il faut pour cela que l’escadre de Toulon rejoigne celle de Brest pour protéger l’embarquement de l’armée d’invasion sur une grande flotte de transport[94]. À Toulon, on arme comme on peut une escadre de 12 vaisseaux et 3 frégates. Retards et contretemps s’accumulent. La Clue en prend de nouveau le commandement et appareille le 5 août 1759 avec des équipages de fortune et des officiers à court d’entraînement[95]. Suffren embarque à nouveau sur l’Océan (80), le navire amiral, et sert sur la première batterie. L’escadre réussit à passer dans l’Atlantique en longeant les côtes marocaines alors que Boscawen fait relâche à Gibraltar pour réparer plusieurs navires, suite à une attaque ratée sur Toulon. Mais une frégate anglaise repère l’escadre le 17 août et Boscawen lance aussitôt la poursuite avec 14 (ou 15) vaisseaux.
Côté français, c’est la confusion. La Clue à l'idée, sans en avertir ses capitaines, d'éteindre ses feux de poupe aux alentours de Gibraltar pour ne pas se faire repérer. Résultat, tous les vaisseaux l'imitent et se perdent dans la nuit. L'escadre se disloque. Cinq vaisseaux et les 3 frégates se réfugient à Cadix, laissant à La Clue 7 vaisseaux. Les Français sont maintenant à un contre deux. Commence alors une dramatique poursuite. La Clue qui remonte lentement vers le nord voit apparaître les voiles anglaises au matin du 18, mais pense d’abord qu’il s’agit de ses vaisseaux qui se sont égarés au large de Cadix. Il est vrai que Boscawen qui n’en est plus à une ruse près avance sans pavillon. Lorsque La Clue se rend compte du piège, il ordonne de mettre toutes les voiles dehors pour décrocher, mais l’escadre doit attendre le Souverain (74 canons), plus lent que tous les autres. La bataille-poursuite s’engage vers 14 heures, lorsque les Anglais qui profitent de leur supériorité remontent la ligne française sur les deux bords, prenant en tenaille les 6 derniers vaisseaux. Le Centaure (74 canons) se sacrifie pour tenter de couvrir la fuite de l’escadre et livre un combat acharné, (« a very gallant resistance » diront plus tard les Anglais)[96]. Il essuie le feu de 5 vaisseaux anglais, reçoit 300 boulets dans la coque, compte 200 morts et blessé et finit par se rendre, totalement désemparé[97]. Sacrifice inutile car Boscawen, sur le HMS Namur (90 canons) rejoint l’Océan vers 16h00. Le combat est furieux, les deux navires se démâtent mutuellement. Totalement pour le Namur, que doit abandonner Boscawen pour un autre navire, le HMS Newark (80), alors que l’Océan qui a tiré plus de 2 500 boulets dispose encore d’une partie de sa voilure et réussit à se dégager. Les pertes sont lourdes, 100 hommes tués sur place et 70 blessés, dont La Clue, grièvement blessé aux deux jambes[98]. Le combat cesse avec la nuit. En fin de compte, avec un seul vaisseau perdu, les Français ont fort bien résisté à l'écrasante supériorité anglaise.
Deux vaisseaux français, le Souverain (74) et le Guerrier (74) profitent de l’obscurité pour se sauver et abandonnent leur chef[99]. Un comble, lorsqu'on se rappelle que dans la journée l'escadre a du réduire la voilure pour attendre le Souverain, navire mauvais marcheur, et engager ainsi le combat pour ne pas avoir à s'en désolidariser... A l’aube, l’escadre française se trouve donc réduite à 4 bâtiments. C'est la consternation. La Clue, toujours soigné dans l'entrepont -et qui va perdre une jambe- se laisse convaincre par son second, le comte de Carné, qu'il n'est plus possible de soutenir un nouveau combat et qu'il vaut mieux chercher refuge dans les eaux neutres du Portugal. L'escadre parvient à se traîner dans la baie d’Almadora près de Lagos. Peine perdue. Au mépris de la neutralité du Portugal, Boscawen vient l’y débusquer. Le dernier acte du drame occupe encore la journée du 19 août, près des deux petits forts d’Almadora. L’Océan, et le Redoutable s'échouent sous voiles et mettent leurs embarcations à l'eau. On coupe ensuite les mâtures pour éviter que les coques ne se disloquent trop vite alors que les soutes commencent à être noyées. L'évacuation s'avère difficile. Les canots de l'Océan se brisent sur la plage et seule une chaloupe reste utilisable alors que les Anglais approchent et ouvrent le feu. Pour éviter des pertes supplémentaires, Carné fait amener le pavillon alors qu'il reste encore à bord 160 hommes et que le navire menace de chavirer. Les Anglais évacuent les prisonniers puis incendient le vaisseau[100]. Le deuxième vaisseau, le Redoutable subit le même sort, une partie de l'équipage parvenant à gagner la terre et l'autre étant capturée.
Les deux derniers vaisseaux, le Téméraire (74) et le Modeste (64) vont mouiller sous les murs des forts, pensant y trouver refuge. La Clue, qui a pu débarquer sur son brancard, envoie un émissaire aux Portugais pour leur demander de protéger les deux navires. Ces derniers tirent mollement quelques coups de canons qui ne gênent en rien les Anglais : les deux vaisseaux sont saisis intacts, sans avoir pu s’incendier[101]. Mais que pouvait-on attendre d’un pays qui avait signé depuis 1703 des accords diplomatiques très favorables avec l’Angleterre ? Les amiraux anglais se sont donc autorisés à évoluer dans les eaux portugaises comme s'ils avaient été au large de Plymouth... Suffren, qui était dans le groupe d’hommes capturé sur l’Océan, se retrouve prisonnier une deuxième fois. Il est débarqué à Gibraltar avec ses compagnons d’infortune. Comme tous les officiers il y est très bien traité, mais il doit supporter de nouveau le spectacle humiliant des vaisseaux français capturés sous les cris de victoire anglais. Pierre-André va rester prisonnier plusieurs mois en Angleterre alors que la marine française connait l’une de ses pires périodes.
Le 20 et 21 novembre 1759, l’escadre de Brest (21 vaisseaux et 5 frégates sous les ordres de Conflans) est vaincue, dispersée à la bataille des Cardinaux près de Quiberon, d’ailleurs sur un schéma voisin de bataille de Lagos (1759) : un mélange d’incompétence et de désobéissance du côté des officiers français permettant à l’escadre de Hawke, pourtant à peine plus nombreuse (23 vaisseaux) d’emporter la victoire[102]. A l’issue de ces deux batailles, la Marine royale a perdu 11 vaisseaux par capture ou destruction et ses unités restantes sont dispersées dans les ports français ou étranger. Elle n’existe plus en tant que grande force organisée combattante, laissant le champ libre à la Navy dans les eaux françaises. C’en était fini du projet d’invasion de l’Angleterre, alors que la Guadeloupe et la Martinique tombaient aussi (1er mai 1759 et janvier 1762), avec Québec (14 septembre 1759), avant que le Canada ne soit entièrement pris (capitulation de Montréal, le 8 septembre 1760), puis les Indes avec la chute de Pondichéry (15 janvier 1761). Il n’y avait plus que quelques petites divisions qui réussissaient à tromper le blocus anglais. On peut bien parler d’absolutisme naval : avec une organisation sans faille, une discipline de fer, et sans aucun scrupule sur les méthodes diplomatico-militaires, la Royal Navy avait atteint la maîtrise des mers. L’Espagne qui avait rejoint la France dans la guerre depuis le 2 janvier 1762 regrettait amèrement son choix : la Royal Navy triomphante s’emparait de La Havane (13 août 1762), faisait la conquête de la Floride, puis de Manille (22 septembre 1762), et capturait les deux galions transpacifiques[103].
En attendant la revanche (1763–1777)
Le retour des prisonniers et le deuxième passage à Malte
 Des pontons. Entre 1755 et 1763, 60 000 marins français croupissent dans ces prisons flottantes. Plus de 8 000 y périssent. Suffren échappe cependant aux pontons grâce à sa qualité d'officier. (Gravure d'après un tableau de Garnerais)
Des pontons. Entre 1755 et 1763, 60 000 marins français croupissent dans ces prisons flottantes. Plus de 8 000 y périssent. Suffren échappe cependant aux pontons grâce à sa qualité d'officier. (Gravure d'après un tableau de Garnerais)
La paix revient en 1763. Le traité de Paris (10 février 1763) entérine la liquidation politique et militaire de la présence française en Amérique du nord et en Inde. On s’estime plus qu’heureux à Versailles d’avoir pu récupérer la Guadeloupe et la Martinique, plusieurs comptoirs sur la côte africaine, et cinq comptoirs sans fortifications sur les côtes indiennes, l’objectif étant de conserver ce qui a le plus d’intérêt économique[104].
Suffren rentre d’Angleterre en 1760, libéré sur parole lors d’un échange d’officier. Il était revenu de sa première captivité avec un vif sentiment anti-anglais. Ce deuxième séjour n'a rien arrangé, mais cette fois il n’est plus seul, toutes les façades maritimes françaises réclamant vengeance contre l’Angleterre. Les méthodes de ratissage de la Royal Navy ont fortement contribué à sa victoire. Elles ont aussi rempli les prisons anglaises de milliers de marins capturés. Pour faire des économies, l’amirauté anglaise a enfermé les captifs dans d’anciens vaisseaux déclassés dont les sabords ont été grillagés : les pontons. Les conditions de détention y sont absolument épouvantables. Sur les 60 000 marins enfermés, 8 500 sont morts, (dont 5 800 de 1756 à 1758), au point que même l’opinion publique anglaise s’en est émue. Les survivants, qui rentrent après la paix « en garderont une haine extraordinaire vis-à-vis des Anglais, haine qui perdurera pendant les guerres d’Amérique, de la Révolution et de l’Empire »[105]. Une haine qui irrigue tous les ports français, mais pas seulement. L'opinion publique, marquée par cette guerre ruineuse et humiliante connaît un fort sursaut patriotique et réclame elle aussi la revanche. La question ne laisse pas indifférent non plus les milieux philosophiques : « Philosophes de tous les pays, amis des hommes, pardonnez à un écrivain français d’exciter sa patrie à élever une marine formidable » s’écrie l’abbé Raynal[106].
En attendant cette hypothétique revanche, Suffren doit respecter sa parole : ne plus se battre jusqu’à la fin du conflit. Nous sommes en 1760 et la guerre est encore loin d’être achevée. Il sollicite auprès du ministre un congé pour poursuivre son apprentissage à Malte. Congé accordé par Choiseul avec une lettre de recommandation au Grand Maître[107]. Pierre-André quitte la France en avril 1761 pour revenir en août 1762. On ne sait rien non plus de ce deuxième séjour maltais. On peut simplement en déduire que pendant ces 16 mois, le chevalier, déjà trentenaire, a achevé son temps réglementaire de caravanes. Suffren retrouve sa place en 1763 dans une marine royale en pleine reconstruction.
Suffren dans la marine royale en reconstruction
 Le Bretagne, fier trois-ponts issu du « don des vaisseaux » des années 1760, incarne avec les 16 autres unités construites la volonté de revanche des Français après les défaites de la Guerre de Sept Ans. (Musée naval de Brest)
Le Bretagne, fier trois-ponts issu du « don des vaisseaux » des années 1760, incarne avec les 16 autres unités construites la volonté de revanche des Français après les défaites de la Guerre de Sept Ans. (Musée naval de Brest)
À Versailles, le principal ministre de Louis XV, le duc de Choiseul, partage aussi l’idée d’une revanche nécessaire contre l’Angleterre et engage avec détermination la reconstruction de la Marine[108]. Choiseul fixe en 1763 l’objectif très ambitieux de porter la flotte à 80 vaisseaux et 45 frégates[109], chiffre irréaliste compte tenu de l’état des finances royales après cette guerre ruineuse. Le très populaire ministre, surfe donc sur le sentiment patriotique pour faire payer par les provinces, les grandes villes et les corps constitués (Fermiers généraux, chambres de commerce) la mise en chantier de nouveaux navires. C’est le « don des vaisseaux », qui apporte à la flotte 17 vaisseaux de ligne et 1 frégate[110]. Choiseul réforme aussi la direction des ports et des arsenaux (1765) et dans une moindre mesure la formation des officiers qui reste insuffisante en temps de paix. En 1772, on arme une escadre d’évolution destinée à l’entrainement.
Un seul personnage reste très prudent : le roi. Louis XV, profondément marqué par les épreuves de la guerre déclare en 1763 à Tercier, l’un de ses intimes : « Raccommodons-nous avec ce que nous avons pour ne pas être engloutis par nos vrais ennemis. Pour cela, il ne faut pas recommencer une nouvelle guerre »[111]. Louis XV est plus préoccupé par l’agitation intérieure des Parlements (tribunaux) qui minent son autorité depuis des années, que par la revanche sur l’Angleterre. En 1770, Louis XV renvoie Choiseul qui est sur le point de déclencher la guerre en soutenant l'Espagne lors d'une crise avec l'Angleterre, et les crédits pour la Marine restent très au-dessous des besoins. La revanche attendra un nouveau roi.
Au mois de mai 1763, Suffren embarque à nouveau sur la Pléiade, qu’il a quittée en 1758. La frégate est engagée avec trois consœurs (deux de Rochefort, deux de Toulon) contre les corsaires marocains de Salé qui se sont livrés à de nombreux actes de piraterie contre le trafic commercial français. Elles sont accompagnées par deux chébecs et deux autres petits navires. La Pléiade appareille de Toulon le 27 mai et rentre le 9 décembre. L’expédition est marquée par un fâcheux incident. Le 16 juillet, la Pléiade canonne et coule bas un corsaire algérien qu’elle a pris pour un salétin. Le Dey d’Alger, furieux, se livre à de violentes représailles antifrançaises[112]. L’affaire est finalement dénouée par une ambassade escortée d’une petite escadre, laquelle conclut un traité de paix, signé le 16 janvier 1764 avec la régence d’Alger.
Au cours de cette croisière, Suffren, rédige un mémoire sur « la façon de réprimer les corsaires d’Alger »[113]. Il adresse le document directement à Choiseul, le puissant ministre de la marine. Démarche étonnante, sachant qu’il n’est qu’un simple lieutenant de vaisseau de 34 ans. Cette sollicitation, si elle se passait aujourd’hui, vaudrait à l’officier des sanctions disciplinaires au nom du respect de la voie hiérarchique. Mais nous sommes au XVIIIe siècle, et le ministre lui adresse une réponse fort aimable dans laquelle il prend acte de la qualité des propositions du jeune officier[114]. Pour Suffren, il s’agissait sans doute de contribuer sincèrement à la bonne marche du service, mais aussi d’un moyen de se faire connaître et de se mettre en valeur. Objectif somme toute réussi. Avec ce premier échange, il inaugure ainsi une démarche qui va devenir habituelle, et sur laquelle nous reviendrons.
Le premier commandement sur le chébec le Caméléon (1764)
 Un chébec. C'est sur ce vaisseau typiquement méditerranéen que Suffren exerce son premier commandement, en 1764. Il a 33 ans.
Un chébec. C'est sur ce vaisseau typiquement méditerranéen que Suffren exerce son premier commandement, en 1764. Il a 33 ans.
L’année 1764 apporte une grande satisfaction à Suffren avec l’attribution du premier commandement qui constitue toujours un moment clé dans la carrière d’un marin. Âgé de 33 ans, Pierre-André n’a pas été spécialement avantagé en ce domaine puisqu’il aurait pu commander un petit navire (une corvette par exemple) beaucoup plus tôt. Mais la qualité de l’unité qu’on lui confie, un chébec, vient largement compenser cette longue attente. La marine royale en dispose d’un petit nombre[115], qui remplacent très avantageusement les galères (supprimées en 1748)[116], pour la lutte contre les « barbaresques » en Méditerranée. Ce sont des petits bâtiments très élégants, élancés, taillés pour la course, portant trois mâts munis de voiles latines. Les chébecs, très manœuvrant, disposent aussi pour le combat, ou forcer l’allure en cas de vent faible, d’ouvertures pour armer à l’aviron et leur faible tirant d’eau leur permet aussi de s’approcher très près du rivage, voire de se hasarder à remonter des petits estuaires. Les avirons amovibles sont un héritage de la galère dont est issu le chébec, avec l’avantage de laisser la place à une solide artillerie dont ne disposait pas cette dernière[117].
Le Caméléon, dont Suffren prend le commandement le 8 mai 1764 est une unité toute neuve, lancée en 1762, de 37 mètres de long pour 9 mètres de large, portant 20 canons et comptant 180 hommes d’équipage, ce qui lui permet d’armer une forte artillerie et de combattre à l’abordage. La mission du navire est dans le prolongement de celle confiée à la Pléiade l’année précédente. Une division forte de deux frégates, la Pléiade et la Gracieuse, et de trois chébecs, le Renard, le Singe et le Caméléon, doit patrouiller en Méditerranée occidentale contre les corsaires de Salé, une escale étant prévue à Alger dans le contexte du traité de paix qui vient d’être fraichement signé avec le Dey.
De ce premier commandement on ne sait pas grand-chose non plus, si ce n’est un grave incident ou Pierre-André manque de perdre la vie. La Pléiade et le Caméléon, qui ont quitté Malaga de conserve, rencontrent des vents très frais dans les parages de Formentera et décident de faire relâche dans cette île en attendant une accalmie. Suffren, qui ne supporte pas l’inaction, décide d’aller vérifier la praticabilité d’un petit passage entre la pointe sud d’Ibiza et des îlots qui jalonnent le détroit séparant cette île de Formentera. Le 13 septembre, il s’embarque avec 11 hommes sur son canot pour aller sonder le passage. Mais lorsqu’il s’y engage, l’embarcation est submergée par deux lames de fond. On repêche péniblement, en fin d’après midi et dans la nuit, les naufragés qui s’accrochent à un morceau de bois pour certains, ou qui ont dérivé sur un îlot (dont Suffren) pour d’autres. Trois hommes se sont noyés. Le Caméléon a failli perdre son commandant mais cet épisode sera porté à son crédit, bien des années après, dans les provisions accordées par le roi pour son élévation à la dignité de vice-amiral. Le document mentionne que lorsqu’il commandait le Caméléon, Suffren « se sauva d’un naufrage par sa vigueur et son courage »[118].
Commandant du Singe pendant expédition de Larache (1765)
 Une chaloupe armée. Suffren participe à l'expédition contre Larache. La ville est sévèrement bombardée, mais l'attaque menée dans l'oued avec des chaloupes se solde par de lourdes pertes.
Une chaloupe armée. Suffren participe à l'expédition contre Larache. La ville est sévèrement bombardée, mais l'attaque menée dans l'oued avec des chaloupes se solde par de lourdes pertes.
En 1765, Suffren se voit confier le commandement du Singe, frère jumeau du Caméléon, et de la division de chébecs constituée de ces deux navires. Le Singe embarque 190 hommes d’équipage et se trouve engagé cette année-là dans une mission d’envergure. Les croisières menées les années précédentes contre les corsaires de Salé n’avaient pas donné grand-chose. Les corsaires musulmans continuaient leurs prises sur le commerce, malgré toutes les mesures préventives ou d’intimidation. Pour faire cesser ces attaques, on décide donc d’une importante opération de représailles. Celle-ci est confiée au comte Du Chaffault qui connait ce genre de mission puisqu'il a participé au bombardement de Tripoli en 1728 et a déjà croisé contre les corsaires de Salé en 1737. Il dispose d’un 64 canons, l’Union, qui sert de navire amiral, accompagné de 4 frégates de Brest et autant de Toulon, complété de la division des 2 chébecs de Suffren, et de deux galiotes à bombes. Cette force respectable de 13 navires dispose d’ordres clairs : « Sa Majesté est informée que tous les moyens dont on peut faire usage pour dompter les Salétins et les forcer à demander une paix relative à la dignité de son pavillon, il n’en est pas de plus sûr et de plus convenable que de chercher les occasions de détruire ces corsaires, même dans leurs ports s’il est possible d’y atteindre et d’y tenter quelques prises. »[119]
Suffren met à la voile le 6 avril avec ses deux chébecs. Il a pour instruction de patrouiller entre Oran et Gibraltar pour protéger les navires français et espagnols (L’Espagne est l’alliée de la France depuis la signature du Pacte de Famille en 1761), et de se joindre aux vaisseaux de Du Chaffault si celui-ci le demande. Ordre effectivement reçu lors d’une escale à Malaga. Le 26 juin, toutes les forces de l’expédition sont regroupées devant Larache. Du Chaffault, qui a bombardé entre-temps Salé (31 mai), mais où il n’a pas pu débarquer à cause de la barre de sable qui protège le port, décide s’en prendre à Larache, dont l’accès semble plus aisé. Il apparait aussi que l'expédition n'a pas été correctement préparée. On manque déjà de munitions. Le ministère doit dépêcher du ravitaillement en poudre, bombes et vivres. Du Chaffault se plaint aussi de la mauvaise qualité des mortiers et des mèches[120].
Le 26 juin, il est décidé que toutes les chaloupes de l’escadre seront mobilisées pour aller brûler, à la faveur de la nuit, une frégate salétine mouillée dans la rivière de l’oued Loukos qui mène à Larache. Cette première tentative nocturne échoue car les chaloupes ne trouvent pas l’entrée de la rivière. Le 27 juin, l’Union (64) et les deux galiotes engagent le bombardement de la ville. Dans la nuit, (vers 22h00), le canot de l’Union, les chaloupes des deux chébecs et de la frégate la Licorne font une nouvelle tentative pour entrer dans la rivière et y parviennent, mais échouent à incendier la frégate barbaresque[121]. Le bombardement de la ville se poursuit le 27 juin, réduisant celle-ci en cendre, alors que la totalité des chaloupes et canots de l’escadre sont mobilisés pour reprendre l’opération sur la rivière. Le Caméléon, grâce à son faible tirant d’eau, remonte l’oued pour escorter la flottille jusqu’à la frégate salétine qui est incendiée par les équipes d’abordage. Le commandant de l’opération décide alors de pousser son avantage en détruisant deux chébecs que l’on aperçoit un mille et demi plus en amont. Mais la situation commence à se gâter. Les berges de la rivière se garnissent peu à peu d’une foule de « maures » qui ouvrent un feu nourri sur les embarcations françaises. Le plus grand des chébecs est abordé et on y met le feu, mais l’attaque du plus petit tourne mal. Le feu s’intensifie depuis les berges. Les quatre chaloupes mises en ligne de front pour l’attaquer perdent plus de la moitié de leurs hommes, alors que les marocains réussissent à éteindre l’incendie sur le premier chébec. Il faut ordonner la retraite sous le feu adverse. Elle est calamiteuse. Les équipages décimés ont du mal à ramer sur le courant de la marée montante et beaucoup de chaloupes s’échouent. Le bilan est très lourd. 7 chaloupes sur 16 sont capturées ou détruites, laissant 250 morts sur le terrain et 49 prisonniers[122]. C’est très cher payé pour la destruction d’une frégate salétine, ce qui entache fortement le bilan de l’opération sur Larache, qui par ailleurs est sévèrement étrillée, comme le voulait les ordres royaux. Quant au Singe, qui n’a perdu aucune chaloupe et ne déplore que trois morts, il reçoit l’ordre avec le Caméléon de reprendre sa croisière et rentre sur Toulon le 29 septembre.
Suffren, resté sur le Singe, n’a pas participé directement à l’attaque dans la rivière de Loukos, mais l’action des deux chébecs a été particulièrement appréciée par Du Chaffault, puisque qu’il reçoit avec le capitaine du Caméléon une forte gratification du ministre (800 livres). Ce dernier exprime même ses regrets de ne pas pouvoir en faire davantage : « Sa Majesté, écrit-il à Suffren, aurait bien désiré vous comprendre dans le remplacement de capitaines de frégate, mais le petit nombre qu’elle en a fait ne lui a pas permis d’aller jusqu’à vous. Elle se réserve de vous accorder ce grade le plus tôt qu’il sera possible. »[123]
De la mission au Maroc au bureau du ministre (1767)
En janvier 1766, Suffren, qui semble inactif à terre, reprend sa plume et sollicite à nouveau le ministre Choiseul pour faire partie de la mission qui doit partir au Maroc y négocier la paix. Suffren affirme vouloir étudier le pays et éventuellement participer aux négociations, affirmant y porter « autant de bonne volonté que de désintéressement. »[124]. Requête osée, même en tenant compte du satisfecit qu’il a obtenu dans sa précédente mission, mais qui est acceptée. Au mois de mars 1767, Suffren embarque à Brest sur l’Union, vaisseau qui doit conduire au Maroc l’ambassadeur français, lequel n’est autre que le commandant du navire, le comte de Breugnon. Le vaisseau, accompagné d’une frégate et d’une corvette, met à la voile en avril et arrive au Maroc à la mi-mai. On ne sait rien du rôle qu’a pu jouer Suffren dans cette ambassade. Sans doute à-t-il fait connaissance avec les rudiments de la diplomatie. Nous verrons ensuite, une quinzaine d’année plus tard, Suffren faire preuve de réelles qualités de diplomate en Inde. L’ambassade du comte de Breugnon est un succès puisque dès le 30 mai est signé avec le sultan Sidi Mohammed ben Abdallah un traité d’amitié et de commerce[125].
L’Union est de retour sur Brest le 25 juillet 1767. Suffren, qui semble avoir tissé des liens avec le comte de Breugnon, obtient l’autorisation de l’accompagner à Versailles. Si la stratégie secrète de Pierre-André était de se faire ouvrir les portes du ministère, c’est réussi. De sa première lettre au ministre en 1763 (voir plus haut) à la première entrevue avec celui-ci, il s’écoule 3 ans. Ce n’est pas si mal, pour un homme qui ne dispose d’aucun appui familial à la Cour et qui ne peut compter que sur lui-même pour défendre ses idées et œuvrer à la réalisation de ses ambitions. Nous reviendrons plus loin sur l’analyse de cette stratégie épistolaire. Nous ne savons rien des conversations qui ont été tenues avec le ministre[126], mais le 18 août Suffren est promu capitaine de frégate (et Breugnon, qui a réussi son ambassade est fait chef d’escadre)[127].
Le troisième séjour à Malte (1769-1772)
L’année 1768 apparait comme une nouvelle page blanche dans la vie de Suffren, tout comme le premier semestre 1769. Il semble se morfondre à terre, à Toulon. Au mois d’octobre 1769, Pierre-André reprend sa plume pour solliciter un nouveau congé, d’une durée de deux ans cette fois, pour reprendre du service à Malte où il doit maintenant « tenir galère. »[128]
« Tenir galère » : Suffren aux commandes du San Antonio
 Suffren prend son premier commandement d'une galère hospitalière en 1769. Malgré sa faible utilité militaire, la galère reste un navire prestigieux en Méditerranée au XVIIIe siècle.
Suffren prend son premier commandement d'une galère hospitalière en 1769. Malgré sa faible utilité militaire, la galère reste un navire prestigieux en Méditerranée au XVIIIe siècle.
La nomination de « Pietro Andréa Suffren » au commandement du San Antonio intervient le 11 janvier 1769[129] alors que Suffren se trouve en France et n’a pas encore obtenu son congé. Le commandement d’un navire de l’Ordre ne peut être confié qu’à un chevalier ayant accompli ses caravanes, condition que remplit Suffren depuis son deuxième passage à Malte. Mais une seconde condition est exigée, celle d’être chevalier profès, que l’intéressé ne remplit pas encore. Suffren arrive sur ses 40 ans, alors que le délai normalement requis est de moins de 26 ans. Il a donc largement passé l’âge, grâce à plusieurs prorogations triennales, sans doute motivées par sa double carrière dans la marine royale, sans que l’on puisse totalement écarter l’hypothèse d’autres projets, comme un mariage[130], finalement abandonné.
On a cru pendant longtemps que Suffren avait prononcé ses vœux à Malte, à la cathédrale Saint-Jean de La Valette. Il n’en est rien, un document des archives de l’Ordre nous apprend que ceux-ci ont été prononcés le 30 novembre 1769 à Marseille, dans la chapelle des Révérends Pères Trinitaires déchaux[131]. La cérémonie à Marseille permet aussi d’organiser une fête familiale en réunissant les parentèles Bruny et Suffren, et sans doute aussi au nouveau chevalier de trouver de l’argent. Car « tenir galère » passe encore au XVIIIe pour être une fonction de prestige, laquelle implique de lourdes dépenses. Le capitaine, en effet, doit non seulement assurer la nourriture de ses officiers mais pourvoir aussi à l’entretien du navire. Le chevalier, qui a fait vœu de pauvreté, doit donc s’endetter. Soit auprès de banquiers maltais, soit dans son environnement familial à Marseille, dernière hypothèse qui semble la plus logique ici. L’attribution d’une commanderie doit permettre par la suite de rembourser les emprunts et de rétablir les finances personnelles. Opération qui sera effectivement réglée en 1771 avec la mise à disposition de la commanderie de Saint-Christol, près de Montpellier. C'est à partir de cette date que Suffren, dans ses courriers, commence à faire précéder sa signature du titre de "Commandeur".
C’est le 5 décembre 1769 que Suffren embarque pour Malte où l’attend le San Antonio, l’une des quatre galères dont dispose l’Ordre à ce moment-là. La galère fait partie du paysage méditerranéen depuis l’Antiquité, tout pays s’y revendiquant puissance navale se devant d’y posséder de nombreuses unités. La galère, qui a connu son apogée au XVIe siècle dans les grands affrontements entre les escadres turques et chrétiennes pour le contrôle de la Méditerranée -comme à la bataille de Lépante- n’est plus maintenant, sur le strict plan de l’utilité militaire, qu’une relique d’une autre époque. L’apparition au XVIIe siècle du vaisseau de ligne, haut sur l’eau, et portant des dizaines de canons sur les flancs alors que la galère n’en possède qu’une poignée sur l’avant, a progressivement déclassé cette dernière[132]. La France, puissance navale de plus en plus axée sur l’Atlantique a renoncé à ses galères, on l’a vu, depuis 1748, ces dernières n’ayant servi strictement à rien pendant la Guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). Mais curieusement, ce navire, qui peut être très avantageusement remplacé par des chébecs, fait de la résistance -si on peut dire- grâce au prestige qui lui reste attaché. Il est vrai que la galère reste un navire spectaculaire. Rutilante, couverte de dorures, de sculptures et de tentures sur ses boiseries, d’oriflammes et pavillons chatoyants sur sa mâture, elle porte fièrement les couleurs de l'État qui l'a armée, et ses déplacements majestueux attirent toujours immanquablement le regard et l’attention des foules, comme le note encore un voyageur anglais assistant au départ des galères de Malte en 1770[133].
Le San Antonio embarque sur son étroite coque 480 hommes, dont 300 galériens[134]. Avec une telle masse d’hommes à nourrir sur un navire ayant fort peu de cale, l’autonomie est limitée à une semaine, même si on mange et on boit bien à bord de la galère (légumes frais, viande et vin en abondance), condition absolue pour que la chiourme ne s’épuise pas ou ne tombe pas malade... Cette faible autonomie est cependant compensée par la facilité à trouver rapidement des escales dans cette mer fermée et de petite taille qu’est la Méditerranée. La tactique au combat est restée sommaire, puisque la galère attaque toujours par une charge à toutes rames le flanc du navire adverse qui est pris à l’abordage après avoir essuyé le feu des trois ou quatre pièces d’artillerie placées dans l’axe avant de la galère. C’est sur ce navire que Suffren est engagé en 1770 dans une nouvelle opération sur les côtes d'Afrique du Nord.
La participation à l'expédition contre le Bey de Tunis (1770)
 Suffren participe en 1770 avec les galères de Malte à l'expédition française contre le Bey de Tunis et qui se solde par le bombardement de plusieurs ports. (N.B. : Les frontières données sur cette carte actuelle n'existent pas en 1770)
Suffren participe en 1770 avec les galères de Malte à l'expédition française contre le Bey de Tunis et qui se solde par le bombardement de plusieurs ports. (N.B. : Les frontières données sur cette carte actuelle n'existent pas en 1770)
Après la courte guerre et l’expédition de Larache de 1765 sur les côtes marocaines, c’est avec la régence tunisienne que la tension est progressivement montée. Le Bey de Tunis, Ali II Bey qui n’a pas reconnu l’acquisition de la Corse par la France, a laissé ses corsaires s’en prendre à l’île. Ces derniers ont capturé plusieurs bâtiments de pêche et enlevé de nombreuses personnes, malgré les traités signés avec la France. Comme dans l’affaire de Larache, Versailles envoie sur les côtes tunisiennes une petite escadre forte de deux vaisseaux, la Provence (64) et le Sagittaire (50), accompagnés de trois frégates, deux chébecs, une flûte, et deux galiotes à bombes. Elle se présente devant Tunis le 20 juin 1770 sous les ordres de M. de Broves où elle retrouve une frégate française déjà présente sur les lieux avec le consul de France[135]. Expédition à laquelle l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem décide de se joindre, en y engageant l’essentiel de ses moyens. L’escadre maltaise arrive à Tunis le 23 juin. « L’ordre de Malte, toujours zélé pour les intérêts de la chrétienté, nous a envoyé trois galères et une demi-galère, cette dernière appartient au Grand Maître qui écrit à M. de Broves et lui mande que toutes les forces de la Religion sont prêtes à marcher pour le service de Sa Majesté [le roi de France] » note un officier du Provence[136]. Les galères maltaises sont commandées par le général des galères en personne, le bailli de Flachslanden (d’origine alsacienne), qui reçoit en renfort le 9 juillet une frégate de 40 canons, alors que les combats ont déjà commencé.
Côté Français, on a pourtant tenté d’ultimes négociations (du 20 au 27 juin). Le Bey a rejeté l’ultimatum lui intimant de réparer dans les 36 heures les « offenses faites au roi », en multipliant les démarches dilatoires pour gagner du temps. Le représentant du Sultan turc - de qui dépend normalement le Bey de Tunis- lui apporte son soutien : « l’amitié du roi de France ne nous est d’aucune utilité et nous importe peu. »[137] Le 28 juin, le chef d’escadre Brovesfait porter la déclaration de guerre au Bey de Tunis, mais les Français n’ont pas préparé suffisamment l’expédition. Broves est arrivé sans cartes sur les ports et forts de la région, et sans renseignement sur les forces de l’adversaire. Tunis, éloignée du rivage par un lac peu profond n’est pas bombardable, tout comme le fort de la Goulette qui constitue la défense avancée de la ville et dont les vaisseaux de ligne ne peuvent s'approcher en raison de la profondeur insuffisantes des eaux littorales. On décide donc de s’en prendre à Bizerte qui est bombardée du 1er au 5 juillet par les deux vaisseaux, les deux galiotes à bombes et les galères de Malte. Les Tunisiens, qui connaissent les effets dévastateurs des galiotes ont évacué la ville qui ne déplore qu’une victime. Les dégâts sont mesurés (destruction d’une partie du fort, de plusieurs maisons et d’un navire). L’escadre a dû manœuvrer avec prudence devant la place qui est défendue par une abondante artillerie, puisqu’en 4 jours de bombardement on a tiré seulement 140 bombes et à peu près 200 boulets, sans compter les 20 coups tirés par les galères.
Si l’objectif de ce premier bombardement était de forcer les Tunisiens à reprendre les négociations, c’est réussi, puisque le 5 juillet, une felouque venue de Tunis apporte un courrier de Ali II Bey en ce sens. Ces premières négociations sont sans effet, puisque les opérations reprennent. Le mauvais temps fait échouer une tentative de bombardement sur Porto Farina (Ghar-El-Melh) où se trouve l’essentiel de la flotte tunisienne, mais l’attaque de Sousse est un succès. Cette riche ville commerçante essuie 17 jours de bombardement, du 27 juillet au 13 août. L’escadre y laisse presque toutes ses munitions ; les galiotes, notamment, avec 900 bombes lancées. La ville souffre de dommages considérables, mais cette dernière opération est un succès, puisqu’elle pousse le Bey à activer les négociations, lesquelles aboutissent vers la fin août. Le traité préliminaire, confirmé en octobre, reconnaît à la France la cession de la Corse et oblige à rendre tous les navires capturés avec leur personnel[138].
Quel enseignement a bien pu tirer Suffren de cette nouvelle campagne en Afrique du Nord ? Nous n’en savons rien hélas, les rapports qu’il se devait de rendre en tant que commandant du San Antonio n’ayant pas été retrouvés à ce jour dans les archives de l’Ordre[139]. On peut simplement constater encore une fois, la très faible utilité militaire des galères, ces dernières, avec leur artillerie réduite n’ayant fourni qu’un appui-feu secondaire (20 boulets tirés sur Bizerte) malgré toute la bonne volonté et l’esprit de collaboration affiché par le bailli de Flachslanden. Précisons aussi que les vaisseaux français ont dû fournir à l’escadre maltaise à leur arrivée pour trois jours d’eau, leur réserves étant épuisées[140]. Ce problème réglé, les galères maltaises se démènent en retour pour contribuer au ravitaillement des Français, ce qui est assez facile car Malte ne se trouve qu’à quelque 180 milles du théâtre d’opération. Plusieurs rotations des galères permettent de fournir à l’escadre de l’eau et des vivres frais.
Suffren a-t-il joué un rôle personnel dans l’établissement de cette chaine d’approvisionnement ? Nous n’en savons rien, mais on ne peut l’exclure, sachant que bien plus tard, lors de la campagne aux Indes, Pierre-André manifestera un immense talent dans l’art difficile de la logistique[141]. Il semble que son rôle ait été suffisamment important pour que le commandant du San Antonio s’en fasse un faire-valoir pour accéder à des fonctions supérieures. Dès le 21 septembre, il prend sa plume pour solliciter avec insistance auprès de Choiseul-Praslin sa promotion au grade de capitaine de vaisseau.
« J’ose vous demander mon avancement avec d’autant plus de confiance que je puis joindre à mes services passés l’avantage d’avoir servi dans l’expédition de la côte de Tunis. C’est une circonstance unique qu’un officier de la marine se soit trouvé commandant une galère de Malte opérant avec une escadre française. La grâce que je demande ne peut tirer à conséquence et serait une preuve de la satisfaction que vous avez du service de nos galères [de Malte]. »[142]
Cette stratégie qui s’efforce de mener de front deux carrières en s’appuyant sur l’une pour faire progresser l’autre demande beaucoup de doigté, outre le culot avec lequel Suffren affiche ses ambitions, comme on peut l’entrevoir dans cette précédente lettre. Il est dommage qu’on ne sache pas exactement quel rôle il a joué à Tunis, mais le nouveau ministre Bourgeois de Boynes, qui vient de succéder à Choiseul-Praslin disgracié, lui marque aussi sa satisfaction, il est vrai un an plus tard, en janvier 1772 :
« Je suis très sensible, Monsieur, au compliment que vous m’avez fait par votre lettre de 10 mai dernier sur la confiance dont le roi m’a honoré en me chargeant du ministère de la Marine. Je serai très aise de me trouver à portée de faire valoir vos services et de procurer à votre zèle toute l’activité que vous désirez. Vous devez avoir reçu une lettre de moi par laquelle vous avez été dans l’expédition de Tunis avec la galère de Malte que vous commandez et j’aurais soin dans l’occasion de rappeler cette époque à Sa Majesté. »[143]
Suffren est promu capitaine de vaisseau le 18 février 1772 et arrive à Toulon au mois de juillet de la même année pour réintégrer la marine royale.
Les campagnes en Méditerranée et en Atlantique (1772-1777)
En mission de présence en Méditerranée orientale sur la frégate la Mignonne
 Après un chébec et une galère, Suffren reçoit en 1772 le commandement d'une frégate. Sur la Mignonne de 26 canons il doit assurer une mission de protection des intérêts français au Levant pendant la guerre Russo-Turque. (Pierre Ozanne)
Après un chébec et une galère, Suffren reçoit en 1772 le commandement d'une frégate. Sur la Mignonne de 26 canons il doit assurer une mission de protection des intérêts français au Levant pendant la guerre Russo-Turque. (Pierre Ozanne)
 Suffren parcourt plusieurs fois la Méditerranée orientale, région sous souveraineté ottomane mais troublée par la guerre Russo-Turque. (Carte de l'Empire ottoman en 1801)
Suffren parcourt plusieurs fois la Méditerranée orientale, région sous souveraineté ottomane mais troublée par la guerre Russo-Turque. (Carte de l'Empire ottoman en 1801)
Depuis Toulon, Pierre-André s’adresse une nouvelle fois au ministre pour se porter candidat à la direction de la compagnie des gardes de Toulon[144], un poste très recherché et prestigieux puisqu’on y forme les jeunes officiers. Bourgeois de Boynes ne donne pas suite à la demande mais lui accorde la commandement de la frégate la Mignonne[145]. C’est une unité assez légère de 26 canons et 224 hommes d’équipage, lancée en 1767. Suffren a 43 ans. C’est maintenant un personnage d’un poids suffisant pour pouvoir choisir une partie de ses officiers et officiers mariniers (certains viennent du Singe) ou d’embarquer des membres de sa famille parmi les gardes de la marine (comme deux de ses neveux, fils de sa sœur Mme de Pierrevert)[146].
La mission du navire est loin d’être anodine, puisqu’il s’agit d’aller patrouiller en Méditerranée orientale, une région secouée par les troubles causés par la guerre Russo-Turque. Celle-ci, engagée depuis 1768 tournait au désavantage de la Turquie. La Russie progressait sur terre le long du Danube, envahissait la Crimée et réussissait l’exploit de déployer une escadre en Méditerranée depuis la Baltique en passant par l’Atlantique. Cette flotte avait infligée en 1770 à Tchesmé une lourde défaite à des vaisseaux turcs pourtant largement supérieurs en nombre et mettait la main sur plusieurs îles de la mer Egée. C’était aussi un défi à la France, alliée traditionnelle de la Turquie, (pour faire face à l’Autriche il est vrai, et pas à la Russie), mais la diplomatie de Louis XV, en panne, se désintéressait de cette guerre qui avait aussi pour conséquence de provoquer une vive agitation anti-chrétienne dans de nombreuses villes littorales, alors même que la France était normalement reconnue par la Turquie comme la protectrice des Chrétiens d’Orient...
C’est donc pour une région sous tension que la frégate appareille le 24 novembre, avec pour mission d’y protéger les intérêts français en rejoignant la division navale de M. de Blotfier qui y patrouille déjà. Suffren fait escale à Malte puis arrive en Crète où on embarque un pilote côtier spécialiste des îles grecques et de la Syrie. A Smyrne, très importante « échelle » de la côte turque où réside une forte colonie marchande française, des troubles sont signalés. Suffren décide de s’y rendre « pour donner à la nation toute la protection et tous les secours qu’on pourra. »[147] Fausse alerte cependant, le consul de France signalant que tout est calme à Smyrne « pour le moment ». Suffren pousse jusqu’aux Dardanelles et escorte des navires marchands français menacés par des pirates grecs et des corsaires russes. Ces derniers étant plus ou moins confondus, puisque sous le pavillon corsaire russe se cachent de nombreux marins grecs en révolte contre le Sultan... Ces derniers ne se montrent pas toujours respectueux de la neutralité française qui en principe devrait même protéger les marchandises françaises embarquées à bord des bâtiments turcs. La Mignonne croise au large de Chio une escadre russe de 6 vaisseaux et 4 frégates, ce qui donne lieu à un échange presque glacial, au dire du récit que Suffren fait au ministre : « Une des frégates fit route pour venir me parler et après quelques compliments fort polis, on me demanda d’où je venais. Trouvant la demande indiscrète, je lui répondis qu’il voyait que j’escortais un convoi de ma nation et cette réponse qui lui prouvait que je n’en voulais pas faire d’autre et qu’en même temps je protégeais les bâtiments qui était avec moi parut le satisfaire. »[148] A bon entendeur…
Au début de 1773, la Mignonne sort de la mer Egée et se présente devant Seyde (Sidon), escale d’ailleurs prévue par l’ordre de mission pour y récupérer le consul de France. Le calme est revenu dans la ville après une période troublée, même si la colonie française est en butte aux tracasseries du représentant local du Sultan. Suffren fait ensuite escale à Beyrouth, à Chypre, puis à nouveau à Smyrne, à la demande de De Blotfier. La situation, apaisée au premier passage (voir plus haut) s’est de nouveau dégradée. Les autorités Turques semblent incapables de s’opposer aux entreprises d’une « populace effrénée et avide désordres. »[149]. Les défaites ottomanes affaiblissent l’autorité du Sultan, ce qui laisse le champ libre à une agitation religieuse, une partie de la population musulmane, par fanatisme ou ignorance en venant à placer tous les Chrétiens et Européens au rang de leurs ennemis censés repartir en croisade... De Blotfier et Suffren constatent d’ailleurs que les Anglais, dont les intérêts dans ces eaux sont bien moindre que ceux de la France, y maintiennent en permanence une ou deux frégates.
La Mignonne rentre à Toulon le 19 juin 1773, après sept mois de campagne. Suffren se montre a peine content du navire qui ne marche pas assez vite à son goût, mais fait un compte-rendu élogieux sur l’équipage :
« Je n’ai qu’à me louer de la subordination et du zèle des officiers qui ont servi avec moi. (…) J’ai été content de mon équipage en général, surtout sur la fin de la campagne. Permettez-moi de remarquer qu’il n’y a que les campagnes longues qui puissent fournir de bon équipages. Les Anglais qui laissent des bâtiments armés des années entières ont bien des avantages sur nous à cet égard. Les précautions que j’ai prises pour conserver dans le bord la salubrité de l’air et préserver mon équipage des maladies m’ont heureusement réussi car il ne m’est mort personne et j’ai même eu très peu de maladies graves. »[150]
On retrouve dans ce courrier plusieurs des traits caractéristiques de Suffren. Le premier, déjà constaté, tient au soin des équipages, le deuxième tient à l’analyse qu’il en tire et sur lesquels les Historiens sont d’accord : les équipages manquent d’entraînement, contrairement aux Anglais qui ont une pratique plus poussée de la navigation en temps de paix[151]. Mais comment peut-il en être autrement, alors que depuis le renvoi de Choiseul (1770) la marine doit de nouveau se contenter de budgets réduits. On fait des économies sur l’entraînement : l'escadre d'évolution, voulue par Bourgeois de Boynes n'a brièvement navigué qu'en 1772 avant de rester inactive en 1773, ce que semble déplorer ici Suffren. On trouve aussi dans le ton de la dernière phrase une forme d’autoglorification bien dans les habitudes du bailli qui sait placer discrètement la bonne tournure pouvant aider à son avancement…
Suffren reste sans emploi jusqu’au mois d’octobre 1774, date à laquelle il reprend le commandement de la Mignonne. Louis XV est mort en mai de cette même année. Le nouveau roi a pris de nouveaux ministres, la marine étant confiée à Sartine, l’ancien chef de la police à Paris. L’échange de courrier entre les deux hommes, plein d’amabilités, semble indiquer que Pierre-André a « négocié » sans dommage le moment toujours périlleux dans une carrière d’un changement de patron[152]. Malade, (il souffre d’une « fièvre putride ») il explique au ministre que sa nomination au commandement de la frégate l’a aidé dans sa convalescence[152] : une petite goute de courtisanerie ne peut pas faire de mal… La nouvelle mission de la Mignonne se déroule entre la fin octobre 1774 et le mois de juin 1775. On ne sait pas grand-chose de cette campagne qui se déroule comme la précédente en Méditerranée orientale mais avec des escales supplémentaires à Zante et à Tunis. A son retour, Suffren exprime à nouveau la satisfaction qu’il a tiré du navire et de l’équipage, puis s’en va passer la fin de l’année 1775 dans sa commanderie de Saint-Christol, près de Lunel, où il n’a encore jamais séjourné.
En escadre d'évolution et toujours des ambitions à Malte
 Modèle réduit d'un vaisseau de 64 canons du même type que le Fantasque dont Suffren reçoit le commandement en 1777. (Musée national de la Marine, Paris)
Modèle réduit d'un vaisseau de 64 canons du même type que le Fantasque dont Suffren reçoit le commandement en 1777. (Musée national de la Marine, Paris)
 Sur le Fantasque, Suffren participe aux exercices à Toulon lors de la visite du frère de Louis XVI et de l'empereur d'Autriche.
Sur le Fantasque, Suffren participe aux exercices à Toulon lors de la visite du frère de Louis XVI et de l'empereur d'Autriche.
Suffren fait maintenant partie des capitaines de vaisseau bien connus du ministère et suffisamment appréciés pour que l’on ne se passe plus de leurs services. C’est un homme expérimenté dans une flotte où les officiers manquent souvent d’entraînement. C’est aussi ce que pense le ministre Sartine qui décide de remettre au goût du jour l’escadre d’évolution voulue par son prédécesseur mais qui n’a que très peu navigué, en 1772 et 1774. Les ordres donnés à Du Chaffault, l’un des meilleurs officiers du règne précédent, et à qui échoit le commandement de cette escadre sont clairs : « Les armements qui s’exécutent annuellement dans les différents ports, soit pour les colonies et le Levant, soit pour le cabotage n’étant jamais assez nombreux pour occuper et instruire les officiers, les gardes et les troupes de la marine, ni pour former les équipages, Sa Majesté a pensé à propos d’y suppléer en mettant cette année en mer une escadre d’évolution composée d’un nombre de bâtiments suffisants pour exercer une partie de sa marine et exécuter toutes les manœuvres de navigation et de guerre auxquelles les officiers ne peuvent être trop accoutumés pour l’avantage de son service »[153].
L’escadre d’évolution doit être formée par 2 vaisseaux, 3 frégates, 3 corvettes et 2 cutters de Brest, 2 frégates et une corvette de Rochefort, 1 vaisseau, 2 frégates et une corvette de Toulon. Tous les navires doivent embarquer des états-majors pléthoriques pour les besoins de l’instruction. Suffren, qui fait partie de la division de Toulon reçoit le commandement de l’Alcmène, une frégate récente (1774) de 26 canons d’un modèle voisin de celui de la Mignonne[154]. La division toulonnaise appareille le 30 avril 1776 pour rejoindre celle sortie de Brest avec Du Chaffault. Cette dernière, est ralliée le 1er mai par la division de Rochefort, et le 15 par celle de Toulon, au large du cap Saint Vincent. Du Chaffault descend vers les côtes marocaines, défile devant Larache puis remonte dans l’Atlantique le long des côtes portugaises et enfin au large d’Ouessant. Les manœuvres montrent qu’effectivement nombre d’officiers manquent d’entrainement. Deux navires s’abordent même au large du Portugal, le Solitaire et la Terpsichore. Le premier est commandé par un prince de sang, le très (trop) jeune duc de Chartres qui a fait ses débuts l’année précédente dans la marine comme volontaire et qui a visiblement bénéficié d’un avancement trop rapide…
La tension est palpable avec les Anglais, qui observent d’un œil méfiant cette escadre d’évolution alors que la révolte gronde dans leurs treize colonies d’Amérique. Depuis le 12 mai 1776, le roi a donné ordre à ses vaisseaux de protéger les bâtiments insurgents ou ceux des États neutres qui demanderaient la protection du pavillon français[155]. Les incidents dans les Antilles ou au large de Terre-Neuve sont fréquents. Il faut tirer un coup de canon pour écarter une frégate anglaise qui cherche à traverser la formation qui navigue en ligne de file. Le 7 août, après plus de deux mois de manœuvre, la division toulonnaise reçoit l’autorisation de rentrer sur sa base. On ne sait pas quel rôle a joué Suffren dans l’entrainement des officiers qu’il avait sous sa responsabilité. Le temps est mauvais et le scorbut a commencé à se déclarer dans l’escadre. L’Alcmène rentre à Toulon le 26 octobre. Suffren sollicite un congé de trois mois pour se rendre à Malte, ou l’attendent des affaires importantes.
Nous avons vu un peu plus haut que Suffren s’efforce de mener de front ses deux carrières au service du roi de France et de Malte en s’appuyant sur l’une pour faire progresser l’autre. C’est ainsi qu’il a fait valoir ses états de service pendant l’expédition de Tunis pour obtenir sa promotion au grade de capitaine de vaisseau. Suffren guigne maintenant beaucoup plus : le Généralat des galères de Malte. Il s’en est ouvert au ministre dès novembre 1772 alors qu’il apprêtait à partir en mission en mer Egée sur la Mignonne. On découvre dans ces courriers un Suffren qui semble persuadé du poids de ses relations auprès du Grand Maître Pinto, (extrêmement âgé, 93 ans), au point d’indiquer au ministre la bonne personne à contacter, c'est-à-dire le vice chancelier de l’ordre qui exerce la réalité du pouvoir. « Il est de mes amis et il ne vous en coûtera qu’une lettre pour doubler ma fortune. » écrit sans mettre de gants le trop sûr de lui bailli[156]. Mais le poste est très prestigieux et donc très convoité. La nomination n’arrive pas, d’où d’autre courriers pressants au ministre et pour finir une demande de congés en octobre 1776 pour se rendre à Malte. On ne sait rien de ce séjour de trois mois mis à profit par Pierre-André pour faire progresser ses « affaires ».
L’année 1777 s’écoule sans que Suffren obtienne satisfaction, mais sa progression dans la marine royale se poursuit. Il accède enfin au commandement d’un vaisseau, le Fantasque, un 64 canons qui fait partie des 6 grosses unités que Toulon arme au début de l’année. La petite escadre est armée en avril 1777 pour faire une démonstration lors de la visite à Toulon de l’empereur d’Autriche Joseph II qui voyage incognito en compagnie du frère de Louis XVI, le comte de Provence[157]. Après la démonstration en rade (août), le Fantasque fait une croisière d’un mois à peine en Méditerranée et qui ne laisse guère satisfait un Suffren toujours sourcilleux sur l’entrainement[158]. Au début de 1778, Pierre-André semble enfin obtenir satisfaction en accédant -enfin- au très convoité généralat des galères de Malte. Les négociations, qui ont fait jouer encore une fois le ministre de la marine semblent avoir été particulièrement compliquées, d’autant que Suffren n’exercera pas le commandement. La guerre, qui reprend cette même année avec l’Angleterre appelle Pierre-André à d’autres responsabilités. Il semble que la charge ait-été confiée à son frère, Paul-Julien qui l’exercera à la place de son ainé, pourtant signalé sur les tablettes officielles de l’ordre comme Generale delle galere du 11 septembre 1780 au 31 août 1782[159].
Suffren dans la guerre d'Amérique : l'ascension vers les hautes responsabilités (1778-1780)
 Louis XVI (1754-1793) en 1776. Le jeune souverain suit attentivement les affaires navales. Les crédits pour la marine de guerre décuplent pendant son règne.
Louis XVI (1754-1793) en 1776. Le jeune souverain suit attentivement les affaires navales. Les crédits pour la marine de guerre décuplent pendant son règne.
En 1774, à la mort de Louis XV la France aligne 62 vaisseaux et 37 frégates. C’est un net redressement, mais on est encore très au-dessous des objectifs affichés en 1763. Cependant, le nouveau souverain, Louis XVI se montre beaucoup plus réceptif à l’idée de revanche sur l’Angleterre que son prédécesseur. Le contexte est donc nettement plus favorable, d’autant que le jeune souverain est aussi amateur de géographie et suit attentivement les questions navales. Les crédits se mettent à abonder, d’autant que la tension remonte lentement entre la France et l’Angleterre. Le 4 juillet 1776, les treize colonies anglaises d’Amérique, en révolte contre les impôts et la présence militaire anglaise permanente proclament leur indépendance. Les « Insurgents » qui manquent de tout, se tournent vers l’ancien ennemi de la guerre précédente : la France, qui leur prête d’abord une oreille prudente, puis attentive, et s’engage progressivement dans le conflit. L’occasion d’affaiblir l’Angleterre est trop belle et le gouvernement français ne peut pas la laisser passer. Louis XVI reçoit fort aimablement l'envoyé du Congrès des Etats-Unis, Benjamin Franklin, venu solliciter l'aide de la France, laisse des corsaires américains opérer depuis les ports français, autorise des volontaires français (La Fayette et de nombreux autres jeunes nobles) à aller se battre outre-Atlantique, livre secrètement des armes, et finit par reconnaître les États-Unis en février 1778 après la défaite d’une armée anglaise à Saratoga. C’est la rupture : le 17 juin 1778, la nouvelle guerre franco-anglaise s’engage avec l’attaque de la frégate anglaise l’Aréthuse contre la frégate française La Belle Poule, qui résiste vaillamment.
La déclaration de guerre déclenche un torrent d’euphorie guerrière qui parcourt tout le pays : « L'enthousiasme des foules était à son comble, témoin de la force inouïe du patriotisme et du désir unanime de gloire des Français » note Jean-Christian Petitfils[160]. L'abbé de Véri, qui se trouve alors à Versailles n'entend qu'un seul cris dans les couloirs : « Guerre ! Guerre ! »[161]. On a le sentiment que la marine française est enfin capable de se mesurer à la Royal Navy et d'effacer la honte du précédent conflit. La mobilisation navale va dépasser tout ce que la France a connu jusque-là en matière de guerre outre-mer. À Brest, Toulon, Rochefort, les arsenaux vont bruisser presque jour et nuit de l’armement des escadres.
Versailles à la recherche d'une stratégie
L’Angleterre qui doit fixer des forces navales et terrestres considérables en Amérique du Nord a perdu l’initiative du conflit et n’est plus en mesure de rééditer la rafle de 1755 qui lui avait grandement facilité la victoire. Côté français on hésite cependant sur la stratégie à suivre car il reste un écart numérique non négligeable en faveur de la Royal Navy, et le ministre de la marine, Antoine de Sartine n’est pas absolument certain de la qualité de l’entrainement des officiers. Louis XVI et son ministre des affaires étrangères, Vergennes, restent de leur côté persuadés qu’il faudra solliciter l’alliance espagnole pour établir une balance des forces plus favorable, mais à Madrid il n’est absolument pas question d’apporter le moindre soutien aux « Insurgents ». Certes, on a rien oublié des humiliations de la guerre de Sept Ans, mais on craint encore plus un effet de contamination révolutionnaire dans les colonies espagnoles.
Le roi finit par approuver la stratégie proposée par le ministre de la marine qui propose d’utiliser séparément les escadres de Brest et de Toulon. La puissante escadre de Brest (30 vaisseaux et 16 frégates), confiée à l'amiral Louis Guillouet d'Orvilliers, reçoit pour mission de combattre dans la Manche en vue de préparer une éventuelle invasion de l’Angleterre, et surtout de convaincre les Espagnols (qui doutent des capacités navales de la France) d’entrer en guerre. L’escadre de Toulon, plus modeste (12 vaisseaux et 5 frégates) doit franchir l’Atlantique pour aller prêter main forte aux « Insurgents » et si possible obtenir un succès décisif qui pousserait l’Angleterre vers la table des négociations. Mission tout à fait considérable, mais jouable à condition de préserver l’effet de surprise sur les escadres anglaises divisées entre New York et Halifax[162]. Suffren, qui depuis 1777 commande le Fantasque se trouve intégré à l'escadre.
Suffren dans l’océan Atlantique (Côtes américaines et Antilles)
Sous les ordres de d'Estaing
 Charles Henri d'Estaing assure le commandement de l'escadre envoyée en Amérique du Nord en 1778-1779. Il apprécie Suffren et reconnait ses talents de marin. L'inverse n'est cependant pas vrai, Suffren se montrant très critique sur son chef.
Charles Henri d'Estaing assure le commandement de l'escadre envoyée en Amérique du Nord en 1778-1779. Il apprécie Suffren et reconnait ses talents de marin. L'inverse n'est cependant pas vrai, Suffren se montrant très critique sur son chef.
C’est un curieux personnage qui reçoit le commandement de l'escadre pour l'Amérique. Charles Henri d'Estaing (1729-1794) est en 1778 un vice-amiral qui a connu une carrière fulgurante depuis la guerre de Sept Ans. Il avait combattu lors de ce conflit sous les ordres de Lally-Tollendal avant de s’improviser marin et de mener une active guerre de course dans l’océan Indien où il avait saccagé de nombreux comptoirs anglais. Ces victoires remarquées -dans cette guerre où la France essuyait de dures défaites- lui avaient valu de très rapides promotions dans l’armée de Terre puis la Marine. Victoires et promotions qui masquaient mal ses graves défauts. Le personnage, fier de sa réussite et grisé de ses succès passés était péremptoire, cassant, maladroit, démagogue... Il s’était très vite attiré par ses critiques et remarques désobligeantes l’inimitié du corps des officiers, dont beaucoup étaient plus âgés que lui[163]. Mais c’était aussi un excellent courtisan qui avait su entrer dans l’amitié de feu Monseigneur le Dauphin, père du futur Louis XVI. C’est de là que venait sa nomination au commandement de l’escadre : le jeune roi l’avait choisi car il était sur la liste des personnes à promouvoir que lui avait laissé son père.
D’Estaing et Suffren se rencontrent à Toulon en 1778 lorsque le bailli vient se placer sous ses ordres. Une rencontre déterminante pour Suffren, car d’Estaing qui apprécie et reconnait rapidement les talents de son subordonné ne va plus cesser de rendre des rapports élogieux à son égard, alors même que Suffren restera toujours très critique vis-à-vis de son chef[164].
L’escadre dont dispose d’Estaing n’est pas de première main. La moyenne d’âge de ces 12 vaisseaux est de 21 ans. Le plus récent, le César a été mis sur cale 11 ans plus tôt. L’un des deux vaisseaux de 80 canons, le Tonnant est un vétéran de 38 ans d’âge qui a traversé deux guerres dont une bataille acharnée à laquelle le jeune Suffren avait participé, le combat du cap Finisterre en 1747 (voir plus haut). Quant au Languedoc, vaisseau amiral mis en chantier 16 ans plus tôt lors du « don des vaisseaux », il n’a encore jamais navigué... L'escadre est complétée d'une force d'éclairage de 5 frégates. Le Fantasque, lancé en 1758 fait partie des vétérans, mais il est en bon état et c'est un navire assez rapide. Il embarque au total 627 hommes, en comptant les troupes de marine, les officier, sous-officiers, les mousses. L’essentiel des matelots vient des côtes provençales et languedociennes, ce qui n’est pas pour déplaire à Suffren[165].
L'escadre appareille pour l’Amérique le 13 avril 1778 (alors que la guerre n’est même pas encore officiellement déclarée)[166]. D’Estaing dispose d’ordres qui lui laissent presque carte blanche. Versailles lui recommande d’attaquer les ennemis « là où il pourrait leur nuire davantage et où il le jugerait le plus utile aux intérêts de Sa Majesté et à la gloire de ses armes ». On lui recommande encore de ne pas quitter les côtes américaines avant d’avoir « engagé une action avantageuse aux Américains, glorieuse pour les armes du roi, propre à manifester immédiatement la protection que Sa Majesté accorde à ses alliés »[167]. L’escadre embarque aussi Silas Deanes, député du Congrès américain et le comte Conrad Alexandre Gérard, ministre plénipotentiaire du roi auprès du Congrès.
La traversée est interminable. À cause des alternances de calme et de vents contraires, l’escadre met 33 jours pour atteindre Gibraltar (16 mai) puis encore 51 jours pour traverser l’Atlantique. D’Estaing, qui n’écoute personne, a trouvé le moyen de prendre la plus mauvaise route[168] puis de perdre encore beaucoup de temps à organiser des exercices de manœuvre dans l’Atlantique. Il arrive à l’embouchure de la Delaware le 7 juillet après plus de 80 jours de traversée... L’effet de surprise est perdu, même si pour se consoler on détruit deux frégates. Howe s’est retiré le 28 juin avec ses 9 vaisseaux pour regrouper ses forces avec celles de Byron, soit 20 vaisseaux. D’Estaing, après avoir débarqué les deux émissaires franco-américains à Chester (près de Philadelphie) se présente devant New York. Mais la ville est défendue par les 12 000 hommes du général Henry Clinton et les pilotes américains font remarquer que le fond manque pour laisser accéder les plus gros vaisseaux à la baie intérieure de New York. D’Estaing, prudent, refuse de forcer les passes de la ville et concocte un nouveau plan avec George Washington (auquel collabore La Fayette) qui propose d'attaquer Newport.
Echec à Newport (août 1778)
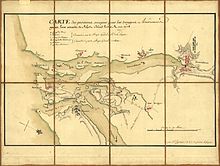 La baie de Newport en 1778. Les Franco-Américains ont beaucoup de mal à coordonner leur action pour tenter de s'emparer de Newport, sur l'île principale. (Carte française de 1778)
La baie de Newport en 1778. Les Franco-Américains ont beaucoup de mal à coordonner leur action pour tenter de s'emparer de Newport, sur l'île principale. (Carte française de 1778)
 Entrée de l'escadre française dans la baie de Newport le 8 août 1778. Suffren s'illustre lors de cette attaque en forçant 5 frégates anglaises à s'échouer et à s'incendier (Lavis de Pierre Ozanne, 1778).
Entrée de l'escadre française dans la baie de Newport le 8 août 1778. Suffren s'illustre lors de cette attaque en forçant 5 frégates anglaises à s'échouer et à s'incendier (Lavis de Pierre Ozanne, 1778).
 Le port de Boston en 1768. La population réserve un accueil mitigé à l'escadre française venue réparer ses avaries après l'échec devant Newport. (Illustration de Paul Revere, Boston Public Library)
Le port de Boston en 1768. La population réserve un accueil mitigé à l'escadre française venue réparer ses avaries après l'échec devant Newport. (Illustration de Paul Revere, Boston Public Library)
Le 12 juillet, la flotte prend la direction de l’importante base anglaise de Newport, devant laquelle elle se présente le 29. Le plan prévoie de bloquer la place par la mer tandis que les miliciens du général Sullivan doivent débarquer dans le nord de l’île de Rhode Island. Newport, en effet, se trouve sur la plus grande île de la baie de Narragansett, laquelle pénètre profondément à l’intérieur des terres (carte ci-contre). L’accès à la baie n’est possible que par trois chenaux relativement étroits et assez peu profonds, dans lesquels on ne peut engager que des frégates ou des 64 canons. Mais la coordination avec les forces américaines du général Sullivan se passe mal. Les troupes de Sullivan ne sont pas rassemblées et le général américain demande qu’on l’attende. L’effet de surprise est perdu. Face aux 6 000 anglais qui défendent la place, il faut se contenter de laisser l’escadre stationner à hauteur de la passe centrale pour en assurer le blocus.
D’Estaing donne cependant l’ordre à deux frégates de pénétrer dans le chenal de l’est, où elles détruisent une corvette de 20 canons et deux galères. L’opération dans le chenal ouest est confiée à Suffren, à la tête de deux vaisseaux, le Fantasque (64) et le Sagittaire (50) commandé par son ami Albert de Rions. La coordination entre les deux hommes est parfaite. Le 5 août, les deux vaisseaux contournent l’île Conanicut par l’ouest et réduisent au silence les deux batteries qui s’y trouvent, puis pénètrent dans la baie de Newport où ils sèment la panique. Voici le compte-rendu rédigé par Suffren pour d’Estaing :
« En conséquence de vos ordres, j’ai appareillé avec le Sagittaire à la pointe du jour. J’ai aperçu par-dessus Conanicut deux frégates anglaises à la voile. Lorsque j’ai paru entre cette île et celle de la Prudence, une venait sur moi au bord opposé, mais elle a bientôt viré de bord. J’ai mis le cap sur elle passant sous le vent des roches. Le Sagittaire a passé au vent. J’étais toutes voiles dehors lorsque la frégate qui ne pouvait nous échapper a donné à terre à pleines voiles, a coupé ses mâts et s’est embrasée. Trois bâtiments mouillés dans une anse que je vous ai décrite dans une de mes lettres se sont aussi brûlés. Deux autres frégates qui étaient à la voile dans le canal de Rhode Island et de Prudence ainsi qu’un brick se sont aussi brûlés. J’ai vu beaucoup de fumée par dessus la ville, ce qui peut faire imaginer qu’il y a eu aussi quelques bâtiments brûlés dedans le port. J’ai fait deux bords dans la rade de Conanicut, tant pour sonder que m’assurer que les bâtiments étaient réellement consumés et pour faire jouir mon équipage de ce spectacle qui aurait été bien plus flatteur si on avait couru quelque danger. Je n’ai vu dans cette partie aucune batterie car outre que je m’en suis approché à moins d’une portée de canon et qu’on n’a pas tiré sur nous, plusieurs petits corsaires américains sont venus pour piller après m’en avoir demandé la permission et l’on n’a pas tiré sur eux[169]. »
Ce raid, qui coûte aux Anglais 5 frégates[170] et quelques petits bâtiments, aurait été salué d'un « Bravo Suffren » lancé par d’Estaing à son brillant subordonné. Le 8 août, enfin, les Américains font savoir qu’ils sont prêts à attaquer. D’Estaing laisse 2 vaisseaux en couverture au large, détache 3 frégates pour fournir un appui feu aux troupes de Sullivan, et force la passe centrale avec 8 vaisseaux en échangeant une vive canonnade avec les batteries de la place. Il est rejoint par Suffren qui rentre de son raid avec ses 2 vaisseaux, alors qu’on prévoit l’attaque franco-américaine pour le 10 août. Mais le 9, les deux vaisseaux laissés en couverture entrent à toutes voiles dans la baie pour signaler l’arrivée d’une forte escadre anglaise. Ce sont les 14 vaisseaux de Howe, sorti de New York après avoir reçu des renforts importants et qui se trouve maintenant en position de bloquer les Français dans la baie. D’Estaing fait rembarquer immédiatement les troupes à peine mises à terre, et profite d’un vent favorable au matin du 10 pour sortir de la nasse en coupant ses câbles. Howe, surpris par cette manœuvre hardie se dérobe. La situation se retourne même complètement puisque d’Estaing se lance à la poursuite de l’Anglais. Dans l’après-midi du 11, l’escadre française est prête à engager le combat, mais la météo s’en mêle et une violente tempête qui se poursuit toute la nuit disperse les deux flottes[171].
Le Languedoc perd son gouvernail, démâte, et se retrouve au matin totalement isolé, roulant bord sur bord. On frise la catastrophe lorsqu’un petit vaisseau anglais isolé vient brièvement attaquer le navire amiral qui ne peut se défendre[172]. Le grand bâtiment à la dérive finit par réussir à mouiller près de la Delaware, rejoint le 14 août par les autres vaisseaux de l’escadre avec encore un vaisseau démâté, le Marseillais, que remorque le Sagittaire. Seul manque à l’appel le César, mais ce dernier est parti se réfugier à Boston, point de ralliement fixé en cas de séparation.
Contre toute attente, malgré les avaries et le scorbut, d’Estaing décide de tenter une nouvelle attaque sur Newport. Le 20 août, les Français sont de nouveau devant la place. Un conseil de guerre réuni à bord du Languedoc fait le point sur les possibilités de faire tomber rapidement la ville. L'opération apparait comme impossible, même en doublant les troupes mises à terre (les Américains demandent 600 hommes, d’Estaing se dit prêt à en fournir 1 200). Le 22 août, le siège est abandonné : l’escadre lève l'ancre pour Boston afin d'y réparer les vaisseaux, les ravitailler et soigner les malades. Une nouvelle déconvenue attend les Français : l’accueil plutôt glacial de la population bostonienne. Si la cause américaine était populaire en France, l’inverse n’était pas tout à fait vrai pour ce qui est de l’aide française... Les Américains sont circonspects face à ces nouveaux venus, réputés pour être des coureurs de jupons légers et frivoles. La population, profondément protestante, se méfie aussi de ces Français « papistes » (catholiques) autrefois leurs ennemis. Les rixes entre Bostoniens et marins français sont fréquentes[173].
Une véritable crise de confiance semble même saisir les deux alliés après le retrait devant Newport. Les Américains considèrent celui-ci comme « dérogatoire à l’honneur de la France, contraire aux intentions du roi et aux intérêts de la nation américaine » [174]. Il faut tout le sens diplomatique de George Washington, bien secondé par La Fayette, pour apaiser ces tensions, alors que côté Français on se plaint du manque d’esprit de coopération des nouveaux alliés, qui parlent fort, exigent beaucoup et n’ont que peu de moyens matériels. Les eaux de la côte américaine sont inconnues des marins français qui dépendent des pilotes américains, à la fiabilité pas toujours certaine. On se rend compte aussi que le port de Boston n’est absolument pas équipé pour entretenir des grands bâtiments de combat et il faut tout improviser. La baie de Boston offre cependant un bon mouillage facile à défendre. En quelques jours, on met en place un puissant dispositif. Les 3 vaisseaux les plus abimés sont mouillés à Quincy bay sous la protection d'un vaste camp retranché et de plusieurs batteries. Les 9 vaisseaux les plus valides sont embossés en demi cercle dans la rade Nantasket, eux aussi protégés par des batteries. Lorsque le 1er septembre, l'escadre de Howe, encore renforcée de plusieurs vaisseaux des forces de Byron se présente devant Boston, elle ne peut que constater la solidité des défenses françaises et se retire sans avoir rien tenté[175].
Les semaines passent. Les réparations sont achevées, les équipages reposés, mais il faut se rendre à l’évidence : l’escadre française est au point mort. D’Estaing n’a aucun plan de rechange et semble frappé d’inertie. Ses subordonnés tentent alors de lui en souffler d’autres, à commencer par Suffren qui propose une attaque sur Terre-Neuve avec un petit détachement de 2 vaisseaux et 2 frégates dont il prendrait la tête pour saccager les pêcheries, nombreuses dans le secteur et saisir les navires de commerce qui vont et viennent autour d'Halifax, Louisbourg et le Canada[176]. Puis c’est La Fayette qui défend un projet voisin avec une attaque sur la base anglaise d’Halifax en Nouvelle-Écosse[173]. D’Estaing refuse les deux projets. Il est vrai qu'il a déjà exploré sans succès la piste canadienne puisqu'il a fait placarder des affiches pour inciter les Québécois à combattre au côté du roi de France, mais ces derniers ont refusé de se ranger auprès de ceux qui ont été leurs ennemis les plus acharnés lors des guerres précédentes[177]. Les chances pour l’escadre d’entreprendre quoi que se soit de victorieux s’amenuisent de jour en jour alors même que les généraux anglais, que cette force française rend très inquiets, évacuent Philadelphie, haut lieu de la résistance des « Insurgents »[178]. Le 17 octobre, la crise de confiance franco-américaine est totalement digérée puisque le Congrès des États-Unis rend un hommage vibrant à d'Estaing et à ses hommes[179], mais la saison est maintenant trop avancée pour envisager la reprise des opérations. En novembre, d’Estaing sort enfin de sa torpeur et profite d'un méchant coup de vent qui disperse l'escadre anglaise devant Boston pour appareiller vers la Martinique (le 4), où il arrive le 9.
Suffren face au maigre bilan de la campagne 1778
 Le 15 décembre 1778, les 12 vaisseaux de d'Estaing (à gauche) surprennent au mouillage à Sainte-Lucie les 7 vaisseaux de Barrington (à droite). Malgré les conseils de Suffren, d'Estaing préfère débarquer ses troupes plutôt qu'engager la bataille.
Le 15 décembre 1778, les 12 vaisseaux de d'Estaing (à gauche) surprennent au mouillage à Sainte-Lucie les 7 vaisseaux de Barrington (à droite). Malgré les conseils de Suffren, d'Estaing préfère débarquer ses troupes plutôt qu'engager la bataille.
Les Antilles étaient la seule source de victoire pour la France, mais sans d’Estaing, puisqu’entre temps, (en septembre) le marquis de Bouillé, gouverneur général des Îles du Vent avait attaqué victorieusement avec 3 frégates, une corvette et deux régiments l'île de la Dominique, perdue en 1763. C’était presque une leçon d’efficacité militaire administrée à d’Estaing qui disposait de moyens bien supérieurs.
Cette victoire est rapidement contrebalancée par l’amiral Barrington, commandant de la division navale des Antilles, qui profite des renforts apportés de New York pour attaquer Sainte-Lucie le 13 décembre. Le gouverneur de l’île, M. de Micoud, qui n’a que de faibles forces à opposer aux 5 000 « tuniques rouges » qui ont débarqué, se replie vers l’intérieur de l’île. Sainte-Lucie est voisine de la Martinique. Il faut réagir immédiatement. D’Estaing appareille aussitôt en embarquant 3 000 hommes de troupe et se présente le 15 décembre devant l’île. Il découvre l’escadre anglaise embossée à l’entrée de la baie du grand Cul-de-sac : 7 vaisseaux ou frégates et une poignée de petites unités. Les Français disposent de 12 vaisseaux. C’est une occasion unique d’attaquer, même si la division anglaise peut compter sur le soutien d’une forte batterie côtière. Peine perdue, on se contente de deux lointaines canonnades malgré les supplications de Suffren. L’ancien corsaire, qui garde une mentalité d’homme de l’armée de terre, préfère débarquer son contingent un peu plus loin avec des pièces d’artillerie de marine et tenter un assaut en règle, le 18 décembre. C’est un sanglant échec qui coûte la vie à 800 hommes, dont 40 officiers tués ou blessés. Suffren, extrêmement inquiet, fait remarquer que les vaisseaux français désarmés par le débarquement d’une partie de leur artillerie et de leurs équipages sont maintenant extrêmement vulnérables si vient à se présenter l’escadre de Byron dont on sait qu’elle croise dans le secteur[180]. Le bailli conseille à son chef de ré-embarquer et d’attaquer les 7 vaisseaux anglais au mouillage avant l’arrivée de Byron, contre qui on pourra se retourner après[181]. D’Estaing rembarque donc, mais pas pour attaquer. Le 24 décembre, il lève l’ancre et regagne piteusement Fort-Royal (aujourd’hui Fort-de-France), contraignant la garnison de Sainte-Lucie à la reddition. Cet « échec inexcusable[182] » livre aux Anglais un excellent mouillage aux portes de la Martinique que la Royal Navy saura utiliser à son avantage[183].
Compte tenu des objectifs affichés au début de l’année (voir plus haut) on n’était pas très loin du fiasco. D’Estaing s’était révélé un chef hésitant, pusillanime et incapable de tirer parti des circonstances[184]. Dans sa correspondance, Suffren laisse éclater sa colère et son dépit :
« Notre campagne a été un enchaînement de vicissitudes, de bonheur, de malheur et de sottises. Depuis 35 ans que je sers, j’en ai beaucoup vu, mais jamais en aussi grande quantité. On ne pourrait imaginer les sottes manœuvres qui ont été faites ; les conseils sots et perfides qui ont été donnés. Enfin, on m’a su mauvais gré d’avoir été d’avis d’attaquer avec 12 gros vaisseaux 7 petits, parce qu’ils étaient défendus par quelques batteries à terre. Je suis on ne peu plus dégoûté de tout ceci, et j’ai bien regret de n’avoir été à Malte »
— [185]
« Jamais campagne n’a été aussi ennuyeuse ; nous avons eu la douleur d’avoir les plus belles occasions et de n’avoir profité d’aucune et nous avons la certitude de n’être capables de rien » juge encore sans appel l’impétueux Bailli »
— [186].
Notons que de l’autre côté de l’Atlantique l’escadre de Brest conduite par l'amiral d'Orvilliers avait rencontré plus de succès en défaisant le 27 juillet 1778 la Royal Navy au large d’Ouessant. Cette belle victoire (non exploitée militairement) rassurait l’Espagne qui s’acheminait vers la guerre contre l’Angleterre. Le reste de l’Europe pouvait constater que si la marine de Louis XVI n’avait pas (encore) pu vaincre, les mers n’étaient cependant plus sous total contrôle anglais comme en 1763[178].
La bataille de la Grenade, ou la victoire sans lendemain (juillet 1779)
 La bataille de la Grenade, le 6 juillet 1779. L'occasion manquée de détruire la flotte anglaise, malgré les conseils de Suffren à d'Estaing. On peut aussi examiner ce plan de la bataille (en allemand).
La bataille de la Grenade, le 6 juillet 1779. L'occasion manquée de détruire la flotte anglaise, malgré les conseils de Suffren à d'Estaing. On peut aussi examiner ce plan de la bataille (en allemand).
Les premiers mois de l’année 1779 sont marquées par une inactivité relative de l’escadre, les équipages ayant besoin de souffler après 9 mois d’une campagne harassante à peine entrecoupée par l’escale de Boston. On monte cependant depuis la Martinique des petites expéditions qui permettent de reprendre des îles secondaires comme Saint-Martin (24 février), Saint-Barthélémy (28 février), ou de faire la conquête de Saint-Vincent (17 juin). Dans les deux camps on reçoit des renforts, signe annonciateur que la campagne va reprendre sur de grands engagements. Venue d’Amérique, l’escadre de l’amiral Byron, forte de 10 vaisseaux arrive à Sainte-Lucie le 6 janvier et reçoit encore un mois plus tard 6 nouveaux vaisseaux. De son côté, d’Estaing voit arriver successivement les 4 vaisseaux du comte de Grasse (19 février), les 2 vaisseaux et les 2 frégates de Vaudreuil qui vient de s’emparer des établissements anglais sur la côte africaine (26 avril) et les 5 vaisseaux de La Motte-Picquet qui a escorté jusqu’à la Martinique un gros convoi marchand de 45 voiles (27 juin). D’Estaing dispose maintenant de 25 vaisseaux[187] et pense dans un premier temps attaquer la Barbade qui abrite une forte base de la Royal Navy, mais la météo ne lui est pas favorable. Il reporte donc son choix sur l’île de la Grenade devant laquelle il se présente le 2 juillet. L’attaque dure deux jours, conduite en personne par d’Estaing, l’épée au point. C’est un plein succès : les 1 200 hommes débarqués balayent la garnison anglaise qui capitule en laissant 700 prisonniers, 3 drapeaux, 102 canons, 16 mortiers et le gouverneur, lord Macartney[184].
Mais le 6 juillet au matin, se présente l’escadre de Byron accompagnée d’un gros convoi de 50 voiles chargé de troupes, sans savoir que l’île est déjà aux mains des Français. Byron, qui pense sans doute qu’une large partie des équipages français sont à terre tente alors un coup d’audace : il se faufile avec ses 21 vaisseaux entre l’île et les 25 vaisseaux de d’Estaing au mouillage, pensant pouvoir les détruire ou les capturer. Mais les équipages sont complets et d'Estaing dispose avec Suffren, De Grasse et La Motte-Picquet de brillants second pour encadrer l'escadre. La manœuvre de Byron se retourne contre lui car il est pris en tenaille entre l’escadre française et l'artillerie des troupes à terre. Suffren, qui fait partie de l'avant garde, se retrouve en tête de la ligne et engage le combat en premier, au passage des vaisseaux anglais. Il en éprouve une grande fierté :
« J’eus le bonheur d’être chef de file ; j’essuyais par ma position le feu des vingt premières bordées, serrant le vent le plus que je pouvais. Cette passe dura une heure un quart. Après que la ligne anglaise m’eut dépassé, je pris mon poste dans la ligne de bataille. Quoique maltraité par la perte de monde, par les avaries, je l’ai été bien moins que le poste honorable que j’ai occupé pouvait le faire craindre. C’est au feu vif et bien dirigé que j’ai fait qu’est dû cet avantage »[188].
On notera la grande fierté qui émane de ce rapport. Sûr de son talent, Suffren semble épanoui au milieu de la bataille. Un autre témoignage, celui de François-Palamède de Suffren confirme le comportement de son commandant au feu et nous donne de nombreux détails sur la violence du combat :
« Notre vaisseau fit des merveilles, nous tirâmes 1 600 coups de canons, autant que le Languedoc [le navire amiral] qui tint son poste. Il n'y eu jamais une manœuvre de cassée dans le temps du combat. Le bailli de Suffren gratifiait tous ceux qui montaient au feu. Le poste que je commandais fut très maltraité, j'eus deux canons démontés, tout mon monde fut tué ou blessé. Il semblait qu'un bon génie m'accompagnait, quand je passais d'une place à l'autre pour donner des ordres, un boulet ennemi venait le balayer. Si je quittais celui-là, il en arrivait de même. J'étais si près d'un matelot dont la tête fut emportée par un boulet de canon que mon visage fut couvert de cervelle : jamais sensation plus horrible. J'eus les dents ébranlées voulant viser un canon parce qu'il me paraissait que le chef de pièce tirait sans pointer : un boulet anglais vint emporter la tête du canon et comme j'avais le menton appuyé de l'autre bout, la commotion me repoussa et me fit saigner toutes les gencives. Je sauvai les jambes au chevalier de Pierrevert qui venait de porter des ordres du bailli de Suffren. Il passa derrière le canon au moment qu'on y mit le feu. Je n'eus que le temps de le prendre par le basque de son habit et l'abattre à mes pieds[189].»
Le Fantasque compte 22 tués et 41 blessés. L'escadre anglaise essuie 21 000 coups de canons et se retrouve sévèrement étrillée. Quatre vaisseaux sont totalement désemparés[190]. L'arrière-garde anglaise se disloque. C’est la victoire, et elle peut être totale si d’Estaing engage la poursuite de l’ennemi mal en point. Peine perdue. Le vice-amiral ne réagit pas, malgré les conseils répétés de Suffren et La Motte-Picquet. Byron, qui déplore aussi plus de 1 000 tués et blessés réussit à se retirer péniblement vers l’île de Saint-Christophe en prenant en remorque ses 4 vaisseaux hors de combat que d’Estaing n’a pas daigné faire saisir. Rien n'est tenté non plus contre le convoi de troupes, pourtant extrêmement vulnérable et qu'un simple vaisseau de 50 canons accompagné de quelques frégates aurait pu capturer, au dire de Suffren[191]. Les Français ont eu 176 tués et 776 blessés. « Le général (d’Estaing) s’est conduit, par terre et par mer, avec beaucoup de valeur. La victoire ne peut lui être disputée ; mais s’il avait été aussi marin que brave, nous n’aurions pas laissé échapper 4 vaisseaux anglais démâtés » juge le bailli dans sa correspondance[192]. Avec le recul, les Historiens sont bien plus sévères. Cette bataille fut « la défaite la plus désastreuse de la Royal Navy depuis la Béveziers en 1690 » selon l’amiral et stratège américain Alfred Mahan qui écrit à la fin du XIXe siècle[193]. Il est vrai que c’était la première fois que la Royal Navy était aussi lourdement battue dans les Antilles. Mais que vaut une victoire non exploitée ? D'Estaing, qui est resté foncièrement un homme de l'armée de terre a beaucoup de mal à voir dans les escadres autre chose qu'un moyen de transporter des troupes. D’Estaing s’est contenté de la conquête de la Grenade, un authentique succès tactique, mais sans portée stratégique dans cette guerre où l’essentiel se joue ailleurs. En laissant filer la Navy, il a laissé « s’échapper une victoire décisive qui lui aurait permis de prendre la Jamaïque » estime de son côté Jean-Christian Petitfils[194]. Et porter un coup terrible au moral des forces anglaises jusqu’en Amérique du Nord, car la bataille eut un retentissement considérable dans les opinions publiques.
Échec sanglant à Savannah (octobre 1779)
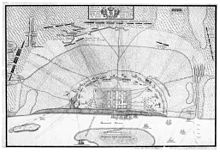 Le siège de Savannah (octobre 1779), mené en collaboration avec les Américains est un lourd échec pour les Français, malgré le succès du débarquement préparé par Suffren. (Carte américaine de 1874, d'après un plan d'époque, Université de Géorgie)
Le siège de Savannah (octobre 1779), mené en collaboration avec les Américains est un lourd échec pour les Français, malgré le succès du débarquement préparé par Suffren. (Carte américaine de 1874, d'après un plan d'époque, Université de Géorgie)
La réputation de Suffren est maintenant bien établie. D’Estaing lui confie une division de 2 vaisseaux et 2 frégates pour forcer à la capitulation les petites îles anglaises de Cariacou et de l’Union dans l’archipel des Grenadines. Mission dont s’acquitte rapidement Suffren. Cariacou, l'île principale est occupée le 14 juillet au soir, la garnison anglaise se rendant au premier coup de canon. L'île voisine de l'Union subit le même sort. Dans les deux cas, les opérations sont menées sans qu'aucun pillage soit exercé par les conquérants. Ce comportement, loin de la prédation assez commune chez tous les belligérants à cette époque, vaut à Suffren un rapport élogieux de son chef au ministre[195]. L'opération terminée, Suffren rejoint d'Estaing qui cherche à engager de nouveau le combat avec Byron (22 juillet). Mais l’Anglais, dont l’escadre a beaucoup souffert, préfère rester à l’ancre à l’abri dans l’île de Saint-Christophe.
D’Estaing fait relâcher sa flotte à Saint-Domingue. On s’achemine encore une fois vers de longs mois d’inactivité lorsqu’arrivent de mauvaises nouvelles des treize colonies en révolte. La situation militaire s’est soudainement dégradée avec l’invasion de la Géorgie, l’État le plus au sud des « États-Unis » (décembre 1778). La Caroline du Sud est sur le point d'être occupée par l'armée anglaise. Libre de ses mouvements, la Royal Navy bloque étroitement les côtes des treize États, multipliant les descentes à terre et interceptant le trafic côtier américain. Le Congrès appelle au secours la flotte française pour délivrer Savannah. De son côté, d’Estaing vient de recevoir l’ordre du roi de rentrer à Toulon, mais d’Estaing s’estime dispensé d’y répondre car son succès à la Grenade est antérieur à la décision du roi[194]...
Avec 20 vaisseaux et 3 000 hommes prélevés sur les garnisons de la Martinique et Saint-Domingue, d’Estaing se porte donc devant Savannah pour aider les troupes du général Lincoln. Mais l’affaire tourne mal. Les ouragans (2 septembre), l’impéritie des pilotes américains incapables de guider les lourds vaisseaux de ligne, les avaries (5 gouvernails brisés ou endommagés), le manque d’eau et les maladies désorganisent l’escadre et brisent le moral des Français avant même que ne commence le siège de Savannah. Le talent de Suffren est une fois de plus sollicité. D’Estaing lui donne l’ordre, avec 3 vaisseaux et 3 frégates de bloquer l’embouchure de la rivière pour empêcher la fuite des vaisseaux anglais qui s’y trouvent à l’ancre[196]. Mission accomplie le 9 septembre lorsque le bailli oblige 4 navires anglais à se réfugier sous les murs de Savannah et détruit les fortifications de l’île de Tybee. On constate que la campagne avançant, Suffren se voit confier des forces de plus en plus importantes. Il mène aussi une importante opération de reconnaissance des côtes pour suppléer les carences des pilotes américains, ce qui permet le débarquement des Français le 12 septembre[197]. Au large, l'escadre capture 2 navires anglais, le HMS Experiment (50 canons) et la frégate Ariel. Ce seront les seuls succès de cette campagne. On perd ensuite du temps, ce qui permet à la garnison anglaise de recevoir des renforts et de se fortifier. Le 9 octobre, d’Estaing qui croit rééditer son exploit de la Grenade, tente un assaut en règle contre la ville de Savannah, bâtie sur une grande terrasse dominant le fleuve. Mais il se heurte à la résistance féroce du général anglais Prévost et il est blessé aux deux jambes. Les Français doivent se retirer sans gloire en rembarquant leurs troupes, leurs tentes, leur artillerie, après avoir perdu 63 officiers et 579 soldats tués ou blessés[194].
C'est une fois de plus l'échec, mais avec des conséquences inattendues et positives pour les Américains : les Anglais ne menacent plus Charleston et la Caroline du Sud. Beaucoup plus au Nord, les Britanniques inquiets du retour de d'Estaing ont évacué le Rhode Island pour concentrer leurs forces à New York. Newport, sur lequel les Français se sont cassés les dents l'année précédente (voir plus haut) se retrouve maintenant libre. Ce bon port va par la suite jouer un rôle décisif en permettant d'accueillir les troupes de Rochambeau.
Le bilan toujours aussi maigre d'une deuxième année de guerre...
 « Je l'ai eu ! ». D'Estaing montrant comment on coupe la tête aux Anglais. Grâce à son courage qui fait oublier ses échecs, d'Estaing est un homme populaire comme le laisse apparaître cette caricature américaine et l'accueil enthousiaste à son retour d'Amérique.
« Je l'ai eu ! ». D'Estaing montrant comment on coupe la tête aux Anglais. Grâce à son courage qui fait oublier ses échecs, d'Estaing est un homme populaire comme le laisse apparaître cette caricature américaine et l'accueil enthousiaste à son retour d'Amérique.
Le retour vers l'Europe est particulièrement difficile. Le 28 octobre, une terrible tempête disloque l’escadre, le Fantasque étant même frappé par la foudre. Trois navires, le Zélé, le Marseillais et le Sagittaire avec une prise anglaise rallient Toulon. Le gros des vaisseaux, dont le Fantasque, gagne Brest autour du César comme chef d’escadre. Il était temps de rentrer : le Fantasque est dans un triste état. Il faut pomper jour et nuit et les trois quarts des matelots souffrent du scorbut. Le Languedoc, emporté par les vents s’est retrouvé seul à quelque 500 milles dans le sud-est de Savannah. Le vaisseau amiral rentre le dernier sur Brest, en solitaire, le 7 décembre... Ce devrait être un triste retour, d’Estaing s'étant révélé « un médiocre marin, lent, indécis, voire pusillanime, contrastant avec la singulière audace du corsaire et de l’aventurier d’autrefois »[198]. Mais d'Estaing est accueilli en héros sur ses béquilles, longuement reçu par le roi, couvert d'éloges, faisant l'objet de poèmes, de chansons et même d'un opéra[199]. « Sa victoire à la Grenade avait fait oublier ses sottises » juge au final Jean-Christian Petitfils[194]. Martine Acerra et Jean Meyer sont un peu moins sévères : « Le vice-amiral d'Estaing n'a pas su tirer le meilleur parti d'une campagne de deux ans pourtant vigoureuse. Il s'est emparé de quelques îles aux Antilles, mais n'a pas pu réellement aider les Insurgents. Au moins, a-t-il attiré hors des eaux européennes une partie de la Royal Navy, aidant ainsi à la préparation du grand plan d'invasion de l'Angleterre. »[200]
Dans la Manche, la flotte française n’avait pourtant rien enregistré non plus de décisif. L’Espagne était entrée en guerre en juin 1779, en rêvant de reconquérir Gibraltar, Minorque, et de débarquer en Angleterre... Mais la flotte espagnole très lente avec ses lourds navires avait tardé à rejoindre la flotte française qui tournait en rond dans le golfe de Gascogne. Les 66 vaisseaux de la flotte combinée franco-espagnole étaient entrée dans la Manche fin juillet pour combattre les 35 vaisseaux de la Royal Navy. Mais les amiraux anglais avaient fui une bataille qui s’annonçait trop déséquilibrée, et les franco-espagnols, bousculés par une tempête, avaient tenu la mer pendant des semaines pour rien, jusqu’à ce que se déclare une grave épidémie dans l’escadre française. Il avait fallu rentrer en septembre sans résultats, alors qu’une armée d’invasion de 40 000 hommes avait été massée -elle aussi pour rien- en Normandie[201]. L’Angleterre s’était pourtant sentie vulnérable : la venue dans la Manche de l’imposante flotte franco-espagnole avait provoqué un début de panique à Londres où la bourse s’était effondrée. Faut de mieux on se contentait de mettre en valeur deux engagements navals acharnés mais secondaires entre frégates et qui s’étaient traduits par la capture ou la destruction des navires anglais[202].
Sur les théâtres d’opérations plus lointains la France avait bien repris le Sénégal (février 1779), mais la Royal Navy avait raflé une partie des possessions d’outre-mer mal défendues : l’île de Gorée, Saint-Pierre-et-Miquelon, Pondichéry et les autres comptoirs des Indes. La Motte-Picquet réussissait l'exploit de tenir en échec avec 3 vaisseaux une forte escadre anglaise pour protéger un grand convois au large de Fort-Royal de la Martinique (18 décembre). Mais au final, l’année 1779 se terminait sur un bilan aussi mince que celui de 1778. L’opinion publique commençait à murmurer devant tant de gâchis. Ne fallait-il pas changer de stratégie, ou au moins de généraux ?
L'année 1780, ou le début de la reconnaissance royale
 Modèle réduit d'un vaisseau de 74 canons. Ces vaisseaux forment l'ossature de la marine française et anglaise. Suffren prend la commandement de son premier "74 canons" en 1780, à 51 ans, et participe brièvement au siège de Gibraltar.
Modèle réduit d'un vaisseau de 74 canons. Ces vaisseaux forment l'ossature de la marine française et anglaise. Suffren prend la commandement de son premier "74 canons" en 1780, à 51 ans, et participe brièvement au siège de Gibraltar.
 En 1780, le ministre de la Marine, Antoine de Sartine, propose de nommer Suffren chef d'escadre, mais Louis XVI refuse dans un premier temps car il y a encore trente-neuf capitaines devant lui au tableau d'avancement.
En 1780, le ministre de la Marine, Antoine de Sartine, propose de nommer Suffren chef d'escadre, mais Louis XVI refuse dans un premier temps car il y a encore trente-neuf capitaines devant lui au tableau d'avancement.
De bons capitaines se sont malgré tout illustrés pendant ces deux premières années de guerre : Vaudreuil, Guichen, De Grasse, La Motte-Picquet et bien sûr Suffren. Mais dans les bureaux de Versailles, on semble peiner à faire des choix, même si Louis XVI suit très attentivement la guerre navale[203]. Guichen part pour les Antilles accompagné de De Grasse et La Motte-Picquet pour protéger les îles françaises et escorter les convois commerciaux. Un autre bon chef, Ternay, prend le commandement de l'escadre qui doit apporter en Amérique les 6 000 soldats du corps expéditionnaire du général Rochambeau chargé de guerroyer aux côtés des Américains. Pour la grande flotte franco-espagnole devant se rassembler à Cadix en vue d’attaquer Gibraltar (ou dans les Antilles), c’est encore d’Estaing qui se retrouve à la barre[204]. Et toujours aucune responsabilité sérieuse pour Suffren...
Pourtant les choses évoluent peu à peu. Le dossier Suffren est maintenant sur le bureau du roi, ne serait-ce que pour récompenser le marin de ses services dans l’escadre de d'Estaing. Ce dernier, s'il s'est révélé être un chef incertain et hésitant, sait malgré tout reconnaitre le talent des autres, puisqu'il certifie au ministre que « ce capitaine sera peut-être le meilleur chef d'escadre que Sa Majesté puisse avoir à son service. » Le ministre de la marine, Antoine de Sartine, propose à Louis XVI d’élever Suffren au rang de chef d’escadre. Mais au rigide tableau d’avancement de la marine, Suffren est encore le quarantième sur la liste... Le jeune souverain, qui craint les protestations des autres officiers et qui reste intellectuellement prisonnier de la société aristocratique et de ses corporatismes, refuse. « Ne se peut pas », écrit à regret Louis XVI sur la proposition de Sartine. Sa Majesté, lui écrit malgré tout le ministre, « vous regarde comme un des officiers les plus propres à commander bientôt ses escadres et son intention est d’accélérer votre avancement le plus qu’il lui sera possible. En attendant, et pour vous marquer sa satisfaction de tout ce que vous venez de faire, elle vous accorde une pension de 1 500 livres et le commandement de 74 canons »[205].
En avril, Suffren se retrouve donc aux commandes du Zélé, affecté à des missions d’escorte dans l’Atlantique, en compagnie du Marseillais. En août, il doit rejoindre l’escadre franco-espagnole qui se rassemble à Cadix. Le 31 juillet, cette force quitte le port espagnol pour manœuvrer dans l’Atlantique. Suffren a tout le loisir d’observer la faible efficacité de la flotte espagnole, avec ses lourds vaisseaux en cèdre de La Havane, lents à la manœuvre et à l’artillerie de médiocre qualité. Depuis plus d’un an déjà, les convois de ravitaillement pour Gibraltar et Minorque escortés par la Royal Navy glissent entre les doigts des Espagnols qui font le blocus de ces deux points d'appuis essentiel à l'Angleterre[206].
Si les vaisseaux français sont supérieurs à ceux des Espagnols, Suffren constate cependant que leur vitesse est insuffisante, lorsque le 9 août il participe à l'interception un gros convoi anglais qui file vers la Jamaïque. Les 64 bâtiments de transports sont escortés par un vaisseau et 3 frégates. Suffren lance la poursuite avec quelques bâtiments espagnols et arrive le premier sur le convoi avec ses 2 vaisseaux. La prise est superbe, puisque outre les 3 000 marins et soldats capturés, on identifie aussi dans le convoi 5 gros navires armés de la Compagnie des Indes Orientales. La perte de ce convoi de 20 millions de livres sterling[207] que se partagent les Français et les Espagnols provoque une forte chute de la bourse de Londres. Mais Suffren, en capitaine attentif, porte ses commentaires ailleurs car l'escorte a réussi à se sauver avec 2 navires de transport.
Les 5 navires anglais qui se sont échappés ont dû leur salut à une innovation apparue dans les chantiers navals anglais en 1775 : le doublage de la coque avec des plaques de cuivre. Cette innovation, qui a pour but au départ de lutter contre les incrustations d’algues et de coquillages, permet aussi d’augmenter la vitesse des navires. Tous les vaisseaux de guerre anglais qui sortent des chantiers navals en sont maintenant dotés. Côté français, on est parfaitement au courant de cette évolution dont on avait pu éprouver l'efficacité lors des courses poursuites avec la Navy dans la Manche, l'année précédente. Mais la Marine royale reste très en retard sur cette innovation, il est vrai très couteuse. Suffren, dans son rapport demande que les chantiers navals français adoptent le plus rapidement possible cette technique.
« L’évasion du vaisseau (anglais) et de ses 2 frégates m’engage à vous adresser un mémoire sur la nécessité de doubler en cuivre, et sur les moyens d’accélérer une opération qui procurera à l’État les plus grands avantages et illustrera votre ministère. Ne croyez pas, Monseigneur, que je cherche à me faire valoir, en vous adressant des mémoires ; je ne suis déterminé que par l’amour du bien de la chose et de notre gloire : un militaire doit se distinguer par des faits, point par des écritures. (...) Je ne saurais finir sans vous réitérer combien l’objet de doubler en cuivre est important »[208].
Message reçu par le ministère qui ordonne de passer au doublage en cuivre, malgré la lenteur de mise en œuvre par les chantiers navals (A la fin de la guerre d’Amérique une partie seulement de la flotte sera équipée).
Cette troisième année de guerre se terminait encore une fois sans résultat décisif. Aux Antilles, Guichen avait lourdement tenu en échec Rodney lors de trois combats navals successifs (17 avril, 15 et 18 mai 1780), mais sans faire évoluer sensiblement la situation militaire. Ternay avait rempli sa mission et débarqué le corps expéditionnaire de Rochambeau, mais des renforts anglais étaient arrivés en même temps et la petite armée française avait dû se retrancher dans Newport avec l'escadre, sans pouvoir rien tenter[209]. Quant à d'Estaing, bousculé dans le golfe de Gascogne par des vents contraires, il était rentré en décembre à Brest sans avoir pu rien faire contre la Royal Navy. L'opinion commençait à gronder contre cette guerre interminable et ruineuse. Malaise qui s'était exprimé aussi au plus haut niveau de l'État. Suite à un Mémoire du ministre des finances, Necker qui dénonçait une mauvaise utilisation des crédits militaires, Louis XVI avait du renvoyer le ministre de la marine, Sartine (octobre 1780) et le ministre de la guerre, Montbarrey. Le nouveau titulaire de la charge, de Castrie comprend qu'il faut davantage miser sur de nouveaux chefs que sur une nouvelle répartition des vaisseaux[210]. Pour Suffren, l'heure d'accéder à de grandes responsabilités semble sonner. Bénéficiant des compte-rendu élogieux de d'Estaing et du soutien de Vergennes, il obtient facilement une entrevue avec le nouveau ministre de la marine au mois de février 1781. Il en fait le récit à sa vieille amie, Mme d'Alès : « je suis parti jeudi de Versailles. On ne voyait pas M. de Castrie ; je lui écrivis, il m'envoya sur-le-champ chercher pour me prier à dîner ; j'y fus, nous causâmes longuement. Il m'a témoigné le plus grand désir de m'employer agréablement, et comme il est vrai, je ne doute pas qu'il ne le fasse s'il le peut. »[211]
Portrait de « l’amiral Satan »
Suffren va prendre le commandement de sa première escadre. Il a 51 ans. Après ces trois premières années dans le conflit américain, sa réputation de marin combattif est maintenant bien établie. C’est d’ailleurs de cette époque - 1780 précisément - que date le premier portrait connu à ce jour, en tout cas dans les archives françaises. On peut déjà faire un premier bilan de sa carrière et achever de dresser le portrait détaillé de celui que les Anglais - sans qu’on sache exactement à partir de quelle date - vont surnommer l’« amiral Satan »[212].
Gros, sale et sportif ?
De par son physique et son caractère Suffren est un personnage haut en couleur. William Hickey, administrateur des Indes orientales anglaises, retenu prisonnier plusieurs jours avec sa femme à bord du Héros nous a laissé du bailli un portrait saisissant :
« De tenue et de tournure bizarres, il avait plus l’apparence d’un boucher anglais, trapu et vulgaire, que d’un Français de qualité. Haut de cinq pieds cinq pouces (1m 65), très corpulent, les cheveux rares sur le dessus du crâne, mais plus nombreux sur les côtés et l’arrière. Bien qu’il fût tout à fait gris, il n’usait ni de poudre ni de pommade ; ne portait pas de boucles et avait une courte queue de trois ou quatre pouces attachées par un vieux bout de fil (bitord). Il portait une paire de vieux souliers dont il avait coupé les sous-pieds, une culotte de toile bleue déboutonnée au genou. Des bas de coton ou de fil, pas des plus propres, lui pendaient sur les jambes ; ni habit ni cravate ; sa chemise de tissu grossier trempée de sueur était ouverte au cou, et les manches étaient retournées au-dessus du coude. »[213]
Tout est dit. Suffren est gros et sale. L’obésité du bailli nous est confirmée par une foule de témoignage qui regorgent d’anecdotes sur sa gloutonnerie et les heures qu’il passe à table. Le rôle d’équipage de son vaisseau qui va partir aux Indes, le Héros, nous apprend qu’il dispose pour son service personnel d’un sommelier, d’un maître d’hôtel et de pas moins de six cuisiniers pour satisfaire son appétit de Gargantua et les officiers qu'il invite à sa table[214].
Obèse ne veut cependant pas dire maladroit, car Suffren, sans être absolument sportif, est agile et jouit d’une grande force physique. Le narrateur anglais précise que, quand il allait à terre, Suffren « bien que très fort et lourd, descendait par le flan du navire au moyen d’une seule et vulgaire corde, aussi lestement que l’eût pu faire un aspirant et sans que personne ne l’aidât. » William Hickey note qu’il saute avec légèreté dans le canot du couple lorsqu’il prend congés de ses hôtes prisonniers. Le régime alimentaire du commandeur est en partie compensé par sa grande activité physique. C'est une brute géante au cuir tanné par les embruns selon Jean-Christian Petitfils[215]. En mer, Suffren parcourt infatigablement son vaisseau et à terre semble avoir la bougeotte. Constamment en sueur, son odeur corporelle en fait un personnage plutôt repoussant, d’autant qu’il en fait des tonnes dans le style débraillé et gesticulant. Suffren vocifère volontiers, se répand en invectives et en jurons, au combat ou à la manœuvre, sur l’adversaire ou sur les hommes dont il n’est pas satisfait, (et parfois les deux) le tout avec un terrible accent provençal. Un mélange de vigueur physique et intellectuelle qui fait dire à l'officier et historien Raoul Castex que chez Suffren « l'ébullition intellectuelle accompagne le violent effort du corps. »[216]
Pourtant, l’homme sait être quand il le veut d’une grande courtoisie, recevoir ses hôtes avec délicatesse, porter avec prestance son costume d’officier de marine et pas seulement dans les bureaux du ministère. A bien des égards, Suffren semble être un timide qui se cache derrière la caricature de méridional qu’il donne de lui-même. Suffren cache un caractère secret et fait preuve le plus souvent de beaucoup de retenue[217]. Sa qualité de chevalier profès de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et les nombreuses dignités dont il est revêtu ne peuvent d’ailleurs que l’engager à observer prudence et réserve dans son comportement et ses écrits, surtout lorsqu’il est à terre.
Suffren à la plume et au rapport
Le vulgaire et braillard officier se révèle un épistolier infatigable à la plume sûre et alerte. Suffren entretient une correspondance fournie avec une foule de gens, qu’il s’agisse d’un ministre, d’un ami ou d’un membre de sa famille. Il n’est pas rare, lors de ses campagnes, qu’il raconte le même évènement à quatre, voire cinq personnes à la fois [218]. Suffren passe plusieurs heures par semaine, voire par jour, la plume à la main, à sa table de travail. Nous avons vu que depuis 1763 il a réussi avec beaucoup d’aplomb à se faire remarquer des bureaux du ministère grâce à un Mémoire sur la « façon de réprimer les corsaires d’Alger ». Ce mémoire avait été précédé en 1762 par un autre concernant la base anglaise de Gibraltar et sur les moyens de l’attaquer [219]. Avec maestria, le bailli a maintenu ce lien épistolaire jusqu’à se faire ouvrir les portes du ministère en 1767. Le lien s’est ensuite maintenu avec tous les ministres qui se sont succédé depuis Choiseul. En 1772-1773, on le voit cette fois utiliser son expérience maltaise pour proposer au gouvernement une politique de lutte contre la piraterie barbaresque. Soucieux d’avoir plusieurs fers aux feux, Suffren profite de ses entrevues avec le ministre pour tisser des liens avec le premier commis du bureau des officiers, Jean-Baptiste Antoine Blouin. Blouin est chargé du recrutement, de la formation, de l’affectation et de l’avancement des officiers. Il s’agit donc dans l’ombre du ministre d’un personnage puissant, d’autant plus utile qu’il est compétent et très apprécié de Louis XVI[220]. C’est sans doute Blouin, en 1780, qui a discrètement poussé le dossier Suffren pour faire nommer ce dernier chef d’escadre, demande rejetée dans un premier temps par le roi (voir plus haut)[221].
Les rapports retrouvés dans les archives nous éclairent aussi sur la curiosité de Suffren qui ne se limite pas seulement aux questions diplomatico-militaires. Suffren s’y montre intéressé par l’ « économie politique, le commerce, l’histoire naturelle »[222] et suit attentivement toutes les évolutions techniques. On l’a vu plaider avec insistance en 1780 pour le doublage en cuivre des coques. Il plaide aussi pour l’adoption du paratonnerre sur les vaisseaux de guerre [223] et profite souvent de ses croisières pour en rapporter idées et propositions qu’il transmet au ministère. C’est ainsi qu’on le voit pendant sa mission sur la Mignonne se pencher sur l’hygiène à bord des navires. Lors d’une escale sur l’île de Kimolos, Suffren en a rapporté de la cimolite, une terre qui a la propriété de mousser dans l’eau de mer. Le bailli y voit un moyen efficace de laver le linge à bord des navires et transmet un mémoire au ministère en ce sens en 1775, désirant que des recherches soient faites en France pour y découvrir « des terres propres au même objet »[224]. Des préoccupations qui ne sont pas secondaires, vu les ravages que font les maladies contagieuses dans les escadres. Préoccupation que l’on retrouve dans les soins que Suffren a toujours eu pour la santé de ses équipages, et qui ne manquent par ailleurs pas de sel lorsque l’on pense au style débraillé et repoussant du gros bailli... La même lettre nous informe qu'il s’est aussi penché « sur les plantations de céleris, objet de commerce très intéressant » (contre le scorbut ?), ce dont il s’excuse presque : « Je serai fâché que vous imaginiez que je m’occupe uniquement de l’histoire naturelle ; quelque attrait qu’elle puisse avoir pour moi, je ne la cultive que relativement à mon métier. Je la regarde comme une ressource contre l’ennui d’être à terre, mais tel est l’enchainement des connaissances humaines que presque toutes se portent des secours mutuels. »[224]. Indiscutablement Suffren a le sens de la formule. On peut en citer encore un exemple avec cette lettre écrite au responsable d’un hôpital lors de la campagne des Indes. Elle montre le sérieux, la compétence et le dévouement du bailli en matière médicale :
« J’ai été Monsieur, voir votre hôpital. J’aurais bien désiré vous y trouver. J’ai remarqué que les malades étaient assez bien. J’ai même vu que leur ration était plutôt forte que faible. Mais je vous avouerai que votre chirurgien-major m’a paru aimer à couper et, comme la plupart de ce qu’il appelle blessures ne sont que des ulcères dépendant d’un vice scorbutique ou autre, il me semble que ces malades ne devraient être traités que par vous, et le chirurgien ne panser et n’opérer que selon vos ordonnances. Je crois que vous êtes trop bien intentionné pour ne pas faire céder ces petits égards au bien des malades. Je désirerais aussi que vos malades fussent plus séparés selon leurs maladies. Un scorbutique qui n’a point de fièvre est très mal entre deux malades qui non seulement l’ont, mais de plus ont une dysenterie épidémique. Au reste, comme vous avez plus d’expérience que moi dans ces sortes de choses, je soumets mes vues aux vôtres. »[225]
Outre les compétences médicales approfondies, tirées de son expérience en campagne et à l’hôpital de Malte, on y trouve la tactique que Suffren emploie dans nombre de ses courriers officiels : des propos argumentés et modérés, même lorsqu’ils vont très loin dans les propositions (ou les reproches comme ici) et qui se terminent par une forme de retraite fort polie ou il s’en remet à la compétence de son interlocuteur à laquelle il soumet ses vues dans l’intérêt du service...
La correspondance du bailli a fait l’objet de longues recherches et nous réserve encore régulièrement de belles surprises. Si les historiens avaient étudié depuis longtemps les archives de la Marine, ils avaient négligé celles d’autres ministères qui paraissaient sans rapport avec la carrière du marin. Bien à tort. C’est ainsi qu’il a fallu attendre 1976 pour que soit mise à jour la correspondance entre Suffren et le ministre des affaires étrangères Vergennes, oubliée pendant presque deux siècles. Personne ne savait que les deux hommes s’étaient rencontrés, peut-être par l’entremise de d’Estaing en 1779, et avaient sympathisé. Roger Glanchant, conservateur des archives du Quai d’Orsay mit la main sur vingt deux lettres et deux mémoires du bailli, lui permettant de dresser un portrait renouvelé de Suffren et sur sa façon de se faire entendre en utilisant d’autres canaux que ceux de sa hiérarchie officielle. L’ouvrage, Suffren et le temps de Vergennes, qui a fait date, reste régulièrement utilisé et cité par les biographes du marin[226]. Le filon n’est pas épuisé, puisque Rémi Monaque, auteur de l’une des dernières biographies, a déniché en 2008 dans les archives du Sri Lanka, à Colombo, un dossier de quarante trois lettres échangées avec le gouverneur néerlandais de l’île en 1782-1783 et qui a permis d’améliorer la compréhension de la plus célèbre des campagnes de Suffren[227].
Combien de lettres du commandeur dorment encore dans des archives publiques ou privées ? Mystère. Les biographes aimeraient entre autres pouvoir retrouver l’abondante correspondance échangée pendant trois décennies entre Suffren et celle qui fut son grand amour, Madame d’Alès, et sur laquelle ils sont fort peu renseignés.
Madame d’Alès, l’amour d’une vie ?
La vie privée de Suffren reste très mal connue. Le manque d’informations dont on dispose a donc laissé la part belle aux rumeurs et aux légendes[217]. La correspondance personnelle -et amoureuse- de Suffren n'a commencé à émerger qu'en 1859, avec la publication par Théodore Ortolan d’une partie des lettres adressées par Pierre-André à Madame d’Alès, arrière-grand-mère de son épouse[228]. Publication complétée de quelques lettres en 1893 par Octave Teissier dans le Petit Marseillais et dans les années 1980 par le don au musée de Saint-Cannat d’une soixantaine de lettres, presque toutes inédites[229]. Le couple a correspondu pendant 36 ans, mais on ne dispose d’aucune lettre de Suffren antérieure à 1776 et les lettres de Madame d’Alès ont toutes disparu. On ne sait qui de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou de la famille du bailli s’est chargé de faire disparaitre cette correspondance qui pouvait paraitre compromettante pour la dignité du personnage. Du côté de la famille de Madame d’Alès, les lettres de Suffren ont fait l’objet d’un tri attentif avant leur première publication en 1859. Ortolan précise que beaucoup des écrits en sa possession « sont des lettres intimes adressées à Madame d’Alès la bisaïeule de ma femme sur des sujets peu intéressants pour l’histoire. »[230] Les deux amants s’écrivaient donc des lettres d'amour, impubliables avec la morale et la censure bourgeoise du XIXe siècle… C’est donc un mince corpus de moins de cent lettres, presque toutes écrites entre 1779 et 1788, soit les neuf dernières années de la vie de Pierre-André que les biographes doivent utiliser pour chercher à reconstituer la vie du couple.
Marie-Thérèse de Perrot est née à Draguignan en 1725. Contrairement à une légende tenace, elle n’est pas une proche cousine, même s’il est possible qu’un lien de parenté lointain ait pu les rapprocher assez tôt. C’est semble-t-il en 1752 à Toulon que les deux jeunes gens se sont rencontrés[231]. Pierre-André a 23 ans, Marie Thérèse 27 ans. Marie-Thérèse vient de perdre son mari, le comte Alexandre-Pierre d’Alès de Corblet, officier de l’armée de terre qu’elle avait épousé 10 mois plus tôt. Elle vient aussi d’accoucher d’une petite fille[232], Marguerite-Louise, pour laquelle Pierre-André éprouvera une vive affection. Marie-Thérèse ne se remariera jamais.
Les deux amants sont unis par un amour profond et brûlant. On l’entraperçoit dans les lettres disponibles qui n’ont heureusement pas été expurgées : « Je t’envoie, ma chère amie, une médaille, puis je t’enverrai mon buste, mon portrait ; tu m’auras de toutes les façons excepté celle que je désirerais que tu m’eusses. » (7 octobre 1784). « Je ne veux pas laisser partir le courrier sans te dire que je t’aime. » (31 décembre 1785) « Mais j’ai le cœur pour juge : il n’a jamais cessé de vous aimer et l’amitié la plus tendre a succédé à d’autres sentiments et elle durera dussiez-vous me haïr. » (9 août 1786) « J’ose me flatter aussi que vous y aurez [à Draguignan] des souvenirs qui seraient bien délicieux pour moi. » (1788) Outre l’alternance du vouvoiement et du tutoiement, on remarque la fraicheur des formules amoureuses de ces lettres des années 1780 alors que Suffren et sa compagne ont allègrement dépassé la cinquantaine[233].
Mme d’Alès semble n’avoir jamais quitté sa Provence natale. Elle mène une vie assez sédentaire, partagée entre sa maison de Draguignan et son château de Bourigaille situé à huit kilomètres au nord de Fayence. Suffren vient l’y rejoindre après ses campagnes, sachant qu’en fonction de ses affectations, il n’est pas rare que le couple reste plusieurs années sans se voir. Les lettres nous révèlent les attentions et services que se rendent les deux amants. Au retour de ses missions Suffren apporte cadeaux et souvenirs. On le voit lui envoyer du vin d’Alicante ou du thé et faire pour elle les boutiques parisiennes. Marie-Thérèse, qui connait la gourmandise de Pierre-André lui envoie régulièrement des produits du terroir : melons, perdrix, champignons, truffes... Les deux amoureux affectionnent aussi beaucoup les longues promenades à cheval dans la campagne provençale. Marie-Thérèse montre le plus vif intérêt pour la carrière de son ami et semble être, en femme instruite et lectrice de gazettes, très avide des nouvelles venues de la Cour. Le couple partage aussi d'importantes affaires d’argent sur lesquelles nous ne savons pas grand-chose et qui donneront lieu aux seules tensions connues entre Pierre-André et sa « chère amie »[234].
Suffren et les garçons
 En mer, Suffren entretient des relations amoureuses avec de jeunes mousses et ne s'en cache pas. (Lithographie du XIXème)
En mer, Suffren entretient des relations amoureuses avec de jeunes mousses et ne s'en cache pas. (Lithographie du XIXème)
Marie-Thérèse sait-elle que Pierre-André a une autre vie amoureuse lorsqu’il la quitte pour reprendre la mer ? On peut penser que oui, compte-tenu de la réputation sulfureuse qui suit (ou précède) le bailli à chacun de ses déplacement. Car Suffren a aussi le goût des garçons. Il ne s’agit pas d’homosexualité comme il a été dit et écrit souvent, mais plutôt de bisexualité avec une orientation pédérastique. Orientation sur laquelle court une foule d’histoires et d’anecdotes, fort difficiles à vérifier car colportées longtemps de bouche à oreille tout au long du XIXe siècle. En mer, le bailli entretient des relations avec de jeunes mousses, les « mignons de Suffren ». Pierre-André organise aussi des unions masculines entre matelots, appariant le novice au vétéran. « Tout pour le bord, Messieurs, et rien pour le bordel ! Moins de risque de vérole ; pas d’enfants, plus de mélancolie... » aurait dit le gros bailli, jamais à court de provocation[235]. En 1872, l’amiral Fleuriot de Langle, dont le grand-père avait connu Suffren, confiait à Pierre Margry, archiviste du département de la marine et des colonies, que l’animosité des capitaines de la campagne des Indes s’expliquait en partie par la prétention de Suffren d’imposer la présence de son giton à la table du Héros[236].
Rémi Monaque adhère du bout des lèvres à l’idée que Suffren, par soucis de lutter contre les maladies vénériennes a « sinon prôné, du moins regardé avec bienveillance les relations sexuelles entre matelots. »[237] Michel Vergé-Franceschi fait remarquer que les mousses servent souvent de gibier sexuel pendant les longues traversées[238]. Les amours masculines embarquées ne sont pas propres à Suffren. Outre les mousses et autres jeunes matelots, nombre d’officiers entretiennent des relations sexuelles entres-eux, phénomène que l’on retrouve aussi dans la Royal Navy[239], mais tous profitent du luxe de disposer d’une cabine pour le faire dans la plus grande discrétion, ce qui n’est pas le cas de Suffren. N’oublions pas non plus qu’en théorie la « sodomie » est encore passible de peine de mort au XVIIIe siècle, même s’il y a déjà longtemps que ce châtiment n’est plus appliqué en France.
Les commandements auxquels accède Suffren montrent qu’il est dans la moyenne d’âge normale et qu’il suit le tableau d’avancement. Ses mœurs ne semblent donc pas lui avoir porté préjudice, excepté cependant en une occasion. En août 1772, Suffren se fend, comme il en a l’habitude, d’une lettre bien troussée pour se porter candidat à la direction de la compagnie des gardes de Toulon. C'est un poste très recherché et prestigieux puisqu’on y forme les jeunes officiers[240]. La réponse du ministre est négative. Bourgeois de Boynes, connaissant les mœurs du demandeur aurait fait jeter à la corbeille la demande avec cette mention : « Pas de loup dans la bergerie »[241]. Rebuffade toute relative puisque le ministre, on l’a vu, lui accorde dans la foulée le commandement de la frégate la Mignonne avec une mission importante en Méditerranée.
On ne peut exclure aussi quelques inquiétudes familiales. Lors de son retour des Indes en mars 1783, Suffren s’arrête chez M. de Vitrolles, le fils de sa sœur ainée. Il fait sauter sur ses genoux leur enfant, un jeune garçon qui n’a pas encore 10 ans, puis s’approche de la mère de l’enfant et finit par lui demander : « Voulez-vous me le donner, je me chargerais de lui avec bonheur. » Le garçon a en effet l’âge de devenir mousse, mais Mme de Vitrolles qui pense certainement à une carrière autre que la marine et qui connait les mœurs de Suffren repousse poliment l’offre : « Plus tard, lorsqu’il sera rendu digne de vos bontés. » A bon entendeur... Quant au bambin, il gardera un souvenir émerveillé de son grand-oncle[242].
Suffren et les autres officiers : des rapports compliqués
 Un officier de marine en grand uniforme. Suffren prend soin de ses équipages mais se montre très sévère avec les officiers. Ces derniers, qui n'apprécient guère ses manières débraillées le lui rendent bien et le surnomment le « gros calfat ». (Tableau attribué à Antoine Graincourt)
Un officier de marine en grand uniforme. Suffren prend soin de ses équipages mais se montre très sévère avec les officiers. Ces derniers, qui n'apprécient guère ses manières débraillées le lui rendent bien et le surnomment le « gros calfat ». (Tableau attribué à Antoine Graincourt)
Suffren prend soin de ses équipages mais se montre sourcilleux sur la discipline. On le voit infliger un jour le terrible supplice de la cale à un matelot qui s’en est pris à un civil à terre. Sévérité qui est dans la norme du temps, mais qui ne l’empêche pas d’être populaire auprès de ses hommes, ce que sa campagne des Indes confirmera encore. Son style débraillé et son langage familier le rapproche du matelot, du gabier et du canonnier. Il en est souvent de même avec les officiers mariniers (l’équivalent des sous-officiers dans l'armée de terre), presque tous de modeste extraction et vis-à-vis de qui il entretient des relations de confiance empreintes de bonhomie. Nombre d’entre-eux sont des Provençaux. On constate que Suffren parvient à garder presque au complet la même équipe de maîtres embarquée lors de ses deux premiers commandements de la guerre d’Amérique. On retrouvera ces hommes sur le Héros : Joseph Causse, le maître d’équipage (dont Suffren fera un officier auxiliaire), Laurent Vidal le canonnier, Jacques Gautier le charpentier, Pierre Maunier, le calfat, Pierre-Etienne Castel, le voilier[243]… Ces techniciens responsables et spécialistes chacun d’une partie du matériel du vaisseau font l’objet de ses soins attentifs. Lorsque Joseph Causse perd son jeune fils en mer, Suffren, sincèrement ému, demande au ministère une indemnité pour son maître d’équipage alors que ce type d’incident n’est pas rare et n’est le plus souvent qu’à peine mentionné dans les rapports[244].
Les choses sont plus complexes avec les autres officiers. Suffren a du mal à trouver sa place chez les « Rouges », comme on surnomme à cette époque les officiers supérieurs[245]. Le corps des officiers, pratiquement tous nobles de haute naissance et éducation, souvent affilié à des clans à la Cour, est imbu d’un fort esprit de caste. Certains sont choqués par les très voyantes meurs pédérastiques de Suffren. La plupart regardent d’assez haut le débraillé et véhément bailli, perçu comme un démagogue vulgaire et qui y gagne le surnom de « gros calfat »[246]alors qu’il est noble lui aussi. Suffren, sévère à leur égard, ne se prive pas de critiquer leur manque d’audace, d’entrainement, d’imagination. Pierre-André se fait rapidement une réputation de commandant pénible à supporter par ses remarques désagréables, ses persiflages, ses coups de colères. Comportement doublé d’un certain manque de franchise, puisqu’il n’est pas rare que Suffren fasse bonne figure par devant et se montre impitoyable par derrière. Un exemple nous en est donné avec ce rapport particulièrement rosse écrit en 1773 sur l’un des officiers de la Mignonne : « Son application pour les sciences abstraites lui a valu un avancement prématuré. Il serait à désirer qu’il eût fait autant de progrès dans la pratique. »[247] Cet officier, l’enseigne de vaisseau de Ruyter, va pourtant le suivre pendant des années sur tous ses commandements. On l’a vu critiquer sévèrement d’Estaing alors que ce dernier a profondément facilité sa carrière et que Suffren s’est toujours comporté en excellent subordonné, échangeant même bon mots et petits cadeaux avec son supérieur. On le verra aussi critiquer Vergennes après son retour des Indes. Un comportement qui vaut à Suffren d’être traité de mauvais coucheur par Rémi Monaque et d’égoïste par Jean-Christian Petitfils[248].
L’examen du rôle des équipages donne aussi une idée des relations délicates de Suffren avec ses confrères. Au moment du passage de commandement du Caméléon et du Singe (1765), on constate qu’aucun officier présent sur le Caméléon ne n’a été repris sur le Singe[249]. Sur la Mignonne (1767), Suffren n’a conservé qu’un seul officier du Singe[250]. Sur le Fantasque (1777), dans l’état-major de trois lieutenants de vaisseaux et de cinq enseignes, on relève seulement deux noms familiers (dont l’un fait partie de ses neveux). Comme on est au début de la campagne d’Amérique et que la flotte commence à peine ses armements, on dispose de beaucoup d’officiers inemployés. Le ministère veut en faire embarquer en surnombre sur les vaisseaux. Le commandant du port de Toulon rend compte des difficultés à faire exécuter l’ordre pour le Fantasque : « Je ne dois pas vous cacher, écrit ce dernier au ministre, que je n’ai pas trouvé le même empressement dans les autres capitaines, pour servir sous les ordres de M. de Suffren (…), quoique je sois bien assuré de leur bonne volonté pour tout autre destination. C’est une affaire de préjugé que je n’ai pas cru devoir combattre, étant convenu avec M. le comte d’Estaing que rien ne se ferait que de gré à gré. »[251] Tout est dit. Les officiers ne se bousculent pas pour servir sous les ordres de l’irascible commandeur.
De son côté, Suffren obtient assez tôt le droit -pour ne pas dire le privilège étonnant- de choisir les officiers qu’il estime à la hauteur ou simplement ceux avec qui il entretient de bonnes relations. Constat que l’on fait sur le Zélé (1780), dont l’état-major est issu en grande partie du Fantasque. Ce petit-noyau d’officiers, dans lequel on retrouve encore l’un de ses neveux, va pour l’essentiel le suivre sur le Héros pour la campagne des Indes. Tous semblent avoir appris à supporter le caractère difficile de leur chef et surtout à comprendre sa personnalité. L’un d’eux, l’enseigne puis lieutenant de vaisseau Hesmery de Moissac joue un rôle de plus en plus important. Dans la nouvelle campagne, il va tenir régulièrement le journal de bord du Héros puis cumuler les fonctions de capitaine de pavillon et de chef d’état-major du bailli. L’historien La Varende lui décerne le brevet de « dompteur de Suffren »[252]. Il faut aussi remarquer, pour que le tableau soit complet, que Suffren est capable d’éloges sincères et appuyées vis-à-vis de ceux -peu nombreux- qui ont révélé leur talent à ses côtés. C’est le cas d’Albert de Rions, commandant du Sagittaire en 1778 dans l’escadre de D’Estaing. Les deux hommes ont noué au cours de cette campagne des liens très forts d’estime et d’amitié. L’action du Sagittaire et du Fantasque qui ont semé la panique et la destruction dans la rade de Newport (voir plus haut), apparait comme un modèle d’habileté manœuvrière et de coopération efficace. L’évidente complicité entre les deux unités y a rendu presque inutile l’usage des signaux. Suffren ne cessera plus par la suite de faire l’éloge de son ami et de réclamer sa présence à ses côtés aux Indes. Même comportement vis-à-vis du chef d’escadre de Peynier dont Suffren appréciera les talents sur la côte de Coromandel et avec lequel il nouera d’excellentes relations.
Le portrait est donc très contrasté. Suffren est une personnalité complexe qui assemble les plus vives qualités aux défauts les plus caricaturaux. A ce stade de sa carrière, le commandeur occupe dans la flotte une place à mi-chemin entre le marginal et l’électron libre. Ce point le fait d’ailleurs ressembler à d’Estaing, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes lorsqu’on connait les critiques de Suffren vis-à-vis de son chef. Mais d’Estaing entretenait lui aussi de mauvais rapports avec presque tous ses officiers -sauf Suffren- alors...
Suffren dans l'Océan Indien : l'heure de la gloire (1781-1784)
Un conflit maritime aux dimensions devenues colossales
 Bataille de Dogger Bank, le 5 août 1781. L'entrée en guerre des Provinces-Unies oblige l'Angleterre à ouvrir une nouvelle zone d'opération, mais la France doit dépêcher des renforts pour protéger les colonies hollandaises. C'est à cette occasion que Suffren reçoit sa première mission importante.
Bataille de Dogger Bank, le 5 août 1781. L'entrée en guerre des Provinces-Unies oblige l'Angleterre à ouvrir une nouvelle zone d'opération, mais la France doit dépêcher des renforts pour protéger les colonies hollandaises. C'est à cette occasion que Suffren reçoit sa première mission importante.
Suffren reçoit l’ordre d’aller porter secours aux Hollandais. Les historiens n’ont peut-être pas assez insisté sur le caractère démesuré que prend la guerre d’Indépendance américaine, et surtout du poids de ce conflit sur les épaules de la France. L’Espagne était entrée en guerre en 1779, mais avec ses propres objectifs, qui n’étaient en rien l’indépendance des États-Unis, qu’elle redoutait pour ses propres colonies. À Madrid, la vision de ce conflit était très terre-à-terre : s'assurer la reconquête de Gibraltar et de Minorque perdus lors de la guerre de Succession d’Espagne, mais aussi de la Floride (perdue en 1763) et la Jamaïque (perdue en 1655), sans parler du rêve, jamais totalement disparu depuis l’échec de l’Invincible Armada en 1588 d’envahir l’Angleterre...
Dans les palais madrilènes et sur les vaisseaux espagnols ont parlait haut et fort, comme au temps du Siècle d’Or, mais sans avoir les moyens d'entreprendre quoi que ce soit de sérieux sans l’aide de la France. Vu de Versailles, l’Espagne était un allié important pour faire pièce à Londres, mais on ne s’illusionnait guère sur la réalité de la puissance espagnole. La Armada espagnole n’était pas capable de battre seule la Royal Navy, mais les vaisseaux espagnols étaient assez nombreux pour former un point de fixation important dans l’Atlantique[253]. Stratégie en apparence payante, car à l’ouverture des hostilités il avait bien fallu que la Royal Navy détache plusieurs escadres pour protéger ses bases aux portes de l’Espagne, et la flotte combinée franco-espagnole avait semé un début de panique à Londres (voir plus haut). Mais l’alliance avait son revers : il fallait supporter les demandes et récriminations incessantes de Madrid, avec le risque de voir l’Espagne se retirer du conflit si elle n’était pas soutenue. Dès le 8 janvier 1780, Rodney, en route pour Gibraltar, capturait un gros convoi espagnol. Huit jours plus tard il infligeait une lourde défaite à la flotte de Juan de Lángara qui perdait 7 vaisseaux dont le navire amiral au cap Saint-Vincent (ou « bataille du clair de lune »). Résultat : à partir de 1780, il fallait en permanence détacher une importante escadre pour soutenir la flotte espagnole dans ses entreprises. L’allié devenait une lourde charge militaire en compagnie de qui on allait faire le siège de Gibraltar, attaquer la Floride et Minorque. En plus d’aider les Insurgents américains, ont travaillait donc aussi pour le roi d’Espagne[254], et bientôt pour les Provinces-Unies.
La diplomatie française s’activait autant que les escadres pour isoler l’Angleterre. Il est vrai que Londres facilitait la tâche de Versailles, car la Royal Navy, fidèle à ses vieilles habitudes, s’était de nouveau arrogée le droit de contrôler tous les navires neutres afin d’en vérifier la cargaison et de saisir celle-ci si elle semblait être à destination de la France. Ce comportement exaspérait de plus en plus de pays en Europe, au point qu’en 1780, plusieurs États (Russie, Prusse, Portugal, Autriche, Royaume des Deux-Siciles, Espagne) avaient proclamé une « Ligue de la neutralité armée » demandant la liberté des mers. Ce texte, qui avait été poussé discrètement par la France, apparaissait comme une dénonciation des pratiques britanniques et fut interprété comme un camouflet diplomatique pour l’Angleterre. Les Provinces-Unies envisageant d’y adhérer, Londres leur déclara froidement la guerre, en décembre 1780[255].
L’Angleterre se retrouvait donc totalement isolée en Europe, et la France avec un nouvel allié. Les Provinces-Unies, avec leurs solides assises financières et maritimes devenaient un partenaire de choix. La flotte hollandaise (32 vaisseaux et 17 frégates) était qualitativement largement supérieure à la flotte espagnole, et la Navy se retrouvait dans la Manche, avec une zone d’opération de plus à assumer[256]. Cependant, si les Provinces-Unies pouvait faire la guerre seule en Europe, il n’en était rien dans les lointains espaces maritimes, où les colonies hollandaises se transformaient en proie de choix pour la marine anglaise. Dès les premiers mois de 1781, l’île de Saint-Eustache, dans les Antilles tombait entre les mains de la Royal Navy et subissait un pillage en règle[257].
Il fallait donc soutenir l’allié hollandais. Un de plus, après l’Espagne. L’effort naval de la France devenait proprement colossal. Les chantiers navals et les arsenaux tournaient à plein régime, et tout particulièrement celui de Brest, pilier essentiel de cette guerre. Louis XVI accordait des crédits presque illimités à ses vaisseaux. Pour la première fois de son histoire, le budget de la marine allait dépasser celui de l’armée de terre[258]. Côté britannique, la mobilisation navale était encore plus gigantesque, d’autant qu’il fallait aussi mener un conflit terrestre de grande ampleur. Il y avait 50 000 « tuniques rouges » à entretenir dans les immenses espaces de l’Amérique du Nord[259] et pour lesquels le Royal Navy immobilisait des escadres importantes en plus des autres théâtres d’opérations navales[260]. Fait révélateur, la Navy n’était plus en mesure d’« insulter » les côtes françaises comme lors du conflit précédent. Il était évident que l’Angleterre combattait à la limite de ses forces. Cependant, si la position de Londres était maintenant très isolée, l’Angleterre combattait pour ses intérêts seuls et n’avait pas d'allié faible ou défaillant à soutenir.
Les choix de Versailles pour la campagne de l'année 1781 et la première grande mission de Suffren
 Le nouveau ministre de la Marine, de Castrie (1727-1801) vient à Brest inspecter la flotte et assister au départ des escadres en 1781. Suffren y gagne un vaisseau de plus pour sa division. (Tableau de J. Boze)
Le nouveau ministre de la Marine, de Castrie (1727-1801) vient à Brest inspecter la flotte et assister au départ des escadres en 1781. Suffren y gagne un vaisseau de plus pour sa division. (Tableau de J. Boze)
De Castrie, le nouveau ministre de la marine est issu de l'armée de terre, mais s'est révélé un des rares bon chefs de la guerre de Sept Ans. Outre des nouveaux commandants, il impose des choix stratégiques qui manquaient à son prédécesseur. La répartition des vaisseaux ne change guère, mais montre qu'il ne croit pas à une victoire en Europe. De Grasse (accompagné de La Motte-Picquet) doit partir avec une grande escadre (20 vaisseaux) dans les Antilles où se porte toujours l’essentiel de l’effort de guerre français, sachant que pour faire des économies, Louis XVI a décidé de ne pas renforcer les 6 000 hommes de Rochambeau retranchés à Newport. Guichen, avec une escadre conséquente (12 vaisseaux) doit aller prêter main forte à la flotte espagnole devant Gibraltar, et Suffren, avec une division, doit porter des renforts à la colonie néerlandaise du Cap (Afrique du Sud), désormais menacée par la Royal Navy. De Castrie a retiré 8 vaisseaux du théâtre européen pour les redistribuer outre-mer, ce qui donne un quasi-équilibre entre les forces françaises et anglaises hors d'Europe. Même si on laisse 12 vaisseaux dans l'Atlantique, il est clair qu'on a renoncé aux projets d'invasion de l'Angleterre. Pour la première fois au XVIIIe siècle, le théâtre d'opération décisif est hors d'Europe, preuve de l'importance prise par les colonies[210].
Le ministre de la marine, le marquis de Castrie, conscient de l’importance de ces armements décide de se rendre à Brest, décision exceptionnelle et fortement symbolique de son engagement personnel dans le suivi des opérations. Il arrive le 13 mars et rencontre le comte d’Hector, commandant de la base de Brest ainsi que le comte de Grasse et tous les officiers des escadres en partance. Il déjeune à bord du Ville de Paris, le navire amiral de De Grasse et assiste à plusieurs exercices dans la rade [261]. La nouvelle de l'armement de l'escadre anglaise à destination du Cap venant d'arriver, de Castrie décide alors de renforcer les forces de Suffren avec un vaisseau[262].
Suffren prend le commandement d'un nouveau 74 canons, le Héros, un navire neuf (1778), doublé de cuivre et réputé bon marcheur. Cette belle unité se retrouve placée à la tête de 4 autres vaisseaux, l’Annibal (74), le Vengeur (64), le Sphinx (64) et l’Artésien (64) que le ministre vient de joindre à la division. Celle-ci est complétée d'une corvette, la Fortune (16), et doit escorter 8 transports embarquant un millier de soldats[263]. L’analyse de cette petite division montre clairement que le théâtre d’opération indien est secondaire, mais aussi qu’à Brest on a atteint les limites du possible en matière de mobilisation navale. Avec deux 74 canons, trois 64 canons et aucune frégate, la puissance de feu n’est pas très élevée, même si tous les vaisseaux sont doublés de cuivre, sauf un, l’Annibal, alors-même que ce « 74 » est lui aussi récent (1779). Le Vengeur (64 canons), déjà ancien (1757) a certes été modernisé avec un doublage de cuivre, mais la coque fait de l’eau et sa mâture est en mauvais état. Suffren bataille auprès des bureaux brestois pour obtenir plus de matériel en supplément, mais sans succès. Le bailli se plaint aussi vivement de l’insuffisance dotation de sa division en bâtiments légers, d’autant que la corvette la Fortune est en mauvais état et marche mal[264].
La composition des équipages pose aussi de redoutables problèmes. En ce début de quatrième année de guerre, la France arrive maintenant au bout de son capital maritime humain, d’autant que c’est bien sûr la grande escadre du comte de Grasse qui a la priorité. On manque d’hommes pour équiper la division de Suffren. Certains matelots qui ont fait les trois campagnes précédentes sont épuisés ou malades, comme sur le Sphinx, l’Artésien et l’Annibal. On complète comme on peut les équipages en embarquant plus de mousses et de novices et on utilise des troupes de marine à des tâches de matelots[265]. Sur le Héros, Suffren a obtenu d’embarquer nombre d’officiers et de sous-officiers qu’il connait bien, presque tous originaires du sud et dont beaucoup ont fait, on l'a vu, les précédentes campagnes avec lui. L’ambiance sur le vaisseau amiral sera résolument provençale note Rémi Monaque[266].
La mission première de Suffren est d’aller préserver la colonie hollandaise d’une capture anglaise. L’action ultérieure doit le porter ensuite dans l’océan Indien. Elle n’est pas clairement définie par Versailles, et ne doit pas être autre chose qu’une opération de diversion sous les ordres du gouverneur de l’île-de-France. Mais Suffren, dans un courrier à Madame d’Alès écrit peu avant le départ, affirme déjà haut et fort qu’il entend bien profiter de cette campagne pour s’illustrer, surtout s’il peut récupérer les vaisseaux qui stationnent dans l’île : « La moindre circonstance heureuse peut me mettre à la tête d’une belle escadre et y acquérir la gloire, cette fumée pour laquelle on fait tant de choses »[267]. Les évènements vont précipiter cette soif de se faire remarquer.
La mêlée de Porto Praya (16 avril 1781)
 Carte de l'archipel du Cap-Vert. Ces îles portugaises au large de l'Afrique sont une escale importante vers l'Océan Indien. L'escadre de Suffren y rencontre à Porto Praya (île de Santiago) l'escadre anglaise qui a la même destination que lui et qui est là pour le même motif : se ravitailler.
Carte de l'archipel du Cap-Vert. Ces îles portugaises au large de l'Afrique sont une escale importante vers l'Océan Indien. L'escadre de Suffren y rencontre à Porto Praya (île de Santiago) l'escadre anglaise qui a la même destination que lui et qui est là pour le même motif : se ravitailler.
 Le poupe du Héros, vaisseau de 74 canons que monte Suffren avec lequel il se bat à Porto-Praya et pendant toute la campagne des Indes. On peut aussi examiner le modèle réduit du Héros sur le site net4war.com.
Le poupe du Héros, vaisseau de 74 canons que monte Suffren avec lequel il se bat à Porto-Praya et pendant toute la campagne des Indes. On peut aussi examiner le modèle réduit du Héros sur le site net4war.com.
 La bataille de Porto Praya, le 16 avril 1781. L'attaque de Suffren bouscule l'escadre de Johnstone qui n'est plus en état de poursuivre sa route. Plan du combat sur le site pirates-corsaires.com.
La bataille de Porto Praya, le 16 avril 1781. L'attaque de Suffren bouscule l'escadre de Johnstone qui n'est plus en état de poursuivre sa route. Plan du combat sur le site pirates-corsaires.com.
Le 22 mars 1781, la rade de Brest s’anime d’un spectacle magnifique : le départ des escadres combinées du comte de Grasse et de Suffren qui lèvent l'ancre accompagnées d’un immense convoi de 130 voiles. Le ministre est resté pour assister au départ de cette quatrième campagne navale, départ suivi aussi par une foule considérable massée sur les berges[268]. Le 29 mars, la division de Suffren se sépare des 20 vaisseaux et frégates de De Grasse pour bifurquer vers l’Atlantique sud. Ses six navires et ses huit transports de troupes sont accompagnés de cinq navires marchands à destination du Sénégal. Le 9 avril, ce convoi se détache vers l’Afrique. Le 11, Suffren décide de faire relâche au Cap-Vert car l’Artésien, vaisseau destiné au départ à la campagne d’Amérique craint de bientôt manquer d'eau. Le 16 avril au matin, l’escadre arrive en vue de la baie de La Praya (la plage, en portugais). L’Artésien, en tête, signale une flotte au mouillage. Ce sont les navires du commodore George Johnstone, qui se ravitaille aussi sur la route du Cap, soit 5 vaisseaux et 3 frégates escortant 25 transports et navires de la Compagnie des Indes[269].
Une flotte surprise au mouillage sur une côte ou dans une baie ouverte est toujours extrêmement vulnérable, d’autant qu’une partie des équipages est souvent à terre. C’est une occasion qu’il ne faut pas laisser passer, mais beaucoup de vaisseaux sont encore loin derrière. Suffren ordonne de resserrer la ligne et de forcer les voiles pour hâter la concentration de ses forces. Le temps passe, le Vengeur et le Sphinx tardent à arriver. On risque de dériver sous le vent, d’être obligé de louvoyer pour entrer dans la baie et de perdre l’effet de surprise. On commence à percevoir clairement l’importance de l’escadre anglaise. Il est 11h00, Suffren n’hésite plus et ordonne de passer à l’attaque avec les trois navires dont il dispose. Côté anglais, les voiles françaises sont repérées depuis 9h30 mais on est absolument pas préparé à recevoir une attaque. 1 500 hommes sont à terre pour faire le ravitaillement ou se reposer. Beaucoup de navires, à l’ancre, ne présentent que leur avant ou leur arrière faiblement armés et peuvent être pris en enfilade par le tir français[270]. Johnstone doit monter sur le navire le plus proche pour organiser la défense.
Suffren s’engage dans l’étroit passage laissé entre les navires anglais en tirant sur les deux bords. Il ouvre le feu à 40 m sur le HMS Isis[271] (50 canons) puis s’en prend au HMS Montmouth (64 canons) dont il fait sauter le couronnement. Il cherche le cœur du dispositif ennemi et se faufile jusqu’au fond de la baie. Suffren cargue ses voiles et jette l’ancre au milieu des Anglais qui n’ont pas encore pu tirer un coup de canon (Un feu abondant de mousqueterie, provenant des soldats anglais commence cependant à cribler de plomb les vaisseaux). Dans la flotte de transport anglaise, c'est la confusion : si plusieurs navires ont ouvert le feu sur les Français au bout de quelques minutes, deux ou trois ont amené leur pavillon et jettent à la mer les précieux paquets de la Compagnie des Indes. D'autres cherchent à gagner le large.
L’Annibal, qui suit juste derrière double alors son chef sur tribord, en s’engageant entre le Héros et le HMS Montmouth. Manœuvre particulièrement audacieuse car il n’y a qu’un espace d’une trentaine de mètres entre le Héros et le navire anglais. Moment impressionnant où les équipages français et anglais peuvent se dévisager à quelques mètres, ce qui interrompt un instant le feu de mousqueterie, tout le monde poussant des hourras... L’Annibal jette l’ancre à son tour devant son chef, mais son capitaine, Trémignon, a fait une bévue énorme : ne croyant pas à un affrontement dans les eaux neutres du Portugal il n’a pas ordonné son branle-bas de combat[272]! Suffren, sur le Héros, se retrouve donc seul au milieu des bateaux anglais, tirant « aussi vite qu'il était possible de charger et de décharger. » Quand à l’Annibal, il reste seul pendant un quart d'heure à supporter le feu de tous les vaisseaux anglais, « tirant à peine un seul coup de canon » notera Johnstone dans son rapport[273].
Ainsi, passé l’effet de surprise, la résistance anglaise se durcit et les deux navires français sont maintenant bien seuls au milieu d’une canonnade acharnée. Le Vengeur arrive, traverse le dispositif ennemi et passe sur l’arrière du Héros mais ressort sans avoir mouillé. Il tire d’assez loin sur les vaisseaux anglais avant de dériver vers le sud de la baie, un peu en dehors du combat. Il s'en prend ensuite aux navires de transport qui cherchent à s’enfuir. L’Artésien, en 4e position, finit par arriver aussi et s’engage au milieu des navires anglais. Il tente d’aborder un vaisseau de la Compagnie des Indes, mais son capitaine est tué au moment où il donne l’ordre de mouiller. L’ordre n’est pas exécuté car le second est au commandement de la première batterie. Pendant qu’il monte sur la dunette, l’Artésien aborde un autre navire de transport, l’Infernal et dérive avec lui vers le large. Exit l’Artésien. Le Sphinx arrive en dernier, mais le vent tourne et le pousse hors de la baie. Il tire quelques bordées alors que l’action touche à sa fin.
Au centre, la situation du Héros et de l’Annibal devient maintenant très périlleuse. Au feu croisé des navires anglais vient s’ajouter le tir de la forteresse portugaise qui réagit au viol de sa neutralité. Le commandant de l’Annibal, Trémignon est tué (la cuisse emportée par un boulet). Son second, M. Morard de Galles, prend aussitôt le commandement, mais le vaisseau perd son mât d’artimon et son grand mât. Il est midi. L'attaque surprise est en train de se transformer en piège. Il faut rompre le combat, à moins de risquer le pire. Suffren fait couper son câble, bientôt suivi par l’Annibal, mais en sortant de la baie le navire perd son troisième mât, abattu par une dernière bordée anglaise. L’Annibal n’est plus qu’un ponton flottant qui doit être pris en remorque par le Sphinx. Dans la confusion du combat, une douzaine de bâtiments britanniques ont déradé, mais on doit renoncer à les saisir car il faut absolument se dégager[274].
L’affrontement a duré une heure trente à peu près. Suffren reforme sa ligne de bataille au large de La Praya et effectue les premières réparations. Les charpentiers de marine s’activent pour réparer les nombreux cordages du Héros qui ont été sectionnés et redonner un début de mâture à l’Annibal. Suffren donne l’ordre au convoi de passer sous le vent et de reprendre vers le sud. Les Français ont capturé deux navires de transport anglais : celui abordé par l’Artésien et un autre qui a dérivé vers eux, mais il faut s’en dessaisir[275]. À terre, Johnstone tient conseil avec ses capitaines puis décide d’appareiller. On peut croire que la bataille va reprendre car vers 15 h 00 l’escadre anglaise sort de la baie et se rapproche presque à portée de canon. Mais face à la fermeté affichée par la division française, le commodore anglais ne tente rien et profite de la nuit pour s’esquiver et se remettre à l’abri dans la baie. Les dégâts infligés à l’escadre et aux navires de transport anglais sont considérables. Johnstone n’est plus en état de tenir la mer, ou alors il lui faut laisser de nombreux bâtiments à La Praya. Il rentre péniblement vers l’île portugaise en louvoyant par vent de face et va devoir y rester 16 jours de plus pour réparer. L’horizon est dégagé pour Suffren qui reprend sa route en faisant remorquer l’Annibal alternativement par le Héros et par le Sphinx.
Cette bataille acharnée, confuse, indécise et extravagante[276] se termine donc sur une victoire française par abandon de l’adversaire. L’historien constate que Suffren a combattu avec à peine la moitié de ses forces. Seul les deux 74 canons ont été engagés à fond, mais avec une efficacité réduite de moitié vu l’erreur de commandant de l’Annibal, qui a bien failli causer la perte du navire. En fin de compte, seul le Héros a combattu à la hauteur de sa puissance de feu et de sa position dans le dispositif adverse. Les pertes sont d’ailleurs importantes : 107 morts et 242 blessés, concentrés pour plus de moitié sur l’Annibal[277] dont deux commandants, celui de l’Annibal qui a payé son erreur de sa vie, et de l’Artésien, tué au début de l'engagement (c'est d'ailleurs le seul mort de ce navire). Les Anglais n’affichent que 6 tués et 34 blessés. Que penser du comportement des capitaines du Vengeur et du Sphinx ? Jean Meyer et Martine Acerra parlent de « signaux mal compris par les commandants des autres vaisseaux »[278]. Jean-Christian Petitfils parle lui de « désobéissance des deux capitaines (...) qui refusent de se battre »[279]. Rémi Monaque note cependant que lorsqu'ils sont arrivés sur le champ de bataille, le vent avait tourné et chassait les navires hors de la baie. Aucun des deux ne sera en tout cas sanctionné au lendemain de cette bataille, alors que l’engagement de leurs vaisseaux de 64 canons aurait peut-être permis la destruction de l’escadre anglaise. L’incompétence, la pusillanimité et/ou l’indiscipline d’une partie des capitaines va aussi devenir une marque de fabrique de cette campagne que nous retrouveront dans d’autres engagements.
Le bailli, que l’on trouve si souvent soucieux de sa renommée dans sa correspondance personnelle, se montre parfaitement réaliste sur cette occasion manquée. Il laisse transparaître sa rage -et son égo- de ne pas avoir réussi à détruire l'escadre anglaise lorsqu’il fait son rapport au ministre de Castrie. « A vous, Monseigneur, j’avoue que j’ai été les attaquer de propos délibéré, espérant qu’à la faveur de la surprise et du désordre du mouillage, les détruirais, que je mènerais à M. d’Orves (le commandant de la division de l’île-de-France) les secours sur lesquels il ne comptait pas et enfin la supériorité décidée dans l’Inde, dont l’avantage inappréciable pouvait faire la paix (...). J’ai manqué l’occasion précieuse de faire de grands choses avec de petits moyens, j’en suis inconsolable »[280].
Suffren s’inquiète aussi des réactions de Versailles lorsque sera connu le viol de la neutralité portugaise et s’en explique au ministre des affaires étrangères, le comte de Vergennes. Il s’appuie sur le précédent de Lagos en 1759 (où il a été fait prisonnier, voir plus haut) lorsque la Royal Navy avait poursuivi l’escadre française de La Clue et pris ou incendié 4 vaisseaux sur les plages portugaises[281]. Précaution inutile car à Versailles on a parfaitement compris la portée de cette bataille, puisqu’elle sauve le Cap de l'invasion anglaise. Le Cap pris, la Royal Navy se serait retrouvée en position de couper la route de l’océan Indien ce qui aurait été catastrophique pour les franco-néerlandais. De Castrie écrit immédiatement à Suffren (le 1er juillet) pour l’informer de la grande satisfaction du roi sur sa conduite, alors que l’affrontement n’est encore connu que par des dépêches anglaises.
Le Cap sauvé de l'invasion anglaise
 Le Cap et la Montagne de la Table. La colonie néerlandaise, sauvée de l'invasion par l'arrivée de Suffren occupe une place essentielle sur la route des Indes orientales. Avec la reprise de l'île de Saint-Eustache, la victoire en Amérique et l'aide victorieuse aux Espagnols en Floride et à Minorque, 1781 apparaît comme une année faste pour la marine française. (Tableau de W. Hodges)
Le Cap et la Montagne de la Table. La colonie néerlandaise, sauvée de l'invasion par l'arrivée de Suffren occupe une place essentielle sur la route des Indes orientales. Avec la reprise de l'île de Saint-Eustache, la victoire en Amérique et l'aide victorieuse aux Espagnols en Floride et à Minorque, 1781 apparaît comme une année faste pour la marine française. (Tableau de W. Hodges)
Le 20 juin, après 64 jours de navigation depuis la Praya (et 92 depuis Brest), la montagne de la Table qui domine la ville du Cap est en vue. La division jette l’ancre dans la rade plus abritée de False Bay à quelques lieues au sud. Il était temps. Les équipages sont épuisés. On débarque près de 600 malades, dont 500 scorbutiques.
Les Hollandais ont été prévenus depuis le 27 mars par une corvette (dépêchée en urgence depuis Brest) de l’entrée en guerre de leur pays et de l’envoi d’une flotte française de secours. Ce qui n’empêche pas Suffren de constater que rien n’a été fait par le gouverneur pour mettre la colonie en défense et accueillir les renforts (Celle-ci n’est protégée que par 400 hommes et les fortifications sont en mauvais état). L’état d’esprit de la population, nettement anglophile, est loin d’être favorable aux Français. Comme le note un militaire français, « ils (les habitants du Cap) regardent les Anglais comme des êtres supérieurs. Ils calculent que sous la domination anglaise, ils jouiraient de beaucoup plus de privilèges, que leur commerce gêné par les entraves que leur impose la compagnie de Hollande, serait plus actif et plus étendu, qu’enfin en temps de guerre, ils seraient protégés plus efficacement qu’ils ne le sont actuellement par la compagnie hollandaise qui semble les avoir oubliés »[282]. Tout est dit. Les Français ne sont pas reçus en sauveurs, et il va falloir toute la discipline exemplaire des troupes qui débarquent pour détendre peu à peu l’atmosphère. Celles-ci arrivent progressivement, entre le 30 juin et le 2 août, la division ayant doublé les navires de transport dans l’Atlantique sud pour arriver la première au Cap. Les relations entre Suffren et le gouverneur hollandais restent difficiles. Ce dernier traine des pieds pour assurer le ravitaillement, l’hébergement, et fournir du bois pour réparer les vaisseaux, ce dont se plaint vivement le bailli[283].
Fin juillet, arrive l’escadre de Johnstone. L’Anglais va-t-il tenter un débarquement de force ? On reste quelques jours à s’observer. Suffren refuse une nouvelle bataille navale vu l’état de ses navires. Le commodore n’insiste pas. Il finit par se retirer, après avoir saisi comme lot de consolation 4 navires hollandais de la Compagnie des Indes qui s’étaient réfugiés dans une baie au nord du Cap. La colonie hollandaise est définitivement sauvée. Cet exploit vaut à Suffren d’être nommé chef d’escadre (la nouvelle ne lui parviendra que tardivement en 1782 compte-tenu des distances).
L’état sanitaire des équipages s’améliore progressivement alors que les charpentiers de marine travaillent dur pour réparer l’Annibal. Les vaisseaux français étaient partis de Brest avec en double un jeu de toile et de cordages comme il était d’habitude pour pouvoir réparer après une bataille (ou un coup de vent). Cependant, malgré les demandes pressantes du bailli, on ne lui avait pas accordé le supplément en bois de mâture. Comment réparer un navire démâté dans ses conditions ? Suffren s’en plaint dès le 10 août depuis le Cap, et ne cessera lors de la suite de la campagne de réclamer du bois de remplacement qui ne viendra pas. « On m’a refusé à Brest les suppléments de rechange nécessaire pour une campagne dans l’Inde. Une épargne de 10 000 livres en coûtera ici plus de 100, sans compter les retardements. Si vous voulez tirer parti des 11 vaisseaux qui sont dans l’Inde, envoyez-nous des munitions navales de tous genres, des bois de mature, des mâts de hune surtout, c’est ce qu’il y a de plus essentiel, des hommes et de l’argent, des officiers »[284]. Ces pénuries obligent Suffren à s’adonner à un ingénieux et permanent bricolage sur ces navires, pour les maintenir en état de naviguer et de combattre. Pour réparer ce 74 canons indispensable à la division, on remonte les mâts du Trois-Amis, un navire de transport du convoi. Un procédé que l’on retrouvera tout au long de cette campagne et sur lequel nous reviendrons[285].
Le 15 août, arrive une frégate de l’île-de-France, porteuse d’une dépêche du gouverneur lui demandant de le rejoindre immédiatement dans l’océan Indien[278]. Le 26 août, après deux mois et demi d’escale, la division lève enfin l’encre en laissant 500 soldats au Cap. La très longue durée de l’escale en dit long sur les difficultés à se ravitailler et à réparer qu'il a fallu résoudre.
L’année 1781 semblait enfin sourire aux Français. A Amsterdam, on ne faisait pas la fine bouche comme au Cap. Lorsqu'on apprenait qu'en plus de cette victoire, La Motte-Picquet avait capturé le convoi anglais gorgé du butin du pillage de l'île de Saint-Eustache[286], on buvait à la santé du roi de France[287]. Aux succès de La Motte-Picquet et de Suffren venait s’ajouter la victoire décisive tant attendue en Amérique du Nord. L’escadre du comte de Grasse, grâce à une opération combinée mer-terre avec les troupes de Rochambeau et de Washington avait encerclé et contraint à la capitulation l'armée de Cornwallis à Yorktown (19 octobre), après une belle victoire navale dans la baie de la Chesapeake (5 septembre). En mai, une escadre franco-espagnole s’était aussi emparée de Pensacola, prélude à la conquête de la Floride et une autre, en août, avait débarqué une forte armée sous les ordres du duc de Crillon pour s’emparer de Minorque[288]. 1781 apparait donc comme une année admirable pour la flotte française, capable d’emporter la décision sur plusieurs théâtres d’opération. Les diplomates pouvaient commencer à négocier le traité de paix, mais en attendant, la guerre se poursuivait et la France pouvait espérer d’autres succès aux Indes en se lançant à la reconquête des postes français enlevés par les Anglais au début du conflit.
L'escale à Port-Louis, ou le défi des intrigues et de la logistique
 Carte de l'« Isle de France » (aujourd'hui l'île Maurice, au large de Madagascar). Suffren y séjourne 6 semaines pour réparer ses vaisseaux et pour se heurter aux intrigues des officiers de la division de d'Orves qui revendiquent le commandement de plusieurs de ses navires. (Carte de 1771)
Carte de l'« Isle de France » (aujourd'hui l'île Maurice, au large de Madagascar). Suffren y séjourne 6 semaines pour réparer ses vaisseaux et pour se heurter aux intrigues des officiers de la division de d'Orves qui revendiquent le commandement de plusieurs de ses navires. (Carte de 1771)
Suffren arrive à l'île-de-France le 25 octobre 1781 (actuellement l'île Maurice)[289]. La traversée s'est passée sans encombre et il a même la surprise d'y trouver deux navires du convoi qui manquaient à l'appel depuis La Praya. Si Suffren noue rapidement de bonnes relations avec le gouverneur de l'île, François de Souillac, il n'en va pas de même avec le commandant de l'escadre, Thomas d'Orves, qui a brillé par son inaction depuis le début du conflit. Cet officier très âgé est le jouet de ses commandants qui ont fait pression sur lui pour prendre le moins de risque possible et qui maintenant émettent des prétentions sur plusieurs vaisseaux de Suffren au nom de leur ancienneté. L'affaire est délicate pour le bailli, car sa division est maintenant fondue dans celle de d'Orves, qui exerce le commandement supérieur[290].
À la Praya, deux commandants ont été tués, celui de l’Artésien et celui de l’Annibal. Suffren n'émet pas d'objection pour que M. Pas de Beaulieu qui avait reçu le commandement de l’Artésien en soit dépossédé. Ce jeune officier n'a pas démérité, mais il peut recevoir en compensation le commandement d'une frégate plus en rapport avec son âge et son grade. Mais Suffren tient beaucoup à M. Morard de Galles (le second du commandant tué) et qui s'est illustré pour sortir l’Annibal démâté de la baie. D'Orves, qui dans un premier temps partage cet avis, se révèle trop faible pour résister aux pressions du groupe d'officier mené par le capitaine de vaisseau de Tromelin, principal bénéficiaire de l'opération (et qui obtient donc le commandement de l’Annibal).
Cette affaire exaspère Suffren qui en informe immédiatement le ministre. « Une cabale s'est élevée parmi les capitaines en service dans l'Inde pour réclamer l'Annibal au nom de l'ancienneté » s'insurge le bailli qui trace au passage un portrait peu amène de ces officiers intrigants, plus préoccupés de leurs plaisirs et de leurs affaires que du service du roi[291]. « Presque tout le monde ici a femme, ou maîtresse, ou habitude ; le sexe y est charmant ; on y mène une vie douce ; ce sont les délices de Capoue ou l'île de Calypso où il n'y a point de Mentor. Beaucoup y ont fait des fortunes, et cela les rend très hauts et indociles » note encore Suffren dans un courrier à un de ses amis[292]. Le ministre donnera entièrement raison à Suffren et désapprouvera d'Orves[293], mais en attendant le retour du courrier il faut bien se plier au choix du vieux chef et supporter la victoire de Tromelin. Cette affaire aura des suites considérables sur la campagne. Désormais, l'hostilité règne entre le petit groupe d'officiers de l'île-de-France et le bailli qui juge sévèrement leur égoïsme et leur affairisme.
En attendant de reprendre les opérations, les équipages prennent un peu de repos, Le mois de novembre est occupé à soigner les scorbutiques et on complète les équipages. On n'hésite pas à embarquer une poignée d’esclaves noirs et on constate, fait intéressant, un afflux de volontaires dans l'escadre, enthousiasmés par la victoire de Suffren à La Praya[294]. L’évènement est suffisamment rare pour être signalé. Cette anecdote nous indique que la réputation du bailli est maintenant bien établie, au point d’attirer des hommes alors que les conditions de vie très éprouvantes à bord des vaisseaux de guerre font généralement fuir les matelots et que les désertions sont légions à chaque escale (dans la Marine française, comme dans la Royal Navy).
Bonnes et mauvaises nouvelles alternent. L’escadre reçoit le 19 novembre un important apport de vivres avec l’arrivée d’une cargaison de bœuf et de riz en provenance de Madagascar. Le 21, arrive la frégate la Bellone. Elle escortait un important convoi de 13 navires marchands partis de Lorient avec des vivres et des précieux gréements, mais celui-ci a été intercepté par un vaisseau anglais au large du Cap. Le convoi a été dispersé et deux transports ont été pris. C’est un coup dur pour les Français, même si la frégate est porteuse de 1,5 million de livres en piastres, destinée aux négociations à mener en Inde[278]. Port-Louis est cependant un port assez bien équipé, aménagé depuis longtemps par l'ancienne compagnie des Indes. Pendant 6 semaines, les vaisseaux réparent leurs avaries, grâce à un travail intensif de remâtage et de carènes à flot. Au final, avec les compléments d’équipage, l’état de l’escadre s’est fortement amélioré puisque Suffren signale à son ami Blouin que les vaisseaux sont en bon état et qu’à l’exception du cordage dont elle manque « elle est réellement mieux armée qu’en partant de Brest »[295].
L’escadre est maintenant composée de 11 vaisseaux : 3 unités de 74 canons, 7 unités de 64 canons et une de 56 canons. Elle est aussi accompagnée de 3 frégates de 38, 36 et 32 canons et 4 petites unités de 24, 12, 10 et 6 (ou 4) canons[296]. C’est la plus puissante escadre dont la France ait jamais disposé en Océan indien, même si elle est loin d’être homogène. L’Orient, seul 74 canons qui entre dans la nouvelle ligne de bataille est déjà un vieux vaisseau (1759). Plusieurs 64 canons ne sont pas de véritables bâtiments de guerre mais d’anciens navires de la compagnie des Indes rachetés par le roi. L’escadre ne compte que deux frégates modernes et doublées de cuivre. C’est peu pour assurer les missions d’éclairage et de liaisons.
De Castrie, qui souhaite depuis sa prise de fonction renforcer le théâtre d’opération de l’Inde a fait parvenir des instructions qui laissent une grande initiative à leurs destinataires tout en les incitant fortement à l’action. Le ministre précise qu’il faut attaquer les Anglais partout ou c’est possible, s’en prendre à leur commerce et leurs comptoirs pour les « ruiner ». La missive se termine par un coup de fouet qui sonne aussi comme un désaveu de la façon dont la guerre a été conduite jusque-là : « Sa Majesté daigne en même temps assurer le comte d’Orves qu’elle ne le rendra point responsable des évènements malheureux qui pourraient arriver, mais qu’il le serait s’il n’employait pas toutes les ressources de son esprit et de son courage pour rendre la campagne également utile et glorieuse à ses armes »[297]. Du pain béni pour un officier qui cherche à s’illustrer comme Suffren, même si ce n’est pour l’instant pas lui qui commande.
Le 7 décembre 1781, l'escadre appareille pour l’Inde. Elle est accompagnée de 10 navires de commerce dont un (le Toscan) aménagé en hôpital. On a embarqué à peu près 3 000 hommes de troupe du Régiment d'Austrasie, de celui de l’île-de-France et de la 3e légion de volontaires étrangers de la marine avec un détachement d’artillerie, sous les ordres du comte Duchemin. L’île-de-France est « exsangue de tout approvisionnement », et il ne reste plus aucune rechange de mâture[298]. Mais le sort en est jeté. Port-Louis est à plus de deux mois de navigation de l’Inde. Pour être efficace et réactif, il faudra trouver de nouvelles bases sur place. On ne reverra plus l’île-de-France avant la fin de la guerre.
L'Inde, ses enjeux et la prise de commandement de Suffren
 Haidar Alî mène depuis des années la lutte contre les Anglais dans le sud de l'Inde et sollicite l'alliance des Français. Celle-ci ne se manifeste qu'en 1782, avec l'arrivée de l'escadre de Suffren.
Haidar Alî mène depuis des années la lutte contre les Anglais dans le sud de l'Inde et sollicite l'alliance des Français. Celle-ci ne se manifeste qu'en 1782, avec l'arrivée de l'escadre de Suffren.
La situation en Inde est complexe. Depuis qu'ils ont évincé les Français du pays en 1763, les Anglais ont étendu leur emprise vers l’intérieur sous la direction de Warren Hastings, devenu gouverneur général de l’Inde en 1773[299]. Mais cette domination se heurte à la vive résistance de nombreux princes indiens. Le plus puissant se trouve être Hyder Ali Khan (le plus souvent appelé Haidar Alî), ancien ministre du nabab du Mysore et qui s’est proclamé nabab à son tour. Ce « potentat cruel et ténébreux »[300] hait les Anglais contre lesquels il mène une guerre interminable. Il alterne succès et revers et sollicite l’aide des Français. Il dispose de 100 000 hommes et d’une bonne artillerie, mais les Français on l’a vu, sont restés inactifs dans la région depuis le début des hostilités. Inactifs au point de n’avoir fait aucun effort sérieux pour défendre leurs comptoirs, alors que Warren Hastings craignait une attaque. Mais les forces françaises s’étaient retirées sur l’île-de-France après un bref combat naval le 10 août 1778 devant Pondichery[301]. La ville, laissée sans secours avait capitulé après deux mois de siège, les quatre autres comptoirs étant saisis sans mal par les Anglais. Depuis 1778, il n’y a donc plus aucune base sur laquelle peut s’appuyer l’escadre française, à moins de compter sur les ports hollandais de l’île de Ceylan (actuellement le Sri Lanka). C'est en théorie possible, à condition d’agir vite avant que ces positions ne tombent elles aussi, et en débarquant les troupes pour coordonner leur l’action avec celles de d’Haidar Alî.
La traversée se passe sans encombre. Pour aller plus vite, le bailli a choisi une nouvelle route qui vient d’être reconnue par le vicomte Grenier. Elle permet de contourner les cyclones et évite aux navires une lente remontée vers l’Inde en louvoyant contre la mousson du nord-est[302]. Le 20 janvier, après deux jours de poursuite, l'escadre fait une prise intéressante : le HMS Annibal, un petit vaisseau récent de 50 canons doublé de cuivre. Le bâtiment, dont l’équipage est miné par le scorbut, se rend après quelques coup de canons symboliques. L’interrogatoire de l’équipage permet d’apprendre que c’est ce navire qui a dispersé le convoi de ravitaillement attendu à l’île-de-France, mais aussi -plus inquiétant- que Johnstone a fait passer vers Bombay 3 bâtiments de sa division[299]. Comme il y a déjà un vaisseau français nommé l’Annibal, on renomme ce dernier le Petit Annibal ou l'Annibal anglais. Le commandement est confié au second de Suffren et le vaisseau, après avoir reçu un équipage français, est intégré à l’escadre[303].
Peu de temps avant l’appareillage de l’île-de-France, Suffren avait écrit à son ami Blouin que « si la santé de M. d’Orves se dérangeait, et qu’on me laissât cette mission, il faut si l’on veut que les choses aillent bien, qu’on me donne de grands pouvoirs. Je désire bien plus de succès que je n’en espère »[304]. Ce vœu un peu cynique va être exaucé au-delà de toute espérance. Le journal de bord du Héros note à partir du 26 janvier 1782 que le vieux chef commence à présenter des signes de défaillance. Le 3 février, D’Orves qui sent sa fin proche et qui garde encore un peu de lucidité, décide de confier le commandement au bailli. Symboliquement, Suffren fait passer son vaisseau, le Héros, en tête de la ligne.
Cette prise de commandement intervient à un moment opportun. La côte de Coromandel, avec la grande base anglaise de Madras, est maintenant presque en vue. Suffren décide donc le 4 février de tenir un conseil de guerre pour consulter les commandants sur la stratégie à suivre. Le bailli, qui d’habitude n’écoute guère que son propre jugement, estime plus prudent de respecter les usages au moment de prendre une décision importante. C’est peut-être aussi une occasion de rompre la glace avec le clan Tromelin. Mais le conseil tourne court lorsque les vigies signalent des voiles à l’horizon. Chacun regagne son vaisseau. Il ne s’agit en fait que d’un navire chargé de riz pour Madras. C’est la première d’une série de prises que l’escadre va faire sur l’intense trafic qui entre et sort de Madras. Un autre navire capturé le 7 février informe Suffren que les Anglais se sont emparés de deux places hollandaises : le port de Negapatam, sur la côte sud-est de l’Inde, et Trinquemalay, sur la côte orientale de Ceylan[305]. Deux bases naguère amies maintenant perdues, ce qui complique encore la situation alors que l'on sort de deux mois de navigation dans l’océan Indien et qu'il faut absolument accoster quelque part.
Le 9 février, Thomas d’Orves décède à bord de son vaisseau. Il faut faire vite, aussi Suffren ne perd pas son temps en oraison funèbre. Le même jour, trois Indiens trouvés à bord d’une prise acceptent de porter des lettres de Suffren à Haidar Ali dont on a appris la présence au sud de Madras. Suffren dédouble aussi les porteurs du courrier en envoyant une de ses corvettes vers Pondichéry avec un émissaire de son état-major. Le 12 février, le bailli remanie aussi le commandement de plusieurs vaisseaux, manière d’affirmer son autorité sur l’escadre[306]. Le 14 février, on est en vue de Madras où les vaisseaux anglais sont signalés au mouillage.
La bataille de Sadras, ou la victoire avec une demi-escadre (17 février 1782)
 Le contre-amiral Edward Hughes (1720-1794) est un bon marin qui connait parfaitement les eaux indiennes et qui va donner du fil à retordre à Suffren.
Le contre-amiral Edward Hughes (1720-1794) est un bon marin qui connait parfaitement les eaux indiennes et qui va donner du fil à retordre à Suffren.
La flotte anglaise de l’Inde est commandée par le contre-amiral Edward Hughes –« la petite mère Hugues »-, comme le surnomment familièrement les matelots. De physionomie il ressemble un peu à Suffren, avec qui il partage l’embonpoint. Bouffi et couperosé[279], mais élégamment vêtu et d’une politesse exquise, contrairement au style débraillé et truculent du bailli. Plus âgé que Suffren de 9 ans, il est comme lui rentré dans la marine vers 15 ans et a fait une belle carrière pendant la guerre de Succession d’Autriche puis de l'Oreille de Jenkins et de Sept Ans, avant de servir aux Indes[307]. C’est un bon marin qui connait parfaitement les eaux indiennes et dispose d’une escadre bien armée. Les historiens anglais estiment que son excellente aptitude au commandement tient plus d’une longue pratique qu’à un quelconque génie. Quoi qu’il en soit, ce marin tenace, professionnel et flegmatique va s’avérer un adversaire d’autant plus coriace qu’il est parfaitement obéi de ses capitaines.
Le 14 février, en fin d’après-midi l’escadre française arrive en vue de Madras. Les 9 vaisseaux de Hugues sont reconnus au mouillage. Suffren, avec ses 12 vaisseaux, dispose d’une nette supériorité. Mais le bailli, qui n’a pas oublié la déconvenue de la Praya, se montre très prudent. Il est déjà tard. En attaquant maintenant, on prend le risque d’un combat nocturne dans des eaux qu'on ne connait pas alors qu’il y a aussi -comme à la Praya- les canons de la forteresse à affronter. Suffren préfère reporter l’attaque au lendemain. Nombre d’observateurs ont critiqué cette décision qui fait perdre aux Français le bénéfice de la surprise, mais Suffren garde cependant l’avantage du nombre.
Au matin du 15, on forme la ligne d’attaque mais on constate aussi que les Anglais ont modifié leur position et se sont embossés sous la protection des forts. Nouvelle hésitation du bailli qui ordonne de mouiller et convoque ses commandants pour tenir un conseil de guerre. À l’exception du capitaine de la Fine, la frégate partie reconnaitre le port, tous estiment que l’escadre anglaise est inattaquable sous la protection des forts. Le vent est certes favorable mais il pousserait aussi à la côte les navires en difficulté. Cette prudence déconcerte l’observateur, compte-tenu du tempérament naturellement fougueux du bailli. Le choix de consulter ses hommes et de temporiser place tout de même l’escadre anglaise dans l’embarras, car Hughes ne peut rester inerte et laisser à Suffren la maîtrise des eaux Madras. L'escadre anglaise va donc devoir sortir pour se battre en infériorité numérique loin de la protection de l’artillerie terrestre[308].
Ordre est donné côté français d’appareiller pour se rendre à Porto Novo, petit port contrôlé par Haidar Ali à une centaine de milles au sud de Madras. On sort de plus de deux mois de navigation : il faut débarquer les troupes, ravitailler l’escadre et soigner les malades[309]. C’est alors que l’escadre anglaise sort de Madras, mais il est de nouveau trop tard pour combattre. Pendant la nuit, suite à des ordres mal compris, le convoi s’éloigne de l’escadre française. Au petit jour, c’est la stupeur : Hughes s’est positionné par hasard entre Suffren et le convoi. La flute Bons-Amis attaquée par la frégate Sea-Horse réussit à se dégager. Cinq anciennes prises sans valeurs sont reprises, mais une autre, le Lauriston qui transporte 369 hommes du régiment de Lauzun, de l’artillerie de campagne et des munitions est saisi[310]. C’est un coup dur pour les Français, même si Suffren qui arrive sur les lieux lance immédiatement la poursuite. Elle se prolonge pendant la nuit en suivant les feux anglais.
Le 17 février vers 15h30, au large du petit port de Sadras, la bataille s’engage enfin. Suffren, qui dispose de la supériorité numérique, choisit de concentrer son attaque sur l’arrière-garde anglaise. Il reprend une tactique déjà ancienne qui consiste à déborder l’arrière de la ligne ennemie pour la prendre entre deux feux avec les vaisseaux en surnombre. L’originalité de la manœuvre tient au fait que Suffren ne compte remonter qu’une partie de la ligne anglaise sur 6 vaisseaux seulement par l’arrière en laissant les 3 premiers non inquiétés. Comme l’escadre française compte 12 vaisseaux, les 6 autres navires en doublant la ligne anglaise doivent donc prendre entre deux feux -et détruire- les 6 vaisseaux anglais doublés des deux côtés[311]. C'est un plan audacieux, mais qui suppose des manœuvres sans failles.
Suffren, qui a réussi à prendre le vent, commence à remonter la ligne anglaise. Il double le HMS Exeter (64 canons) qu’il canonne copieusement puis le HMS Monarca (74), le HMS Isis (54), le HMS Hero (74) et enfin arrive au niveau du HMS Superb (79), navire amiral de Hugues contre lequel il fixe son attaque en diminuant sa voilure (Il n’engage donc que 5 vaisseaux au lieu de 6). Les 4 vaisseaux qui suivent le Héros de Suffren, soit l’Orient (74), le Sphinx (64), le Vengeur (64) et le Petit Annibal (50) imitent leur chef et attaquent les vaisseaux anglais qui viennent d’être doublés[312].
La bataille semble donc bien engagée, lorsque vers 16h15 le bailli donne l’ordre aux autres vaisseaux français de commencer la manœuvre de doublage de l’escadre anglaise par l’arrière. Mais Tromelin, qui commande ces unités restées en retrait, ne bouge pas malgré la répétition des signaux. Trois vaisseaux français qui ont vu les ordres (ou compris la manœuvre) se détachent pour tenter de doubler la ligne anglaise, mais Tromelin leur intime l’ordre de rester dans son groupe. L’Ajax (64) se plie à l’injonction, mais le Flamand (54) et le Brillant (64) désobéissent et entament la manœuvre. L’engagement de ces deux navires met rapidement les derniers vaisseaux anglais, les HMS Exeter et Monarca (déjà sérieusement touchés par les bordées de tous les navires qui suivaient Suffren) dans une situation intenable. Heureusement pour eux, le Brillant perd son mât d’artimon. De ce fait il pivote dans le vent et présente sa poupe à l’Exeter qui réussit à lui placer une bordée en enfilade et à faire de nombreuses victimes. Le Flamand prend la place du Brillant et poursuit la canonnade sur l’Exeter. Le vaisseau anglais, complètement désemparé, n’est plus qu’une épave sanglante qui lance des signaux de détresse puis amène son pavillon, mais les Français ne le voient pas et poursuivent le combat[313].
Pour Hughes, la situation devient très difficile. Les vaisseaux anglais, sous le vent des Français, sont inclinés et reçoivent de nombreux boulets sous la ligne de flottaison. Le navire amiral est à deux doigts de couler car ses pompes ne suffisent pas à étaler les voies d’eau alors que les calfats s’activent pour « temponner » les trous[314]. Hughes donne l’ordre à 3 des 4 vaisseaux de son avant-garde inemployée de virer pour se porter au secours de l’arrière garde en difficulté [les HMS Eagle (64), Burford (64) et Montmouth (64)]. Mais comme Hughes le reconnaitra plus tard[315], la tactique de Suffren rend cette manœuvre très difficile car les Anglais étant sous un faible vent, les 3 vaisseaux ont du mal à se retourner pour longer la ligne vers l’arrière. Ils réussissent cependant à sauver l’Exceter et à le prendre en remorque alors que la nuit tombe et que le contre-amiral décide de rompre le combat.
La journée se termine donc par une victoire française, incomplète cependant car Hughes, bien que sévèrement étrillé, a tout de même réussi à sauver son escadre. Les Anglais ont perdu 137 hommes et déplorent 430 blessés. Les Français comptent 30 morts, dont 4 sur le Héros[316]. C’est une victoire paradoxale, car arrivé en nette supériorité numérique le matin, Suffren a combattu en nette infériorité l’après-midi, compte-tenu de la défection de 5 vaisseaux. On peut comprendre le commentaire du bailli au ministre des affaires étrangères : « la nuit et d’autres circonstances, m’ont enlevé une victoire qui aurait décidé du sort de l’Inde. Les Anglais ont profité de la nuit pour cacher leur fuite »[317]. Les « autres circonstances » font penser au comportement de Tromelin et des commandants qui sont restés hors de la bataille. Il apparait évident qu’il y un problème de discipline ou de commandement dans l’escadre.
Article détaillé : Bataille de Sadras.Les suites de Sadras, ou le début d'une grave crise de commandement
 Le sud de l'Inde et l'île de Ceylan (carte anglaise de 1794). Toutes les batailles que livre Suffren en 1782 et 1783 se déroulent sur ces côtes. On peut aussi trouver la totalité des localités et ports concernés sur cette carte plus lisible publiée par histoire-genealogie.com
Le sud de l'Inde et l'île de Ceylan (carte anglaise de 1794). Toutes les batailles que livre Suffren en 1782 et 1783 se déroulent sur ces côtes. On peut aussi trouver la totalité des localités et ports concernés sur cette carte plus lisible publiée par histoire-genealogie.com
Le lendemain du combat, ont tient conseil à bord du Héros. Avec 5 vaisseaux qui n’ont pas suivi leur chef, l’explication promet d’être orageuse, surtout pour Tromelin, vu les ordres reçus quelques jours plus tôt et dont voici l’essentiel :
« Si nous sommes assez heureux pour être au vent, comme ils ne sont que 8 ou 9 au plus, mon dessein est de les doubler par la queue, supposé que votre division soit de l’arrière, vous verrez par votre position quel nombre de vaisseaux débordera la ligne ennemie, et vous leur ferez signal de doubler. Si nous sommes sous le vent et que vos vaisseaux puissent en forçant de voiles doubler les ennemis, soit qu’ils ne soient pas attaqués du tout ou qu’ils le fussent que de loin ou faiblement, vous pourriez les faire revirer pour doubler au vent ; enfin dans tous les cas je vous prie de commander à votre division les manœuvres pour assurer le succès de l’action. »[318]
Des ordres très clairs, qui envisagent plusieurs cas de figure tout en laissant à l’officier une grande liberté d’action pour atteindre l’objectif (comme Suffen aime en avoir pour lui-même). Des ordres ouverts qui peuvent permettre à un officier talentueux de se faire remarquer, mais qui de toute façon, comme le précise la dernière phrase sont une quasi obligation d’engager le combat. Tromelin n’a absolument pas profité de la liberté de manœuvre que lui avait implicitement laissé Suffren et en fin de compte lui a totalement désobéi. Un tel comportement dans la Royal Navy vaudrait à l’officier mis en cause le conseil de guerre. Or Suffren ne prend aucune sanction et passe même l’éponge, ce qui laisse encore aujourd’hui pantois nombre d’observateurs.
Tromelin se défend en faisant valoir que comme le temps étant brumeux et Suffren très éloigné, il n’a pas vu les signaux de son chef. Rémi Monaque fait remarquer que Suffren a sans doute commis une erreur en prenant la tête de la ligne. Avec 12 vaisseaux à commander, le bailli aurait dû rester au centre de la position française pour piloter au plus près la délicate manœuvre de doublement par l’arrière[319]. Suffren a peut-être commis une deuxième erreur en ordonnant de « se former sur une ligne quelconque », c'est-à-dire une ligne dans laquelle les vaisseaux se rangent par ordre de vitesse derrière lui. Ordre qui a entrainé une confusion peu compatible avec la précision nécessaire à la manœuvre projetée et a laissé en arrière les vaisseaux les plus lents autour de Tromelin, qui par ailleurs n’avait pas reçu la liste nominative des navires à commander. Explications qui semblent toutes bien minces compte-tenu des ordres précédemment cités.
Suffren, en contradiction avec son tempérament, adopte curieusement une attitude bonasse avec ses capitaines qui l’ont abandonné. Il rassure en public le commandant de l’Ajax qui avait commencé la manœuvre de doublement par l’arrière avant de rentrer dans le rang sous l’injonction de Tromelin, et qui de honte n’ose plus l’approcher. Ce comportement garde une part de mystère. On a même l’impression que Tromelin a barre sur Suffren. Tromelin détient-il des informations sur son chef et qui ne nous sont pas parvenues ? Rémi Monaque estime que c’est possible[320]. Suffren craint-il cet officier de haute noblesse, intrigant redoutable qui construit peu à peu un véritable dossier d’accusation contre son chef ? C’est possible aussi. Roger Glanchant note que « d’une certaine façon, et c’est presque comique, Suffren avait peur de Tromelin et de ses amis »[321].
Dans son compte-rendu au ministre, Suffen fait le constat que depuis l’île-de-France il n’a pas obtenu l’adhésion de ses capitaines à son commandement. Il s’accorde encore un peu de temps pour réussir et fait quasiment porter le chapeau à d’Orves, décédé depuis quelques jours ! « J’ai pris le parti de ne me plaindre de personne. Comme nous nous reverrons avec l’escadre anglaise, il serait peut-être dangereux de dégoûter ces messieurs qui, accoutumés à l’excessive bonté de M. d’Orves, ne s’accoutument point à être commandés. Encore faut-il se servir d’eux car dans les subalternes on ne trouverait pas à les remplacer »[322].
Un ultime incident nous montre cependant que si les tensions à l’intérieur de l’escadre proviennent bien de l’indiscipline d’un groupe d’officiers, le caractère difficile de Suffren est aussi en cause. C’est ainsi que l’on a raté l’occasion de récupérer le transport le Lauriston, que la frégate la Pourvoyeuse (38) était en position de reprendre au début de la bataille. Son capitaine ne l’a pas fait car il avait reçu l’ordre de se préparer à doubler la ligne anglaise et a eu peur de déplaire à Suffren. C’est bien sûr ce qui se produit, mais pour la raison inverse, Suffren lui reprochant vivement son inaction. Incident caractéristique de la mauvaise communication entre Suffren et ses officiers. Pour Suffren, un officier brillant au caractère trempé (comme lui-même) peut considérer qu’un ordre est caduc si l’occasion de porter un coup à l’adversaire se présente. Mais la crainte d’encourir les reproches de l’irascible bailli paralyse les subordonnés, sans les garantir de nouvelles algarades ressenties comme profondément injustes. Le capitaine de la Pourvoyeuse, bon marin qui a jusque-là fidèlement servi Suffren offre sa démission pour raison de santé. Démission acceptée pour l’officier qui regagne l’île-de-France[323]. C’est la première d’une série dans ce qui apparait comme le début d'une véritable crise interne du commandement et qui se manifestera désormais à chaque bataille.
Le débarquement à Porto-Novo et le court repos de l'escadre (23 février-24 mars 1782)
 Les ruines de Pondichéry. La ville, totalement dévastée par les Anglais, n'est plus en 1782 que l'ombre de de sa gloire passée. Suffren choisit plutôt de débarquer à Porto-Novo.
Les ruines de Pondichéry. La ville, totalement dévastée par les Anglais, n'est plus en 1782 que l'ombre de de sa gloire passée. Suffren choisit plutôt de débarquer à Porto-Novo.
Au lendemain de Sadras, l’escadre anglaise a disparu. Hughes s’est échappé pour gagner Trinquemalay sur l’île de Ceylan afin d'y panser ses plaies. Suffren reste donc maître des eaux sur la côte de Coromandel. Il est temps de songer à ravitailler l’escadre, débarquer les troupes, les blessés et les malades. Le 19 février, l’escadre mouille devant Pondichéry. Mais l'ancien comptoir de la Compagnie des Indes n’est plus à même de recevoir une grande escadre. Totalement dévastée par les Anglais lors du siège de 1761, puis de nouveau prise et pillée en 1778, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. Les Anglais ont même fini par l’évacuer en février 1781, laissant Haidar Alî occuper la place[324].
On fait donc route au sud vers Porto-Novo, un port lui aussi dévasté par la guerre mais où il est plus facile de faire de l’eau (voir cartes plus haut). Le 23 février, on débarque les blessés et les scorbutiques et ont met en place un hôpital improvisé. Des représentants d’Haidar Alî sont sur place et ont reçu l’ordre d’apporter aux Français toute l’aide nécessaire. Suffren envoie deux de ses officiers rencontrer le Nabab qui leur fait un excellent accueil. Haidar Alî insiste sur le débarquement rapide des troupes françaises et confie aux deux hommes 100 000 roupies et de l’approvisionnement[325]. Le 9 mars, les troupes et tous les effets appartenant à l’armée sont mis à terre, mais il faut attendre encore plusieurs jours pour que l’on puisse récupérer les navires du convoi, dispersés la veille de Sadras. Cinq navires rallient Porto-Novo seuls, alors que d’autres se sont réfugiés à Galle (Sri Lanka) sur la côte sud de l’île de Ceylan. Ces bâtiments vont y rester encore plusieurs semaines et ne seront rejoint que plus tard par l'escadre. C’est donc une toute petite troupe de sans doute moins de 2 000 hommes qui a débarqué à Porto-Novo sous les ordres du général Duchemin[326] .
On apprend aussi que le Toscan, navire hôpital du convoi, s’est fait prendre (c’est le deuxième après la prise du Lauriston). Ces pertes sont en partie compensées par la capture (ou la destruction) d’une quinzaine de navires marchands anglais et d’une corvette de 18 canons, le Chasseur, par les frégates parties à la recherche du convoi. L’escadre inaugure, avec ces prises qui permettent de vivre sur le dos de l’adversaire, une pratique que l’on va retrouver pendant toute la campagne. Pendant que les navires réparent leurs avaries et que les équipages se « rafraîchissent », on apprend que Hughes a reçu du renfort : deux vaisseaux, les HMS Sultan et Magnanime, de respectivement 74 et 64 canons. L’avantage numérique de Suffren commence donc à se réduire. Néanmoins, cela n’entame en rien sa détermination pour se maintenir sur le théâtre d’opération et engager un nouveau combat, car « n’ayant ni port ni arsenaux, ni magasins, ni argent, je ne puis me soutenir à la côte que par une grande supériorité et je n’ai qu’un moyen de l’acquérir [détruire la flotte britannique] »[327]. Tout est dit. Le 24 mars, l'escadre lève l'ancre et part à la recherche des vaisseaux de Hughes.
La « pagaille de Provédien » (12-13 avril 1782)
 La bataille de Provédien se déroule sur la côte est de l'île de Ceylan, entre la baie de Trinquemalay et le port de Batticaloa. (L’îlot de Provédien n'est souvent signalé que sur les cartes anciennes.)
La bataille de Provédien se déroule sur la côte est de l'île de Ceylan, entre la baie de Trinquemalay et le port de Batticaloa. (L’îlot de Provédien n'est souvent signalé que sur les cartes anciennes.)
En quittant Porto-Novo, Suffren se dirige vers la grande île de Ceylan. Le bailli, qui a retrouvé bon moral, s'est donné semble-t-il deux objectifs : reconquérir la grande base de Trinquemalay (sachant que l’essentiel de l’île reste encore aux mains des Néerlandais) et détruire l’escadre anglaise, qui ne manquera pas de venir se battre pour défendre cette position clé[328].
De son côté, Hughes après avoir réparé ses avaries à Trinquemalay, est retourné à Madras. Apprenant que les Français ont quitté Porto-Novo, il comprend que Suffren veut s’en prendre à la précieuse base de Ceylan. Il appareille aussitôt, et le 9 avril les deux adversaires sont en vue l’un de l’autre, mais des deux côtés on se montre extrêmement prudent. Suffren met ses 12 vaisseaux en ligne et Hughes fait de même avec ses 11 unités. A l’issue de trois jours de manœuvres et de contre-manœuvre, Suffren réussit à se placer au matin du 12 au vent de son adversaire, et donc en mesure de lui imposer le combat. La rencontre a lieu sur la côte orientale de Ceylan, au large de l’îlot de Provédien (au sud de la baie de Trinquemalay). Le lieu est dangereux car il y a de nombreux haut-fonds et récifs, même si Hughes est sans doute un peu avantagé car il connait la côte mieux que les Français[329].
Vers 14 heures, les deux escadres se retrouvent alignées dans un axe sud-nord, le long de la côte sur vent de tribord. La manœuvre est extrêmement classique. Suffren semble s’être rallié à l’habituel engagement en ligne de file, peut-être pour être mieux compris de ses capitaines et aussi être mieux vu puisqu’il s’est positionné au centre de l’escadre (toujours sur le Héros). Le bailli cherche malgré tout à profiter du navire en surnombre qui lui reste pour tenter de doubler sur l’arrière le dernier vaisseau de la ligne anglaise (comme à Sadras) et le prendre entre deux feux.
Suffren donne l’ordre d’attaquer en se rapprochant « à portée de fusil », c'est-à-dire au plus près, mais la manœuvre ne se déroule pas comme prévu. Les deux vaisseaux de tête, le Vengeur (64 canons) et l’Artésien (64), bon voiliers, prennent de l’avance et ont tendance à s’éloigner vers la droite. Seuls les 5 vaisseaux suivants, le Petit Annibal (50), le Sphinx (64), le Héros (74), l’Orient (74) et le Brillant (64) entament la canonnade de près. L’arrière garde, avec le Sévère (64), l’Ajax (64), l’Annibal (74) et le Flamand (50) prend du retard et reste sur la droite (comme l’avant-garde) en canonnant de loin les vaisseaux anglais. Quand au Bizarre (64), chargé de la manœuvre de doublement de la ligne anglaise sur l’arrière, il se montre totalement incapable de l’exécuter, malgré les ordres répétés du navire amiral. Ce vaisseau est cependant connu comme le plus lent de l’escadre et c’est sans aucun doute une faute de Suffren de l’avoir choisi pour mener une telle attaque[330].
En fin de compte, on se retrouve avec un schéma de bataille voisin de celui de Sadras, soit 5 vaisseaux fortement engagés et 7 autres (les 2 de l’avant-garde et les 5 derniers) qui ne participent pas, ou mollement, de loin. Au centre, le combat est particulièrement violent. Le Héros et le HMS Superb se canonnent furieusement, ce qui donne à l’affrontement des airs de « bataille d’amiraux »[331]. Un incendie se déclare sur le Suberb. Suffren ordonne à l’Orient de poursuivre l’attaque sur le navire de Hughes alors qu’il concentre ses efforts sur le HMS Montmouth qui précède. Le navire anglais démâte sous les coups et quitte la ligne en tournant sur lui-même. Suffren, qui constate par ailleurs que le fond se réduit, ordonne à l’escadre de virer « lof pour lof » sur le vaisseau anglais désemparé[332]. Le bailli, retrouvant sa fougue, veut profiter de l’occasion pour rompre la ligne ennemie. Mais le Héros, sévèrement touché sur son gréement, perd à son tour une partie de sa mature alors que le Suberb, qui a réussi à éteindre ses incendies, s’interpose entre lui et le Montmouth. Les deux lignes se disloquent. Le combat tourne à la mêlée générale. L’Orient attaque l’Exeter pour aider le Héros, mais un incendie se déclare sur sa grande voile et le Brillant, qui suit, doit intervenir pour le dégager. Vers 15h45, les 5 vaisseaux français de l’arrière-garde restés jusque-là en retrait commencent enfin par se rapprocher.
Suffren, dont le navire n’est plus manœuvrable, passe vers 17h00 sur l’Ajax. Son capitaine, totalement dépassé par les évènements, a laissé son vaisseau se faire masquer par l’Annibal devant les Anglais sans pouvoir tirer un coup de canon. Suffren en prend le commandement pour constater que l’Ajax, qui est un navire peu manœuvrant, n’est guère en mesure de poursuivre Hughes qui vient d'ordonner la retraite. Les eaux sont dangereuses. Plusieurs vaisseaux, dont l’Ajax, touchent l’un des nombreux et dangereux bancs de sable[333]. Suffren fait cesser la poursuite. La bataille a duré plus de cinq heures. Hughes, qui connait mieux le secteur, réussit à mettre son escadre à l'abri entre le banc de sable, l’îlot de Provédien, et la côte de Ceylan. Les Français sont à une portée et demie de canon dans une confusion qui reste extrême. Un officier, que Suffren envoie à la nuit tombante porter un ordre, se trompe à son retour à cause de l'obscurité et vient s'arrimer au vaisseau de Hughes qu’il a confondu avec celui de son chef. Le frégate la Fine aborde un bâtiment anglais de 50 canons, mais les deux unités n’engagent pas le combat. « Il y a peu d’exemple d’une pareille mêlée » note Suffren dans son rapport[334]. Un orage tropical éclate. Les deux escadres, les voiles en lambeaux, passent une nuit sinistre, ballotées sur leurs ancres au milieu des récifs.
Les deux chefs restent face à face pendant une semaine. Les charpentiers de marine s’activent pour réparer les matures. Suffren est rapidement prêt à reprendre le combat et canonne plusieurs fois Hughes pour le faire sortir de son abri. Peine perdue. L’Anglais préfère se tenir à l’abri, même si c’est pour se sentir humilié par les bordées de son adversaire, alors que le moral de ses équipages est au plus bas[335]. Le 19 avril, l’escadre française appareille, se forme en ligne de bataille et défile -ultime provocation- devant l’escadre britannique embossée. Suffren renonce à l’attaquer et s’éloigne vers le sud pour gagner Batticaloa, petit port hollandais tout proche[336]. C’est donc malgré tout une victoire française puisque le bailli reste encore une fois maître des eaux sur la côte de Ceylan et de Coromandel. Les pertes sont loin d’être négligeables : 139 morts et 364 blessés, et autant côté anglais (137 morts et 437 blessés), ce qui montre que le combat a été aussi acharné que confus. Cette bataille marque les esprits au point que la « pagaille de Provédien » va demeurer pendant longtemps une expression célèbre dans la marine française pour caractériser ce genre de mêlée[337].
Article détaillé : Bataille de Provédien.L'après Provédien : la mêche lente de la crise de commandement
 Suffren se retrouve très isolé après Provédien. Il est très mécontent de la tenue au combat de ses capitaines alors que ceux-ci demandent à rentrer sur l'île-de-France (Sculpture du XIXe).
Suffren se retrouve très isolé après Provédien. Il est très mécontent de la tenue au combat de ses capitaines alors que ceux-ci demandent à rentrer sur l'île-de-France (Sculpture du XIXe).
 Armand de Saint-Félix se fait le porte-parole des officiers qui veulent arrêter la campagne, mais Suffren refuse de l'écouter.
Armand de Saint-Félix se fait le porte-parole des officiers qui veulent arrêter la campagne, mais Suffren refuse de l'écouter.
Cette bataille laisse Suffren profondément déçu et amer. Comme à Sadras, le bailli est persuadé d’avoir raté l’occasion d’anéantir l’escadre anglaise à causes des fautes de ses commandants. « Si tous les vaisseaux eussent approché comme le Héros, le Sphinx, l’Orient et le Brillant, je crois que nous aurions eu une victoire complète. Si mon vaisseau n’eut pas été désemparé au point qu’il l’a été, qu’il eut pu se mouvoir, je suis assuré qu’en coupant la ligne anglaise, elle aurait été anéantie. Après le démâtage du Monmouth, il y avait un quart de lieue entre l’amiral et le vaisseau qui était de l’avant à lui. Je les ai laissés (les Anglais) embossés à terre, et outre bien des raisons de ne pas les attaquer, il y en a une que vous devinerez et que je ne puis dire »[338]. Les derniers mots du bailli font penser, comme au lendemain de Sadras, à la mise en cause de plusieurs subordonnés. On est dans le non dit, mais Suffren est plus précis avec le ministre dans son compte-rendu rédigé quatre jours après le combat : « je ne puis entrer dans aucun détail mais, si dans cette escadre on ne change point cinq à six capitaines, on ne fera jamais rien et peut-être perdra-t-on toutes les occasions »[332].
Ces « cinq ou six capitaines » contre lesquels rumine le commandeur sont ceux du Vengeur et de l’Artésien, M.M. Forbin et Maurville, qui sont restés loin devant l’escadre, de l’Ajax, avec M. Bouvet « qui radote et n’est plus bon à rien », du Bizarre de M. La Landelle qui n’a pas réussi sa manœuvre de dépassement de l’arrière anglaise, et du Sévère de M. Cillard. Même le capitaine de l’Orient, La Pallière qui a combattu au centre et a secouru le Héros se retrouve étrillé : « [il] va encore bien au feu, mais il est fort tombé » alors que curieusement Tromelin sur l’Annibal reçoit un demi satisfecit « [il a] fait bien mieux que le 17 février [à Sadras] mais je doute qu’il se soit approché aussi près qu’il était possible »[339]. Faut-il prendre toutes ces accusations pour argent comptant ? L’examen des pertes par navire montre que l’on peut donner raison à Suffren pour le Vengeur, resté loin à l’avant-garde et qui sort quasi intact avec seulement 2 blessés, ainsi que pour l’Ajax (4 morts, 11 blessés), resté hors du combat jusqu’à ce que Suffren en prenne le commandement. Mais pour les autres, on constate des niveaux de perte non négligeables comme sur l’Artésien (12 morts, 20 blessés) le Sévère (12 morts, 20 blessés aussi) et le Bizarre (12 morts et 28 blessés) ce qui montre que ces navires ont fini par rejoindre eux aussi la mêlée. Les accusations contre le capitaine de l’Orient semblent bien injustes aussi car c’est lui qui enregistre les plus lourdes pertes (25 morts, 73 blessés), loin devant l’Annibal de Tromelin (16 morts, 29 blessés) qui lui-même coiffe légèrement le navire du commandeur (12 morts, 38 blessés)[340]. Donc, hormis 2 vaisseaux, on peut considérer que tous les navires ont été engagés, il n’y a eu aucun acte de désobéissance caractérisée autour de Tromelin comme à Sadras.
Ce qui exaspère Suffren, c’est la lenteur à exécuter ses ordres sur l’arrière-garde au début de la bataille, et l’impression, -comme il le dit à la fin de son appréciation sur Tromelin- que même lorsqu’ils ont rejoint la mêlée, tous ne l’ont pas fait à fond, tous n’ont pas pris tous les risques, comme lui. Mais tous les capitaines ne sont pas Suffren... Au final, seul les commandants du Vengeur et de l’Ajax sont sanctionnables, mais là encore le bailli n’en fait rien alors que la crise gagne en gravité comme le montre l’incident qui se produit quelques jours plus tard lorsque pendant le mouillage à Batticaloa.
Le capitaine du Brillant, M. de Saint-Félix, vient trouver Suffren en tant que porte-parole des autres officiers. « M. de Saint-Félix, qui avait fait plusieurs campagnes dans l’Inde (...), m’écrivit une lettre plus longue que celle-ci, pour me prouver que je ne regagnerais point la côte de Ceylan, et que (...) le seul parti à prendre était d’aller à l’île-de-France. Quand je fus mouillé, il vint me haranguer, m’assura que tous les capitaines pensaient comme lui, et me proposa de les assembler. Je lui fis bien assurer qu’ils étaient tous de son avis, pour lors je dis qu’on n’assemblait des conseils que pour savoir l’avis des gens ; que le sachant je n’en avais que faire »[341]. Saint-Félix est un bon capitaine qui s’est comporté avec beaucoup de courage et de talent lors des deux batailles, conduite qui lui a valu les éloges de Suffren. C’est sans doute pour cela que les autres capitaines l’on choisi pour cette mission délicate qui sonne comme un vote de défiance. Cette démarche illustre l’isolement de Suffren qui fait face à sa manière, en envoyant tout le monde promener. Est-ce une erreur du bailli ? Peut-être, car ainsi il perd l’occasion d’expliquer ses choix militaires et politiques et s’aliène l’un des rares commandants qu’il tenait en haute estime. Mais inversement on peut aussi s’interroger sur cet étrange -et inouï- syndicat des officiers qui estiment que la guerre n’est pas gagnable et qu’il est temps de rentrer, ce qui fournit au passage la clé de leur comportement au combat[342]...
La crise de commandement, amorcée lors des tortueuses tractations de l’île-de-France sur le remplacement des officiers tués à La Praya, puis amplifiée par les batailles de Sadras et de Provédien, se poursuit donc en sourdine, comme une mèche lente, derrière les regards gênés -ou inquisiteurs- et les sourires de façade. Le plus extraordinaire étant que Suffren faisant l’inventaire de ses forces après Provédien dispose de tous les arguments pour donner raison à ses officiers. Car l’escadre est exsangue, comme l’avoue lui-même le bailli dans ses rapports et ses lettres. Voilà cinq mois que l’on a quitté l’île-de-France, donc quatre complets passés en mer (si on soustrait les 29 jours d’escale à Porto-Novo), et que l’on a livré deux batailles en moins de deux mois. La poudre et les boulets s’épuisent, la flotte manque de cordage pour les gréements, de bois de mâture, et les équipages fondent tout doucement, au fil des affrontements des maladies et des désertions[343]. S’obstiner c’est courir le risque du désastre. Et pourtant Suffren s’obstine. Il regarde au-delà des questions militaires et considère que l’enjeu dépasse de loin les problèmes matériels immédiats de l’escadre, comme il l’exprime au ministre des affaires étrangères : « Je vois bien des difficultés à tenir la côte et je crois que si je la quitte, Ceylan sera prise et que le nabab [Haidar Alî] fera la paix [avec l’Angleterre]. Plaignez-moi Monsieur le comte, d’être dans une pareille position, mais soyez bien sûr que je ferai tout ce qui sera possible. Un effort pour l’Inde peut tout décider »[344]. En clair, si on rentre on perd tout de toute façon alors que si on s’obstine, un ultime « effort » c'est-à-dire une troisième bataille peut encore tout faire basculer en faveur des intérêts de la France.
Un beau succès diplomatique et logistique : la coopération franco-hollandaise
 Les possessions et les échanges commerciaux de la Compagnie des Indes néerlandaises. Grâce à la collaboration établie entre le gouverneur de Ceylan et Suffren, l'escadre française bénéficie d'un important soutien logistique tout en défendant les possessions hollandaises.
Les possessions et les échanges commerciaux de la Compagnie des Indes néerlandaises. Grâce à la collaboration établie entre le gouverneur de Ceylan et Suffren, l'escadre française bénéficie d'un important soutien logistique tout en défendant les possessions hollandaises.
Traditionnellement, les vaisseaux de l’océan Indien ont pour base de repli et d’hivernage Port-Louis, sur l’île-de-France[345], ce qui explique aussi la demande des commandants de renter, tout comme celle du gouverneur de l’île, François de Souillac qui invite Suffren à en faire de même. Avec le choix de rester sur le théâtre d’opération alors qu’on ne peut attendre qu’un soutien très aléatoire voire inexistant de Port-Louis, on entre donc dans le hors norme logistique. Il va falloir trouver sur place tout ce qui manque à l’escadre. Haidar Alî, on l’a vu à Porto-Novo, a fourni aux Français de l’argent et de la nourriture. Les Anglais avec les nombreux navires que saisissent les Français font involontairement de même. C’est un bon début, mais sans doute insuffisant tant que l’on ne dispose pas d’un grand port et de l’aide des Néerlandais qui tiennent encore l’essentiel de Ceylan. Ce grand port ne peut être que celui de Trinquemalay, dont les Anglais se sont emparés en 1781. En attendant de le leur reprendre, Suffren fait relâche le 30 avril dans le petit port de Batticaloa, au sud-est de l’île. Les ressources locales sont faibles, mais on peut s’y ravitailler en eau et en bois. Les équipages se « rafraichissent » à terre et profitent des eaux très poissonneuses pour améliorer l’ordinaire. On complète les réparations faites après la bataille et on en profite pour faire rallier les bâtiments de transport qui s’étaient réfugiés à Galle lorsque le convoi avait été dispersé avant Sadras. On puise dans leurs cargaisons et dans leur personnel au bénéfice de l’escadre[346].
Suffren, qui semble veiller à tout avec un coup d’avance a commencé à solliciter le gouverneur hollandais de Ceylan dès le lendemain de Sadras, dans un premier courrier envoyé le 12 mars 1782 depuis Porto-Novo. La collaboration franco-hollandaise avait commencé avec le sauvetage du Cap après la bataille de Porto Praya. Elle avait été très délicate, les Néerlandais ne se sentant aucune affinité avec les Français, lesquels avaient presque sauvé le comptoir du Cap à son corps défendant (voir plus haut). Suffren va-t-il être mieux accueilli à Ceylan ? Le gouverneur de l’île, Iman Willem Falk[347] est heureusement un homme d’envergure qui comprend immédiatement tout l’intérêt qu’il peut retirer d’une bonne collaboration avec l’escadre française. L’empire colonial hollandais est considérable dans l’océan Indien. Outre Ceylan, il remonte jusqu’à la côte occidentale de l’Inde avec Cochin puis s’étend à l’actuelle Indonésie avec Batavia pour capitale et file jusqu’au sud de la Chine et du Japon. Il est très riche, mais on est plus au XVIIe siècle où les navires armés de la « VOC » (Compagnie des Indes néerlandaises) pourchassaient les Portugais et les Anglais pour établir ses comptoirs et garantir le monopole de son commerce. La puissance militaire navale des Néerlandais s’est progressivement effacée au XVIIIe siècle, et l’empire est maintenant une proie facile pour les Anglais, comme nous l’avons déjà vu pour l’île de Saint-Eustache et le Cap. C’est donc un partenariat « gagnant-gagnant » pour reprendre un terme actuel qui s’engage entre Suffren et Falk : le bailli en menant la guerre navale contre la Royal Navy défend les intérêts de Louis XVI et des Provinces-Unies, qui en échange met les ressources de son empire à la disposition de l’escadre française.
Depuis Colombo où il réside, Falk va échanger une correspondance régulière avec Suffren qui va durer jusqu’en septembre 1783, avec d’autant plus de facilité qu’il est parfaitement francophone[348]. Il ne semble pas que les deux hommes se soient rencontrés mais tous les sujets sont traités avec franchise, signe de la confiance mutuelle qu’ils ont su développer. Les effets sont immédiats des deux côtés. Grâce aux renseignements fournis par les Néerlandais, on apprend que l’escadre anglaise s’est réfugiée à Trinquemalay où elle répare ses avaries et perd beaucoup de monde par maladie et des suites des blessures au combat. Les premiers navires hollandais arrivent, porteur de blé et de boulets. Le ravitaillement en nourriture pose une foule de problème car les Français sont des gros consommateurs de pain et de biscuit, donc de blé, céréale difficile à trouver dans cette région alors que les Néerlandais se sont mis depuis longtemps au riz. Les Français achètent des moulins à main pour fabriquer de la farine à terre. Le gouverneur fait aussi convoyer des troupeaux de bœufs et de chèvres pour fournir l'escadre en viande fraiche, ce qui ne va pas sans mal non plus sur une île où le régime est végétarien. Pour ce qui est de trouver du vin, c’est mission impossible, mais Falk peut fournir de l’arak, alcool de riz local auquel s’adaptent rapidement les Français...
Suffren a capturé, peu avant Provédien, un navire anglais embarquant un diplomate chargé de négocier avec un roi indigène de l’intérieur de l’île une alliance contre les Hollandais. Il fait passer immédiatement l’information et les papiers saisis à Falk. De manière générale, Suffren transmettra à ce dernier tous les renseignements dont il dispose sur les mouvements de la Navy et sur ceux qu'il envisage pour son escadre. Falk, qui dispose d’agents dans tous les ports, fera de même en matière de renseignement, ce qui aidera grandement Suffren pour attaquer Trinquemalay. Le financement de l’escadre française pose aussi de redoutables problèmes. Falk va y déployer tous ses talents, au prix de toute sortes d’acrobaties financières, sachant qu’il ne s’agit pas de payer les soldes des matelots -qui sont toujours les derniers sur les feuilles d’émargement[349]- mais les vivres et fournitures que consomme l’escadre. Suffren ose aussi demander à Falk s’il n’a pas « du monde à lui prêter » pour compléter ses équipages[350]. Refus poli de Falk qui n’a déjà pas assez de matelots pour ses propres navires. On ne peut pas tout avoir, mais on trouvera plus tard des troupes d’origine asiatique soldées par les Néerlandais et mises à la disposition du bailli.
Après l’escale à Batticaloa, on peut considérer que Suffren marche sur trois pattes pour poursuivre sa campagne. La première est l’aide du nabab Haidar Alî, mais elle est surtout concentrée sur le contingent à terre. La seconde est celle des prises anglaises qui sont nombreuses et régulières. La troisième est l'aide issue de la collaboration franco-hollandaise. Allant bien au-delà des vivres, des munitions et de l'argent, c'est peut-être la plus importante. La complexité du bricolage diplomatique et logistique avec lequel Suffren jongle en permanence -et avec maestria- rend presque impossible les tentatives pour savoir ce qu’a bien pu « coûter » cette campagne des Indes. Sachant que les liaisons avec la France sont presque rompues, on peut vraiment dire qu'on entre dans le hors-norme militaire.
Le premier succès français à terre et les projets de Suffren (3 juin-3 juillet 1782)
 Le port de Négapatam sur la côte de Coromandel. Suffren a pour projet de reprendre ce comptoir hollandais enlevé par les Anglais en 1781. Mais auparavant, il doit se débarrasser des nombreux prisonniers anglais qui encombrent l'escadre.
Le port de Négapatam sur la côte de Coromandel. Suffren a pour projet de reprendre ce comptoir hollandais enlevé par les Anglais en 1781. Mais auparavant, il doit se débarrasser des nombreux prisonniers anglais qui encombrent l'escadre.
L’escale à Batticaloa s’achève le 3 juin. Elle a duré 33 jours et a fait « grand bien à nos équipages » si l’on se fie au témoignage d’un officier de l’Artésien[351]. C’est donc une escadre requinquée qui quitte Ceylan pour gagner la côte indienne en vue des prochains combats. Le 5 juin, l’escadre mouille à Trinquebar (ou Tranquebar), petit port neutre danois où elle reçoit encore du ravitaillement avec trois navires hollandais et quatre danois chargés « d’effets nautiques, de vivres et d’argent »[352]. Suffren est reçu fort aimablement par le gouverneur danois, M. Abbastée. Les neutres pencheraient-ils pour la France ? On ne peut l’exclure. Recevoir et ravitailler les Français relève d’un vrai choix politique, compte tenu du comportement prédateur de la Royal Navy qui saisit les navires neutres suspects de trafiquer avec l'ennemi. On peut penser aussi que les prétentions anglaises au contrôle total des mers ont fini par inquiéter tout le monde jusque dans l’océan Indien.
On profite aussi de l’escale pour reprendre contact avec Haidar Alî. La coopération avec le nabab a porté ses premiers fruits puisque le 3 avril, peu de temps avant la bataille de Provédien, la petite troupe du général Duchemin débarquée lors de l’escale de Porto-Novo a pris le port de Gondelour (appelé aussi Cuddalore). La faible garnison anglaise s’est rendue sans combattre aux Français, il est vrai fortement renforcés par de nombreuses soldats de Haidar Alî. Le nabab, fait savoir à l’envoyé de Suffren qu’il laisse un corps de 3 000 hommes à sa disposition et qu’il désire fortement le rencontrer. Haidar Alî envoie en cadeau un grand nombre de bœufs pour ravitailler l’escadre, mais fait aussi savoir qu’il trouve le général Duchemin beaucoup trop passif depuis la prise de Gondelour[353]. Duchemin, cependant, est malade depuis peu et doit rester alité.
Le 20 juin, Suffren quitte Trinquebar pour Gondelour où il arrive le jour même. Suffren a pour intention d’attaquer Négapatam, le port hollandais occupé par les Anglais depuis 1781. Mais on apprend aussi que Hughes, qui se doute certainement des projets du bailli, a quitté Trinquemalay pour venir mouiller à Négapatam. Il en faut plus pour faire renoncer Suffren à son projet. Il décide d’attaquer Hughes tout en embarquant des troupes pour compléter ses équipages et attaquer la place, soit 700 hommes de Duchemin et 800 cipayes fournis par le nabab. Notons que le système de ravitaillement patiemment tricoté par Suffren tourne à plein, puisque outre le ravitaillement fourni par les Hollandais, les Danois et le nabab cité plus haut, les frégates qui balayent l’espace autour de l’escadre ont raflé 4 navires anglais porteurs de poudre, de boulets, d’artillerie de siège, de riz, de blé, de légumes[354].
Ces belles et nombreuses prises dans les eaux indiennes posent cependant un redoutable problème : que faire des prisonniers ? Il y en a sur tous les navires et on ne peut les laisser à terre faute de monde pour les garder, sachant que les malades qui ont été débarqués désertent des hôpitaux. Suffren fait des propositions d’échange aux Anglais qui refusent. Il semble que du côté de Hughes on fasse le calcul tortueux que ces prisonniers sont un poids mort qui consomment les ressources de l’escadre française, sans parler des risques qu’ils font courir à la sécurité des vaisseaux. Calcul étonnant alors que tous les renseignements indiquent que côté anglais on manque aussi d’hommes. Suffren décide donc de confier les prisonniers à la garde d’Haidar Alî, décision qui aujourd’hui encore fait hurler les historiens anglais, compte-tenu de la cruauté du prince indien. Mais Suffren assume, malgré les cris et les supplications des prisonniers[355]. La faute en revient aux Anglais eux-mêmes et c’est aussi une décision politique destinée à « gagner la confiance du nabab »[356] et qui peut par ailleurs fournir à ce dernier des moyens de pression pour négocier face au gouverneur de Madras.
Article détaillé : Bataille de Gondelour (1782).Négapatam, encore une sanglante et indécise bataille (6 juillet 1782)
 La bataille de Négapatam, le 6 juillet 1782. Engagée sur la tactique classique de la ligne de file, elle tourne à la confusion sur les avant-gardes et se révèle indécise.
La bataille de Négapatam, le 6 juillet 1782. Engagée sur la tactique classique de la ligne de file, elle tourne à la confusion sur les avant-gardes et se révèle indécise.
 Vue centrale de la bataille de Négapatam, peut-être une représentation du HMS Sultan pris en enfilade par le tir du Sévère. Sur cette bataille complexe on peut aussi consulter le plan détaillé proposé par le site net4war.com
Vue centrale de la bataille de Négapatam, peut-être une représentation du HMS Sultan pris en enfilade par le tir du Sévère. Sur cette bataille complexe on peut aussi consulter le plan détaillé proposé par le site net4war.com
Le 3 juillet, l’escadre quitte Gondelour pour se porter à la rencontre des forces de Hughes. On entame les manœuvres d’approche, mais le 5, vers 15h00, un mauvais coup de vent local démâte partiellement l’Ajax. Suffren détache la frégate la Bellone pour lui porter assistance et ordonne au navire de prendre place à l’arrière de la ligne. Le vent tourne au profit des Anglais, mais Hughes n’en profite pas et file vers le large. Suffren ordonne vers 17 h 45 de mettre en panne puis de mouiller pour attendre l’Ajax[355] alors que Hughes revient vers la côte à la tombée de la nuit.
Le 6 au matin, une nouvelle déconvenue attend Suffren : l’Ajax n’a pas achevé ses réparations, situation d’autant plus exaspérante que son capitaine, Bouvet a refusé l’aide des charpentiers du Héros. C’est donc à 11 vaisseaux qu’il va falloir combattre. Les deux escadres sont nominalement du même ordre mais Hughes dispose d’une puissance de feu supérieure avec 5 vaisseaux à 74 canons contre 3 seulement pour Suffren. Les deux chefs se mettent en formation selon la tactique habituelle de la ligne de file et commencent à se rapprocher. Hughes, qui a l’avantage du vent, se laisse porter pour engager le combat. Mais il n’est pas dans le tempérament de Suffren d’attendre passivement l’attaque de l’ennemi. A 7h35, il ordonne à l’escadre de virer de bord par vent devant avec l’espoir de passer à proximité de l’arrière-garde anglaise et d’y concentrer ses efforts. Mais le Brillant qui conduit la ligne rate sa manœuvre et dérive sous le vent. Cette erreur fait donc manquer le retournement offensif voulu par Suffren. Faute de mieux, le Brillant reçoit l’ordre de s’intercaler entre le Sévère et le Héros alors que les Anglais se rapprochent[357].
A 10h50, le combat s’engage entre les deux avant-gardes alors que les navires sur l’arrière restent encore loin. Puis, comme à Provédien, la bataille devient confuse. Une saute brutale de vent bouscule plusieurs vaisseaux des deux escadres qui virent de bord involontairement. Les deux avant-gardes se disloquent, les navires des deux partis courant un peu dans toutes les directions. Le Flamand (60), qui était en tête de la ligne, se retrouve aux prises avec les 2 vaisseaux anglais de l’avant. Il réussit à endommager gravement le HMS Exeter (64) qui quitte la bataille sans demander l’autorisation de Hughes. Il élonge tout le reste de la ligne française à contre-bord et reçoit sans riposter les bordées des vaisseaux français. Le Flamand réussit même à toucher au gouvernail le deuxième vaisseau, le HMS Hero (74). Le Brillant (64) et le Sévère (64) se retrouvent au plus près d’un groupe de navires anglais dans une furieuse canonnade. Le Brillant, qui perd son grand mât, ne doit son salut qu’à l’intervention de Suffren sur le Héros (74). Derrière le Héros, le Sphinx (64) affronte le navire amiral anglais, le HMS Superb (74)[358].
Le Sévère est entrainé au milieu de 3 vaisseaux anglais (deux « 74 » et un « 64 »). Son capitaine « craque » littéralement lorsque les deux officiers qui le secondent sur la dunette sont mis hors de combat. Perdant son sang-froid, il ordonne de baisser pavillon, puis se met à parcourir la galerie qui longe la poupe en faisant -déshonneur suprême- signe avec son chapeau au HMS Sultan (74) de ne plus tirer[359]. Les 3 bâtiments anglais cessent alors la canonnade et le Sultan met en panne pour envoyer un canot de prise. C’est alors qu’interviennent les deux officiers qui commandent les batteries du Sévère. Ils montent sur la dunette avec le soutien bruyant de l’équipage et obligent le commandant à reprendre le combat. Cette quasi mutinerie sauve le vaisseau : on hisse de nouveau les couleurs et le feu reprend. Le Sultan, qui a dérivé en présentant son arrière au Sévère, reçoit un terrible tir d’enfilade qui le dévaste sur toute sa longueur et qui l’écarte définitivement du combat[360].
Le Petit Annibal (50) lutte à armes presque égales avec le HMS Isis (56), mais l’Artésien (64) qui suit, se retrouve en difficulté à cause d’un violent incendie qui ravage sa poupe. Son capitaine, mal inspiré, commet en plus l’erreur de présenter son navire par vent arrière ce qui ne fait qu’attiser les flammes au risque d’embraser le vaisseau. L’incendie est finalement maîtrisé alors que le Héros tente de se rapprocher du Superb. Mais Hughes se dérobe. Suffren lâche une bordée d’insultes et de boulets sur l’arrière du vaisseau amiral anglais, ce qui déclenche une masse de hurlements et de "God Damned" sur le pont du navire anglais[361]. Les 3 derniers vaisseaux de la ligne française, le Vengeur (64), le Bizarre (64) et l’Orient (74) sont peu ou pas engagés.
Vers 14h50, comme par une sorte de consentement mutuel, le feu cesse de part et d’autre. Les combats ont duré à peu près quatre heures. Les Anglais se rassemblent, tiennent le vent et s’éloignent vers le large. Hughes reconnaîtra honnêtement que ses « vaisseaux étaient considérablement désemparés et en général ingouvernables. (...) Le 7 dans la matinée, les dommages qu’avaient essuyés les divers vaisseaux de l’escadre m'apparurent être si considérables, que j’abandonnai toute idée de poursuivre l’ennemi »[362]. Suffren rassemble aussi son escadre mais serre la côte, rejoint par l’Ajax qui a enfin réparé sa mâture. Vers 17h00 l’escadre mouille, puis lève l’encre le lendemain pour gagner Gondelour, où elle arrive le 8. La bataille a coûté 178 morts et 601 blessés côté français alors que Hughes ne déplore que 77 tués et 232 blessés. Négapatam est une sanglante journée qui laisse les Français très éprouvés. Une fois encore, l’escadre Anglaise n’a pu être détruite et il faut renoncer à assiéger le port du même nom, même si Suffren garde la maîtrise des eaux entre la côte de Coromandel et Ceylan.
Article détaillé : Bataille de Négapatam (1782).Les suites de la bataille : la première charrette des commandants renvoyés
 La poupe de l'Artésien subit un violent incendie pendant la bataille de Négapatam et son capitaine présente le navire par vent arrière au risque d'embraser le vaisseau. Cette bévue lui vaut d'être renvoyé par Suffren. (Maquette du musée de la Marine).
La poupe de l'Artésien subit un violent incendie pendant la bataille de Négapatam et son capitaine présente le navire par vent arrière au risque d'embraser le vaisseau. Cette bévue lui vaut d'être renvoyé par Suffren. (Maquette du musée de la Marine).
Cette troisième bataille dans les eaux indiennes va faire d’autres victimes : les officiers qui n’ont pas été à la hauteur ou que Suffren juge comme tel. Voilà des mois que dure cette crise de commandement qui empoisonne l’escadre à chaque bataille et dont on a pu suivre le développement depuis les premières intrigues à l’île-de-France. Au retour de l’escadre à Gondelour, Suffren décide de démonter de leur commandement quatre de ses officiers.
Le premier est le chevalier de Cillard, commandant du Sévère (64), qui a « craqué » pendant la bataille en amenant son pavillon alors que son vaisseau était en difficulté contre trois Anglais. Cillard tentera de se justifier après la guerre[363] en mettant en cause la qualité insuffisante de son vaisseau, mauvais marcheur, de son équipage insuffisant en nombre et en entrainement, et pour finir de Suffren lui-même qui a écouté les rapports de gens malintentionnés alors que son ordre de baisser pavillon n’était qu’une feinte pour se dégager... Pitoyable défense, au vu des nombreux témoignages sur sa conduite et sur l’état du navire, encore intact de mâture et en parfait état de combattre comme l’a montré la suite de la bataille. Notons que Suffren ne le démonte de son commandement que 12 jours après la bataille ce qui montre qu’il a pris le temps d’enquêter. Suffren rend au passage au ministre un rapport élogieux sur les deux officiers qui ont refusé de baisser pavillon[364].
Le deuxième est M. Bouvet, commandant de l’Ajax (64). Bouvet ne s’était déjà pas montré à la hauteur à Provédien en positionnant son navire hors de la ligne de feu. En se montrant incapable de réparer ses avaries dans un délai raisonnable tout en refusant l’aide des charpentiers du Héros et le remorquage par la frégate la Bellone, il a gravement compromis la situation de l’escadre peu avant le combat. Suffren avait déjà noté au lendemain de Provédien que Bouvet « radotait ». Il devient clair que cet officier autrefois vaillant n’est plus à même de remplir ses fonctions. À l'égard de son passé, Suffren organise sa démission pour raison de santé. Bouvet, parvenu au bout de ses forces physiques et morales meurt peu de temps après, le 6 octobre 1782 à Trinquemalay[365].
Le troisième est M. Bidé de Maurville, commandant de l’Artésien (64). C’est un jeune officier supérieur (moins de 40 ans) mais que Suffren a dans le collimateur depuis Sadras et Provédien car il estime qu’il a médiocrement conduit son vaisseau à chacun de ces engagements. Pendant l’escale à Tranquebar en juin, Maurville a aussi commis l’erreur de laisser s’échapper un gros navire de la Compagnie des Indes sous prétexte que les ordres étaient de rentrer à la nuit. Cette application étroite des ordres reçus qui prive l’escadre de précieuses ressources a provoqué la colère de Suffren. Pour finir, la grossière bévue de Maurville, positionnant l’Artésien par vent arrière avec un incendie sur sa poupe au risque d’un incendie général du vaisseau achève de convaincre Suffren qu’il doit se défaire de cet officier[366].
Le dernier est Forbin, commandant du Vengeur (64)[367]. Suffren sanctionne chez cet officier un manque d’initiative et de pugnacité relevé tout au long de la campagne. Forbin est passé à côté de la bataille à La Praya, avant de se battre honorablement à Sadras, puis de nouveau décevoir Suffren à Provédien où il est resté loin à l’avant-garde avant de rester plutôt loin derrière à Négapatam... Ses pertes lors de ces deux derniers combats sont d’ailleurs assez faibles (aucun mort, 2 blessés à Provédien, 8 morts, 44 blessés à Négapatam) même si on ne peut lui reprocher aucune faute de commandement avérée comme pour les autres officiers.
Cet épisode fournit aussi en creux un état moral des équipages. Le Sèvère a été sauvé de son commandant défaillant par deux officiers déterminés, soutenus par la bronca des canonniers et des matelots. Des hommes épuisés et démoralisés n’auraient sans doute guère bougé pour sauver leur vaisseau aux prises avec 3 anglais. Le comportement des hommes de l’Ajax montrent aussi qu’ils désapprouvent l’attitude du vieux commandant qui se montre incapable de faire réparer son vaisseau : « Les yeux se fixaient sur lui avec une indignation peu commune » note le chevalier de Froberville[368]. On peut donc en déduire que les efforts de Suffren qui surveille avec soin le ravitaillement et l’état sanitaire de l’escadre sont payés de retour par des équipages ayant un bon moral et qui sont plus combattifs que certains d’officiers supérieurs.
Tous les officiers démontés sont remplacés par des capitaines de frégate, ce qui rajeunit le commandement et provoque au passage un vigoureux « turn over » dans l’escadre, (pour reprendre une expression actuelle) puisqu’il faut aussi trouver des remplaçants à ceux qui montent en grade. Notons que Tromelin, le principal ennemi de Suffren n’est pas touché par ces changements. Il est vrai qu’il s’est bien comporté à Negapatam, avec des pertes supérieures à celle de son chef (28 tués et 80 blessés sur l’Annibal contre 25 tués et 72 blessés sur le Héros).
On peut aussi s’étonner que Suffren ait attendu son quatrième combat depuis son départ de France pour mener cette opération disciplinaire alors que sa correspondance déborde de critiques contre ses capitaines. Il est vrai que tous les officiers qui commandent les vaisseaux de guerre sont de grands nobles qui peuvent se prévaloir de multiples soutiens à la Cour. De quoi faire réfléchir même un homme comme Suffren, sachant qu’un tel acte d’autorité relève du « jamais vu » dans aucune escadre française. Si Suffren passe à l’acte, c’est certainement qu’il se sait maintenant appuyé à Versailles. Compte-tenu du temps de transit entre Brest et Ceylan (un peu moins de 6 mois) il a sans doute entre les mains le courrier de De Castrie du 24 novembre 1781 qui l’incite à la sévérité : « Je vous ordonne de la part du roi de me rendre compte de ce qui s’est passé lors de votre attaque à La Praya et de renvoyer en France les commandants de vos vaisseaux dont vous auriez à vous plaindre. Il ne peut y avoir d’égards ni de considérations qui puissent vous dispenser de vous faire obéir et je compte que vous me mettrez dans le cas de faire connaître au roi la vérité »[369]. Ce coup d’éclat sera-t-il suffisant pour rétablir son autorité auprès des autres officiers qui trainent des pieds à chaque bataille ? La suite va hélas prouver que non, alors que par ailleurs se manifestent les premiers signes d'admiration dans le camp adverse.
Les premiers signes d’admiration anglais et le succès diplomatique de l'alliance franco-indienne (juillet 1782)
Au lendemain de la bataille, alors que l’escadre vient de lever l’encre pour Gondelour, se présente un brick anglais portant pavillon parlementaire. On reçoit l’émissaire anglais qui porte une lettre de Hughes demandant poliment à ce qu’on lui remette le Sévère qui avait amené son pavillon la veille... La lettre est portée par le capitaine de vaisseau Watt du HMS Sultan, pris en enfilade par le même Sévère au moment de l’incident du pavillon. Suffren refuse la demande en arguant que le pavillon est tombé suite à une rupture accidentelle de drisse (cordage) sous l’effet du feu ennemi, et que de toute façon, il était lui-même très près du Sévère avec le Héros « pour le secourir et même pour le reprendre au cas qu’il se fût rendu »[370]. Ce gros mensonge, que Suffren argumente avec un incident qui se produit régulièrement lors des combats, lui permet d’évacuer prestement la demande et Hughes n’insiste pas. Suffren, par représailles au refus de Hughes de recevoir un de ses officiers après Provédien, refuse à son tour de recevoir Watt qui veut lui présenter ses hommages. Ce dernier engage donc la conversation avec le principal officier de Suffren, Moissac. Watt se montre alors fort admiratif pour l’escadre française et pour son chef. Watt demande comment font les Français « pour tenir aussi longtemps à la côte, étant depuis huit mois loin de l’île-de-France, n’ayant pu en emporter que pour six mois de vivres et n’en ayant reçu aucun secours ? ». Lorsque l’Anglais demande à Moissac quand l’escadre compte s’en aller, celui-ci lui répond avec le plus grand sang-froid : « Ma foi, monsieur, le général a dessein de rester ici tant que vous lui fournirez des vivres et des munitions pour faire la guerre. » Et Watt de s’exclamer :
« Ah ! Quel homme que ce M. de Suffren, plus je l’examine et plus je suis persuadé qu’il est peut-être le premier général de son siècle ; de quelque manière que tourne la fortune, cette campagne est la plus glorieuse que la France ait faite. Tous les Anglais, gens sensés et sans partialité, disent que si on donnait un tableau de la campagne que fait M. de Suffren à un de leurs meilleurs amiraux et qu’on lui proposât d’en faire autant avec les mêmes moyens, il n’y en a pas un qui voulût s’en charger et de plus ils doutent qu’il y eût un officier et un matelot qui voulût s’y embarquer[371] ».
Ce récit rédigé à l’île-de-France quelques semaines plus tard est sans doute un peu complaisant mais il sonne agréablement aux oreilles françaises. Il témoigne aussi, en creux derrière les louanges, du relatif désarroi dans lequel se trouve l’escadre de Hughes. Côté anglais, malgré les espions, on ne parvient pas à percer les secrets du bricolage logistique de Suffren alors que l’on s’était visiblement habitué à voir les officiers français peu combattifs rentrer rapidement se mettre à l’abri à l'île-de-France.
 La rencontre entre Suffren et Haidar Alî en juillet 1782 est un beau succès diplomatique qui débouche sur une alliance entre les deux chefs contre les Anglais. (Gravure de J.B. Morret, 1789)
La rencontre entre Suffren et Haidar Alî en juillet 1782 est un beau succès diplomatique qui débouche sur une alliance entre les deux chefs contre les Anglais. (Gravure de J.B. Morret, 1789)
Alors que les Britanniques semblent connaître un coup de « blues », Suffren réussit un à nouer un bel accord militaire et diplomatique qui ne peut que les inquiéter encore plus. Le 8 juillet, deux jours après la bataille, l’escadre arrive à Gondelour. On débarque les blessés, on entame les travaux de réparation avec le jeu habituel des mâtures échangées entre vaisseaux ou démontées sur des prises. Dès le 18 juillet, Suffren estime que son escadre est prête à reprendre la mer[372]. C’est alors qu’Haidar Alî décide de venir à sa rencontre. C’est l’occasion d’organiser un sommet diplomatique qui peut être déterminant pour la suite de la campagne. Le nabab parcourt 30 lieues en trois jours avec 100 000 hommes et son artillerie. Le 25 juillet, il se présente devant Gondelour et installe son campement devant la place. Il est salué par la terre de 21 coups de canon, accompagné d’un salut général de tous les vaisseaux. Suffren et Haidar Alî se rencontrent quatre fois, entre le 26 et le 29 juillet.
Ce « sommet » entre les deux chefs prend des allures de « fête extraordinaire et pittoresque »[337] avec des cohortes d’éléphants, de buffles, de chameaux chargés de riches bagages. Haider Alî parait escorté de ses lanciers, porté dans un superbe palanquin face à Suffren entouré de ses officiers. Le bailli, en sueur, s’est forcé à enfiler son plus beau costume... On fait échange d’amabilités, Haidar Alî se montrant particulièrement prévenant[373]. Conformément aux traditions, le nabab offre des bijoux et de l’argent : 10 000 roupies à Suffren, 1 000 à tous ses officiers, lequel offre en retour des beaux objets d’orfèvrerie trouvés sur les navires capturés, dont une superbe pendule en forme d’édifice chinois. Le nabab régale ses hôtes avec plusieurs déjeuners fastueux « au goût indien » tout au long des discussions sous les tentes.
À l’issue de ces entretiens, on convient d’améliorer la coordination entre les troupes indiennes et françaises, ces dernières étant inertes depuis que le général Duchemin, tombé malade, doit resté alité. Suffren reçoit pendant les négociations un courrier apporté par le cutter le Lézard arrivé de l’île-de-France et qui lui annonce que les renforts qu’il demande depuis des mois arrivent enfin. Il s’agit du corps expéditionnaire commandé par M. de Bussy, accompagnés de plusieurs vaisseaux de guerre. Deux d’entre-eux, le Saint-Michel et l’Illustre ayant à leur bord un bataillon, ont déjà appareillé depuis le 25 juin et ne devrait plus guère tarder à arriver. C’est une excellente nouvelle. Les promesses tant de fois faites au nabab d’une intervention plus vigoureuse de la France se concrétisent enfin. La nouvelle encourage Haidar Alî à maintenir sa présence sur les côtes de Coromandel alors qu’une forte armée anglaise menace ses provinces de l’ouest. Le nabab s’engage même à fournir vivre et argent à la troupe de Duchemin dont il critiquait jusque-là le faible engagement. Dans son compte-rendu au ministre, Suffren montre toute sa satisfaction et son optimisme sur les relations futures avec le nabab.
« Ce prince m’a donné publiquement 10 000 roupies pour tenir lieu, dit-il, de l’éléphant dont je ne puis faire usage et très secrètement m’a complété un lac (100 000 roupies)[374], disant qu’il me recommandait le secret pour ne pas exciter la jalousie. Cela s’est fait à la dernière audience. Je puis affirmer que si on avait su prendre ce prince, on en aurait fait ce qu’on en aurait voulu. Je n’ai d’autre art pour lui que de n’en point avoir et de lui dire toujours vrai »[375].
On ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire sur l’autosatisfaction du bailli, mais il n’en reste pas moins que c’est un beau succès diplomatique. Cette alliance ouvre aux Français de vastes possibilités de reconquête sur la côte de Coromandel alors même que celle-ci n’intéresse pas Haidar Alî[376]. Il ne reste plus qu’à concrétiser cet engagement avec l’arrivée des renforts promis, ce qui va s’avérer beaucoup plus complexe que prévu.
Une belle victoire Mer contre Terre : la prise de Trinquemalay (août 1782)
 L'île de Ceylan. La prise de Trinquemalay apparait comme un brillant succès de Suffren qui a su organiser le débarquement et le siège en quelques jours. L'immense baie est rendue aux Hollandais et offre un abri sûr à l'escadre.
L'île de Ceylan. La prise de Trinquemalay apparait comme un brillant succès de Suffren qui a su organiser le débarquement et le siège en quelques jours. L'immense baie est rendue aux Hollandais et offre un abri sûr à l'escadre.
 « Plan du fort de Trinquemalay (...) rendu le 30 août 1782 à M. le chevalier de Suffren ». On peut zoomer sur les détails du plan du siège levé en 1782 sur le site des archives nationales de l'outre-mer.
« Plan du fort de Trinquemalay (...) rendu le 30 août 1782 à M. le chevalier de Suffren ». On peut zoomer sur les détails du plan du siège levé en 1782 sur le site des archives nationales de l'outre-mer.
Le 1er août 1782, Suffren appareille pour Ceylan et vient mouiller le 8 août dans le petit port de Batticaloa. Le lieu est déjà connu des Français qui y avaient fait relâche au lendemain de Provédien (voir plus haut) et sert pour l’occasion de point de concentration des forces en vue de l’attaque que Suffren veut monter sur Trinquemalay. Le commandeur a embarqué assez de munitions pour mener un « petit siège » et a pris avec lui des hommes du génie et quelques artilleurs. En attendant l’arrivée des vaisseaux de l’île-de-France, on procède au classique (et permanent) entretien des vaisseaux, d’autant que deux d’entre eux, l’Orient et la Fine se sont abordés pendant la traversée. On travaille sur la carène du navire amiral, le Héros et on doit faire face aux aléas de la guerre en trouvant un nouveau commandant et un second à la frégate la Bellone, tués tous les deux lors d’un combat malheureux avec une frégate anglaise[377].
La collaboration avec les Néerlandais est maintenant bien rodée. Le gouverneur Falk fait parvenir des vivres et met à la disposition pour la première fois des troupes, en l’occurrence une compagnie de 120 soldats malais[378]. Tout aussi intéressants sont les renseignements que fournit Falk sur le port. Les Hollandais connaissent bien Trinquemalay qui était encore entre leurs mains quelques mois plus tôt et disposent des rapports des espions restés dans la place, complétés par les interrogatoires des déserteurs. Les Français peuvent donc préparer l’opération avec une parfaite connaissance de l’état des forces anglaises, de leur armement, et de leur dispositif de défense articulé sur les deux forts d’Ostemburg et Frederick[379].
Le 21 août, se présentent enfin à Batticaloa les deux vaisseaux de renforts attendus, le Saint-Michel (60 canons) et l’Illustre (74 canons), accompagnés de la corvette la Fortune (18 canons) et escortant un gros convoi de 17 navires marchands dont 2 hollandais chargés de munitions, de vivres et avec 600 hommes du régiment de l’île-de-France. On répartit rapidement les hommes et le ravitaillement sur les bâtiments, et le 23 août, on appareille pour Trinquemalay. L’objectif n’est qu’à une soixantaine de mille au nord de Batticaloa ce qui facilite grandement l’opération.
Le cutter le Lézard vient confirmer que l'immense baie de Trinquemalay est vide de navires anglais. Le 26 août au matin, après avoir brièvement supporté le tir d’une batterie côtière, on entreprend le débarquement sur une plage à moins d’une lieue du fort Frederick. 2 300 hommes sont mis à terre dont 600 cipayes et 500 hommes des troupes de marine. Le lieutenant colonel d’Algoud de la légion de Lauzun commande la petite armée. Le siège est rondement mené. On repousse une sortie anglaise (27 août) et les deux batteries mises en place commencent à pilonner le fort Frederick (29 août). Suffren reste à terre pour dynamiser la conduite du siège avec son énergie habituelle et souhaite en finir rapidement car il craint le retour de l’escadre anglaise. Le 30 août, Suffren juge le moment venu de sommer le gouverneur de capituler. Les pourparlers aboutissent presque immédiatement. La garnison anglaise sort donc avec les honneurs de la guerre, une partie de son artillerie, et doit être évacuée sur Madras par les vainqueurs, ce qui sera effectif le 29 septembre avec deux navires de transport. On s’engage aussi à n’exercer aucunes représailles vis-à-vis des Français capturés quelques mois plus tôt sur le transport le Lauriston (peu avant Sadras, voir plus haut) et dont certains se sont engagés depuis dans l’armée anglaise[380]...
Reste à obtenir la capitulation du fort d’Ostembourg commandant l’entrée de la rade intérieure. Pendant la nuit du 30, on s’empare d’une petite redoute sur une hauteur à demi-portée de fusil du fort, ce qui pousse le commandant anglais à négocier. Le 31, le colonel d’Algoud fait sommation de se rendre sous peine d’être envoyé comme prisonnier dans les geôles d’Haidar Alî, mais l’Anglais ne veut négocier qu’avec celui qu’il perçoit comme le chef véritable du siège, Suffren lui-même. L’officier anglais sorti parlementer obtient la même capitulation que le fort précédent[381].
Au final, c’est une brillante victoire du bailli qui a enlevé Trinquemalay en moins d’une semaine et au prix de 25 tués ou blessés seulement. Ce n’est pas cher payé pour une base aussi précieuse et qui livre au passage un beau butin de guerre. Dans le seul fort d’Ostembourg on trouve 50 000 piastres, 20 000 livres de poudre, 1 650 boulets, six mois de vivres, 1 200 fusils, 4 canons de campagne, 10 obusiers et 30 canons de forteresse[382]. Un butin qui montre que les Anglais avaient de quoi soutenir un long siège et qui laisse percevoir en creux leur faible moral dans cette affaire où ils avaient tout à gagner à pousser leur résistance en attendant l’arrivée prochaine de leur escadre. Suffren ne s’y trompe pas : « J’ai accordé une belle capitulation, parce qu’ayant 1 200 hommes à terre, l’arrivée de M. Hughes pouvait m’embarrasser[383]». Tout est dit, et la suite va prouver qu’à deux jours près il aurait pu se retrouver pris entre deux feux. Trinquemalay étant toujours sous souveraineté hollandaise, il convient aussi de respecter les règles du droit : Suffren se réserve le commandement militaire de la place, mais un administrateur hollandais, M. Van Seuden est nommé gouverneur civil de la ville[384].
Le 2 septembre, Suffren est à terre et invite les officiers britanniques prisonniers à déjeuner. On est encore à table, lorsqu’à 15 heures deux coups de canons du Héros signalent l’arrivée d’une escadre anglaise. Il s’agit bien sûr de Hughes qui peut constater à la longue vue que le drapeau français flotte sur les forts. Suffren donne immédiatement congé à ses hôtes et rallie son vaisseau. L’occasion de couronner la victoire terrestre par une victoire navale est vraiment trop tentante. Le 3 août, à 5h45 du matin, Suffren hisse le signal d’appareillage. Le sort en est jeté pour une quatrième rencontre avec le chef anglais.
 La bataille de Trinquemalay, le 3 septembre 1782, par le peintre Dominique Serres (1719-1793). A droite, la ligne anglaise à bord opposé avec les trois vaisseaux français les plus engagés.
La bataille de Trinquemalay, le 3 septembre 1782, par le peintre Dominique Serres (1719-1793). A droite, la ligne anglaise à bord opposé avec les trois vaisseaux français les plus engagés.
 La batterie d'un vaisseau de 74 canons. La qualité du tir français endommage gravement sous la ligne de flottaison de nombreux vaisseaux anglais, dont le navire amiral (modèle réduit, Musée de la marine).
La batterie d'un vaisseau de 74 canons. La qualité du tir français endommage gravement sous la ligne de flottaison de nombreux vaisseaux anglais, dont le navire amiral (modèle réduit, Musée de la marine).
Dans quel état d’esprit se trouvent les capitaines de Suffren au moment d’engager ce combat qui ne semble pas utile alors qu’il suffit d’attendre que Hughes s’épuise devant Trinquemalay puis fasse demi-tour ? Nous n’en savons rien. Mais une fois plus, la bataille va se révéler extrêmement confuse, avec de nombreux navires peu ou mal engagés, un Suffren furieux, des capitaines qui clament leur innocence et des Historiens qui ont bien du mal à y voir clair dans les compte-rendu très contradictoires de cet affrontement[385].
Suffren sort de la baie avec ses 14 vaisseaux et innove en engageant aussi sa plus grosse frégate, la Consolante (36 canons) pour creuser l’écart avec Hughes qui ne dispose que de 12 navires. On dispose donc de bonnes chances de victoire, d’autant que le vent semble favorable. Mais Suffren éprouve les pires difficultés à former sa ligne. Les ordres doivent être affichés plusieurs fois, sous forme générale ou individuelle. La Bellone est même utilisée pour faire circuler verbalement les ordres, ce qui se révèle une erreur. Le temps que la frégate arrive et de nouveaux ordres se sont affichés dans la mâture du vaisseau amiral. On peut comprendre la perplexité de certains commandants[386] et la relative confusion qui règne dans l’escadre alors que Suffren semble vouloir aller toujours plus vite que la musique... En face, Hughes a formé une ligne impeccable, réglée traditionnellement sur la marche du voilier le plus lent, et observe circonspect les manœuvres adverses. Suffren réussit malgré tout à former plus ou moins sa ligne, articulée en trois divisions. Il se place au centre, toujours sur le Héros (74), alors que l’avant-garde est commandée par d’Aymar sur le Saint-Michel (64) et que l’arrière-garde est sous les ordres de Tromelin sur l’Annibal (74)[387].
Vers 15h00, Suffren engage le combat. Il ordonne au Vengeur (64) et à la Consolante (36) de doubler la ligne anglaise sur l’arrière pour prendre celle-ci entre deux feux, tactique classique et que l’on a déjà vu dans les engagements précédents. Mais encore une fois, la manœuvre échoue et le Vengeur qui perd son mât d’artimon doit s’éloigner du champ de bataille alors que la commandant de la Consolante est tué. A l’avant-garde, l’Artésien (64) ne comprend pas les ordres et s’éloigne trop en avant, suivi de l’Orient (74) et du Saint-Michel (64). C’est au centre que se déroulent le gros de l’action, comme toujours menée par Suffren sur le Héros (74), suivi par l’Illustre (74) et l’Ajax (64). Les 3 vaisseaux qui se détachent de la ligne française engagent au plus près les Anglais et se retrouvent rapidement bien seuls. La suite est dramatique. Les 3 navires se font accabler chacun par le tir convergent de trois, quatre ou cinq vaisseaux ennemis sans que le reste de l’escadre viennent à leur secours. Au plus fort de l’action, le Héros doit faire face au Superb (74), au Montmouth (64), au Burford (74) et à l’Eagle (64)[388]. Hughes fait virer par vent arrière. S’il l’avait fait par vent devant, les trois vaisseaux français auraient pu être coupés du reste de l’escadre et anéantis. Moissac, le principal officier de Suffren raconte : « Nous avons redoublé notre feu pour gêner leur évolution ; notre équipage désespéré de la mauvaise manœuvre de nos vaisseaux [le reste de l’escadre] n’en était cependant pas découragé et nous avons toujours répondu avec la même vivacité au feu des 12 vaisseaux ennemis que nous recevions alors à bord opposé, réparti sur l’Ajax, l’Illustre et nous » [389]. A 18h00, le Héros perd son grand mât puis c’est au tour de l’Ajax de subir la même avarie. L’Illustre démâte aussi de son grand mât, de son mât de hune, de son mât d’artimon, de son perroquet de fougue... Le Héros perd son mât d’artimon, ce qui entraîne le pavillon français dans la mer et déclenche un grand hourra sur les vaisseaux anglais, où l’on pense que le bailli vient d’amener ses couleurs[390]. Suffren fait rageusement remonter les couleurs, mais la situation des 3 vaisseaux devenus ingouvernables est maintenant désespérée. Heureusement, vers 18h45, les vaisseaux français non engagés virent de bord et viennent secourir les trois isolés. Les deux navires démâtés sont pris en remorque. Suffren passe sur l’Orient alors que l’Artésien qui est revenu dans la bataille reste fortement engagé contre l’arrière-garde de Hughes qui a fait le signal de retraite.
On se retrouve avec un schéma de bataille qui n’est pas sans rappeler Sadras ou Provédien, avec une large partie de l’escadre qui n’a pas ou peu participé à l’engagement. Suffren est absolument furieux :
« J’ai le cœur navré par la défection la plus générale, je viens de manquer l’occasion de détruire l’escadre anglaise. (...) Ma ligne à peu près formée, j’attaquai et fis signal d’approcher. J’avais fait signal au Vengeur et à la Consolante de doubler par la queue. L’on n’approcha point. Il n’y a eu que le Héros, l’Illustre et l’Ajax qui ont combattu de près et en ligne. Les autres, sans égard à leurs postes, sans faire aucune manœuvre ont tiraillé de loin, ou pour mieux dire hors de la portée de canon. Tous, oui tous, ont pu approcher puisque nous étions au vent et aucun ne l’a fait. Plusieurs de ceux-là se sont conduits bravement dans d’autres combats. Je ne puis attribuer cette horreur qu’à l’envie de finir la campagne, à la mauvaise volonté et à l’ignorance, car je n’oserais supporter rien de pis. »[391]
Sur l’instant, les chiffres lui donnent raison, puisque les 82 morts et 255 blessés de l'affrontement sont concentrés essentiellement sur le Héros (30 morts, 72 blessés) l’Illustre (24 morts, 82 blessés) et l’Ajax (10 morts, 24 blessés)[392], mais l’examen attentif des faits montre cependant une situation beaucoup plus complexe. Tromelin, (qui commandait l’arrière garde) est resté comme à Sadras hors de la bataille et d’Aymar (qui commandait l’avant-garde) s’est révélé un chef médiocre, mais plusieurs navires se sont aussi retrouvés en panne par les caprices du vent qui ne s’est pas maintenu sur toute la ligne. Parmi ces vaisseaux, on compte le Flamand, le Bizarre, l’Annibal et semble-t-il le petit Annibal[393]. Certains ont tenté de se faire touer par leurs canots. Le récit donné par Hughes montre aussi un combat beaucoup plus intense sur le reste de la ligne française, contrairement à ce qu'en dit Suffren et son principal officier, Moissac. A l’arrière-garde, où les Français « tombant furieusement sur notre vaisseau de queue le Worcester (64) trouvèrent une brave résistance et à l’avant-garde où l’Exeter (64) et l’Isis (56) sont accablés par 5 vaisseaux français »[394]. Il s’agit effectivement des 5 vaisseaux de la tête de ligne française, mal engagés pour Suffren, mais en réalité très regroupés et tirant d’assez près pour matraquer les deux premiers vaisseaux anglais alors que les suivants sont accaparés par l’attaque au plus près du Héros, de l’Illustre et de l’Ajax. Malgré sa supériorité numérique, le centre anglais semble même vivre un véritable enfer :
« Les vaisseaux de notre escadre avaient, selon les apparences, souffert si considérablement, qu’ils n’étaient pas en état de poursuivre [le combat]. (...) L’Eagle, le Monmouth, le Burford, le Suberb et plusieurs autres vaisseaux ayant beaucoup de voies d’eau occasionnées par des boulets qui les avaient atteints si bas, qu’on ne pouvait arriver à l’endroit où étaient les trous pour les boucher efficacement, tous les autres vaisseaux ayant considérablement souffert dans leurs mâts et agrès. »[394]
Ce commentaire étonnant sonne presque comme un démentis au rapport de Suffren, et comme un hommage à la qualité de l’entrainement des canonniers français, lesquels ont profité de ce que les coques anglaises sous le vent présentaient leurs œuvres vives pour placer de nombreux coups sous les lignes de flottaison.
A 19h20, le combat cesse. L’Exeter, désemparé, est sorti de la ligne anglaise. Les pertes anglaises, avec 51 tués et 283 blessés sont presque équivalentes aux pertes françaises. Les commandants de l’Isis, (Lumley) et du Sultan, (Watt) ont été tués (c'est ce dernier qui avait exprimé son admiration pour l’escadre française après Négapatam, voir plus haut) et un autre (Wood) agonise sur son vaisseau. Hughes doit se replier sur Madras pour réparer. La victoire reste donc à Suffren, mais une fois de plus l’escadre anglaise n’est pas anéantie et les problèmes de commandement que l’on pensait réglés au lendemain de Négapatam (avec le renvoi de quatre commandants) ne le sont toujours pas. Une nouvelle crise dans l'état-major se profile, alors que par ailleurs les mauvaises nouvelles affluent de la côte de Coromandel et que l’escadre doit en plus faire face à une série de naufrages.
Article connexe : Bataille de Trinquemalay.Naufrages et démissions : des lendemains de bataille très difficiles (septembre-octobre 1782)
 Le naufrage de l'Orient (74), quelques jours après la bataille, puis du Bizarre (64) un mois plus tard est un rude coup qui fait perdre à l'escadre deux grosses unités. Gravure de l’Orient par Pierre Ozanne.
Le naufrage de l'Orient (74), quelques jours après la bataille, puis du Bizarre (64) un mois plus tard est un rude coup qui fait perdre à l'escadre deux grosses unités. Gravure de l’Orient par Pierre Ozanne.
Le retour de l’escadre sur Trinquemalay est particulièrement laborieux. Les deux vaisseaux démâtés doivent être remorqués, le Héros par le Sphinx et l’Illustre par le Petit Annibal. Suffren ne regagne son vaisseau que le 6 septembre. Dans la nuit du 7 septembre, un tragique accident de mer vient encore alourdir le bilan de la bataille. L’Orient s’échoue aux abords de Trinquemalay, dans un secteur bien connu pour ses eaux dangereuses. Le jeune officier de quart fait sonder et découvre que le fond est proche, mais préfère aller avertir le capitaine (son père) plutôt que de virer de bord immédiatement. Lorsque celui-ci arrive sur la dunette et constate qu’il ne reste presque plus de fond, il ordonne de brasser à culer[395], mais il est trop tard. L’Orient heurte les rochers ; la coque déchirée, il ne peut-être dégagé. Suffren organise aussitôt le sauvetage. Les opérations durent jusqu’au 16 septembre, dans des conditions très difficiles à cause d’une forte houle et d’un vent soutenu. On parvient à évacuer tout l’équipage, une grande partie des vivres, quelques canons et des éléments importants de la précieuse mâture[396]. Cet échouage, par la faute d’un jeune officier qui craint son père, sonne comme un coup dur supplémentaire pour l’escadre qui laisse dans cette affaire une grosse unité de 74 canons.
Le 17 septembre, l’escadre fait enfin son entrée dans la rade de Trinquemalay. Les charpentiers se mettent au travail pour rétablir les mâtures. Le Héros reçoit une partie des mâts récupérés sur l’Orient, l’Illustre récupère le grand mât du Bizarre qui prend celui de la Consolante... Par ailleurs, les nouvelles sont mauvaises. Au retour de la bataille, le cutter le Lézard est venu informer le commandeur que le général Duchemin, malade depuis des semaines, est mort. La petite armée française enfermée dans Gondelour est maintenant assiégée par les Anglais, alors qu’Haidar Alî, qui manque de fourrage, ne peut apporter son aide. Il n’est pas possible non plus à l’escadre de bouger tant que les réparations ne sont pas achevées. On n’en finit plus aussi d’attendre les renforts français qui stationnent à l’île-de-France et que l’on a promis à Haidar Alî. Mais que fait donc Bussy ?
A ces tracas s’ajoute le dernier acte de la crise de commandement qui se joue depuis des mois. Le 23 septembre, quatre capitaines, Tromelin, La Landelle, Saint-Félix et Morard de Galles demandent à être relevés de leurs fonctions. Tous les quatre invoquent une santé profondément délabrée après des mois de campagne. Mais qu’en est-il exactement ? Cette démission déguisée intervient vingt jours après la bataille de Trinquemalay. Tous commandaient des vaisseaux qui n’ont pas été engagés dans le combat ou assez peu : l’Annibal pour le premier, le Bizarre pour le second, l’Artésien pour le troisième et le Petit Annibal pour le dernier. Dans ses rapports, Suffren s’est montré très sévère avec tous ses commandants, excepté les deux qui l’ont suivi au plus près du centre de la bataille, Bruyère sur l’Illustre et Beaumont sur l’Ajax[397]. Une fois de plus pour le commandeur, si on n’est pas au plus près de l’ennemi, on n’est pas à la hauteur, et tant pis pour ceux qui peuvent invoquer à juste titre que le vent était tombé dans leur secteur (pour trois d’entre-eux, Tromelin, La Landelle, Morard de Galles). Suffren ressasse aussi des arguments que l’on a déjà vu après les précédentes batailles sur l’incompétence des officiers venus de l’île-de-France, leur faible motivation, leur corruption[398].
On peut être certain qu’en plus de ses rapports, Suffren a fait pleuvoir sur ces officiers de virulentes critiques et autres remarques désobligeantes, voire insultantes… C’est sans doute ces propos qui poussent vers la sortie les quatre commandants. La démission de Tromelin, élément profondément perturbateur dans l’escadre est une véritable délivrance pour Suffren qui se trouve débarrassé d’un homme qui lui était foncièrement hostile depuis l’escale à l’île-de-France. La Landelle est un officier assez médiocre qui ne s’est illustré dans aucun combat. Sa démission ne pose aucun problème d’autant que sa santé est réellement défaillante, il s’est même évanoui plusieurs fois à bord de son navire. La démission des deux autres officiers est plus grave et sonne comme un désaveu du comportement de Suffren. Il s’agit de deux hommes dont le bailli s’était montré jusque-là très satisfait, voire avait fait leur éloge dans les combats précédents. Saint-Félix commandait le Brillant dans l’escadre de l’île-de-France et avait été promu au commandement de l’Artésien au lendemain de la bataille de Négapatam, (prouvant au passage que les officiers de l’océan Indien n’étaient pas tous incompétents et corrompus). Morard de Galles, officier d’un calibre supérieur au précédent, s’était illustré en sauvant l’Annibal à la Praya et avait ensuite parfaitement bien tenu le Petit Annibal, navire sur lequel il a par ailleurs été blessé au combat. Leur démission affecte vivement Suffren qui par dépit leur accorde « avec plaisir » le droit de quitter l’escadre sans remettre en cause son propre comportement[399].
Les quatre hommes quittent piteusement Trinquemalay pour être accueillis froidement par Bussy à l’île-de-France. Saint-Félix et Morard de Galles reviennent d’ailleurs rapidement sur leur décision et demandent à servir de nouveau, même en sous-ordre, ce qui leur est accordé. Si La Landelle apparait comme réellement malade, la situation de Tromelin n’est pas la même : « Je ne puis trouver ses motifs valables note Bussy. Sa santé me paraît bonne. J’ignore quelles sont ses affaires, mais il faudra qu’elles soient bien importantes pour que le roi et son ministre ne le juge pas avec la plus grande sévérité »[400]. Tout est dit. Tromelin sera rayé des cadres en 1784 « sans satisfaction »[401]. Suffren reçoit le renfort inattendu de la presse anglaise locale : le Calcutta Gazette juge les officiers qui s'en vont comme étant « indignes de servir un si grand homme »[402].
Cette ultime vague de démissions provoque un nouveau mouvement d’officiers dans l’escadre, Suffren déplaçant certains commandants et assurant la promotion d’autres, de plus en plus jeunes. C’est un petit casse tête car les états-majors sont très limités quand au nombre et à la qualification des officiers disponibles[403]. De plus en plus de navires sont maintenant commandés par de simples lieutenants de vaisseau, pas forcément très expérimentés, comme la suite des évènements va le confirmer.
Le 1er octobre, l’escadre enfin réparée appareille pour secourir Gondelour. En chemin on croise un vaisseau anglais qui préfère se jeter à la côte dans les environs de Négapatam plutôt que d’être capturé. C’est une petite unité porteuse de 24 canons, mais neuve et doublée de cuivre. Il y a possibilité de la déséchouer, mais l’officier qui dirige l’équipe envoyée à bord préfère y mettre le feu sans vérifier la cargaison, contrairement aux ordres. Le bâtiment saute dans une immense explosion, alors qu’il était chargé de poudre, de canons, de mortiers, de bombes, de boulets et de riz… Nouveau coup de sang du bailli contre cette bévue qui prive l’escadre d’un précieux ravitaillement. Il s’agissait pourtant d’un des officiers favoris de Suffren, membre de son état-major sur le Héros et sur lequel il avait rendu de nombreux compte-rendu flatteurs.
L’incident suivant est bien plus grave. Le 4 octobre, l’escadre arrive en vue de Gondelour. Le Bizarre (64) s’approche trop près du rivage, s’échoue sur la barre et se voit précipité sur la côte. La coque percée, il ne peut être relevé. C’est la consternation. Son commandant, M. de Thérouet venait d’être promu à ce poste quatre jours avant pour remplacer La Landelle démissionnaire. Ce jeune officier de 32 ans avait pourtant une excellente réputation[404]. En un mois, l’escadre vient de perdre deux grosses unités par accident alors qu’elle n’en avait laissé aucune sur le champ de bataille. Le gain de puissance obtenu le 21 août par l’arrivée des deux vaisseaux en renfort est annihilé, d’autant qu’on apprend en même temps que le cutter le Lézard a été saisi par surprise dans le port neutre danois de Tranquebar[405].
Comme pour l’Orient, on s’active pour récupérer tout ce qui peut l’être, à commencer par la précieuse mâture. Ces deux naufrages successifs ont au moins l’avantage - si l’on peut dire - de fournir au reste de l’escadre un complément d’équipage plus que nécessaire. Suffren fait débarquer le maximum de troupes pour renforcer la petite garnison de Gondelour. Seule bonne nouvelle de cette équipée, on constate que la menace anglaise sur la ville s’est écartée, sans doute pour plusieurs semaines, car la mousson approche ce qui rend absolument impossible toute opération militaire sur terre comme sur mer. Suffren s’attarde jusqu’au 15 octobre, mais le mauvais temps rend la situation intenable sur une côte réputée dangereuse pendant cette période de l'année. Il faut absolument mettre l’escadre à l’abri et trouver un lieu d'hivernage.
L’hivernage réparateur à Aceh (novembre-décembre 1782)
 Carte des « Indes orientales ». Suffren choisit d'hiverner à Aceh, sur la pointe nord de Sumatra, pour faire reposer son escadre et attendre les renforts. (On peut visionner plus facilement cette immense carte française de 1771 et trouver les localités citées dans l'article en utilisant le zoom toolserver)
Carte des « Indes orientales ». Suffren choisit d'hiverner à Aceh, sur la pointe nord de Sumatra, pour faire reposer son escadre et attendre les renforts. (On peut visionner plus facilement cette immense carte française de 1771 et trouver les localités citées dans l'article en utilisant le zoom toolserver)
Suffren a pris dès le début, on l’a vu, la décision -malgré les demandes pressantes de ses officiers- de ne pas retourner à l'île-de-France. Il lui faut donc trouver un lieu sûr où il peut radouber ses vaisseaux, faire reposer ses équipages dans de bonnes conditions sanitaires, maintenir les liaisons avec les alliés hollandais et indiens, et pour finir, s’assurer d’une jonction facile avec l’escadre de Bussy qui doit appareiller de l’île-de-France pour le rejoindre. Les Anglais ont résolu depuis longtemps le problème de la mousson d'est en évacuant Madras au profit de Bombay, port à l'abri sur la côte ouest, mais les Français n'ont rien de tel. La baie de Trinquemalay fraichement conquise offre une possibilité de repli, mais les ressources de l’île de Ceylan sont limitées et elles ont déjà été très sollicitées. C’est finalement une base un peu à l’écart du secteur des opérations qui est retenue par Suffren : Aceh ("Achem"), à la pointe nord de l’île de Sumatra, de l’autre côté du golfe du Bengale. Ce port, fréquenté depuis longtemps par les vaisseaux de la Compagnie des Indes qui viennent s'y mettre à l'abri de la mousson, offre de bonnes possibilités de ravitaillement et les renseignements dont on dispose laissent entendre que le climat y est plus sain qu’à Trinquemalay. Le régime des vents rend aussi le déplacement assez facile puisqu’il faut moins d'une vingtaine de jours seulement pour faire la traversée, dans un sens comme dans l’autre[404].
Le 2 novembre, dans l’après-midi, l’escadre se présente devant Aceh[406]. Le lendemain de l’arrivée, Moissac, le principal officier de Suffren se rend à la ville pour « faire part au roi de notre arrivée et lui présenter les respects du général [Suffren] »[407]. La rencontre avec l’un des ministres du roi, puis avec deux de ses parents quelques jours plus tard permet de tisser de relations convenables avec le petit royaume. Comme en Inde, on échange des présents, ce dont le jeune sultan se montre très avide. Suffren comprend aussi que ses hôtes ont besoin d’être rassurés car jamais une aussi forte escadre européenne n’avait paru dans leurs eaux. Les piastres abondamment distribués par les Français achèvent de convaincre les dirigeants de la petite cité que l’escadre n’est là que pour se ravitailler, et pas pour une tentative de conquête. L’île de Sumatra, islamisée depuis le IXe siècle, a d'abord résisté aux Portugais avant de faire de même avec les Néerlandais qui ne sont guère installés que sur les étroites bandes littorales dépendantes de leurs comptoirs, sous l'autorité du gouverneur de Batavia. La région d’Aceh échappe à leur emprise et Suffren se montre prudent, d’autant que la population a la réputation d’être farouche et que l’autorité du prince passe pour mal assurée. Le commandeur n’est pas mécontent de voir que le sultan refuse l’autorisation de dresser des tentes pour les malades sur le rivage et ne permet d’aller à terre qu’aux seuls officiers et aux marins des embarcations venant chercher de l’eau et des vivres. Il n’y aura donc aucun incident à terre avec la population, et les désertions seront plus que limitées.
Le séjour à Aceh s’avère très profitable. Dès le 16 décembre, Suffren estime possible de reprendre la mer pour l’Inde[408]. Le port est excellent tant pour la sécurité nautique que pour les rafraichissements que l’on trouve en abondance à des prix satisfaisants. On fait facilement de l’eau dans la rivière, et le bois que l’escadre a été autorisée à faire à Pulo-Way revient beaucoup moins cher que celui qu’on se fait livrer de la ville. Seule ombre au tableau, l’air est moins sain que ce que l’on avait espéré et l'état sanitaire de l'escadre ne s'améliore guère[409]. La coopération avec les Néerlandais fonctionne toujours correctement. Le 17 novembre, la frégate la Pourvoyeuse (38) rentre du comptoir de Malacca avec un chargement de bois de mâture. Ce succès n'empêche pas Suffren de se montrer très irrité du manque de mordant de son commandant qui a laissé s'échapper 5 gros vaisseaux anglais de commerce au motif qu'ils faisaient bonne contenance[410].
Suffren guette aussi les nouvelles d'Europe et sur l'arrivée tant promise des renforts de Bussy qui devraient lui permettre de reprendre vigoureusement la campagne. Malheureusement, les dépêches qu'apportent la corvette le Duc-de-Chartes le 24 novembre sont tous sauf satisfaisantes, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est passé sur les autres théâtres d'opération pendant l'année 1782.
La guerre en 1782 vue depuis Versailles : la Jamaïque et Gibraltar plus importants que les Indes ?
 La bataille des Saintes le 12 avril 1782. Le théâtre d'opération des Antilles reste prioritaire en 1782. Versailles y consacre plus de 30 vaisseaux sous les ordres du comte de Grasse. (T. Whitcombe)
La bataille des Saintes le 12 avril 1782. Le théâtre d'opération des Antilles reste prioritaire en 1782. Versailles y consacre plus de 30 vaisseaux sous les ordres du comte de Grasse. (T. Whitcombe)
 Le siège de Gibraltar au côté des Espagnols apparaît comme la deuxième priorité de Versailles en 1782, loin devant la guerre en Inde malgré les succès de Suffren. (Tableau de George Carter).
Le siège de Gibraltar au côté des Espagnols apparaît comme la deuxième priorité de Versailles en 1782, loin devant la guerre en Inde malgré les succès de Suffren. (Tableau de George Carter).
C’est une particularité des conflits d’avant la Révolution française : la guerre peut se poursuivre avec acharnement pendant des mois (ou des années) alors que les diplomates planchent sur les projets de paix. A ce titre, l’année 1782 joue sur les deux tableaux. Même s’il est évident que la guerre est gagnée en Amérique du Nord, rien n’est encore joué ailleurs et tous les protagonistes cherchent à obtenir d’ultimes avancées militaires qui sont autant de cartes gagnantes dans le jeu diplomatique. Indiscutablement, les succès de Suffren sont un atout pour Louis XVI, mais il faut six mois aux dépêches d’Asie pour arriver en Europe et malheureusement pour le bailli, les priorités de Versailles sont ailleurs. Il convient donc de revenir un peu en arrière et de se pencher sur le bilan de l’année 1782 sur les autres théâtres d’opérations, même si on doit prendre pour cela le risque de s’écarter un peu de notre sujet.
La victoire franco-américaine de Yorktown (octobre 1781) a fait chuter le gouvernement anglais (mars 1782) et provoqué un armistice de facto dans les treize colonies. Armistice qui a eu un effet inattendu : il a libéré la Royal Navy d’un immense et épuisant théâtre d’opération. Dès décembre 1781, les effets se sont fait sentir dans l’Atlantique avec la dispersion d’un important convoi français partis de Brest pour apporter des renforts aux Antilles et aux Indes[411].
La guerre terminée en Amérique du Nord, le théâtre d’opération essentiel était passé aux Antilles où l’on avait continué à se battre pour le contrôle des « isles » à sucre en y concentrant les plus grands moyens. De Grasse, avec ses 35 vaisseaux, avait enlevé l’île de Saint-Christophe (janvier-février 1782) et repris les missions traditionnelles d’escorte aux convois marchands. En face d’elle, la Royal Navy avait concentré 37 vaisseaux à la Barbade sous les ordres de Rodney pour reprendre la main dans la région et faire barrage au projet franco-espagnol de conquête de la Jamaïque. Madrid rêvait depuis longtemps de reprendre cette riche île que lui avaient enlevé les Anglais au XVIIe siècle et avait réussi à entrainer Versailles dans ce projet qui pourtant n’intéressait pas la France. Rêve qui se fracasse le 12 avril 1782, lorsque l’escadre du comte De Grasse, encombrée d’un important convoi marchand, est lourdement battue aux Saintes (le jour-même où Suffren est vainqueur à Provédien)[412]. La Jamaïque sauvée, l'effet de cette bataille a aussi été moral : la Royal Navy a repris confiance en elle et Londres qui restait sous le coup de l’humiliation de Yorktown a pu aborder les premières négociations de paix (été 1782) en meilleure posture.
La deuxième priorité de 1782 semblait être... Gibraltar. Le « rocher » était assiégé par les Espagnols depuis 1779, Suffren y ayant brièvement participé en 1780 (voir plus haut). La reprise de ce point d’appui à l’entrée de la Méditerranée était une des obsessions de Madrid dans laquelle se trouvait entrainé Versailles, toujours au non de l’alliance franco-espagnole. Le siège qui mobilisait 40 000 hommes arrivait sur sa troisième année. Il n’y avait qu’un seul moyen d’enlever la forteresse : assurer un blocus terrestre et naval complet de la base pour l’affamer. Le blocus terrestre fonctionnait, mais la lourde et mal commandée flotte espagnole s’était montrée absolument incapable d’intercepter les convois de ravitaillement escortés par la Navy. Douze vaisseaux français étaient pourtant mobilisés en permanence pour aider la flotte ibérique, mais ils ne faisaient qu’en partager l’impuissance puisque le commandement restait espagnol. C’était trop peu pour le gouvernement espagnol qui multipliait les demandes et les récriminations pour obtenir beaucoup plus, et qui y réussit en grande partie, malgré l’exaspération grandissante de Louis XVI et de son ministre des affaires étrangères, Vergennes[413]. On monta donc une gigantesque attaque au moyen de 10 batteries flottantes soutenues par 48 vaisseaux franco-espagnols. L’échec fut total, sanglant et ruineux, sous le feu de l’artillerie anglaise tirant à boulets rouges (13 septembre)[414].
Les historiens restent encore aujourd’hui étonnés du « suivisme » de Versailles dans les projets de Madrid[415]. On a accordé à l’alliance avec l’Espagne des moyens gigantesques, quasi aussi importants que ceux accordés aux « Insurgents » contre l’Angleterre, et qui auraient sans aucun doute été mieux employés ailleurs. Mais Suffren et son escadre sont restés ce qu’ils étaient depuis le début : une entreprise de diversion sur un théâtre d’opération lointain et secondaire, ni Louis XVI, ni Vergennes n’ayant eu pour objectif la reconquête des Indes[416]. Un seul homme semble avoir compris tout l’intérêt des victoires du bailli : le marquis de Castrie, qui s’affirme peu à peu dans cette guerre comme un grand ministre de la marine. C’est de Castrie qui prête une oreille attentive aux demandes de renfort de Suffren et finit par obtenir du roi l’envoi d’un corps expéditionnaire important. Mais n’est-il pas déjà un peu tard alors que la Royal Navy retrouve son mordant et qu'elle détache elle aussi des renforts vers les Indes ?
Une campagne corsaire intensive en attendant l'arrivée des renforts (décembre 1782-mars 1783)
 La côte de Coromandel, du Masulipatnam à Gondelour. Au retour de l'hivernage d'Aceh, Suffren mène une active campagne corsaire du nord au sud de la côte, pour ravitailler son escadre et maintenir la pression sur les Anglais. (Carte de 1753)
La côte de Coromandel, du Masulipatnam à Gondelour. Au retour de l'hivernage d'Aceh, Suffren mène une active campagne corsaire du nord au sud de la côte, pour ravitailler son escadre et maintenir la pression sur les Anglais. (Carte de 1753)
De Castrie, dès sa prise de fonction (octobre 1780) avait manifesté son intérêt pour renfoncer l’effort de guerre français en Inde. Les bonnes nouvelles transmises par Suffren prouvaient qu’il était possible d’y changer la donne. On pouvait espérer un soulèvement général des princes contre la domination anglaise sur l’Inde et restaurer son indépendance, ce qui aurait porté un coup terrible à l’économie anglaise qui tirait de très gros revenus de cet immense pays. Des objectifs clairement indiqués au roi en décembre 1780 dans un « Projet d’expédition à faire dans l’Inde en 1781. »[417]
Mais il y a loin du projet à la réalité. Il faut attendre pratiquement un an ( ! ) avant que le roi ne donne son accord et que soit montée l’opération. Louis XVI et son ministre confient l’expédition à l’ancien bras droit de Dupleix, Charles Joseph Patissier de Bussy-Castelnau, qui passe pour un bon connaisseur de l’Inde et qui devrait pouvoir profiter de son ancienne réputation pour rallier les princes indiens.
Bussy quitte Paris le 13 novembre 1781, mais plutôt que d’embarquer à Brest il préfère traverser les Pyrénées pour Cadix où il rejoint les vaisseaux l’Illustre et le Saint-Michel accompagnés de trois navires de transport. Ce curieux voyage s’avère cependant une bonne décision car le convoi parti de Brest le 11 décembre (à destination des Amériques et des Indes) escorté par les vaisseaux de Guichen est en partie capturé au large d’Ouessant par les Anglais, et le reste dispersé par une tempête[418]. Un nouveau convoi, toujours escorté par Guichen part de Brest en février 1782 à destination de Cadix, avant que le chef d’escadre Peynier n’en prenne le commandement (Guichen restant à Cadix pour le siège de Gibraltar) et ne rejoigne Bussy. La suite du voyage s'avère très difficile puisqu'une partie du convoi est lui aussi assailli et saisi par les Anglais. Arrivé en avril au Cap, il faut faire relâcher longuement le convoi dans lequel s’est déclarée une grosse épidémie. On y stationne plus de deux mois et on doit y laisser encore 600 hommes pour renforcer la place que l'on croit à nouveau menacée par les Anglais. Le convoi qui rallie l’île-de-France est épuisé. Bussy tombe malade à son tour. L’expédition est totalement immobilisée alors que l’épidémie fauche un tiers des troupes[419].
Suffren découvre la situation à Aceh dans les courriers apportés par la corvette le Duc-de-Chartres, avec, cerise sur le gâteau des mauvaises nouvelles, la défaite de De Grasse et sa capture aux Saintes le 12 avril précédent. Pour le bailli, qui se voyait déjà à la tête d’une grande force en Inde, la douche est glacée :
« Je suis accablé, Monsieur, par les affreuses nouvelles d’Amérique et d’Europe. Malgré cela notre position eut encore été belle, sans l’épidémie qui a tenu M. de Peynier deux mois et demi à Falsebay et qui le retient encore à l’île-de-France, de sorte que je croyais que nous serions réunis ici 20 vaisseaux et 7 000 hommes de débarquement ; point du tout, aucune réunion, me voilà avec 12 vaisseaux en très mauvais état, contre 17 plus forts, dont 12 doublés [de cuivre], sans savoir ni quand ni comment je serai renforcé. Des vaisseaux en mauvais état, en général mal commandés, très mal en officiers et en équipage ; si nous ne sommes renforcés, je ne sais ce qui arrivera. »[420]
A Vergennes il confie son inquiétude sur la suite de la campagne si les renforts n’arrivent pas avec de bons vaisseaux, en envisageant la perte pour les Hollandais de « toutes leurs colonies » et pour la France « tout espoir de remettre les pieds en Inde » même si une campagne corsaire, pourrait, faute de mieux, faire « grand mal au commerce anglais. »[421]
Campagne corsaire que Suffren pratique déjà depuis des mois, on l’a vu, en vivant de ce qu’il trouve sur les nombreux navires anglais saisis. Il doit même, au sortir de l’hivernage, accentuer cette pratique en attendant l’arrivée hypothétique de Bussy. Le 20 décembre, l’escadre quitte Aceh. Suffren a décidé de toucher le plus au nord possible la côte de Coromandel puis de longer celle-ci vers le sud dans l’espoir de faire le plus de captures possible. Il détache deux de ses unités les plus rapides, le Petit Annibal (50 canons) et la frégate la Bellone (32) jusqu’au delta du Gange pour y faire une croisière contre le commerce britannique.
Le 8 janvier 1783 l’escadre aperçoit la côte indienne vers Ganjam, à 400 milles nautiques au nord de Madras. Comme Suffren l’a espéré, les prises sur le commerce anglais sont très nombreuses et le ravitaillement de l’escadre en riz est rapidement assuré. On capture par surprise, dans la nuit du 11 janvier une frégate anglaise de 28 canons, le Coventry. Le navire a été trompé par les signaux anglais que Suffren a fait distribuer à l’escadre. C’est une belle unité très rapide que l’on dote de 150 hommes d’équipage et qui va faire de très gros dégâts sur le commerce anglais[422]. La croisière corsaire se poursuit vers le sud. Les prises, trop nombreuses doivent être brûlées après récupération de ce qui intéresse l’escadre. Le 5 février on arrive à Pondichéry où l’on a confirmation de la nouvelle déjà donnée par les Anglais capturés sur le Conventry : Haidar Alî est mort depuis plusieurs semaines (décembre 1782) emporté par un cancer (ou un abcès mal soigné). Voilà les Français privés de leur allié et on ne sait pas ce que va faire son fils Tipû Sâhib, dont le pouvoir semble par ailleurs mal assuré. Ces mauvaises nouvelles poussent Suffren à rallier Gondelour (où stationne toujours l’armée française) le plus vite possible. Il faut débarquer de nombreux malades, surtout de l’Illustre et du Sévère et on reprend les habitudes de l’année précédente en envoyant des navires faire de l’eau plus facilement à Porto-Novo et d’autres chercher du biscuit à Pondichéry.
Le 15 février l’escadre mouille à Porto-Novo. Suffren envoie un émissaire à Tipû Sâhib qui croit de moins en moins aux promesses tant de fois faites par les Français sur l’arrivée de renforts, et qui veut abandonner la côte de Coromandel pour se porter vers l’intérieur des terres où une de ses provinces s’est révoltée au profit des Anglais. L’escale dure à peine, puisque le 16 février Suffren lève l’encre pour Trinquemalay qui est atteint le 23. Deux navires, le Vengeur et la Pourvoyeuse, en mauvais état y avaient déjà été envoyés pour commencer des opérations de carénage. Le bailli est très mécontent de constater que rien ou presque n’a été fait sur les deux vaisseaux en son absence. Suffren n’en finit plus de porter à bout de bras cette campagne. Sans sa présence et son impulsion rien ne semble avancer[423]...
Il y a tout de même quelques bonnes nouvelles au milieu de ces tracas : l’arrivée de la corvette la Naïade (22 canons) le 26 février, informe Suffren qu’il est fait chef d’escadre (suite au combat de La Praya) et que Bussy a quitté l’île-de-France depuis la mi-décembre. Il ne devrait plus tarder à arriver, ce qui est de la plus grande urgence car Tipû Sâhib a quitté la côte de Coromandel pour aller mater les révoltés sur la côte occidentale de l’Inde. Le 2 mars, le Petit Annibal et la Bellone rentrent de leur croisière sur le delta du Gange après avoir détruit de nombreux bâtiments, suivis le 7 du Saint-Michel et du Conventry qui ont fait de même et ont fait parvenir à la garnison de Gondelour des cargaisons de riz. La campagne corsaire sur le commerce anglais n’est pas encore achevée, mais depuis qu’elle dure elle a occasionné de lourdes pertes avec une cinquantaine de navires saisis ou détruits, en précisant bien que Suffren n'est pas seul à la pratiquer. Tous les belligérants s'en prennent au commerce adverse et revendent, réutilisent ou détruisent les prises en fonction des circonstances[424]. Le 10 mars, de nombreuses voiles sont aperçues à l'horizon : c'est le convoi de Bussy qui arrive enfin sur le théâtre d'opération, plus de 12 mois après son départ de France.
Suffren face à Bussy
 Charles Bussy de Castelnau, au temps de sa gloire, lorsqu'il servait Dupleix. En 1783 ce n'est malheureusement plus qu'un chef vieilli et impotent lorsqu'il arrive en Inde avec les renforts.
Charles Bussy de Castelnau, au temps de sa gloire, lorsqu'il servait Dupleix. En 1783 ce n'est malheureusement plus qu'un chef vieilli et impotent lorsqu'il arrive en Inde avec les renforts.
La division de M. de Peynier, forte de trois vaisseaux et d’une frégate accompagnant 35 voiles chargées de vivres, de munitions navales et portant environ 2 500 hommes de troupes entre dans la baie intérieure de Trinquemalay le 11 mars 1783. Bussy apporte aussi 5 millions pour le financement des opérations futures. « Mieux vaut tard que jamais » écrit Suffren à son ami Blouin[425]. C’est à peu près le seul commentaire positif du bailli, au vu de l’état du convoi et de son chef. Plusieurs vaisseaux sont dans un état lamentable. Le Hardi (66 canons) a du subir un radoub de trois mois à l’île-de-France avant de pouvoir reprendre la mer, et un autre vaisseau, l’Alexandre est resté bloqué à Port-Louis pour subir un grand carénage qui ne sera jamais terminé. Suffren est furieux : « l’on a envoyé le Hardi et l’Alexandre, non seulement non doublés de cuivre, mais coulant bas d’eau. Si ce dernier eût été trois jours de plus en mer on l’abandonnait. Il a écrasé les équipages des autres vaisseaux qu’on envoyait pomper. »[425] Pour Suffren qui comptait sur beaucoup plus, le renfort est plutôt mince, même si les deux autres vaisseaux arrivés, le Fendant et l’Argonaute sont deux 74 canons dans un état satisfaisant ainsi que la frégate la Cléopâtre (36).
C’est cependant l’état de Bussy qui inquiète le plus. Charles Joseph Patissier de Bussy-Castelnau avait été entre 1746 et 1760 le brillant second de Dupleix puis de Lally-Tollendal dans le sud de l’Inde. Excellent général, il avait infligé de lourdes pertes aux Anglais devant Pondichéry, pris des forteresses qui passaient pour imprenables, mis en déroute de grandes armées indiennes avec une poignée d’hommes et avait porté au pouvoir plusieurs princes favorables à la France, avant de devoir rentrer en 1760, prisonnier relâché sur parole en pleine Guerre de Sept Ans. Mais le flamboyant officier, à qui un nabab avait un jour juré fidélité, avait beaucoup vieilli. Très affaibli par les fièvres à l’île-de-France, miné par la goutte, il pouvait à peine marcher et semblait être devenu une caricature de son personnage passé, un « guerrier d’apparat et raffiné jouisseur aux lenteurs orientales » selon l’historien Jean-Christian Petitfils qui le décrit comme « un moribond solennel et desséché, au visage mangé par les plaques de poudre. »[426] Suffren ne se fait pas d’illusion sur les capacités du vieux chef : « La santé de Monsieur de Bussy est dans un état déplorable, et quoiqu’il soit mieux, tant depuis son départ de l’île-de-France que depuis son arrivée à la côte, je doute fort qu’il puisse soutenir les fatigues d’un général d’armée. »[427] L’Historien s’étonne du choix d’un tel commandant pour les Indes. C’est à croire qu'avant d'être nommé il n’a pas été reçu par le ministre et le roi qui n’ont pris en compte que ses états de service lointains.
Suffren n’est pas loin de penser que la campagne est manquée, vu l’arrivée tardive des renforts qui laisse passer l’occasion de faire le siège de Madras. Le bailli s’inquiète aussi de sa place dans la suite des opérations. Après 15 mois de service en jouissant d’une pleine indépendance, Suffren redoute de tomber sous la coupe d’un général de l’armée de terre qui n’est plus en pleine possession de ses moyens mais qui reste très jaloux de son autorité. De Castrie, ministre de la Marine, mais issu de l’armée de terre a donné des ordres précis et souples. Précis, car Bussy, commandant en chef des troupes a la pleine autorité pour ordonner les mouvements de l’escadre, ce qui subordonne celle-ci aux déplacement des forces terrestres. Souples, car de Castrie a aussi ordonné a Bussy de toujours consulter Suffren en qui il doit avoir pleinement confiance pour l’organisation des opérations maritimes[428]. De Castrie précise à Suffren que « si la marine a été subordonnée à l’armée de terre, c’est dans la crainte que, comme lors des opérations précédentes, l’amiral subisse de telles pressions qu’il abandonne les Indes pour se reposer à l’île-de-France, cette précaution n’était pas nécessaire avec vous, la fermeté que vous avez montré en renvoyant des capitaines ajoute à votre gloire. »[429] La situation est presque ironique pour Suffren : à force de s’être plaint du peu d’entrain de ses officiers pour ce théâtre d’opération, il se retrouve sous la coupe de l’armée de terre... Dans les faits, le bailli tout en sachant garder les formes et les apparences de la subordination à Bussy, va continuer à conduire son escadre en pleine indépendance mais avec un sens aigu de ses devoirs vis-à-vis de l’armée de terre. Il y a aussi une bonne surprise pour Suffren : Peynier se révèle un chef d’escadre déterminé et capable de prendre avec efficacité et loyauté les bonnes initiatives tout en exécutant ses ordres. Les relations entre les deux hommes vont se révéler excellentes. L’interminable crise de commandement semble s’achever.
Le débarquement des renforts et le retour de l'escadre anglaise (mars-avril 1783)
 Le jeune capitaine Louis Thomas Villaret de Joyeuse opère sur l'ordre de Suffren une mission très difficile qui lui vaut d'être capturé. Suffren ayant vanté ses qualités pour l'encourager, Villaret commentera des années plus tard : « Le seigneur Jupiter savait dorer la pilule ».
Le jeune capitaine Louis Thomas Villaret de Joyeuse opère sur l'ordre de Suffren une mission très difficile qui lui vaut d'être capturé. Suffren ayant vanté ses qualités pour l'encourager, Villaret commentera des années plus tard : « Le seigneur Jupiter savait dorer la pilule ».
Suffren et Bussy sont d’accord sur la conduite immédiate des opérations : il faut débarquer le plus rapidement possible les renforts à Gondelour pour y concentrer toutes les forces terrestres avant le retour de la Royal Navy. Pour ce faire, Suffren décide de resserrer l’escadre en n’employant que les vaisseaux doublés de cuivre et les transports qui marchent le mieux au cas où on croiserait malgré tout la flotte anglaise. Le 14 mars, soit trois jours à peine après l’arrivée de Bussy le convoi de troupe et de matériel appareille, escorté par 7 vaisseaux et 5 frégates[430]. Les deux chefs ont convenu d’un double débarquement. A Porto Novo pour les troupes et à Gondelour pour le bagage, l’artillerie, les munitions et le ravitaillement. Les troupes débarquées à Porto Novo sur les embarcations de l’escadre avec quelques jours de vivres devront rejoindre à pied Gondelour où le débarquement ne peut se faire qu’en utilisant des embarcations locales à fond plat, des chelingues, seules capables d'affronter la barre des brisants. Le 17 mars au matin, Suffren et Bussy descendent à terre. Bussy est salué par 21 coups de canons par tous les bâtiments de l’escadre et passe en revue les troupes en grande tenue. Un représentant du nouveau nabab vient aussi à la rencontre de Bussy qui peine à se déplacer. Le vieux chef à demi impotent devra suivre ses troupes en palanquin... Suffren s’éclipse l’après-midi pour assurer le débarquement du matériel à Gondelour, opération achevée le 23 mars.
Avant de rentrer sur Ceylan, le bailli qui dispose de bons renseignements, décide de tenter l’interception d’un convoi anglais annoncé venant d’Europe et qui n’est escorté que par un seul vaisseau. Sous les ordres de Peynier, il détache une division de 2 vaisseaux, (le Fendant et le Saint-Michel) et de 2 frégates, la (Cléopâtre et le Conventry) pour guetter l’arrivée du convoi devant Madras.
Le retour sur Trinquemalay est rendu difficile par des vents contraires. On est presque arrivé lorsque la frégate la Bellone signale des voiles sur l’horizon. C’est Hughes qui est de retour, avec une forte escadre. Le bailli force ses voiles et atteint Trinquemalay dans la soirée du 10 avril. Le port est mis en défense immédiatement, mais Hughes poursuit sa route sur Madras. La situation reste cependant très délicate car c’est maintenant la division de Peynier, laissée devant Madras qui est menacée. Suffren décide de l’avertir du danger en lui envoyant immédiatement un navire. Il se tourne vers le capitaine de brûlot Louis Thomas Villaret de Joyeuse, qui commande la Bellone (32). Mais comme il ne peut compromettre une frégate dans cette périlleuse mission il lui confie la corvette la Naïade de 22 canons. Villaret de Joyeuse fait remarquer que sur une telle « charrette » il a peu de chance de s’en sortir. Suffren acquiesce mais maintien la mission. « Je sens comme vous le danger qui vous menace, mais je ne veux pas compromettre une aussi belle frégate que la Bellone ; je veux me mettre en règle en cas qu’il mésarrive à la division de M. de Peynier, et si quelqu’un peut réussir ce projet, c’est vous. » Villaret commentera à un de ses amis : « Le seigneur Jupiter, comme vous le savez mon cher, savait dorer la pilule. »[431].
La mission de Villaret de Joyeuse va effectivement mal se passer. La Naïade est repérée par le HMS Sceptre (64 canons), qui engage la poursuite. Villaret tente de s’esquiver à la faveur de la nuit, mais la pleine lune le trahit et il est rejoint par le vaisseau anglais. La corvette de 22 canons soutient 5 heures de combat acharné avant de devoir baisser pavillon, gouvernail hors d’usage, presque démâtée, et son équipage décimé. Villaret terminera la guerre prisonnier, mais avec une belle réputation de courage et d’habileté. Villaret de Joyeuse était un officier de l’océan Indien, ce qui nous indique au passage que tous ces hommes n’étaient pas aussi inefficaces que ce que l’on a pu écrire à leur sujet[432].
Fort heureusement, la division de Peynier ne voyant pas arriver le convoi anglais attendu remet le cap au sud, la veille de l’arrivée de l’escadre de Hughes. Elle rentre saine et sauve à Trinquemalay le 21 avril après avoir fait plusieurs prises et les avoir détruites. L’escadre est maintenant au complet et au repos. Elle va y rester, pour le plus gros jusqu’au 11 juin 1783.
Les Français dans une position de plus en plus difficile (mai-juin 1783)
 Navire en carénage dans un port européen. De nombreux vaisseaux n'ont pas été radoubés depuis trois ou quatre ans et certains sont dans un état inquiétant.
Navire en carénage dans un port européen. De nombreux vaisseaux n'ont pas été radoubés depuis trois ou quatre ans et certains sont dans un état inquiétant.
 Vaisseau en partance. Le 11 juin 1783, Suffren doit lever l'ancre précipitamment pour dégager Gondelour assiégé.
Vaisseau en partance. Le 11 juin 1783, Suffren doit lever l'ancre précipitamment pour dégager Gondelour assiégé.
La situation matérielle et humaine de l’escadre est maintenant très délicate. Le rapport de force évolue défavorablement car on a perdu la supériorité dont on disposait au début de la campagne. Même renforcée de la division de Peynier, l’escadre ne peut aligner que 15 vaisseaux contre les 18 de Hughes. Les Anglais ont reçu le renfort d’un vaisseau de 84 canons et disposent d’un 74 et d’un 70 de plus, ce qui est considérable. Suffren relève que, « avantage inappréciable », les vaisseaux anglais sont tous doublés de cuivre alors que 8 français seulement le sont et que les 7 autres « marchent pis que des marchands. »[433] La plupart des vaisseaux n’ont pas été carénés depuis trois ou quatre ans. L'Illustre et le Saint-Michel font beaucoup d'eau. Ce déséquilibre des forces préoccupe Suffren depuis longtemps puisque dès le mois de janvier 1783 il a demandé au gouverneur Falk de pouvoir intégrer à son escadre les 4 vaisseaux néerlandais de 50 canons dont il vient d'apprendre l'arrivée au Cap. Mais les 4 unités et leur 600 hommes de renfort n'arriveront qu'après la cessation des hostilités[434].
Malgré la fin de la crise de commandement, Suffren n’a toujours qu’une confiance incertaine en ses commandants. Il juge que quatre ou cinq d’entre eux sont des « gens très ineptes. »[435] Les équipages sont dans un piètre état. On compte 900 malades à terre, malgré l'abondance de vivres qui permet même à Suffren de faire ravitailler Colombo où les Néerlandais crient famine[436]. La pénurie de personnel devient très inquiétante. Le 23 mai, Suffren doit prendre des mesures radicales pour renforcer son corps de bataille. Il fait désarmer toutes les frégates et les flûtes, à l’exception de la Cléopâtre et du Conventry. Les bâtiments particuliers sont mis à contribution et on prélève sur leurs équipages le maximum de marins possibles en les remplaçant par des prisonniers anglais. On embarque aussi 250 soldats de la garnison, 300 Cipayes, des Lascars et d’autres ouvriers du port[437]... Avec des équipages aussi composites on ne peut que s’interroger sur l’entrainement et l’efficacité de l’escadre, d’autant qu’on peine à atteindre les 75% d'effectifs réglementaires.
L’escadre est-elle proche de son point de rupture ? Suffren ne laisse rien entendre de tel, mais sa volonté de combattre Hughes semble un peu émoussée. On perçoit de toute façon un changement dans sa tactique puisqu’il semble privilégier -comme on l’a vu au retour de l’hivernage à Aceh et avec la division de Peynier devant Madras- une guerre corsaire de harcèlement sur les lignes ennemies. Les évènements vont cependant en décider autrement.
Le 24 mai, alors que la réorganisation de l’escadre est en cours l’escadre anglaise parait devant Trinquemalay. Suffren met son pavillon sur l’Annibal, mais refuse le combat et ordonne d’embosser tous les vaisseaux dans la rade extérieure près du fort d'Ostemburg. Hughes reste quatre jours à observer les défenses françaises et s’éloigne le 28 mai, puis revient le 31 mai, entre dans la baie, observe, puis s’éloigne à nouveau. Il revient le lendemain 1er juin et se montre prêt à engager le combat. Mais Hughes, qui semble ne plus en finir d’hésiter malgré sa supériorité numérique, met une nouvelle fois en panne, peut-être impressionné par la ligne française bien embossée, et s’éloigne encore une fois... Suffren profite de cette valse hésitation pour faire appareiller une petite division sous les ordres de Peynier pour apporter à Bussy les munitions de guerre et de bouche qu’il demande (28 mai). Mais Peynier ne parvient pas à faire passer le ravitaillement à cause de l’escadre anglaise, et les nouvelles qu’il rapporte le 7 juin de Gondelour sont très inquiétantes.
La force française stationnée à Gondelour n’avait pas bougé depuis la prise de la localité, en avril 1782. A la mort de son premier commandant, le commissaire général de Launay avait noté avec une solide ironie : « M. Duchemin est mort, l’État n’y a rien perdu. M. d’Hoffelize lui a succédé, l’État n’y a rien gagné. »[438] L’arrivée du troisième chef, avec le vieux Bussy impotent dans son palanquin n'améliore pas la situation. La troupe restait toujours immobile sous ses tentes. On comptait pas loin de 900 malades alors que Bussy qui semblait vivre dans ses souvenirs, essayait de se reconstituer une cour à l’orientale, élément indispensable à l’autorité et au prestige d’un chef en Inde... Tout n’avait pourtant pas si mal commencé, puisque Tipû Sâhib lorsqu’il était parti mater une de ses provinces révoltée sur la côte occidentale de l’Inde (en mars 1783, voir plus haut) avait laissé un important détachement de 20 000 hommes à Gondelour alors que le régiment de l’île-de-France, soit à peu près 600 hommes était parti accompagner le nabab dans son expédition. C’était un signe fort que l’alliance franco-indienne continuait à fonctionner. L’expédition avait été un succès, puisque le nabab avait défait et en partie capturé une forte armée anglaise. La nouvelle, connue le 11 mai à Trinquemalay était de très bonne augure, d’autant que le régiment de l’île-de-France semblait avoir pris une belle part à cette victoire, ce qui ne pouvait que renforcer la confiance de Tipû Sâhib. Joie de courte durée car Bussy se montrait incapable de profiter de l’occasion et se retrouvait maintenant menacée par une forte armée anglaise de 15-16 000 hommes qui marchait sur lui depuis Madras sous les ordres du général Stuart[439].
Au vu de ces mauvaises nouvelles, Suffren réunit le 10 juin un conseil de guerre. Gondelour risque d’être assiégée de tous côtés, alors que les ordres de Bussy arrivés le même jour précisent que l’escadre ne doit sortir qu’en cas de siège avéré par terre et par mer. Autant attendre la capitulation de la place ! « Je ne pourrais presque point être instruit de ces deux points, ou au moins je ne pourrais l’être que lorsqu’il n’en serait plus temps, commente Suffren. Après avoir exposé à MM. les capitaines notre position et les ordres du général, ils furent ainsi que moi de l’avis de partir. Je mis à la voile le 11. »[440] Pour la première fois depuis le début de cette campagne, Suffren recueille l’adhésion de tous ses officiers, et c’est pour désobéir aux ordres ineptes du général en chef... Il va falloir attaquer l’escadre anglaise, « seul moyen de sauver l’armée de Gondelour pressée par terre et par mer, »[441] alors que par ailleurs circulent les premières rumeurs de paix, colportées par des navires neutres, danois et portugais[442].
Gondelour, une bataille longuement mûrie (20 juin 1783)
Ordre de bataille n°3 de Suffren. Le plan, très audacieux, prévoie de diluer le feu sur les 12 premiers vaisseaux anglais avec 8 vaisseaux français pour concentrer l'attaque avec les plus grosses unités sur les deux flans de l'arrière-garde anglaise afin de l'anéantir. (Croquis réalisé sur le Journal de bord du Fendant)
Le 11 juin au matin, le Héros fait le signal d’appareillage. L’escadre compte 15 vaisseaux, 3 frégates, 1 brûlot et 2 navires particuliers. Hughes en aligne 18, tous doublés de cuivre et qui ont bénéficié pendant l’hivernage des soins de la base de Bombay. Suffren doit aussi se soumettre aux nouvelles directives du ministre qui prescrivent que l’amiral doit quitter son vaisseau pour diriger le combat depuis une frégate. La bataille des Saintes, le 12 avril 1782 où le comte de Grasse a été fait prisonnier à bord du Ville de Paris est à l’origine de cette mesure qui éloigne le bailli de son lieu favori : le cœur du combat. Suffren devra donc arpenter la ligne de file de son escadre et se porter là où sa présence paraît le plus utile pour la conduite des opérations[443]. De son côté, Suffren a longuement réfléchi à la situation et a dressé des plans pendant la longue escale à Trinquemalay. Il arrête sa décision sur trois ordres de bataille qui sont diffusés dans l’escadre le 26 mai 1783[444] alors qu’on est encore au mouillage et que les mauvaises nouvelles de Gondelour ne vont arriver que le 7 juin. Démarche qui montre que malgré son état d’infériorité Suffren ne se contente pas d’une campagne corsaire et n’a toujours pas renoncé à l’idée de détruire au moins partiellement la flotte de Hughes. L’ordre de bataille n°1 est le plus classique : l’escadre est répartie en trois divisions de cinq vaisseaux, celle du centre la plus forte avec trois 74 canons, avant-garde et arrière-garde avec chacune un 74. L’ordre de bataille n°2 prévoit une forte avant-garde avec trois 74, un centre faible et une arrière-garde comptant deux 74 canons (il ne sera jamais mis en œuvre). L’ordre de bataille n°3 est le plus novateur, même s’il reprend la tactique déjà souvent utilisée dans les combats en ligne de file de l’enveloppement de l’arrière garde. Suffren calcule de tenir en respect d’assez loin les 12 premières unités de la ligne anglaise avec 7 vaisseaux de 64 canons et un de 56 canons et d’accabler à courte distance les six derniers navires entre les cinq 74 canons français et une division légère formée des trois unités les plus petites de l’escadre, avec 60, 50 et 36 canons puisqu’il prévoit aussi d’engager la frégate[445]. Ce plan est aussi extraordinairement risqué puisqu’il suppose que Hughes accepte une lointaine canonnade sur son avant-garde et son centre où va forcément se trouver ses plus fortes unités (dont le 84 canons qui vient d’arriver) alors qu’en face il n’y a que des 64 canons (et un 56 canons) bien moins nombreux et que son arrière garde en difficulté va forcément demander de l’aide... Hughes n’est pas un grand tacticien, mais va-t-il accepter de se laisser manœuvrer de la sorte et les capitaines français dans lesquels Suffren n’a qu’une confiance incertaine vont-ils être (enfin) à la hauteur ?
Suffren choisit la frégate la Cléopâtre pour y mettre son pavillon. Commence alors une étonnante course poursuite où les deux amiraux emploient toute leur science navale pour prendre ou conserver le vent et se placer dans les meilleures conditions pour le combat.
Le 13 juin, alors qu’on est dans les parages de Porto Novo la flotte anglaise est aperçue au mouillage un peu au nord de la place. La journée étant trop avancée pour engager le combat et Suffren désirant conserver l’avantage du vent, on décide de mouiller. Les deux flottes, éclairées par leurs frégates sont à 20-25 milles l’une de l’autre. La flotte anglaise, qui couvre aussi un important convoi de ravitaillement pour l’armée assiégeante, assure le blocus de Gondelour en mouillant entre la place et Porto Novo où se présente Suffren qui remonte la côte vers le nord. En cette période de l’année les vents dominants sont plutôt favorables à Hughes, mais ce dernier, très prudent, voire timoré[446] ne bouge pas et laisse les Français à la manœuvre.
Le 14 juin à 2h30 du matin, l’escadre française appareille sous petites voiles pour prendre le temps de se former. Suffren signale de prendre l’ordre de bataille n°3 et à 8h45 passe à bord de la Cléopâtre. Mais la brise du large que l’on espérait ne vient pas et l’escadre anglaise reste au mouillage. Suffren repasse sur le Héros à 20h30.
Le 15 juin, les deux escadres passent la plus grande partie de la journée à s’observer au mouillage. A 13h30 Suffren fait pourtant d’appareiller sur l’ordre de bataille n°3 puis se ravise et met en panne. A 22h30 on appareille de nouveau car l’escadre anglaise fait mouvement, mais Hughes ne fait que se rapprocher de ses transports mouillés juste au sud de Gondelour. Encore une fausse alerte. Les deux chefs sont visiblement devenus très prudents[447].
Le 16 juin à l’aube, Suffren fait lever l’ancre en prenant l’ordre de bataille n°3 et se rapproche de l’ennemi. Suffren passe à 11h30 sur la Cléopâtre alors qu’à 13h30 Hughes appareille à son tour mais va former sa ligne au large. Suffren semble cette fois déterminé à engager la bataille et multiplie les manœuvres d’approche, mais on est en fin de journée. Suffren, qui ne veut pas d’un combat de nuit stoppe le mouvement et se porte vers Gondelour. Suffren repasse sur le Héros à 19h00. C’est en fin de compte une belle journée pour les Français, puisqu’en poussant Hughes vers le large, le blocus naval de Gondelour est levé sans avoir tiré un coup de canon.
Le 17 juin au matin, l’escadre anglaise est au large sous le vent. On entre en communication avec Gondelour : un canot venu de la place porte un courrier de Bussy. Un violent engagement s’est déroulé le 13 juin. Stuart avec ses 15-16 000 hommes a attaqué les 5 000 (ou 5 200) soldats retranchés de Bussy[448]. Pour se dégager, le régiment d’Austrasie a chargé à la baïonnette et a occasionné de lourdes pertes à l’adversaire qui a laissé 1 200 hommes tués ou blessés sur le terrain. Mais les Français qui ont aussi perdu entre 6 et 700 hommes ont dû se replier en laissant 20 pièces d’artillerie à Stuart, et aucun secours n’est à espérer de Tipû Sâhib, occupé au siège d’une autre place. Suffren ordonne de former la ligne de bataille, mais le vent n’est pas favorable. Le bailli en profite vers 12h30 pour dépêcher le Conventry (28 canons) en appui-feu de la place et pilonner le camp anglais que l’on aperçoit au sud. Suffren informe Bussy qu’il va venir mouiller devant Gondelour et sollicite son aide pour compléter ses équipages avec des troupes de l’armée de terre. Bussy, qui comprend que la défaite de la flotte signifierait la chute de Gondelour accepte immédiatement.
Le 18 juin, à 3h00 du matin des chelingues rallient l’escadre avec 600 européens et 600 cipayes. L’opération prive la place de plus d’un cinquième de ses effectifs et requiert le plus grand secret. De son côté Suffren y gagne un renfort de 100 hommes par navire ce qui est considérable et représente à peu près 12% des effectifs réglementaires[449]. Au matin, l’escadre anglaise qui se rapproche de la place est en vue. Suffren ordonne d’appareiller vers 9h00 et fait prendre l’ordre de bataille n°3 et passe sur la Cléopâtre à 11h00 pour suivre l’évolution de sa ligne de vaisseaux, mais les Anglais refusent d’engager le combat. La journée se passe en manœuvres complexes dans un vent changeant alors que Suffren qui a refait prendre l’ordre de bataille n°1 tente de se rapprocher de l’escadre anglaise, mais Hughes avec ses navires plus rapides réussit une fois de plus à « fuir en ordre. »[450]
Le 19 juin, les manœuvres complexes reprennent. Suffren est encore une fois déterminé à engager le combat, mais semble un peu hésiter sur le plan à suivre. Après avoir fait prendre l’ordre de bataille n°3 il revient comme la veille au n°1, mais cette manœuvre provoque un abordage entre l’Ajax et l’Illustre ce qui cause quelques dommages à ce dernier. Quoi qu’il en soit, l’escadre anglaise refuse une nouvelle fois la bataille. Moissac note que « nous étions depuis longtemps à portée d’espérer de combattre l’escadre ennemie si toutefois elle l’eût voulu. »[451] Dans l’après-midi, les vents qui deviennent très variables et faibles gênent encore une fois les manœuvres d’approche des Français. Les vents se stabilisent le soir mais il est une fois de plus encore trop tard pour combattre avant la nuit.
 La Bataille de Gondelour, le 20 juin 1783, est finalement conduite sur la classique tactique de la ligne de file et se termine par la fuite de l'escadre anglaise (Tableau d'Auguste Jugelet, 1836).
La Bataille de Gondelour, le 20 juin 1783, est finalement conduite sur la classique tactique de la ligne de file et se termine par la fuite de l'escadre anglaise (Tableau d'Auguste Jugelet, 1836).
 « Action glorieuse de l'amiral français Suffren contre l'amiral anglais Hughes dans les mers de Ceylan » (mai 1783). Cette gravure hollandaise est imaginaire puisqu'elle reprend des modèles de navires du milieu du XVIIe siècle, et aucun vaisseau n'a explosé pendant les combats. Elle témoigne cependant de la gratitude des Néerlandais pour l'action de Suffren.
« Action glorieuse de l'amiral français Suffren contre l'amiral anglais Hughes dans les mers de Ceylan » (mai 1783). Cette gravure hollandaise est imaginaire puisqu'elle reprend des modèles de navires du milieu du XVIIe siècle, et aucun vaisseau n'a explosé pendant les combats. Elle témoigne cependant de la gratitude des Néerlandais pour l'action de Suffren.
Ces six jours de manœuvres et de contre manœuvres permettent de voir que Suffren a désormais bien en main son escadre. Les ordres circulent parfaitement et on ne note aucun problème de commandement. Par ailleurs, ces multiples manœuvres forment un excellent exercice d’entrainement qui ne peut qu’être profitable aux équipages très composites, pour ne pas dire cosmopolites de l’escadre, même si l’incident entre l’Ajax et l’Illustre montre que l’on peut encore progresser. Suffren semble plus réfléchi que lors de ses précédents engagements, presque hésitant aussi sur le choix de son ordre de bataille, mais cela ne l’empêche pas de prendre peu à peu un ascendant moral[452] sur un adversaire pourtant supérieur en nombre et qui semble se défiler à chaque occasion, au point de lever le blocus de Gondelour sans combattre. Les historiens anglais ont été longtemps très irrités de voir 18 vaisseaux supérieurement armés de la Royal Navy surclassés par une escadre française qui n’en compte que 15[452]. Ils font aussi remarquer que la très grande prudence de Hughes s’explique aussi par la nécessité de protéger son convoi, la pénurie d’eau et l’état de ses équipages, ce dernier point constituant le véritable talon d’Achille de l’escadre anglaise. Hughes avait quitté Bombay et était arrivé à Madras après plusieurs semaines de navigation éprouvante. Stationnant du 13 avril au 2 mai à Madras, l’escadre anglaise avait eu beaucoup de mal à y faire de l’eau compte tenu d’un manque d’embarcations locales et d’une forte houle. C’est avec un ravitaillement très partiel que Hughes avait repris la mer alors que le scorbut qui s’était déclaré dans l’escadre avait rendu indisponible 1 142 hommes et qu’il avait fallu en débarquer 556 à Madras[452]. Alors que Suffren dispose d’équipages frais qui n’ont que dix jours de navigation depuis Trinquemalay, les équipages de Hughes sont déjà plus ou moins épuisés. En n’engageant pas au plus vite le combat, Hughes a laissé sa flotte s’épuiser un peu plus dans le manque d’eau et le scorbut et a peu à peu abandonné à Suffren l’espace devant Gondelour au point de se voir imposer la bataille dans des conditions nettement moins bonnes que s’il l’avait accepté dès le 13-14 juin.
Le 20 juin à l’aube, l’ennemi est aperçu dans le sud-sud-est et le vent lui est légèrement favorable. Suffren passe la matinée à faire prendre à son escadre la formation de combat. Après de longues réflexions le bailli a décidé de prendre l’ordre de bataille n°1 au détriment de l’ordre n°3 sans doute beaucoup trop risqué. C’est donc sur la formation habituelle en ligne de file sur trois divisions que va s’engager le combat. Suffren essaye cependant de combler une partie de son infériorité numérique en alignant l'une de ses plus fortes frégates, la Consolante (36) sur la dernière position de sa ligne[453]. Le vent, très faible rend difficile les manœuvres. Certains vaisseaux ont du mal à virer et doivent se faire touer par leurs chaloupes. Ce n’est qu’à 13h00 que la ligne est à peu près formée et que Suffren peut embarquer sur la Cléopâtre (36). Un vent d’ouest régulier s’est maintenant levé, ce qui place Hughes sous le vent de Suffren, mais l’Anglais cherche à s’esquiver en attendant, comme les jours précédents que le vent tourne à son profit. Le vent se maintient cependant à l’ouest et Hughes ne peut maintenant plus reculer. Il finit par se résoudre à combattre sous le vent, « fatigué apparemment d’une attente vaine »[454] et peut-être aussi par peur de perdre la face[455]. L’escadre française se rapproche peu à peu sur une ligne impeccable et en exécutant au bon moment l’ordre de venir dans le vent pour se placer sur une ligne parallèle à celle de son adversaire. Il est vrai que Suffren, depuis la Cléopâtre parcourt la ligne en donnant ses ordres depuis un porte-voix avec sa verve habituelle : « vaincre ou mourir, messieurs, vaincre ou mourir » pour encourager ses capitaines, mais aussi « arrivez, monsieur (...) ; si vous craignez les boulets anglais, je vous en enverrai des français, » pour houspiller un autre qui semble hésiter à s’approcher de la ligne ennemie[456]. L’ordre du ministère de placer l’amiral sur une petite unité hors de la ligne de bataille donne au bailli des allures de mouche du coche...
Le combat commence vers 16h20 lorsque les 16 français et les 18 anglais sont à une demi portée de canon[457]. Ce classique affrontement en ligne de file est loin des péripéties que l’on a pu voir dans les précédentes batailles, ce qui n’empêche pas le feu d’être très violent. Sur l’avant-garde, le Flamand (56) est sévèrement malmené et son commandant est tué. Le feu prend sur la hune d’artimon du Fendant (74) où explose la réserve de grenades du navire. Le vaisseau français sort un moment de la ligne alors que le Flamand tente de s’interposer. Le HMS Gibraltar (84) dont le capitaine avait parié qu’il ramènerait de son premier combat un navire français sort à son tour de la ligne anglaise, mais le Flamand réduit sa voilure, se laisse rattraper alors que l’Anglais est en train de recharger son artillerie et lui lâche une bordée meurtrière sur le flan. Le capitaine doit regagner précipitamment sa ligne sous les ricanements des autres marins anglais[458]. Le capitaine de l’Ajax (64) qui se trouve derrière le Flamand est tué à son tour, alors qu’un certain désordre s’installe sur l’arrière-garde puisque le Vengeur (64) et l’Annibal (74), pourtant en théorie séparés par le Sévère (64) s’abordent pendant le combat, mais le désordre règne aussi sur l’arrière-garde anglaise. La bataille tourne malgré tout à l’avantage des Français puisque les vaisseaux anglais prennent de plus en plus une attitude défensive et tendent à s’éloigner insensiblement[458]. A 18h30 Suffren ordonne de cesser le combat puis repasse peu après sur le Héros. La bataille a duré moins de deux heures et on ne poursuivra pas de nuit[459]. Le bilan des pertes s’établit à 102 morts et 376 blessés pour les Français, surtout concentrés sur l’avant-garde et le centre, ce qui montre que le combat y a été plus intense. Les deux commandants tués faisaient d’ailleurs partie de l’avant-garde, alors que deux vaisseaux de l’arrière-garde n’ont aucun mort et seulement quelques blessés. Les pertes anglaises sont du même ordre, (99 morts 434 blessés), constat d’équilibre que les historiens dressent habituellement pour les combats en ligne de file.
Le 21 juin, en milieu de matinée Suffren mouille à la hauteur de Pondichery alors que Hughes reste au large. Les deux escadres sont un peu « groggy » et récupèrent chacune de leur côté, Suffren envoyant tout de même un de ses officiers vers Gondelour pour « instruire M. de Bussy de notre combat. »[460]
Le 22 juin, les deux escadres sont de nouveau à la vue l’une de l’autre. Va-t-on reprendre le combat ? Suffren ordonne l’appareillage et forme de nouveau sa ligne de bataille. Côté anglais l’escadre se présente en ordre dispersée car plusieurs unités ont des avaries sérieuses, comme le vaisseau amiral qui est partiellement démâté, mais il semble aussi que l’on ait vu qu’au dernier moment les navires français dont les couleurs se mêlent à la côte[461]. Lorsque la ligne française est découverte en pleine approche, un seul mot d’ordre semble animer l’escadre anglaise : la fuite, toutes voiles déployées en serrant le vent au plus près. C’est la victoire : Hughes jette l’éponge en s’enfuyant aussi vite qu’il le peut vers Madras et en abandonnant tout soutien à l’armée de Stuart. Suffren renonce à le poursuivre car couvrir Gondelour assiégée reste prioritaire[462]. Cette bataille est commentée en 1927 par l’amiral anglais Ballard en des termes qui montrent sa vive admiration pour Suffren :
« Après avoir embarqué de la nourriture et des munitions pour les troupes assiégées, il fit aussitôt force de voiles vers le nord et par la hardiesse de son approche, avec seulement 15 vaisseaux contre 18, il perturba Hughes à un tel point que ce dernier abandonna le blocus et laissa Gondelour ouvert à son assistance. Après avoir débarqué les secours pour la garnison, Suffren suivit la flotte britannique et le 20 juin 1783, dans une cinquième et dernière bataille, attaqua si violemment et en si bon ordre qu’il fit carrément tomber son adversaire (knocked off the stage). A la tombée de la nuit, Hughes se retira en homme battu. Fort d’avoir contraint à la retraite une flotte ennemie supérieure à la sienne dans tous les domaines sauf celui du commandement, le grand français, triomphant, avait accompli l’exploit le plus remarquable de sa carrière. »[463]
Ce texte en partie inexact et un brin excessif a été largement revu depuis par les commentateurs britanniques mais témoigne malgré tout de la réelle admiration doit jouit le bailli dans le monde anglo-saxon. Admiration dont nous avons vu les premiers signes pendant la campagne, et sur laquelle nous reviendrons encore.
Le 23 juin, c’est une escadre victorieuse qui se présente devant Gondelour. Suffren est salué de 15 coups de canons lorsqu’il met le pied à terre, tous les officiers de l’armée le regardant comme le sauveur de Gondelour et le saluant des cris de « Vive le roi, vive Suffren ! »[464] On débarque les 1 200 hommes qui étaient venus renforcer l’escadre avant la bataille, alors que Bussy, peut-être jaloux de la gloire de son subordonné tente le 25 août une sortie de nuit contre le camp anglais. L’opération, mal organisée et mal conduite contre un ennemi pourtant démoralisé est un sanglant échec. Ce seront les derniers morts de ce conflit : le 29 juin la frégate anglaise la Medea vient sous pavillon parlementaire apporter la nouvelle officielle de la paix.
Article détaillé : Bataille de Gondelour (1783).La paix, enfin...
 "Vaisseau en rade donnant une fête". Tous les belligérants accueillent avec joie la nouvelle de la paix. Pour Suffren c'est le début d'une longue série de festivités en son honneur. (Dessin de N. Ozanne)
"Vaisseau en rade donnant une fête". Tous les belligérants accueillent avec joie la nouvelle de la paix. Pour Suffren c'est le début d'une longue série de festivités en son honneur. (Dessin de N. Ozanne)
La Medea est porteuse de courriers de l’amiral Hughes et de lord Macartney, gouverneur de Madras pour Suffren et pour Bussy. Les deux hommes demandent la cessation des hostilités. La lettre de Hughes mérite d’être reproduite en totalité :
« Monsieur, ayant reçu à mon arrivée dans cette rade [de Madras] avec l’escadre de Sa Majesté britannique sous son commandement plusieurs papiers très authentiques et autres indices par lesquels il me parait clair et certain que les préliminaires de paix entre la Grande-Bretagne et l’Espagne et aussi entre la Grande-Bretagne et l’Amérique ont été signés à Versailles par les ministres plénipotentiaires de ces différentes puissances le 20 janvier dernier et ratifiés par la France le 9 février suivant, j’ai pris la liberté d’envoyer à Votre Excellence copie de ces papiers par lesquels il me paraît que toute hostilité entre les sujets de la Grande-Bretagne et de la France doit cesser dans l’Inde le 9 du mois de juillet prochain. Je crois que Votre Excellence connaît assez bien mon caractère comme officier et comme homme pour attribuer la communication des résolutions de nos Cours respectives aux principes d’humanité qui ont toujours été dans mon cœur. Je prie seulement Votre Excellence, après un examen des papiers ci-joints, de m’informer amicalement et ouvertement aussitôt qu’il sera possible, s’il veut ou non continuer par mer une guerre malheureuse et destructive. Je compte sur l’honneur de Votre Excellence pour avoir une réponse sincère et prompte. Monsieur Garberet, capitaine de la frégate la Medea présentement en parlementaire, aura l’honneur de vous les faire passer. Comme étant du devoir des officiers de nos cours respectives de n’être pas plus longtemps ennemis entre nous, j’espère avoir l’honneur de rencontrer bientôt Votre Excellence comme ami... »[465]
Une lettre bien dans le ton des officiers aristocratiques du XVIIIe siècle, qui après s’être offerts au feu de l’ennemi pour leurs rois respectifs, sont capables l’instant suivant de faire preuve de la plus exquise politesse entre gens de haute éducation. Le courrier de Hughes laisse aussi transparaître une réelle estime, voire une certaine admiration, même s’il ne faut pas en exagérer la portée. Il semble bien en effet que la nouvelle officielle de la paix (et non sous forme de rumeurs) soit parvenue à Madras bien avant la bataille de Gondelour, mais qu’on l’ait tenue secrète -ultime fourberie- dans l’attente d’une victoire anglaise qui semblait inéluctable[466]. La défaite de Hughes l’a poussé à écrire une lettre au ton et au contenu sans doute un peu différent de ce qui était espéré. Notons au passage que l’Anglais ne fait aucune référence à la bataille, comme s’il était de bon ton de l’oublier...
Quoiqu’il en soit, la nouvelle officielle de la paix est accueillie avec allégresse par tous les belligérants épuisés par ce long conflit. Suffren ne cache pas non plus sa joie dans ses courriers. Avec le recul, les Historiens estiment même que vu l’état de l’escadre (plusieurs vaisseaux, trop abimés ne pourront pas rentrer en Europe), la paix a sans doute sauvé le bailli[467]. Les conditions du traité de paix vont peu à peu être connues au rythme de l’arrivée des dépêches. Pour les Indes on retrouve à peu près la situation d’avant la guerre. Les trois puissances européennes impliquées, France, Grande-Bretagne et Hollande se restituent grosso-modo leurs possessions respectives avant la guerre. La France recouvre ses cinq comptoirs sur les côtes indiennes (Pondichéry, Karikal, Chandernagor, Yanaon, Mahé)[468] avec un agrandissement pour Pondichéry, alors que la Grande Bretagne conserve ses acquis de 1763 et réalise même un petit gain puisqu’elle garde le comptoir hollandais de Negapatam.
Pris au pied de la lettre, le traité est décevant pour la France compte tenu de l’effort consenti, mais pouvait-il en être autrement ? Les positions anglaises en Inde ont tremblé pendant 17 mois mais ne se sont pas écroulées. Les batailles livrées par Suffren sont toutes glorieuses compte-tenu du bricolage logistique dans lesquelles elles ont été conduites, mais l’escadre de Hughes a échappé à la destruction, et surtout l’action à terre a été cruellement insuffisante. Il aurait fallu débarquer en Inde au moins 6 000 hommes pour peser au côté du nabab et entrainer un vaste mouvement anti-anglais. Les interceptions des convois français et les épidémies en ont décidé autrement, mais il aurait surtout fallu que ces troupes, même si elles avaient été plus nombreuses, aient été beaucoup mieux commandées. Les trois généraux qui se sont succédé (Duchemin, Hoffelize, Bussy) s’en sont montrés incapables, malgré les multiples sollicitations des Indiens et l’aide d’Haidar Ali. Gondelour reste la seule conquête à terre des Français, réalisée au lendemain du débarquement avant que le contingent français n’y végète jusqu’à la fin des hostilités. De cet échec Suffren n’est en rien responsable alors que le bailli, faisant des pieds et des mains avec un petit contingent a réussit brillamment sur Ceylan la reconquête de Trinquemalay, montrant au passage ses talents d’homme de guerre à terre. On peut effectivement se lamenter, comme le fait le commissaire général de Launay que l’armée n’ait pas eu à sa tête « au moins un demi-Suffren. »[438] Rappelons encore une fois, au risque de se répéter qu’il n’a jamais été question pour Louis XVI et Vergennes de se lancer dans la reconquête des Indes. Sans l’action de Suffren il est probable que la France ait définitivement perdu ses comptoirs indiens, sans parler de la saisie de tout l’Empire néerlandais dans la région. Seul de Castrie, on l’a vu, partageait les mêmes idées que Suffren sur les possibilités de chasser les Anglais de l’Inde et il est d’ailleurs intéressant de noter que le ministre de la marine, peu satisfait des gains de la France souhaitait continuer la guerre[469]malgré des pertes de plus en plus élevées[470]. Le traité de paix définitif est signé à Versailles le 3 septembre 1783[471] alors que la victoire de Gondelour n’est pas encore connue et qu’elle aurait peut-être permis d’arrondir les possessions françaises en Inde. Quoi qu’il en soit, on entre dans l’organisation de l’après-guerre, tâche qui va occuper Suffren jusqu’au mois d’octobre.
Suffren envoie Moissac, son principal officier, en parlementaire à Madras afin de s’accorder avec l’amiral anglais sur les modalités de la suspension des combats. Les 500 prisonniers français détenus dans la ville sont immédiatement libérés, mais il semble que Bussy ait subitement pris conscience d’avoir raté sa deuxième campagne des Indes au point de multiplier subitement les difficultés. Il laisse trainer les combats trois jours de plus après la nouvelle de la paix et les tirs ne cessent que le 2 juillet au soir. Le lendemain on échange les prisonniers, mais l’escadre française reste encore tout le mois de juillet à Gondelour. Le vieux chef, jaloux de son autorité a beaucoup de mal à se séparer de celle-ci malgré les sollicitations de Suffren qui fait remarquer que pour préparer le retour en Europe le seul port possible est celui de Trinquemalay.
Le 1er août l’escadre quitte enfin Gondelour et fait escale le 2 à Tranquebar où Suffren est reçu avec beaucoup de chaleur par le gouverneur danois qui fait tirer plusieurs salves de canons. Le 4 on fait relâche à Karikal, comptoir français encore aux mains des britanniques. Le gouverneur anglais donne immédiatement une fête en l’honneur de Suffren et de ses officiers. Ces fêtes ne sont que les premières d’une longue série qui vont durer jusqu’à l’arrivée de Suffren à Versailles et après. Le 8 août l’escadre arrive à Trinquemalay et va y rester pour l’essentiel jusqu’à son appareillage pour l’Europe. Le sort de ce port se révèle par ailleurs difficile à régler. Les Britanniques veulent se faire remettre la base par les Français avant de la rétrocéder aux Hollandais. Une grosse prétention que l’on parvient après de longues tractations à réduire à une journée pour y opérer prestement les deux rétrocessions[472].
Le 15 septembre, Suffren appareille de Trinquemalay pour Pondichéry où Bussy a installé son état-major. C’est au cours de cette escale qui dure jusqu’au 26 septembre que Suffren reçoit enfin les ordres de Versailles relatifs à la mise en place de la paix. Il apprend sa promotion au grade de lieutenant général, accompagnée des félicitations chaleureuses du ministre et avec la possibilité de rentrer le plus rapidement qu’il lui convient, y compris en prenant une frégate. Les instructions lui prescrivent de laisser aux Indes autant de vaisseaux que les Britanniques en laisseront[473]. De concert avec Bussy on décide de laisser 5 vaisseaux et 3 frégates sous les ordres du chef d’escadre de Peynier. Libéré de la pesante tutelle de Bussy qui va rester en Inde[474], le commandeur est de retour le 29 septembre à Trinquemalay pour finaliser les préparatifs de retour et échanger les derniers courriers avec le gouverneur de Ceylan[475]. Suffren a décidé de rentrer sur le Héros en prenant sur lui de ramener le vaisseau amiral à Toulon et non pas à Brest, son port d’armement. La gloire autorise quelques libertés, la première étant de retrouver sa Provence natale et sa famille... Les équipages ne sont pas oubliés non plus puisqu’on fait passer sur les vaisseaux destinés à Brest tout le personnel originaire de la Bretagne et on embarque les Provençaux sur le Héros. Le 6 octobre le Héros appareille pour l’Europe et commence un voyage retour qui prend des allures de marche triomphale.
De Trinquemalay à Versailles : un retour triomphal (octobre 1783-avril 1784)
 Après l'accueil enthousiaste de l'île-de-France Suffren croise au Cap une escadre anglaise qui rentre elle aussi des Indes. Les officiers anglais s'empressent de venir le saluer, tant sa renommée est devenue immense. (English ships in Table Bay, tableau de Robert Dodd, 1787)
Après l'accueil enthousiaste de l'île-de-France Suffren croise au Cap une escadre anglaise qui rentre elle aussi des Indes. Les officiers anglais s'empressent de venir le saluer, tant sa renommée est devenue immense. (English ships in Table Bay, tableau de Robert Dodd, 1787)
 Suffren arrive très rapidement à Versailles et surprend à table la famille royale, ce qui n'empêche pas Louis XVI de le féliciter. Quant à Marie-Antoinette, elle en profite pour lui présenter ses enfants. (Marie-Antoinette en 1787, par Élisabeth Vigée-Le Brun)
Suffren arrive très rapidement à Versailles et surprend à table la famille royale, ce qui n'empêche pas Louis XVI de le féliciter. Quant à Marie-Antoinette, elle en profite pour lui présenter ses enfants. (Marie-Antoinette en 1787, par Élisabeth Vigée-Le Brun)
Dans sa lettre du 24 avril 1783, de Castrie a prévenu Suffren de l’immense popularité dont il est déjà auréolé :
« Si vous étiez en Europe, vous jouiriez complètement de la réputation que vous avez acquise dans l’Inde. Sa Majesté vous y marquerait sa satisfaction Elle-même. En effet, c’est une belle récompense, pour celui qui à l’âme élevée que de voir toute l’Europe lui rendre hommage. La fermeté que vous avez marquée en renvoyant les capitaines dont vous étiez mécontent ajoute à votre gloire car les généraux qui par crainte de déplaire aux particuliers sacrifient l’intérêt public sont de mauvais serviteurs du roi (...). Vous serez maître des honneurs et des punitions (...). En attendant vous suppléez à tout parce que vous êtes bon à tout. »[476]
On est dans l’éloge la plus affirmée, alors même que la nouvelle de la victoire de Gondelour n’est pas encore connue en Europe ! La suite du voyage va montrer que de Castrie n’a pas exagéré ses commentaires. C’est presque une haie d’honneur qui accompagne Suffren de Trinquemalay à Versailles.
Parti le 6 octobre en compagnie du Vengeur qui fait beaucoup d’eau et qu’il faut escorter, le Héros arrive à l'île-de-France le 12 novembre. L’accueil de Port-Louis est enthousiaste. Le gouverneur, M. de Souillac vient saluer Suffren à bord de son vaisseau puis on multiplie les réjouissances en l’honneur du bailli qui est salué par 21 coups de canons lorsqu’il met pied à terre. Une foule immense se rassemble aux cris de « Vive le Roi ! , Vive Suffren ! » Après le dîner chez le gouverneur « toutes les dames de la ville de la ville viennent rendre visite à l’amiral et lui donnent une sérénade. »[477] Les riches colons se disputent la faveur de recevoir Suffren et le 18 novembre le gouverneur fait donner une grande fête avec feu d’artifice. « Je suis accablé de vers, de compliments, de chansons » note le bailli[478]. On est loin de l’époque, vieille seulement de deux ans, où Suffren, simple capitaine de vaisseau subordonné au vieux M. d’Orves était en butte à la cabale de Tromelin et de ses amis...
Le 29 novembre, accompagné cette fois de la Cléopâtre, le Héros lève l’encre pour le Cap qui est atteint le 22 décembre. L'accueil est meilleur qu'à l'aller : « Les bons Hollandais m'ont reçu ici comme leur libérateur » note ingénument le bailli[479]. Le hasard veut qu’au même moment une escadre anglaise de 9 vaisseaux fasse escale dans la colonie néerlandaise. La plupart de ces navires ont combattu Suffren pendant la campagne des Indes, mais la renommée du bailli est telle que tous les officiers anglais se rendent en corps à bord du Héros « pour saluer en personne un maître de leur profession. »[480] Cette scène est probablement unique dans l’histoire de la marine française... et anglaise.
Le Héros et la Cléopâtre appareillent du Cap le 3 janvier 1784, franchissent le détroit de Gibraltar le 19 mars et se présentent devant Toulon le 26 mars. Le Courrier d’Avignon rend compte de l’accueil : « Le peuple s’est porté en foule pour le recevoir ; et les cris de "Vive le roi, vive le bailli de Suffren !" y ont renouvelé la scène attendrissante du cap de Bonne-Espérance. (...) Le maire et les consuls, en habit de cérémonie, ont été au-devant de lui, et le maire lui a donné la main pour descendre à terre. »[481] Une fête est organisée à l’hôtel de l’Intendance au cours de laquelle on sert au désert un petit vaisseau en sucrerie fait sur le modèle du Héros...
Le 27 mars, Suffren quitte Toulon après avoir laissé à son principal officier, le fidèle Moissac, le soin de veiller au désarmement du Héros[482]. L’escale toulonnaise n’a duré qu’un jour : Suffren est visiblement très pressé de remonter sur Versailles. Il arrive à Aix le 28 mars pour saluer son frère, son cousin germain, le marquis de Castellane-Esparron et son neveu, M. de Vitrolles, le fils de sa sœur ainée, conseiller au parlement d’Aix. Reconnu dans la rue il est suivi par une foule grandissante qui tire 50 boîtes de feux d’artifice. Chez les Vitrolles il reçoit de nombreux hommages de la part des magistrats au Parlement, de la chambre des comptes, du clergé, des officiers de la garnison, des administrateurs de la province[483]... L’escale aixoise est fort brève aussi, puisqu’il reprend la route le jour même (!) pour Versailles en passant par Saint-Cannat puis Salon où il rencontre brièvement sa sœur Thérèse, religieuse ursuline, et prend un bain de foule au milieu de ses concitoyens en liesse.
Le 2 avril, Suffren arrive à Versailles. Sept jours à peine se sont écoulés depuis Toulon. Suffren, visiblement très pressé de goûter aux honneurs de la Cour a roulé de nuit pour brûler les étapes, au point de surprendre le roi à table, au dire du Courrier d’Avignon :
« M. le bailli de Suffren (...) eut l’honneur d’être présenté au Roi, à la Reine et à la famille royale par M. le Maréchal de Castrie. (...) Des personnes qui étaient à Versailles au moment de l’arrivée de M. de Suffren écrivent que ce général a été annoncé au Roi au moment où il dînait avec la Reine, Monsieur et Madame, que Sa Majesté a bien voulu se déranger pour accueillir le vainqueur et le présenter à la Reine en disant : "Voilà le meilleur de mes serviteurs." On ajoute que Madame Jules de Polignac ayant amené Mgr le Dauphin et Madame Royale, la Reine leur a dit : "Voilà M. de Suffren, que vous ne devez jamais oublier, car il a rendu les plus grands services au roi." Les habitants de Versailles étaient accourus en foule au Château et témoignaient leur satisfaction par des battements de mains redoublés. On admirait le héros sensible à la reconnaissance du roi et du peuple, ayant la contenance la plus modeste et s’efforçant de retenir les larmes de joie et de tendresse qui s’échappaient malgré lui. »[484]
Un autre récit de la réception royale nous montre une Marie-Antoinette particulièrement empressée : « M. le bailli, lui dit-elle, vous avez fait de la bonne besogne et moi aussi, je veux vous montrer la mienne : Qu’on fasse venir mes enfants. »[485]
Le Courrier d’Avignon, avec une pointe d’ironie, nous conte aussi les retrouvailles de Suffren avec d’Estaing, lequel fait beaucoup d’effort pour se montrer au côté de son ancien subordonné :
« M. le comte de d’Estaing n’a pas cessé de l’accompagner et paraissait partager sa gloire. (...) On a admiré surtout, poursuit le journal, la noble modestie avec laquelle M. d’Estaing s’est prêté à procurer à M. de Suffren toutes sortes de distinctions. Ils dînaient l’un et l’autre chez M. le maréchal de Castrie. Un des officiers de marine qui y dînait aussi, adressant la parole à M. d’Estaing, l’appelait mon Général : celui-ci le prit sur le mot et, lui désignant M. de Suffren, lui dit : "Voilà le seul Général qu’il y ait ici". »[486]
D’Estaing ne pouvait pourtant pas ignorer les sévères critiques dont Suffren l’avait étrillé dans sa correspondance et ses conversations. Mais D’Estaing restait ce qu’il avait toujours été : un courtisan infatigable capable de placer partout les bons mots à l’adresse des bonnes personnes, quelles que soient les banderilles reçues... Il restait aussi le général qui avait joué un rôle clé dans la promotion de Suffren par ses rapports constamment élogieux et le bailli ne pouvait pas l’oublier (tout comme les Historiens).
Le temps des honneurs et des récompenses
 Pour Louis XVI et de Castrie l'action de Suffren a été essentielle pour restaurer le prestige de la marine royale, ce qui justifie de grand honneurs. (Tableau de 1786)
Pour Louis XVI et de Castrie l'action de Suffren a été essentielle pour restaurer le prestige de la marine royale, ce qui justifie de grand honneurs. (Tableau de 1786)
 Médaille en argent émise en 1784 par les Etats de Provence en l'honneur de Suffren et portant au revers un résumé de sa campagne aux Indes. (Musée de Londres)
Médaille en argent émise en 1784 par les Etats de Provence en l'honneur de Suffren et portant au revers un résumé de sa campagne aux Indes. (Musée de Londres)
 Suffren reçoit en 1784 une épée d'or offerte par les Provinces-Unies pour le remercier d'avoir protégé les colonies néerlandaises. (Gravure néerlandaise de Jacobus Buys vers 1784-85)
Suffren reçoit en 1784 une épée d'or offerte par les Provinces-Unies pour le remercier d'avoir protégé les colonies néerlandaises. (Gravure néerlandaise de Jacobus Buys vers 1784-85)
Le 2 avril, jour même de l’arrivée de Suffren à Versailles, de Castrie rédige un très long mémoire sur les diverses possibilités de récompenser les services de ce dernier. Ce texte s’ouvre sur un résumé de l’action de Suffren et de ses mérites pendant la campagne des Indes :
« L’affaire de la Praya est la première époque où il ait développé les talents et le courage d’un homme de guerre : c’est au parti vigoureux qu’il prit alors que l’on doit rapporter la conservation du Cap et de tous les établissements hollandais dans l’Inde ; sa perte eut entraîné celle de l’Asie entière qui eut été fermée pour toujours au reste de l’Europe. (...) C’est à la fermeté seule de cet officier général qu’on doit ses derniers succès. C’est aux exemples qu’il a eu le courage de faire qu’on doit rapporter l’énergie et l’obéissance qui ont décidé l’avantage de son dernier combat. C’est par une conduite également éclairée et vigoureuse qu’il a fait voir aux Princes de l’Inde ainsi qu’à l’Europe, que les Anglais n’étaient pas invincibles et que leur empire à la première guerre pouvait être renversé. Il a prouvé enfin qu’il ne manquait à notre nation que des chefs pour la conduire et la subordonner. C’est donc à lui qu’est principalement dû le ton de supériorité que la marine de France a repris dans l’opinion de toute l’Europe que les combats de la Hougue et de Malaga lui avaient fait perdre. (...) Votre Majesté sait que l’opinion de l’Europe, de l’Angleterre et de son royaume place cet officier général sur la même ligne que les plus grands hommes de mer. »[487]
Cette analyse dressée d’une plume alerte par le ministre de la marine appelle plusieurs commentaires. De Castrie est un bon stratège qui fait un constat sur lequel les Historiens sont aujourd’hui d’accords, à savoir que l’action de Suffren a gardé ouvert les portes de l’Asie au reste de l’Europe. Mais de Castrie ne se livre pas ici à une analyse globale du conflit (ce qu'on ne peut lui reprocher, ce n'est pas le but du mémoire), ce qui nous pousse encore une fois à rappeler que le cœur de la guerre s’est déroulé en Amérique du nord où la victoire française a été éclatante, et avec des conséquences géopolitiques -la naissance des États-Unis- bien supérieures à la préservation de la liberté d’accès à l’Inde. De Grasse, le vainqueur direct de la Chesapeake (5 septembre 1781) et indirect de Yorktown (19 octobre 1781), à qui George Washington aurait déclaré « vous avez été l'arbitre de la guerre » devrait logiquement être sur une popularité supérieure à celle de Suffren. Hors il n'en est rien. L’explication est à chercher du côté de la défaite des Saintes (12 avril 1782). Cette malheureuse bataille, sans grande conséquence sur le théâtre américain mais douloureuse pour l’orgueil national, s’est terminée par une calamiteuse polémique dans laquelle de Grasse, qui a mis en cause le comportement de ses subordonnés, a fini par s’abimer avant de connaître la disgrâce royale. Il est vrai que de Grasse n’a pas hésité à prendre à témoin l’opinion en violant le secret militaire depuis sa captivité en Angleterre[488]... Suffren qui a lui aussi été confronté à de graves problèmes de commandement mais qui rentre invaincu de cette guerre vole la vedette à son malheureux confrère au bilan pourtant supérieur au sien (et lui aussi, ironie de l’histoire, provençal et membre de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem...). Suffren est-il conscient de cette situation ? Il semblerait que oui, au dire de ce commentaire qu’il aurait tenu : « Je me sens plus considéré que je ne le mérite. »[489]
Terminons avec la notion de restauration de la puissance navale de la France et sur laquelle insiste longuement de Castrie. Elle est essentielle à ses yeux et nous confirme dans l’analyse faite au moment de la signature des traités de paix que cette guerre a été essentiellement faite pour recouvrer l’honneur national, loin devant toute idée de conquête. Le rappel par le ministre de lointaines défaites navales sous Louis XIV (La Hougue en 1692, Malaga en 1704[490]), lavées par les victoires de Suffren est tout à fait significatif de cette vision des choses. L'honneur est une notion dont l'épaisseur varie au fil de l'histoire et des mentalités, mais au XVIIIe siècle on ne transige guère sur ce point pour lequel on est prêt à payer le prix le plus élevé. La marine royale a retrouvé son honneur en grande partie grâce à Suffren et la gloire de ce dernier est incontestable. La guerre d'Amérique, avec son prolongement indien est « psychologiquement victorieuse et tourne les esprits vers la mer » notent Martine Acerra et Jean Meyer[491]. L'Angleterre n'apparait pas (ou plus) comme invincible, même si ses forces demeurent redoutables. Louis XVI va maintenir des crédits extraordinairement élevés pour la marine après le conflit et Suffren va avoir droit aux honneurs presque les plus hauts.
De Castrie ne voit que trois « grâces » susceptibles d’être accordées par le roi. La première est une nomination au grade de vice-amiral. Mais ce grade, qui pourtant n’existe que pour trois titulaires, a souvent été donné à l’ancienneté à des officiers très âgés et manque maintenant de lustre. Il faut donc une deuxième grâce qui ne peut être que l’entrée dans les ordres honorifiques du roi, à savoir l’ordre du Saint-Esprit et Saint Michel, faveur normalement réservée à quelques rares privilégiés de la haute noblesse. La troisième grâce pourrait être l’élévation à la dignité très enviée de maréchal de France. Mais de Castrie s’emploie à écarter cette récompense au prétexte que les maréchaux sont déjà très nombreux (en oubliant de dire que lui-même vient d’être nommé à ce titre), et qu’il faut garder cette promotion pour des services futurs[492]... Louis XVI va suivre son ministre. Suffren est nommé vice-amiral, une quatrième charge étant créée pour lui, et accède à la dignité de chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit. La cérémonie d’entrée dans l’ordre est célébrée le dimanche de Pentecôte (30 mai) en présence de Louis XVI, de tous les princes de sang, et conclue par une grande messe chantée par la musique du roi. Suffren accède aussi aux entrées de la Chambre royale[493]. Ces dignités permettent à Suffren de s’agréger à la plus haute noblesse et aux personnages les mieux en cour. Le pouvoir d’influence du bailli s’en trouve décuplé car il dispose maintenant d’un accès naturel et fréquent à toutes les personnalités qui comptent dans le royaume et qui gravitent autour du roi.
Les hommages ne sont cependant pas terminés car un peu partout de province et d’ailleurs se manifestent les propositions de toute sorte. La ville de Saint-Tropez veut faire sculpter un buste du célèbre marin mais Suffren parvient à convaincre la municipalité de renoncer à ce projet et de consacrer le budget au soulagement des familles des marins de Saint-Tropez disparus au cours de la dernière campagne[494]. A Salon en revanche la municipalité parvient a mener à bien un projet identique sans que Suffren ne s’y oppose. L’œuvre est inaugurée en grande pompe le 30 décembre 1784, précédée d’un Te Deum et suivie d’un feu de joie et d’illuminations. Elle est placée dans une des salles de l’hôtel de ville sur une colonne de marbre blanc porteuse d’une longue inscription en l’honneur du bailli[495]. A Aix, les États de Provence font graver une médaille portant le portrait du bailli à l’avers et la liste de ses exploits au revers :
« Le Cap protégé, Trincomalé pris, Gondelour libéré, L’Inde défendue, Six combats glorieux. »
L’objet est remis à Suffren à Paris au mois d’octobre 1784[496] .
Mais c’est de Hollande que viennent les cadeaux les plus fastueux. Pendant l’été 1784 les ambassadeurs des Provinces-Unies se présentent avec une épée d’or enrichie de diamants d’une valeur estimée à 50 000 écus... Le gouvernement néerlandais commande aussi au célèbre sculpteur Houdon un buste de Suffren. L’œuvre, saisissante de réalisme, est conservée au musée de La Haye et constitue encore aujourd’hui l’un des plus célèbres portrait de Suffren, de nombreuses fois copié[497]. La Compagnie hollandaise des Indes orientales se manifeste aussi en 1785 par un présent de haute valeur, une boite en or renfermant une médaille du même métal et rappelant les services rendus au commerce néerlandais pendant la dernière guerre. La même compagnie, qui connait visiblement les goûts de Suffren pour la table, s’engage aussi à fournir chaque année au bailli une livraison « du meilleur vin du Cap. »[498] Au mois de mai 1785, une escadre hollandaise de six vaisseaux fait escale à Toulon. Lorsque son commandant, le chevalier de Kinsbergen apprend que Suffren est présent dans le port, il demande immédiatement à le rencontrer. Suffren accepte bien volontiers de le recevoir, en portant au passage la riche épée offerte l’année précédente. Le 22 mai le bailli rend la visite à bord du navire amiral où il est salué de 17 coups de canons. La visite se termine le lendemain par un somptueux repas à bord du navire amiral en compagnie d’une partie de la famille de Suffren (deux de ses frères, plusieurs de ses neveux), d’officiers de la marine française et de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les Néerlandais auraient-ils fait preuve d’autant de sollicitude s’ils avaient su que Suffren, avec une bonne dose de duplicité avait demandé l’annexion de Trinquemalay à la France au nom des services rendus, le sauvetage du Cap notamment, et pour en faire « le boulevard de la libération de l’Inde » en vue sans doute d’une guerre future [499]? On ne sait. Notons, pour finir sur ce point, qu'aujourd'hui encore le souvenir de l’action du bailli pour les Bataves ne s’est pas perdu puisque le musée d’Amsterdam propose une animation permanente sur Suffren dans l’Océan indien.
Les dernières années (1784-1788)
Les derniers voyages
Suivre Suffren dans les dernières années de sa vie n’est pas chose facile. Le bailli reste ce qu’il a toujours été : un homme qui à la bougeotte et qui garde le secret sur son emploi du temps privé lorsqu’il sort des charges et des honneurs. On ne sait rien ou presque de sa vie entre sa réception à Versailles au printemps 1784 et le début de 1785. Une lettre de mars 1785 à Madame d’Alès[500] nous indique qu’il a le projet de redescendre en Provence pour la retrouver à Draguignan puis de passer à Toulon et se rendre à Malte où il peut espérer aussi des honneurs importants, d’autant qu’il connaît bien le Grand Maître de l’Ordre. Il arrive à Toulon sans doute le 10 mai où l’attend depuis 6 semaines son frère Pierre-Julien avec deux frégates maltaises. C’est lors de ce séjour toulonnais que Suffren reçoit la visite des officiers de l’escadre hollandaise citée un peu plus haut. Il reçoit aussi quatre députés du commerce de Marseille qui le supplient d’honorer leur ville de sa présence, mais Suffren qui doit partir pour Malte ne peut y répondre favorablement. Il promet sa visite le plus rapidement qu’il le pourra et embarque sur la frégate la Sainte-Catherine pour Malte où il arrive le 1er juin. Suffren se montre très assidu auprès du Grand Maître Rohan et aux séances du conseil de l’Ordre. Les courriers échangés entre Malte et l’ambassade à Paris vantent la prudence et la sagesse du bailli. Doublet, le secrétaire du Grand Maître note à l’adresse de Cibon, le secrétaire de l’ambassade :
 Intérieur du port de Marseille. La popularité de Suffren est considérable : Marseille lui réserve un accueil enthousiaste lors de son passage dans la cité en 1785. (Tableau de Joseph Vernet, 1754)
Intérieur du port de Marseille. La popularité de Suffren est considérable : Marseille lui réserve un accueil enthousiaste lors de son passage dans la cité en 1785. (Tableau de Joseph Vernet, 1754)
« M. le bailli de Suffren, après avoir préparé la fortune du chevalier de Saint-Tropez son frère (...) va partir demain pour Naples et de là traverser l’Italie pour retourner vous voir. Par rapport à l’agitation de nos petites affaires intérieures on s’attendait que ce vice-amiral aurait quelques commissions particulières de la Cour, mais nos oisifs médisants ont resté bec clos quand ils ont vu le bailli de Suffren en bon et sage religieux ne vouloir entrer en aucune intrigue et faire assidûment sa cour au Grand Maître qui l’a traité avec la plus cordiale intimité. »[501]
Suffren « bon et sage religieux » loin des intrigues politiques internes... On ne peut s’empêcher de sourire sur ce comportement qui est bien sûr de façade, mais qui nous rappelle comment s’ordonnent les rapports politiques avant 1789, à Versailles comme à Malte. Faire sa cour n’a rien de déshonorant et l’auteur de la lettre ne s’en montre absolument pas choqué. Suffren est là pour la promotion de son frère et la sienne auprès du Grand Maître, en s’appuyant sur sa gloire rapportée d’Inde. Le voyage, à ce titre est un succès : Suffren sera bientôt nommé ambassadeur de l’Ordre à Paris, Ordre qui y gagnera au passage un homme bien introduit auprès du roi. Echange classique de bons procédés, chacun étant censé y gagner en poids politique.
Suffren retrouve aussi son goût pour les expériences économiques et humaines. Il s’agit même d’une grosse affaire puisque le bailli a fait venir des Indes plusieurs familles, une cinquantaine de personnes au total spécialisés dans la manufacture des cotonnades. Au milieu des vicissitudes de la guerre, Suffren a constaté la haute qualité du travail des tisserands indiens et a eu l’idée d’embarquer un groupe d’hommes et de femmes « ouvriers en toile »[502] pour les acclimater avec leurs techniques à Malte. Ils ont embarqué sur le Héros au frais du bailli et ont débarqué à Toulon avec lui pour être immédiatement acheminé vers Malte, où leur protecteur espérait développer l’industrie textile en utilisant la production locale de coton. Grâce à la Gazette de France on apprend qu’une fabrique de mousseline a été créée avec leur appoint, les Maltais étant habiles à filer, mais ayant beaucoup à apprendre des Indiens pour le tramage[503]. L’expérience au dire des journaux semble donc fonctionner puisque le Courrier d’Avignon précise de son côté que les ouvriers indiens ont produit des pièces de toile de grande beauté sur le mode de ce qu’on trouve sur la côte de Coromandel et dans l’île de Ceylan[504]. Sans qu’on sache exactement pourquoi, il semble que Suffren ait été moins satisfait de leur sort que ce qu’en disent les gazettes, puisqu’il décide pendant son passage à Malte de les rapatrier en France pour les mettre au service des manufactures royales. Le 4 juillet, veille de son départ il fait embarquer la petite colonie sur un navire pour Marseille. On retrouve les 25 familles à Lyon en septembre où elles font sensation avant de reprendre la route pour Paris. On perd ensuite leur trace. L’expérience n’était-elle pas un peu trop audacieuse ? Suffren a-t-il fait finalement rapatrier le petit groupe ? C’est parfaitement possible vu les revenus maintenant importants dont il dispose, mais on reste là dans le domaine de la pure hypothèse.
Le 5 juillet 1785, Suffren se rembarque sur la Sainte-Catherine, toujours sous le pavillon de son frère pour se rendre à Naples après une escale à Palerme. On ne sait rien de son séjour à Naples, même s’il a sans doute porté quelques messages du Grand Maître de l’Ordre à destination du roi de Naples. En août, Suffren est à Rome pour plaider auprès du Pape plusieurs affaires en cours concernant les affaires de l’Ordre, mais semble-t-il sans grand succès[505]. Le séjour romain est cependant très plaisant pour l’amateur d’art et le bon vivant qu’est Suffren. Il noue des relations extrêmement cordiales avec le cardinal de Bernis, ambassadeur français auprès du Saint-Siège, qui lui fait profiter du train de vie particulièrement luxueux dont il dispose au palais de Carolis et dans les résidences environnantes. C’est lors de ce séjour que le peintre Pompeo Batoni réalise le portrait de Suffren en grand uniforme d'officier général de la Marine qui reste encore aujourd’hui l’œuvre la plus utilisée pour illustrer les livres ou articles sur le bailli. Pierre-André regagne ensuite la France par la route en passant par Gênes et arrive à Marseille le 9 septembre, répondant à l’invitation qui lui a été faite quatre mois plus tôt. La popularité de Suffren ne faiblit pas, si l’on en croit le Courrier d’Avignon qui consacre un long article à cette visite :
« M. le bailli de Suffren a bien voulu suivant la promesse qu’il en avait faite aux députés que notre chambre de commerce lui envoya à Toulon lors de son dernier embarquement, honorer notre ville de sa présence. Il est entré le 9 de ce mois dans notre port venant de Naples. Il a été accueilli par le peuple qui a prodigué ses démonstrations de joie, indication certaine de ses sentiments. Les officiers municipaux s’empressèrent d’aller le visiter, et un instant après ils furent honorés de sa visite à l’hôtel de ville. Le 10, M. de Suffren parut à la Bourse ; on sent déjà que l’affluence était extraordinaire. La présence du vainqueur de l’Inde dans le lieu central du commerce y produisit une sensation si vive, et les applaudissements furent si énergiquement exprimés qu’ils allèrent jusqu’au cœur de celui qui en était l’objet et si l’on en croit quelques observateurs, ils le forcèrent à répandre des larmes d’attendrissement. Cette circonstance, loin de déparer le héros, ajoute à sa gloire ; car elle fait l’éloge de sa sensibilité et de son patriotisme. M. de Suffren s’est montré au spectacle et dans les promenades publiques ; partout mêmes empressements, mêmes acclamations, mêmes remarques d’amour. »[506]
Après le séjour marseillais, Suffren prend la route de Paris en s’arrêtant à Pierrelatte pour la célébration du mariage de Louis-Victor de Suffren, second fils de son frère aîné. Le 25 octobre il est de retour à Paris après un voyage de plus de sept mois, alors que sa santé commence à se dégrader et qu’il est appelé à de nouvelles responsabilités.
Ambassadeur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem auprès du roi de France
 Le Grand Maître Rohan propose à Suffren de devenir ambassadeur de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem à Versailles. Suffren accepte immédiatement, sans en avoir mesuré les contraintes. (Anonyme)
Le Grand Maître Rohan propose à Suffren de devenir ambassadeur de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem à Versailles. Suffren accepte immédiatement, sans en avoir mesuré les contraintes. (Anonyme)
Le 25 août 1785 était mort le bailli de Breteuil, ambassadeur de l’Ordre à Paris. Le Grand Maître Rohan pense immédiatement à Suffren pour le remplacer. Outre que les deux hommes se sont rencontrés il y a peu, Rohan voit tout l’intérêt qu’il y a pour l’Ordre à être représenté auprès du roi par le héros de la campagne des Indes au sommet de sa popularité. Le Grand Maître sollicite Suffren dans une longue lettre, craignant que ce dernier ne refuse en trouvant le poste pas assez prestigieux[507]. Suffren est cependant trop heureux d’être sollicité pour une fonction qui lui assure une place officielle à la Cour de France. Il accepte immédiatement et le roi donne son accord, ce qui n’était pas forcément couru d’avance car cette nomination fait de Suffren le représentant de deux puissances, l’ordre de Saint Jean de Jérusalem et le Roi, lesquelles n’ont pas forcément les mêmes intérêts… Le 7 mars 1786, Suffren en grand uniforme, accompagné de plusieurs grands-croix, baillis et chevaliers de l’Ordre, est reçu par le roi et lui remet ses lettres de créance[507].
L’ambassadeur d’un Ordre en crise
Les biographes ont longtemps tenu pour une sinécure sans grand intérêt l'ambassade de Suffren auprès du roi, reprenant le jugement négatif qu’il porte sur celle-ci dans un de ses courriers à Madame d’Alès, à peine plus d'un mois après sa nomination : « Tu ne saurais croire, combien cette ambassade est fatigante par les petits et ennuyeux détails qu’elle entraîne, car il n’y a rien de sérieux ni d’essentiel »[508]. Rien de sérieux et d’essentiel ? Les recherches les plus récentes dans les archives françaises et maltaises montrent que Suffren a en fait consacré jusqu’à sa mort beaucoup de temps à la défense de son Ordre[509]. Tâche qu’il n’a pas toujours mené avec beaucoup de méthode, mais toujours avec beaucoup d’ardeur alors qu’elle était très difficile à cause des graves difficultés de l’Ordre.
Car Suffren est l'ambassadeur d’une institution en crise. Nous avons déjà évoqué les difficultés de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem au début de cet article, lors de l’entrée de Pierre-André dans celui-ci. Ces difficultés n’ont fait que s’accentuer depuis. L’Ordre est miné par de graves querelles à l’intérieur de l’administration centrale, entre les différentes « Langues » et, à l’intérieur même de celle-ci, entre les prieurés. Désordre qui semble spécialement prononcé chez les chevaliers français — les plus nombreux dans l’Ordre- dont la rigueur religieuse et les vœux d’obéissances poursuivent leur érosion sous l’effet des Lumières. Le Grand Maître Rohan, qui dirige l’Ordre depuis 1775, est ouvertement contesté, y compris par son bras droit le bailli de Loras[510]. La papauté elle-même se montre de plus en plus hostile à un ordre qui échappe à son autorité et Rome accueille avec bienveillance toutes les appels que les dissidents portent devant ses tribunaux. A Malte même, l’Inquisiteur papal se fait un malin plaisir de recevoir toutes les plaintes des jeunes chevaliers en révolte contre leurs supérieurs[510].
Cette situation est en fait liée à une crise beaucoup plus profonde, d’ordre quasi existentiel. Avec une navigation en Méditerranée de plus en plus sécurisée, l’utilité des caravanes est remise en cause. La Turquie a perdu de son mordant et inquiète plus pour sa faiblesse militaire face à la Russie que pour ses galères de guerre. Les cités « barbaresques » d’Afrique du nord sont minées par l’anarchie et les corsaires musulmans de Tunis, d’Alger ou de Salé représentent maintenant plus une gêne qu’une véritable menace pour la navigation. Les navires de l’Ordre semblent aussi ne plus être adaptés. Le procureur général de l’Ordre à Paris note en 1789 à l’adresse du Grand Maître que « nos vaisseaux, nos galères sortent tous les ans et depuis des années font rarement des prises ; ce n’est pas qu’ils ne puissent trouver des ennemis dignes de leur courroux, mais il manque à l’ordre l’espèce de bâtiments susceptibles de les rencontrer : des chébecs. »[511] Et le même personnage de conclure que l’efficacité retrouvée de la flotte de Malte « militerait plus en faveur des privilèges que nous réclamons, que tous nos mémoires apologétiques. » A cela s’ajoute la vie souvent dissolue des dignitaires de l’Ordre, le non-respect de leurs vœux monastiques, notamment ceux de pauvreté et de chasteté. L’esprit de lucre, la chasse aux honneurs et aux prébendes semblent avoir pris le pas chez beaucoup de chevaliers, dignitaires et aspirants à le devenir, sur la vocation religieuse, hospitalière et militaire qui devrait les animer[512]. Le Grand Maître Rohan semble lui-même très pessimiste sur l’avenir de l’Ordre, puisqu’il confesse carrément à Suffren que « nous avons la morgue des anciens templiers avec une avidité qui nous nuira à la fin comme à eux. »[513] Tout est dit.
Les responsabilités qui pèsent sur les épaules de ambassadeur de l’Ordre auprès du roi de France sont cependant considérables. Car après Malte et Rome, le troisième centre de décision de l’Ordre se trouve à Versailles. La France, avec les vénérables « Langues » de France, d’Auvergne et de Provence fournit en effet les deux tiers des chevaliers de l’Ordre et lui procure l’essentiel de ses ressources. En retour, le commerce français en Méditerranée bénéficie de la protection de la flotte maltaise et les vaisseaux de guerre du roi trouvent à Malte une base toujours disponible pour leur ravitaillement[514]. Les relations étant difficiles avec la papauté, le lien avec le roi de France n’en parait que plus important. « Vous savez que Versailles est notre étoile Polaire » lâche le Grand Maître à son nouvel ambassadeur[515]. Suffren a la surprise de découvrir à son arrivée un secrétaire en poste depuis vingt ans, M. Cibon, et qui s’avère être un ambassadeur bis si ce n’est le véritable ambassadeur… Ce personnage discret contrôle toutes les opérations du chiffre et entretient une correspondance directe avec le Grand Maître qui lui confie aussi des missions secrètes dans le dos de l'ambassadeur (!). Cibon a ses entrées à Versailles, non seulement dans les bureaux des ministères, mais aussi directement auprès du comte de Vergennes, le ministres des Affaires étrangères, et du marquis de Castrie, le ministre de la Marine[516]. Si Suffren pensait avoir les coudées franches c’est raté. Le bailli doit s’accommoder de ce puissant secrétaire, ce qui a aussi pour avantage de le dispenser d’un certain nombre de tâches ingrates et lui permet plus aisément des escapades loin de Paris. Le poste n’est cependant pas de pure représentation. Les dossiers à traiter sont nombreux. Suffren les suit à sa façon, c'est-à-dire de manière quelque peu brouillonne et fantasque, sans forcément respecter les usages de la chancellerie maltaise et en usant d’une liberté de ton qui ne va pas aller sans poser des problèmes avec ses supérieurs.
Les grands et petits tracas des dossiers traités
 L'abbaye de Saint-Antoine est absorbée par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le procès des religieuses contre les projets de l'Ordre accapare l'emploi du temps de Suffren et lui cause un vif dépit.
L'abbaye de Saint-Antoine est absorbée par l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Le procès des religieuses contre les projets de l'Ordre accapare l'emploi du temps de Suffren et lui cause un vif dépit.
Les dossiers traités concernent pour l’essentiel la gestion des biens de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem en France. Ils ne relèvent donc pas de la haute diplomatie mais nous plongent dans les arcanes religieuses et politiques -par ailleurs typiques- de la France d’avant 1789. Comme souvent derrière la gestion des biens religieux se manifestent de grosses affaires d’argent cernées par d’impitoyables luttes d’influences, lesquelles finissent souvent par arriver jusque sur le bureau du roi. Suffren intervient en juin 1786 au sujet du prieuré de Toulouse en révolte contre l’Ordre avec le soutien de Rome. Tâche dont il acquitte avec succès, ce qui lui vaut les félicitations du Grand Maître[516].
Le dossier suivant est autrement complexe et va empoisonner toute la durée de l’ambassade. L’affaire avait commencé en 1775, lorsque l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem avait absorbé l’ordre des Hospitaliers de Saint-Antoine, et ainsi acquis l’abbaye de Saint-Antoine, située entre Valence et Grenoble. Après y avoir établi une commanderie, le Grand Maître avait pris la décision d’utiliser une partie des immenses bâtiments disponibles pour y loger les chanoinesses de l’Ordre, congrégation alors en pleine expansion et dont le noyau était constitué par les chanoinesses du chapitre noble de Tullins. Mais l’opération se révèle calamiteuse. L’Ordre en espère, bien qu’il s’en défende, une ressource financière importante. Les familles des futures chanoinesses, accueillies en nombre illimités, pourvu qu’elles fournissent leurs preuves de noblesse, doivent en effet apporter une dot de 2 000 livres et acquitter de droits de réception élevé. La noblesse locale applaudit sans état d’âme à un projet qui lui permet de « caser » honorablement une partie des nombreuses filles cadettes qu’elle ne veut pas marier. On parle vite de 500 candidatures… Mais l’Ordre, qui a acquis l’abbaye dans des conditions financières très onéreuses et qui doit faire de gros travaux pour adapter les locaux aux besoins des chanoinesses, décide de vendre une partie des biens de l’abbaye. Cette opération n’est pas du goût des chanoinesses toujours installées à Tullins et qui estiment lésés leurs droits sur l’abbaye de Saint-Antoine. Les religieuses se lancent alors dans d’innombrables procédures contre l’Ordre, faisant saisir les biens vendus et réclamant pour elles la totalité des dots fournies par les nouvelles arrivantes novices. Le Parlement de Grenoble s’en mêle et soutient les religieuses en révolte. Les membres de cette assemblée de justice, presque tous nobles, sont en effets les premiers à chercher des places de chanoinesses pour leurs filles[517].
Suffren se montre vite agacé d’avoir à gérer un pareil dossier qui n’est pas loin de ressembler à un guêpier. Le bailli tente d’abord des démarches de conciliation. A la grande prieuse des chanoinesses de Malte à Tullins il écrit une lettre accommodante mais tout en la rappelant à ses devoirs religieux : « L’esprit de l’Evangile qui respire la charité et l’union ne s’accorde guère avec les huissiers, et il me semble qu’il fallait attendre les décisions du Grand Maître sur les propositions que vous lui aviez faites. »[518] En vain. Il s’adresse aussi au premier président du Parlement de Grenoble pour « calmer les chaleurs des dames de Tullins devenues chanoinesses de Malte ou au moins celle de leurs conseils. » [519] Peine perdue. Suffren, qui veut en finir accorde de larges concessions aux chanoinesses… et se fait désavouer par le Grand Maître Rohan[520]. Peu convaincu du bien fondé pour l’Ordre de toute cette procédure et de la publicité déplorable qu’elle lui fait, il fait part sans ménagement de ses doutes à Rohan : « Ce chapitre ne sera-t-il point le voile humiliant d’une avide opération de finance pour nous ? » ou bien encore « ne donnera-t-il pas le spectacle ridicule d’une fourmilière de jeunes personnes abusant de l’état le plus libre sous l’apparence d’être chanoinesse ? »[521] Suffren, qui a fait preuve dans le passé de réelles qualités de diplomate, semble au milieu de cette affaire terriblement provinciale, nettement moins à l’aise que lorsqu’il faisait face au gouverneur néerlandais de Ceylan ou au nabab Haidar Alî... Le dossier, qui sera finalement tranché au Conseil du roi, lui est entre-temps retiré par le Grand Maître qui le confie à un envoyé spécial maltais, le chevalier de Saint-Sulpice. Le bailli en gardera des traces profondes et évoquera encore peu de temps avant sa mort « la répugnance et le dégoût qu’inspire une affaire aussi désavantageuse. »[522]
Cette affaire, conjuguée au peu d’envergure des dossiers à traiter, semble avoir lourdement pesé sur les relations entre Pierre-André et ses supérieurs. Le bailli, qui a on l’a vu, la sens de la formule -pour ne pas dire de la saillie- ne prend guère de gants dans ses rapports officiels, au point que ses remarques ou commentaires finissent par paraitre insupportables à une partie de sa hiérarchie. Si le Grand Maître Rohan parait s'accommoder du style personnel de son ambassadeur, son bras droit, le bailli de Loras ne partage pas cet avis, d’autant que le suivi des dossiers lui semble nettement à désirer. Ce dernier se fend, en mars 1787, d’une lettre qui a tout de ce que nous appellerions en langage actuel une remontée de bretelles et qui montre encore une fois que Suffren a le don de se faire des ennemis virulents :
« J’ai l’honneur de prévenir Votre Excellence que, ne voulant rien vous cacher de ce que je fais ou de ce que je pense relativement à votre personne, j’ai pris la liberté de dire franchement à deux confrères estimables qui vous sont dévoués que je désapprouvais votre correspondance parce que n’ayant égard ni au système des affaires, ni aux instructions anciennes, ni aux conséquences si funestes des contradictions de dépêches. Vous ne vous réglez que par l’impulsion du moment ne répondant ni aux commissions, ni aux discussions et éludant toujours les examens sérieux par des plaisanteries ou des reproches. J’ai dit encore que cette manière de mépriser ses fonctions n’était pas digne de votre cœur et que le ton épigrammatique de vos lettres soit ministérielles, soit confidentielles étaient encore moins digne de votre honnêteté (…). Voilà, M. le bailli, ce que je n’ai pas dissimulé à vos vrais amis quoi que je me sois abstenu soigneusement de tenir à notre respectable chef un langage semblable dont jamais je ne l’entretiendrai. Quant aux injures qui vous sont échappées contre moi et que j’ai parfaitement distinguées au travers des enveloppes dont vous avez voulu les couvrir, elles me sont trop sensibles pour que je puisse les oublier. Je continuerai cependant à vous servir par zèle pour le bien commun, mais je me dispenserai de vous écrire pour ne gêner ni votre opinion ni votre confiance quoique la plaie de mon cœur soit excessivement profonde, je n’en serai pas moins toute ma vie avec les mêmes sentiments de respect de Votre Excellence le très humble et le très obéissant serviteur. »[523]
Les relations entre les deux hommes vont malgré tout reprendre, en alternant les embellies et les crises. On remarque cependant que les relations avec Cibon, l’inamovible secrétaire de l'ambassade sont bonnes et que ce dernier, d’une grande loyauté envers Suffren, défend son action auprès du Grand Maître[524]. Si la manière dont Suffren mène son ambassade est sujette à discussion, l’examen de ses activités montre cependant qu’il rend les services qu’on attend d’un diplomate en temps de paix. A la correspondance officielle, Suffren préfère les contacts humains où il sait user de son charme et de sa persuasion, mais cela ne l’empêche pas de rendre de nombreux rapports sur la situation à la Cour. Le bailli renseigne parfaitement l’Ordre sur l’évolution de la situation intérieure française à la veille de la Révolution[525] et remplit les devoirs de sa charge en apportant les hommages traditionnels au roi de France. A chaque nouvelle année, l’Ordre offre des oranges, de l’eau de fleur d’oranger et des faucons au roi, lesquels sont scrupuleusement vérifiés par l’ambassadeur. Suffren se plaint à l’Ordre en 1786 du médiocre calibre des oranges et en 1787 de la non arrivée de l’eau de fleur d’oranger, ce qui a été fort remarqué à la Cour, incident qu’il a pu réparer en puisant dans ses réserves personnelles[526]...
L’Ambassadeur en ses commanderies
Porte fortifiée de la commanderie de Jalès. Suffren dispose de quatre commanderies pour vivre selon son rang de dignitaire de l’Ordre et séjourne plusieurs fois à Jalès. Il affectionne beaucoup le lieu.
A son arrivée à Paris en 1784, Suffren s’installe d’abord rue de Tournon puis déménage dans l’actuelle rue de Lille, à côté du Palais-Bourbon. Au printemps 1786 il se fixe définitivement Chaussée d’Antin, dans un hôtel particulier loué à la princesse de Luxembourg[526]. Il s’agit d’une belle bâtisse digne de son rang d’ambassadeur et de vice-amiral, avec salle de réception et de conseil, un grand salon (premier étage) et pas moins de 12 chambres (deuxième étage). Il y a aussi une grande écurie, l’ensemble étant servi par un personnel de maison nombreux placé sous l’autorité d’un intendant.
En temps que haut dignitaire de l’Ordre, Suffren est pourvu de plusieurs commanderies, celles-ci devant lui assurer des revenus en rapport avec son rang. A celle de Saint-Christol dont il a été pourvu en 1771, s’ajoute en 1782 la commanderie de Jalès, dans la région d’Aubenas, en 1784, celle de Puimoisson dans le canton de Riez et, en 1786, celle de Troyes[527]. La commanderie de Saint-Christol est échangée en 1786 contre celle de Trinquetaille près d’Arles, semble-t-il pour aider son frère Paul-Julien[528]. Ces quatre commanderies fournissent aussi à un homme qui a, on l’a vu, la bougeotte, l’occasion de s’échapper de la région parisienne et des tracas de son ambassade. Suffren n’a semble-t-il jamais séjourné à Puimoisson -une commanderie pourtant magnifique- et à Troyes[529]. Il n’est pas sûr qu’il se soit rendu à Trinquetaille comme il dit en avoir le projet dans un courrier d’octobre 1786. En revanche, Suffren séjourne régulièrement à Jalès et semble apprécier particulièrement le lieu. Présence toute relative, puisqu’il n’y réside que quelques mois en 1786 et 1787, mais assez pour pouvoir dire dans ses lettres « J’irai chez moi » chaque fois qu’il s’apprête à s’y rendre[530].
La commanderie, construite vers 1150 par les Templiers, se trouve près du village de Berrias, à mi-distance entre Aubenas et Alès[531]. Jalès a connu une phase de déclin important au XVIe et XVIIe siècles avant d’être reprise en main à partir de 1740 par le commandeur Pierre-Emmanuel de Lauberivière de Quinsonas. Ce dernier, grâce à la restauration des droits féodaux, une meilleure gestion des terres et l’introduction de nouvelles cultures, a pu obtenir une sensible augmentation des revenus de la commanderie et se lancer dans des travaux d’agrandissement[532]. La grosse bâtisse, qui garde une allure austère de maison forte médiévale avec ses murailles crénelées, ses guérites, son grand portail muni d'une herse et d’un petit pont-levis[533], a été dotée d’un nouveau bâtiment pris dans l’espace de la cour, alors que trois appartements confortables ont été aménagés au premier étage des ailes est et ouest. Suffren y fait encore quelques travaux pour rendre le lieu plus à son goût. En septembre 1786, il reçoit son frère Louis-Jérôme, évêque de Sisteron, ainsi que de nombreux membres de sa famille. En octobre, la commanderie est encore pleine : « J'ai autant de monde que la maison peut en contenir. J'ai six femmes ! »[534] L’année suivante, le bailli fait un premier séjour dans sa commanderie au mois de mai. Il y retourne en septembre et se montre satisfait des améliorations apportées à sa résidence préférée. A Mme d’Alès il confie que « Jalès est maintenant habitable, la maison est fort logeable. Il y a un bon potager. Je désire bien que des temps plus tranquilles me permettent d’y passer quelques mois, surtout si tu peux y venir. »[535] Il est vrai que les deux amoureux ne se sont pas revus depuis 1785. Un vœu qui ne sera pas exaucé, alors qu’en 1788 la santé trop délabrée de Suffren ne semble pas lui avoir permis de séjourner dans sa commanderie du Vivarais.
Le « mystère » de la mort de Suffren
Une santé dégradée et un emploi du temps qui reste chargé
 En septembre 1788, Louis XVI reçoit les ambassadeurs de Tipû Sâhib venus solliciter son alliance contre les Anglais. A l'occasion de cette visite, Suffren se déclare prêt à reprendre du service en Inde.
En septembre 1788, Louis XVI reçoit les ambassadeurs de Tipû Sâhib venus solliciter son alliance contre les Anglais. A l'occasion de cette visite, Suffren se déclare prêt à reprendre du service en Inde.
Au retour de son voyage d’Italie, (août 1785, voir plus haut), la santé de Suffren commence à se dégrader, tendance qui ne fait que s’accentuer les années suivantes. Le marin infatigable, resté longtemps agile malgré sa corpulence, mène désormais une vie presque sédentaire, et ses excès de table en font peu à peu un homme d’une extrême obésité. A Jalès, la légende locale colporte qu'il s'est fait fabriquer une table échancrée pour y loger commodément son énorme bedaine. Le buste sculpté par Houdon à cette époque, saisissant de réalisme, nous montre un personnage presque bouffi, au point que les historiens cherchent des qualificatifs imagés pour le décrire : Rémi Monaque parle de « lourd pachyderme »[536], et Jean-Christian Petitfils de « tonneau de graisse »[537]. Le commandeur est aussi accablé par la goutte et une érysipèle récurrent qui l’oblige à garder la chambre et le laisse incapable selon son propre témoignage, de travailler plus de quelques heures par jour : « Je deviens pesant après le dîner (déjeuner), je ne puis plus écrire, de même qu’à la lumière, de sorte que je n’ai que le matin. »[538]. Suffren est parfaitement conscient que ses excès de table sont la cause première de son impotence, mais ne change rien à sa gloutonnerie et ne peut que constater que des activités qu’il affectionnait autrefois lui sont désormais impossibles à cause de son poids. Ainsi en 1785, à l’occasion de son dernier séjour provençal auprès de Mme d’Alès il avoue à celle-ci : « Tu comprendras que ma corpulence, ma position ne me permettent pas de courir les montagnes à cheval comme il y a vingt ans »[500]. Parler de « position » [sociale] pour justifier de ne plus monter à cheval à une époque où tous les nobles se doivent de maitriser cet art pour les plaisirs de la chasse ne manque pas de sel, et cache bien mal l’argument clé de la « corpulence ».
Les relations avec Mme d’Alès connaissent une période difficile. On connait très mal la vie de Marie-Thérèse, mais celle-ci, dans les années 1780, connait des embarras financiers importants à cause de procès dans lesquels elle est engagée pour d’obscures questions d’héritages. Elle sollicite continuellement son ami qui de son côté fait intervenir en sa faveur ses parents, frères et neveux, et les hauts personnages qu’il fréquente à Paris[539]. Il lui offre aussi plusieurs fois de l’aider financièrement, mais il faut croire que ce soutien est insuffisant ou n’est pas à la hauteur des promesses, car Marie-Thérèse se répand alors en reproches jugés « terribles » par l'intéressé. A l’été 1786 le couple semble même en crise. Suffren ne sait plus comment faire pour obtenir son pardon tout en confessant à demi-mot son impuissance morale et physique pour satisfaire ses demandes :
« Quel qu’affreux que fut le coup porté par votre lettre du 9 juillet, ma chère amie, je me flattais que vous vous reprocheriez cette dureté et que vous reviendriez à moi sans attendre ma réponse. Votre silence redouble mon inquiétude et je ne crains que trop que vous n’ayez pris parti bien affligeant pour mon cœur (…). Vous savez bien que naturellement je ne suis pas attentif, que les Affaires, l’affaissement des organes qui est une suite de l’âge, la paresse, tout enfin a pu me faire paraître coupable. » [540]
Lorsque sa santé le lui permet, Suffren se rend aux activités de la loge de la Société Olympique et de la Parfaite Estime. Il semble que se soit à son retour des Indes qu’il se soit laissé initier à la franc-maçonnerie. Le bailli est un esprit beaucoup trop indépendant pour se plier aux rites d’une société secrète. Cependant, la Société Olympique et de la Parfaite Estime, si on examine les opuscules de l’époque, semble n’avoir guère de préoccupation philosophique et politique puisqu’elle organise essentiellement des concerts et sert de lieu de sociabilité à l’élite nobiliaire parisienne[541]. La cotisation annuelle, assez élevée (120 livres), donne droit à l’entrée à 12 concerts, aux travaux de la maçonnerie et à la fréquentation journalière du local où sont mis à la disposition des membres de nombreux journaux. Les locaux sont au 65 des Arcades du Palais-Royal, et l’orchestre, entièrement composé de membres de la loge, donne les concerts non loin de là, aux Tuileries. Suffren fait partie des 359 membres administrateurs ou abonnés mélomanes que compte la loge en 1788[542]. Le commandeur y côtoie des nombreux acteurs de la Guerre d’Amérique, comme le marquis de Bouillé, l’ancien ministre Sartine, le vice-amiral d’Estaing, le comte de Rochambeau ou d’autres têtes politiques comme Choiseul, l’abbé de Calonne, les ducs de Luxembourg et d’Orléans… L’ambassadeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem peut donc joindre l’utile à l’agréable par la fréquentation, dans la meilleure des ambiances, de personnalités très introduites à la Cour et proches du gouvernement.
Au mois de juillet 1787, Suffren est à Cherbourg. Il s’agit d’un voyage d’agrément pour examiner les gigantesques travaux commencés l’année précédente en présence du roi afin de doter la rade d’une digue et donner enfin à la marine de guerre un port en eau profonde dans le Manche[541]. Cette même année, une montée de tension franco-anglaise pousse Versailles à le nommer chef de l’escadre de Brest. Une responsabilité très prestigieuse qui le met à la tête d’une force de plus de 30 vaisseaux, mais sur laquelle on ne sait rien ou presque, les biographes du marin ne s’y attardant pas, au point qu’on ne sait même pas si Suffren à séjourné à Brest[543]. Quoi qu’il en soit, même malade, l’homme se déplace toujours beaucoup si l’on prend en compte le fait qu’en mai de cette même année il séjournait dans sa commanderie de Jalès et qu’il y retourne encore en septembre.
En 1788, Suffren ne semble pas, cette fois, s’être éloigné de la région parisienne. La France est en pleine agitation politique et il suit attentivement les évènements. Sa position d’ambassadeur et l’accès régulier qu’il a auprès de plusieurs ministres, notamment ceux de la Marine et des Affaires étrangères en font un observateur privilégié des crises successives qui vont emporter la Monarchie absolue, même s’il se garde bien de donner son avis en public, tellement les esprits sont échauffés[544]. Sa correspondance montre cependant qu’il est favorable aux réformes financières envisagées avec la convocation de l’assemblée des notables. A l’occasion de la première réunion de celle-ci en février-mai 1787, il écrit à Mme d’Alès qu’il n’a rien contre le projet d’imposition de la noblesse et du clergé[545]. Le 18 novembre 1788, lors de la deuxième réunion de l’assemblée des notables, il s’entretient avec le ministre Necker au sujet de la possible imposition de l’Ordre[546].
Aux Indes, la résistance des princes indiens contre les Anglais ne faiblit pas. Tipû Sâhib, envoie une ambassade solliciter l’alliance du roi de France qui les reçoit fastueusement en septembre. Une grande fête est donnée à Versailles. Suffren, qui ne perd pas de vue les questions internationales, en profite pour remettre aux émissaires indiens une lettre qui montre aussi qu’il n’a rien perdu de ses ardeurs belliqueuses contre l’Angleterre :
« Je suis maintenant un ambassadeur d’une petite puissance, mais cela ne m’empêche pas de servir, et je serais au comble de mes vœux si, étant uni avec vous, je pouvais jamais contribuer à rendre leur liberté aux peuples de l’Inde en la libérant des Anglais. (…) Si jamais la guerre revenait, votre puissance étant unie à la nôtre, avec les connaissances que nous avons acquises dans l’Inde, je ne doute pas que les Anglais n’en seraient chassés, et je me chargerais avec plaisir du commandement des forces navales. Avec votre aide, il n’est rien que nous ne puissions entreprendre (…) »[547].
Une lettre bien dans le ton habituel du bailli. Suffren passe sans complexe sur le fait qu’il ne représente que la « petite puissance » de Malte, et se voit déjà reprendre du service sans savoir si le roi et ses ministres ont réellement besoin de lui, ces derniers ne l’ayant même pas consulté à l’occasion de cette ambassade !
Une mort soudaine
 C’est lors d’une visite chez Madame Victoire que Suffren perd connaissance après deux saignées et décède peu de temps après. (Tableau de Jean-Marc Nattier)
C’est lors d’une visite chez Madame Victoire que Suffren perd connaissance après deux saignées et décède peu de temps après. (Tableau de Jean-Marc Nattier)
À l’automne 1788, la santé de Suffren semble s’améliorer. Le 9 octobre, il annonce à Mme d’Alès que son érysipèle va mieux et l’assure qu’il est en bonne santé[548]. Le 4 décembre 1788 Suffren se rend à Versailles pour assister à une réunion de l’assemblée des notables. Après la séance, il fait une visite à son amie, Madame Victoire, l’une des filles de Louis XV dont il a fait connaissance à son retour des Indes. Cette dernière, restée célibataire, adore la compagnie du bailli et entendre le récit de ses campagnes, que ce dernier lui conte bien volontiers. La suite nous est donnée par le médecin personnel de Suffren, Alfonse Leroy, régent de la faculté de Paris :
« Suffen était allé faire sa cour à Mme Victoire, tante du roi, celle-ci frappée de sa mauvaise mine, voulut qu’il consultât son propre médecin. Celui-ci, ne connaissant pas son tempérament, le saigna : à peine piqué, il perdit connaissance. La goutte fit une métastase rapide sur la poitrine. On réitéra la saignée et lorsque j’allai voir cet illustre ami qui m’avait promis de se faire appliquer des sangsues, je restai stupéfait, en apprenant son agonie. »[549]
Comme le veut l’usage du temps, il n’est pas possible que quelqu’un meure dans les appartements d’une princesse de sang royal. On porte donc prestement le bailli dans sa voiture et on le renvoie à son domicile parisien par un froid glacial. Suffren garde la chambre pendant plusieurs jours, sans qu’on sache s’il reprend connaissance. Il décède la 8 décembre, entouré de quelques proches. Sylvain, son valet, fait quelques jours plus tard, le récit de ses derniers instants :
« Monsieur et Madame le comte et la comtesse de Saint-Tropez sont arrivés à Paris le 7 courant. Ils ont trouvé Monsieur de Suffren au lit depuis trois jours et, le lendemain à trois heures et demi de l’après-midi, ils ont eu le chagrin de le voir mourir entre leurs bras, ce qui, comme il est facile à concevoir, les a bien affligés ainsi que Monseigneur l’évêque de Sisteron. Un rhume, une goutte remontée, joints à une fièvre putride, pour tout cela les saignées, ont eu bientôt pris fin [sic] de ses jours. (…) Vous savez sans doute, Monsieur, cette triste nouvelle, mais peut-être pas si détaillée. Je suis fâchée d’être si mauvais nouvelliste. Signé Ordinaire dit Sylvain. »[550]
Suffren avait 59 ans et cinq mois. La date et l’heure du décès sont confirmés par le commissaire Jean Sirbeau, requis pour apposer les scellés sur les biens, meubles et papiers du bailli, et qui entrevoit son corps « gisant sur un lit étant dans une chambre ayant partiellement vue sur le boulevard. »[551] Le 10 décembre, Suffren est porté en terre à l’église Sainte-Marie du Temple à Paris, comme l’ont été avant lui plusieurs dignitaires de son Ordre.
Les circonstances de la mort de Suffren sont donc clairement établies par les documents et témoignages d’époque et ont toujours été acceptées, sans aucune réserve, par les membres de sa famille. Une légende va pourtant naitre quelques années plus tard, bâtie sur la rumeur selon laquelle Suffren serait mort des suites d’un duel dans les jardins de Versailles. Un duel dont maints chroniqueurs vont chercher à percer le « mystère » de l’adversaire inconnu et de ses motifs. Divers noms vont circuler, dont ceux des officiers Tromelin et Cillart qui auraient cherché à venger leur honneur suite à leur sanction lors de la campagne des Indes (voir plus haut). Une fable romanesque confortée par le témoignage d’un certain Dehodencq, cabaretier se présentant comme un ancien domestique de Suffren et livrant cette version à deux historiens différents, en 1832 et 1845. Un témoignage extrêmement tardif, émanant d’un personnage douteux cherchant peut-être à faire parler de lui et dont on ne trouve pas trace dans la liste des domestiques de Suffren, bien qu’on ne peut exclure que le commandeur l’ait congédié avant sa mort[552]. Au début du XXe siècle, les historiens, passant en revue les documents d’époque feront table rase de ce témoignage et du « mystère » de ce duel fantôme, peut-être né au départ des taches de sang que devait porter Suffren après ses deux saignées[553], à moins qu'il ne s'agisse d'une rumeur colportée dans Paris par des proches de Madame Victoire soucieux de protéger la réputation de la princesse royale. Mais le roman a la vie dure, et il n'est pas rare, aujourd’hui encore, que cette version des faits se retrouve dans certains ouvrages ou sites internet mal renseignés[554]. En fait, si mystère il y a, il est plutôt à éclaircir du côté de la situation financière très dégradée que Suffren laisse derrière lui.
Un mort couvert de dettes
 Suffren a emprunté de fortes sommes d'argent sans qu'on en connaisse exactement le motif. Il laisse à sa mort, en 1788, des dettes considérables que son Ordre peine à rembourser.
Suffren a emprunté de fortes sommes d'argent sans qu'on en connaisse exactement le motif. Il laisse à sa mort, en 1788, des dettes considérables que son Ordre peine à rembourser.
Selon les règles en vigueur, et conformément au vœu de pauvreté prononcé par les chevaliers, l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem hérite des biens laissés par ses membres. L’usage autorise cependant les chevaliers à disposer à leur guise de un cinquième de leurs biens. Suffren dispose dans les dernières années de sa vie de revenus confortables et sûrs. A ses 18 000 livres d’appointements de vice-amiral, s’ajoutent la pension de 1 500 livres, récompense de sa campagne d’Amérique et le revenu de ses quatre commanderies[555]. Pourtant, l’inventaire après décès révèle une montagne de dettes et une foule d’ayants droit de toutes origines.
Le plus important se trouve être l’avocat Pouget, à qui le bailli a confié la « régie et gestion » de ses commanderies. L’homme réclame à l’Ordre le remboursement de 80 252 livres dont il se trouve créancier. Suffren, semble s’être servi de son régisseur comme d’un banquier en consommant par anticipation les revenus de ses commanderies, lesquelles ont servi de garantie auprès du préteur. Pierre-André semble avoir emprunté de l’argent à tout son entourage. Le marquis de Suffren, frère ainé du bailli, réclame une somme de 23 000 livres que lui aurait légué le vice-amiral. Puis ce sont 22 951 livres qui sont demandés par un « groupe d’ouvriers qui ont travaillé pour M. le bailli de Suffren ». On y trouve le maître tailleur du commandeur, un architecte, un peintre, un tapissier, un galonnier, un bourrelier, un charron, un serrurier et deux chirurgiens[556]. Et la liste s’allonge encore avec Martin Claude Monnot, sculpteur, Alphonse Le Roy, régent de la faculté de médecine de Paris, puis les directeurs de l’école gratuite et royale de dessin. D’autres créanciers se manifestent en 1789. Les frères Mouttet, négociants à Toulon, réclament le paiement d’une somme de 2 966 livres et de leurs intérêts. Puis c’est une demoiselle Marie-Jeanne Bertin, marchande de mode à Paris qui fait valoir ses droits pour les sommes et intérêts qui lui sont dus, suivie de Maître Abraham de La Carrière, ancien conseiller au Châtelet, pour les mêmes motifs. Le 9 mars c’est le carrossier et le maître tapissier de Suffren qui interviennent à leur tour. Cerise sur le gâteau, la princesse de Luxembourg, propriétaire de l’hôtel loué par Suffren en 1786, se manifeste elle aussi par l’intermédiaire de son homme d’affaires pour protéger ses droits et créances. Chose à peine croyable, le héros de la campagne des Indes négligeait de payer son loyer[557]…
L'essentiel des actifs de Suffren est composé d'actions de la Compagnie du Sénégal, au conseil d'administration de laquelle il siégeait à Paris. Il y en a pour la somme élevée de 40 000 livres, mais la vente de ces dernières et des biens du bailli ne peut couvrir les demandes des créanciers[558]. A l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, c’est la consternation. Le 12 juin 1790, le chevalier d’Estournel, trésorier du grand prieuré de France, fait le point sur la situation devant l’assemblée des six grands prieurés de France :
« J’ai la douleur, Messeigneurs, d’entrevoir que la dépouille de M. le bailli de Suffren pourra devenir onéreuse par le nombre de dettes qui semblent renaître à mesure que je les éteins et j’avoue que je m’afflige de voir manquer à toute la gloire de ce religieux l’avantage d’avoir conservé dans ses affaires l’ordre et l’économie qui sont nos premiers devoirs. En vain, par des réductions convenables sur des dettes, j’ai cherché à balancer au moins l’actif et le passif. Cet équilibre n’a pu résister à une créance de 83 000 livres réclamée par le sieur Pouget, régisseur et receveur des trois commanderies de son Excellence en Provence. »[559]
Comment expliquer une telle dérive financière ? Les dernières années de sa vie, Suffren vit confortablement, mais ne semble pas avoir mené grand train à la manière d’un noble de Cour. Les chroniqueurs de l’époque, généralement aussi féroces que bien informés, ne remarquent pas de sorties à l'opéra aux côtés de courtisanes de luxe, et ne notent pas sa présence aux nombreuses tables de jeu parisiennes. Le gros investissement dans la Compagnie du Sénégal peut fournir un début d'explication, mais elle est loin d'être suffisante. Un passage du compte-rendu du chevalier d’Estournel nous donne peut-être une autre piste. Il remarque en effet avec étonnement que l’énorme avance consentie au bailli par son receveur remonte seulement aux deux dernières années de jouissance du revenu de ses commanderies, c'est-à-dire à partir de 1786. Hors c’est cette année-là, nous l’avons évoqué un peu plus haut, que Madame d’Alès le harcèle pour faire face à ses tracas judiciaires. Suffren a-t-il cédé au-delà de toute raison aux sollicitations de sa « chère amie » ? A-t-il réglé des procédures judiciaires qu’elle a perdues ? Nous n’en savons strictement rien, mais la question -sans réponse à ce jour- mérite d’être posée.
Les lettres de Madame d’Alès devaient se trouver à l’hôtel de la Chaussée d’Antin. Les mains anonymes qui s’en sont saisies après le décès de l’illustre locataire ne l’ont peut-être pas fait seulement pour cacher ou détruire des écrits amoureux non conformes à la chasteté officielle du chevalier, mais peut-être aussi pour soustraire à la vue du public de peu glorieux transferts d’argent pour lesquels il est plus que douteux que Madame d’Alès ait laissé des reconnaissances de dettes. Ce mystère relatif jette une ombre sur les dernières années de Suffren et il est peu probable qu’une réponse soit un jour trouvée, à moins de fouiller les archives judiciaires et notariales provençales pour en savoir un peu plus sur les affaires de Madame d’Alès, recherches qui restent encore à faire. Quoi qu’il en soit, avec la tourmente révolutionnaire qui saisit progressivement la France et balaye l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem du pays en 1792, il semble douteux que le régisseur de Suffren (et combien d’autres ?) ait pu rentrer dans ses fonds[560].
Après sa mort
 Plaque commémorative à Saint-Tropez.
Plaque commémorative à Saint-Tropez.
En 1793, les restes de Suffren, encore très reconnaissables, sont jetés sur un tas d’ordures, comme le corps de Mirabeau chassé du Panthéon de Paris[561]. Marie-Joseph Chénier est-il à l’origine de cette décision ? Selon, Roger Glachant, cela se fit par les soins d'une catégorie spéciale d'idéologues, qui comptaient récupérer des bagues dans les cercueils[562]. L'amiral Caron parle lui de révolutionnaires réduit à profaner en 1793 ses restes ensevelis en l'église du Temple[563]. De toutes façons, l'église du Temple sera vendue en 1796 avec le cimetière à un particulier qui la fera raser.
Napoléon Ier regrettera de ne pas avoir Suffren à ses côtés pour combattre Nelson et il sera souvent comparé à ce dernier ou à Ruyter sur les plans tactiques et stratégiques.
Sa statue à Saint-Tropez sera coulée avec les bronzes des canons pris à l'ennemi que Napoléon III offrira à la ville en 1866. À l'inauguration de la statue de Suffren à Toulon, la foule chante la belle chanson de Mireille pour honorer la mémoire de ce cadet de Provence[564].
 Le Suffren (1899 - 1916)
Le Suffren (1899 - 1916)
Suffren va devenir un exemple à suivre pour les marins français. Huit bâtiments de la Marine nationale sont nommés ainsi en son honneur :
- Un navire de ligne de 74 canons (1791–1794), rebaptisé Le Redoutable en 1794, qui participa à la bataille de Trafalgar ;
- Un navire de ligne de 74 canons (1801–1815) ;
- Un navire de ligne de 90 canons, le Suffren (1824–1865) ;
- Une frégate armée (1866–1897) ;
- Un cuirassé, Le Suffren (1899–1916) ;
- Un croiseur, Le Suffren (1926–1963) ;
- Une frégate lance-missile, Le Suffren (1968–2001) ;
- Un futur sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) du type Barracuda, Le Suffren.
Galerie
À ce jour, il ne nous est parvenu aucun portrait de Suffren dans sa jeunesse, avant qu'il ne connaisse la gloire. La physionomie très ronde du bailli et son visage qui laisse transparaitre son caractère difficile semblent avoir posé problème aux artistes. Nombreux sont ceux qui cherchent à l'amaigrir ou à lisser ses traits, au risque de le rendre plus ou moins méconnaissable, comme on peut l'entrapercevoir dans la galerie ci-dessous.
-
Cette peinture de Pompeo Batoni, réalisée du vivant de Suffren, est la plus couramment utilisée pour illustrer les ouvrages sur le célèbre marin. -
Les graveurs semblent avoir eu plus de facilité avec le profil de Suffren, comme le montre cette médaille de 1825 ou celle-ci, réalisée du vivant du bailli. -
Ce portrait de 1837 vaguement inspiré du tableau de P. Batoni nous livre un Suffren presque souriant, mais que l'on peine encore une fois à reconnaitre.
Notes et références
- Cité par Rémi Monaque, Suffren, un destin inachevé, éditions Tallandier, 2009, p. 14.
- King, Ernest, (fleet admiral), A naval record, New York, w.w. Norton, 1952, cité par Rémi Monaque, ibidem.
- Un calfat est un marin chargé d’assurer l’étanchéité des navires en remplissant les joints des bordages avec des cordons d’étoupe recouverts de brai. Au combat il est chargé de colmater les trous fait par les boulets dans la coque avec des tampons de bois correspondant au calibre des boulets. Ces hommes essentiels à la sécurité du navire sont assez curieusement méprisés, sans doute parce que leur activité est pénible et salissante.
- Rémi Monaque, op. cit., p. 15.
- Raoul Castex, Les Idées militaires de la marine du XVIIIe siècle siècle. De Ruyter à Suffren, Paris, Fournier, 1911.
- François Caron, Le Mythe de Suffren, Paris, Service historique de la Marine, 1996.
- Suffren va bientôt donner son nom à un huitième vaisseau avec un sous-marin nucléaire d’attaque de classe Barracuda. Pour les sept vaisseaux précédents, voir la fin de l’article.
- Rémi Monaque, Suffren, un destin inachevé, éditions Tallendier, 2009, p.19.
- Le premier a d’abord été abbé de Saint-Victor. C’est lui qui aurait donné naissance à l’expression marseillaise « ma fagues pas venir lou San Suffren » (Ne me fais pas mettre en colère). Le second a été moine de l’abbaye de Lérins avant de devenir évêque de Carpentras au début du VIIe siècle. Une rue de Marseille et deux hameaux près de Lambesc et de Forcalquier portent le nom de Saint-Suffren. Ibidem.
- Suffren est par ailleurs un prénom d’origine germanique remontant sans doute aux mouvements de populations du Haut Moyen Âge, Siegfried, et comporte plusieurs variantes : Sifroi, Sifrein, Siffrein ou encore Sylfred. Ibidem.
- Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d'Histoire Maritime, collection Bouquins, éditions Robert Laffont, 2002, p.1051.
- Luc Antonini, Une grande famille provençale : les Suffren, 13240, Septèmes-les-Vallons, 2000.
- Lettres d’anoblissements de Jehan Suffren de Sallon de Craux, Archives des Bouches-du-Rhône, B47, fol.150.
- Information donnée par Rémi Monaque, (op. cit., p.21.) sans en préciser la date.
- Il achète et vend de tout : riz, café, cacao, morue, sucre, huiles, amandes, câpres, fer, cuivre, étain, coton, soies, organsins, cire, encens, dentelles et rubans... Il brasse une foule de lettre de changes et fait aussi commerce de monnaies étrangères, avec, pour finir, une activité typiquement marseillaise, la production de savon. Luc Antonini, Les Bruny, 13420 Septèmes-les-Vallons, 2003.
- Rémi Monaque, op. cit., p.24.
- À prononcer « Babéou » en provençal, diminutif courant pour Élisabeth dans la sud de la France. Rémi Monaque, op. cit., p. 28.
- De 1764 à 1789, puis évêque de Nevers. Il fera creuser un grand canal pour irriguer la région de Sisteron.
- Cette information nous est donnée par Suffren dans un échange de lettres avec la municipalité de Saint-Tropez, le 22 mai 1784, lorsque la ville cherche à obtenir son accord pour commander un buste à sa gloire. « C’est une grande satisfaction d’être célèbre dans le pays où pour la première fois on a été sur la mer. » Archives municipales de Saint-Tropez.
- Rémi Monaque, op. cit., p.30.
- Ce qui semble prouver, selon Rémi Monaque, que Suffren a passé l’essentiel de son enfance avec sa nourrice et les bandes d'enfants de Saint-Cannat et de Richebois, plutôt qu’en compagnie de ses parents ou dans les salons de la bonne société aixoise. Ibidem.
- Aujourd’hui oublié, l’essor du commerce colonial français des années 1730–1740 frappait tous les observateurs de l’époque, « objet de la jalousie des Anglais et des Hollandais » note en 1746 le lointain roi Frédéric II de Prusse. Anecdote rapportée par André Zysberg, La monarchie des Lumières, 1715–1786, Nouvelle Histoire de la France moderne, Point Seuil, 2002, p. 213.
- Il s’agit de la guerre de l’oreille de Jenkins, du nom d’un capitaine anglais qui avait eu une oreille coupée par les douaniers espagnols pour cause de contrebande. L’homme était venu exhiber son oreille coupée devant le Parlement pour enflammer le nationalisme anglais contre l’Espagne ; avec succès car la guerre avait été déclarée par Londres (juin 1739). Mais le conflit, après un succès de la Royal Navy avec la prise de Porto Belo à Panama en novembre 1739, se traînait en longueur. La Royal Navy échouait devant Carthagène puis Santiago de Cuba, ces échecs faisant même chuter le gouvernement anglais en 1742. André Zysberg, op. cit., p. 215 et 220.
- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe (XVIIe – XVIIIe siècles), Presses Universitaires de France, 1992, p. 484 et p. 503–504. Sur le déclenchement progressif de la guerre on peut aussi consulter l'article Histoire de la marine française.
- À cette date (1744), la Royal Navy dispose à peu près de 120 vaisseaux et frégates alors que la marine française n’en dispose qu’un peu moins de 80.
- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 81.
- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 80
- Rémi Monaque, Suffren : un destin inachevé, Éditions Tallandier, 2009.
- C’est un valeureux combattant des guerres de Louis XIV. Il a participé à la bataille de Bévéziers en 1690. Étienne Taillemite, Dictionnaire, op. cit.
- La Royal Navy « semble rouillée » note André Zysberg, La Monarchie des Lumières, op. cit., p. 220. Rémi Monaque fait la même remarque, en reprenant l’historiographie britannique. Rémi Monaque, op. cit., p. 36.
- Dont le navire amiral le Namur de 90 canons et le Marlborough qui coule. Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises, Jean-Claude Castex, Les Presses de l’Université Laval (Canada), 2004, p. 386–389.
- L’Europe, la mer et les colonies, XVIIe–XVIIIe siècle, Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, Carré Histoire, Hachette, 1997, p. 82.
- Jean Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas était ministre de la Marine depuis 1723. Il avait favorisé la carrière de nouveaux constructeurs navals et rationalisé les constructions. Conscient que la France ne pouvait pas rattraper le retard numérique pris sur la Navy, il voulait compenser cet écart par la supériorité technique. Il avait poussé à un début de standardisation des constructions avec les vaisseaux de 64, 74 et 80 canons, dotés d’une coque de chêne plus large et d’une puissante artillerie pouvant tirer par gros temps car un peu plus haute sur la ligne de flottaison. Cette innovation permettait aux vaisseaux français d’affronter sans complexe les trois-ponts anglais de 80-90 canons qui devaient garder fermée leur batterie basse par mer formée, sous peine d’embarquer des paquets de mer par les sabords. Les Anglais, trop confiants dans leur supériorité numérique n’avaient pas vu ces innovations et ne s’en rendront compte qu’en 1745–1746. Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, ibidem, p. 78–79.
- En oubliant au passage que sans la présence de la flotte française jamais l’escadre espagnole n’aurait pu sortir de Toulon. Court de La Bruyère fut disgracié pour complaire à Madrid. Rémi Monaque, op. cit., p. 36.
- Rémi Monaque, ibidem, p37.
- « La question, connait-il les coupables ? A répondu que non, mais qu’il vit un grand nombre qui manquaient de leur poste mais qu’il ne peut les démêler ni savoir qui ils sont parce qu’il était nuit et ne les avaient pas entendus depuis ». Extrait du rapport établi par le commandement de la Marine à Dunkerque et par la commission d’enquête réunie à Brest à la fin de la campagne. Cité par Rémi Monaque, op. cit., p. 39.
- ibidem, p. 40.
- Patrick Villers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 83.
- Rémi Monaque, op. cit., p. 41.
- Maurepas organise deux convois en mai et septembre 1744. Le 14 mai 1745, Maurepas publie une ordonnance organisant les convois obligatoires sous peine de 500 l.t (livres tournois) d’amende pour le capitaine. En 1745, trois convois partent pour les Antilles (dont un de 123 voiles en septembre) et deux en reviennent. L’escadre de huit vaisseaux de Piosins protège l’arrivée à Cadix d’un convoi franco-espagnol de dix millions de piastres. En 1746, deux départs seulement, mais Hubert de Brienne de Conflans et Emmanuel Auguste Dubois de La Motte escortent sans perte 123 et 80 navires. La Galissonnière ramène 6 navires de la compagnie des Indes. En janvier 1747, Dubois de La Motte rentre avec le convoi des Antilles estimé à 40 millions de l.t, soit deux fois le budget de la Marine. La Marine de Louis XV remplit donc avec brio et efficacité ses missions au nez et à la barbe de la Royal Navy. Patrick Villiers Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 86–87.
- La Belgique actuelle. L’armée française y récolte un magnifique chapelet de victoires : Fontenoy (11 mai 1745), où le maréchal de Saxe et Louis XV en personne écrasent l’armée du duc William Augustus de Cumberland, fils du roi d’Angleterre, à la bataille de Rocourt le 11 octobre 1746 contre les Autrichiens, et à la bataille de Lauffeld le 2 juillet 1747 encore une fois contre de Cumberland. Tous les Pays-Bas autrichiens étaient conquis et les Provinces-Unies menacée d’invasion avec la chute des forteresses de Berg-op-Zoom (16 septembre 1747) puis de Maastricht le (7 mai 1748), ce qui hâta les pourparlers de paix. Lucien Bély, op. cit., p. 506–513.
- Patrick Villiers Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 84–85.
- Jacques-Pierre de Taffanel de La Jonquière (1685-1752) était un capitaine expérimenté qui avait commencé sa carrière sous Louis XV. Il avait participé à l’expédition de Rio de Janeiro en 1711 au côté de Duguay-Trouin. C’était aussi un habitué des missions d’escorte. Étienne Taillemite, op. cit. Avec six vaisseaux de ligne il doit affronter les quatorze vaisseaux anglais de George Anson. L’escorte française, qui se jette sur l’escadre anglaise pour lui couper la route, est anéantie et La Jonquière capturé. Sacrifice en partie inutile car la Royal Navy réussit à saisir 24 navires de transport de troupe, trop lents, sur les 40 du convoi. Six frégates françaises réussissent à accompagner les seize navires restants à leur destination finale, le Canada, qui reçoit ainsi quelques renforts. C’était une lourde défaite, malgré le courage des équipages qui avaient soutenu un long combat en situation de grande infériorité. Patrick Villiers Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 85.
- Les deux batailles ont lieu à peu près au même endroit, au large du Cabo Finistera, c’est-à-dire au nord-ouest de l’Espagne, région de la province de la Galice (et non pas de la Bretagne comme pourrait le laisser croire le nom). Notons que la bataille du cap Ortegal est appelée aussi bataille du cap Finisterre par certains historiens, ce qui peut prêter à confusion, avec deux batailles du même nom la même année au même endroit... D’après Jean-Claude Castex, Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises, Presses de l’Université de Laval, (Canada) 2004, p. 81–86.
- Henri-François Desherbiers, marquis de Létanduère (1682-1750) était un valeureux capitaine, qui avait fait ses preuves dans de nombreux combats sous Louis XIV et dans de nombreuses missions d’exploration hydrographiques aux Indes et au Canada dans les années 1710–1730. C’était un habitué des missions d’escorte. Étienne Taillemite, op. cit
- Citons pour mémoire les sept autres vaisseaux : l’Intrépide (74 canons), le Trident (64 canons), le Terrible (74 canons), le Tonnant, vaisseau amiral (80 canons), le Severne (56 canons), le Fougueux (64 canons) et le Neptune (68 canons). D’après Charles Marie Cunat, Histoire du bailli de Suffren, 1852, Rennes, imprimerie de A. Marteville et Lefas.
- Saint-André détaille les pertes chez les officiers et cite ceux qui « ont rempli leurs devoirs avec toute la bravoure imaginable ainsi que Messieurs les gardes de la marine. M. de Suferin (sic) leur commandant a une légère blessure au côté. » Lettre du 10 novembre 1947 au ministre depuis Plymouth. B.N., Manuscrits, collection Margry, NAF 9431.
- Louis-Philippe de Rigaud, marquis de Vaudreuil (1691–1763) était un brillant capitaine resté victorieux à chacun de ses engagements. Il avait participé à la bataille du cap Sicié en 1744 avant de s’illustrer au cap Finistère. Étienne Taillemite, op. cit.
- Notons que les Anglais, qui pratiquent aussi la politique des convois, sacrifient toujours le convoi marchand au profit de l’escorte. Cette politique leur permet de maintenir leur supériorité numérique. À l’inverse, la France a perdu douze vaisseaux de guerre dans ces deux batailles de 1747, mais ce sacrifice lui a permis de maintenir son commerce colonial. Les océans n’étaient pas encore anglais. Jean-Pierre Duteil, Patrick Villiers, op. cit., p. 85.
- Rémi Monaque, op., cit., p. 43.
- Ibidem, p. 44. Rémi Monaque compare au passage son comportement à celui de Nelson, qui lui refusera toute sa vie par sentiment anti-français d’en apprendre le moindre mot.
- Archives de Malte, ARCH 3629. Rappelons que la mère des deux enfants, Hiéronyme de Bruny est la fille d’un riche marchand marseillais récemment anobli, et que ses ancêtres ne peuvent en aucune manière prétendre à la noblesse. Voir le début de l’article, sur les origines de la famille Suffren.
- Le résultat de cette enquête, daté de 1746, est conservé aux Archives des Bouches-du- Rhône, fonds de Malte, dossier 432.
- Le dossier comporte plusieurs contrats de mariage remontant au XVIe siècle, ibidem.
- Acte reçu par maître Jean, notaire royal d’Aix-en-Provence, le 3 mars 1746, Archives de Malte, ARCH 3629, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.60.
- Voir le début de l’article sur les origines des Suffren.
- Dossier de l’enquête, Rémi Monaque, ibidem. Ils ont même eu recours à des interrogatoires secrets.
- Les clichés vis-à-vis des Méditerranéens ne sont pas une tendance culturelle récente... Suffren aurait été insulté par le chevalier de Ploesquellec, issue d’une vieille famille bretonne à la noblesse prouvée jusqu’au XIIIe siècle. Jean de la Varende, Suffren et ses ennemis, Paris, éditions Flammarion, 1948, p.25.
- Les duels sont normalement interdits, sous peine de perte de l’habit, et de lourdes peines de prison pour le survivant s’il ne bénéficie pas d’une protection. Mais en refusant de se battre pour défendre son honneur Suffren aurait encouru le mépris général, y compris de ses supérieurs. Rémi Monaque, op. cit., p.65.
- Il a repoussé un long siège et a massivement participé à la bataille de Lépante
- Extrait des Reflexions d’un Chevalier de Malte par le chevalier de Cany, 1689, Archives nationales de Malte, manuscrit LIBR. 324., cité par Rémi Monaque, op. cit., p.66.
- Doublet, Pierre-Jean-Louis-Ovide, Mémoires historiques sur l’invasion et l’occupation de Malte par une armée française en 1798. Paris, Firmin Ddot, 1883.
- Rémi Monaque, op. cit. p.67.
- On ne peut entrer ici dans le détail d’un traité de paix international qui concerne aussi l’Autriche, la Prusse, les États italiens. Retenons cependant que la France et l’Angleterre concluent en 1748 la paix sur la base de restitutions réciproques. Louis XV retrouvait Louisbourg (prise en 1745, voir plus haut), et l’Angleterre Madras, l'un des ses principaux ports et comptoirs en Inde (dont les Français Dupleix et La Bourdonnais s’étaient emparés en 1746). André Zysberg, op. cit., p.236-237. Il était cependant temps que la guerre se termine, le niveau de pertes de 1747-48 étant tout simplement intenable. De 79 vaisseaux et frégates en 1745, on était tombé à 50 en 1748. 23 vaisseaux et frégates avaient été pris, coulés, naufragés lors des deux dernières années de la guerre, soit les trois quarts des pertes.
- 40 millions de livres. « Nous l’échappons belle » écrit le comte de [[Philip Stanhope (4e comte de Chesterfield)|Chesterfield]] après la signature des préliminaires de paix. Cité par André Zysberg, op.cit., p.237.
- Une prospérité éclatante qui s’appuie sur le trafic colonial avec les « isles » de Saint-Domingue, de la Guadeloupe et la Martinique. Les plantations de sucre étaient au cœur de ce trafic, mais il y avait aussi le café, l’indigo et le coton. Les études économiques récentes tentent à montrer que vers 1750 le revenu des Antilles françaises dépassait celui des Antilles anglaises. Une active contrebande du sucre et de l’alcool se développait aussi entre les îles françaises et les colonies anglaises d’Amérique car ces produits avaient un coup de production moins cher dans les îles françaises. Autant dire qu’il y avait de quoi exaspérer le puissant lobby colonial et marchand de Londres. André Zysberg, op. cit., p.243. Patrick Villiers, op. cit., p.115.
- Et de s'appuyer sur une alliance avec une puissance maritime pour apporter une vingtaine de vaisseaux et obtenir ainsi une balance navale presque équilibrée. Il pense sans le dire à l'Espagne. Patrick Villiers, op. cit., p.96.
- Jean Meyer et Martine Acerra. Histoire de la Marine française, des origines à nos jours, Éditions Ouest-France, 1994, p.94.
- Martine Acerra, Jean Meyer, op. cit., p.109.
- Elle supprimait la catégorie des trois-ponts de 80 canons trop courts, peu manœuvrant, moins bien armés et plus chers que les 74 canons à deux ponts des Français. Ainsi naissait la Valliant class de 74 canons à deux ponts copiée sur l’Invincible et qui allait rester la norme jusqu'en 1815. André Zysberg, Martine Acerra, L’essor des marines de guerre européennes, 1690-1790, SEDES, 1997, p.68. Ces « marines » (le mot, d'origine française a perduré jusqu'à aujourd'hui) aident aussi aux canons et tirent au fusil en combat rapproché. Ils permettent, pour finir, de tenir plus soigneusement les équipages en prévenant toute tentative de mutinerie. Patrick Villiers, op. cit., p.94-95.
- Il s'agissait des « Articles of War », code qui restera en vigueur jusqu'en 1865. Patrick Villiers, Ibidem.
- Le Parlement anglais vote en mars 1755 un crédit de 1 million de livres "afin de sauvegarder les justes droits et les possessions de la Couronne en Amérique". Cité par André Zysberg, op. cit., p.245.
- Elles passent de 17,7 millions de l.t (livres tournois) en 1754 à 31,3 millions de l.t en 1755, 40 millions en 1756, 39 millions en 1757, 42,3 millions en 1758, 56,9 millions en 1759. Chiffres donnés par Patrick Villiers, op. cit., p.91.
- André Zysberg, op. cit., p. 245.
- Comme le navire amiral l’Entreprenant de Dubois de La Motte et le vaisseau le Défenseur. Dubois de La Motte était un capitaine expérimenté qui avait commencé sa carrière sous Louis XIV. Il avait lui aussi participé à la grande expédition de Duguay-Trouin sur Rio en 1711 et avait rempli avec succès ses missions d’escorte pendant la guerre de Succession d’Espagne. Étienne Taillemite, op. cit.
- Anecdote rapportée par Lucien Bély, op. cit., p. 521.
- Preuve s’il en est de l’importance qu’avait pris le commerce colonial dans l’économie française. Le duc de Croÿ note dans son journal que « cette nouvelle mit la consternation, surtout par les suites que l’on sentit lors. Je passais devant la bourse, où je descendis pour la première fois. J’y appris la confirmation de la nouvelle et l’on s’attendait à tout voir dégringoler, surtout les actions : elles tombèrent tout d’un coup ». Cité par André Zysberg, op. cit., p. 246.
- L’expression est employée par André Zysberg, op. cit., p. 244.
- C’est le « Grand dérangement », qui semble avoir touché la moitié de la population de l’Acadie. Une partie se réfugie en Louisiane, mais surtout en France, dans le Poitou, en Bretagne et en Normandie. Une petite partie revient en Acadie. Voir aussi l’article sur la déportation des Acadiens.
- Instructions données en juillet et août 1755 aux amiraux anglais. Elles sont secrètes, la paix restant encore la ligne de conduite officielle du gouvernement. Louis XV, Michel Antoine, éditions Hachette, collection Pluriel, 1989, p.671.
- Le vaisseau, inutilisable est ensuite brûlé par les Anglais. Son commandant, le vicomte de Bouville, refuse sa liberté, déclarant avoir été la proie de pirates et offre avec hauteur une rançon. Il restera pendant deux ans dans les prisons anglaises. Rémi Monaque, op. cit., p.48. L’historien Michel Antoine, qui analyse dans le détail la politique anglaise en 1755 donne raison deux siècles après au malheureux vicomte de Bouville en parlant lui aussi d’acte de piraterie de la part de la Royal Navy. Michel Antoine, op. cit., p.671.
- Michel Antoine, ibidem.
- La population, fatiguée de la domination anglaise accueille les Français en libérateurs. Lucien Bély, op. cit., p. 539.
- 38 morts et 175 blessés côté français, dont 10 tués et 9 blessés sur l’Orphée ce qui est un pourcentage très supérieur aux pertes des autres navires. Les Anglais ont des pertes voisines mais ont perdu deux capitaines. Rémi Monaque, op. cit., p.51.
- Lettre du 3 août 1756, cité par Rémi Monaque, ibidem., p.52. La Galissonière meurt peut de temps après, le 26 octobre 1756 sur la route de Versailles alors que Louis XV s’apprêtait à faire de lui un maréchal de France. Étienne Taillemite, op. cit.
- Une belle victoire du marquis de Montcalm avec 3 000 hommes et ses alliés indiens. Fort Oswego était « dix fois plus important que Minorque » soutenait le ministre Horace Walpole. Lucien Bély, op. cit., p. 539.
- Dans une atmosphère d’exaltation nationale anti-française que l’on a du mal à imaginer aujourd’hui (d’autant que c’était l’Angleterre qui avait provoqué le guerre). Le château de Byng était pillé par la foule en furie. Commentaire de Voltaire après l’exécution de Byng : « Dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. » Tout était dit. Cité par Martine Acerra et André Zysberg, L’essor des marines de guerres. op. cit., p. 204-205.). Ironie de l'histoire : Byng était fusillé sur le HMS Monarque, ex Monarque français capturé en 1747 à la bataille du cap Finisterre et sur lequel avait combattu le jeune Suffren.
- « Pitt devient ainsi un véritable ministre de la Guerre, dictant une stratégie de lutte globale contre la France sur tous les espaces maritimes et coloniaux où il déploie les vaisseaux et les soldats de marine au service de sa glorieuse majesté britannique. » André Zysberg, op. cit., p. 252-253 et Lucien Bély, op. cit., p. 539 et 547.
- Elles ne cessent pas en 1756, 1757, 1758, au plus près des côtes françaises. Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.103.
- Les deux navires faisaient partie d’une division de trois vaisseaux et une frégate commandée par le marquis de Duquesne de Menneville. Le troisième vaisseau s'échoue.
- Londres avait envoyé une grande escadre de 17 vaisseaux et 16 frégates avec 15 000 soldats. En face, Dubois de La Motte rassemblait trois escadres parvenues à Louisbourg : 18 vaisseaux, 15 frégates et 11 000 soldats. Les Anglais n'osèrent pas attaquer. C'est la dernière grande opération navale victorieuse de la marine française dans cette guerre. André Zysberg, op. cit., p. 257.
- L’épidémie s’était déclarée pendant le retour de l’escadre de Dubois de La Motte de Louisbourg. Le 23 novembre 1757 il avait débarqué 5 000 malades qui contaminèrent toute la ville et ses environs en firent entre 10 et 15 000 morts. Jean Meyer, Martine Acerra, op. cit., p. 106.
- Ce sont des opérations de diversion de grande envergure qui ont pour but d'entretenir une insécurité permanente sur les côtes françaises en multipliant les coups de main dévastateurs et en fixant le maximum de troupes françaises sur les côtes. L'île d'Aix est ainsi brièvement occupée entre le 20 et le 30 septembre 1757, mais sans rien oser entreprendre contre Rochefort. Le 18 juin 1758, ce sont 15 000 Anglais qui débarquent à Cancale et à Paramé où ils détruisent 80 navires marchands. Le 7 août, c'est Cherbourg qui est victime d'un raid dévastateur de 10 000 tuniques rouges. La ville, qui armait au commerce, à la guerre et à la course est mise à sac avec toutes ses installations portuaires. En septembre 1758, les Anglais débarquent près de la cité corsaire de Saint-Malo, avec la claire intention de lui faire subir le même sort qu'à Cherbourg. La défense vigoureuse du gouverneur de Bretagne rejette cependant les envahisseurs à la mer avec de lourdes pertes, mais l'émoi est considérable. En juillet 1759, la Royal Navy vient bombarder Le Havre. Au printemps 1761, ce sera encore Belle-Île qui sera saisie par les Anglais et conservée jusqu'à la fin de la guerre. A Zysberg, op. cit., p. 265-266.
- Plus de 45 000 hommes embarqués sur plus de 330 bateaux. Un plan superbe sur le papier, mais qui ne tenait déjà plus compte de l'état réel de la flotte. (Béranger et Meyer 1993, p. 231).
- Jean-Pierre Duteil, op. cit., p. 103.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.55.
- Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d'Histoire Maritime, op. cit., p.827-828.
- Le second de La Clue qui a pris le commandement, parle lui de 25 tués et 40 blessés graves, ce qui semble sous-estimé, vu la violence de l'engagement. Les Historiens ne sont pas tous d'accord non plus sur le récit des combats, puisque selon Rémi Monaque, c'est le Centaure qui endommage gravement le HMS Namur, et non l'Océan contrairement au récit qu'en fait Jean-Claude Castex et que nous avons cité en premier ici. Écart de compte-rendu qui ne change guère le fil de la bataille cependant.
- Le premier pour les Canaries, le second pour Rochefort. Il s'agit d'un acte caractérisée de désertion qui ne sera jamais sanctionné.
- Jean-Claude Castex, Dictionnaire..., op. cit., p. 223–226.
- Il semble possible aussi que l’ordre de destruction n’ait pas été exécuté. Là encore, le récit diverge quelque peu d’un historien à l’autre, ce qui ne change pas grand-chose au drame.
- Deux vaisseaux français sombrent car on a laissé ouvert les sabords de la batterie basse alors que les deux unités étaient très inclinées. Plusieurs vaisseaux abandonnent froidement leur chef et se sauvent avant le combat. Deux vaisseaux sont pris, deux autres, dont le Soleil Royal, le navire amiral sont incendiés à la côte. Les survivants se réfugient dans l’entrée de la Vilaine ou à Rochefort. La marine anglaise peut ainsi accentuer son blocus, même si la victoire des Cardinaux lui a tout de même coûté deux vaisseaux, mais pas sous le feu des Français, les deux unités s’étant fracassées sur des rochers dans les eaux dangereuses du golfe de Quiberon.
- L’Espagne, exaspérée par le viol du pavillon neutre, les attaques des corsaires anglais sur son commerce en temps de paix et qui cherche à récupérer Gibraltar, avait rejoint Versailles dans la lutte, après des négociations particulièrement tortueuses. C’était le « Pacte de famille » signé entre les Bourbon de Madrid, de Versailles, de Parme, de Naples, de Sicile. Mais à Versailles comme à Madrid on s’était illusionné sur la puissance de la flotte espagnole. André Zysberg, op. cit., p. 275-278.
- Sur l’instant, c’est ce qui paraît le plus important : conserver les bases de la prospérité commerciale, qui de fait, va repartir rapidement avec la paix. La compagnie des Indes peut relancer ses activités depuis les Mascareignes, tout comme les négriers et négociants de Bordeaux et Nantes avec les Antilles (et surtout Saint-Domingue, l’île la plus prospère). Le Canada, qui coûtait très cher à défendre avant la guerre et ne rapportait pas assez avec le modeste commerce des fourrures n’est guère regretté, d’autant que les droits de pêche à l’entrée du Saint-Laurent restent maintenus. À Versailles, on a su profiter de la chute du gouvernement Pitt en 1761 -que le nouveau roi ne supporte pas et qui est devenu impopulaire à cause de son autoritarisme et des impôts de guerre- pour négocier habilement avec le peu d’atout dont on disposait. Les objectifs de Pitt en 1757 – la destruction totale de l’Empire français – ne sont donc qu’à moitié réalisés. L’opinion publique anglaise ne s’y trompe pas et critique fortement le traité. Louis XV, très généreux, (et qui tient à conserver le Pacte de famille) a cependant cédé la Louisiane aux Espagnols pour les indemniser de la perte de la Floride que Londres a conservé contre la restitution de Cuba et des Philippines. Patrick Villiers, op. cit., p.112-113, André Zysberg, op. cit., p.278-280.
- Patrick Villiers, op. cit., p. 103.
- Cité par André Zysberg, op. cit., p. 280.
- Lettre du 6 novembre 1760, A.N. Marine, C1 39.
- Étienne François de Choiseul est ministre de la Marine et de la Guerre. Il contrôle aussi les Affaires étrangères grâce à son cousin Choiseul-Praslin. Très influent et populaire, il joue le rôle d'un véritable Premier ministre auprès de Louis XV.
- En 1762 la flotte française n’a plus que 47 vaisseaux et 20 frégates, alors que la Royal Navy aligne 145 vaisseaux et 103 frégates. André Zysberg, ibidem, p. 379.
- Il y en a pour 18 millions de l.t., soit à peu près l’équivalent d’une année de budget de la Marine. Tous les vaisseaux sont construits entre 1763 et 1766. Ils vont porter le nom de ceux qui les ont financés. Ainsi nait la Ville de Paris (104 canons, futur navire amiral), la Bretagne (100 canons), le Bourgogne et le Marseillais (74 canons chacun), le Saint-Esprit (80 canons, don des chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit), la Ferme (don des fermiers généraux). Jean Béranger, Jean Meyer, op. cit., p.240-243.
- Cité par Jean Béranger, Jean Meyer, op. cit., p.239.
- Il fait donner la bastonnade à un malheureux capitaine français sous prétexte qu’il a combattu l’un de ses corsaires, ordonne que le consul de France soit mis à la chaîne et aux travaux publics en compagnie de son chancelier et du vicaire apostolique, et pour finir, menace de mettre la main sur les deux comptoirs commerciaux français de La Câle et de Bône. Rémi Monaque, op. cit., p.84.
- Lettre du 16 octobre 1763, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.84.
- « Le plan des croisières que vous établissez par ce mémoire me paraît bien concerté et j’ai vu avec satisfaction qu’il ne diffère qu’en très peu de choses de celui qu’on a proposé de faire suivre aux vaisseaux et autres bâtiments qui seront employés contre ces corsaires si les circonstances l’exigent. Ainsi je ne peux que vous savoir gré de m’avoir fait part de vos réflexions sur un objet aussi intéressant dans la circonstance d’une rupture avec cette régence. » Lettre de Choiseul du 18 novembre 1763, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.85.
- Neuf constructions entre 1750 et 1759, quatre en 1762, Rémi Monaque, op. cit., p.83.
- Sur la fin des galères françaises, voir l'article Arsenal des galères à Marseille.
- Burlet René, Les galères au Musée de la marine, Voyage a travers le monde des galères, Presses de l’Université de Paris Sorbonne, Paris, 2001.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.87.
- Mémoire du roi du 22 mars 1765 pour servir d’instruction à M. Du Chaffault, B.N. Manuscrits, Collection Margry, BAF 9431. Ce marin aujourd'hui oublié (1708-1794), était l'un des meilleurs capitaines de Louis XV. Il s'était illustré dans les missions d'escorte pendant la Guerre de Sept Ans où il était sorti victorieux de plusieurs combats contre la Royal Navy. Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français. op. cit.
- Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d'Histoire Maritime, éditions Robert Laffont, collection Bouquins, 2002, p.838.
- Les chemises soufrées, utilisées pour mettre le feu au navire ennemi n’ont pas fonctionné correctement. Rémi Monaque, op. cit., p.90.
- François Dessertenne, « L’affaire de Larache, 27 juin 1765 ». Revue Historique des armées, n°1, 1987. Le rapport de Suffren sur cette opération a hélas été perdu. Rémi Monaque, op. cit., p.89.
- B.N., Collection Margry, BAF 9431.
- Lettre du 30 janvier 1766, Archives Nationales, fond marine, B4 109, fol. 229. Prudent, il sollicite aussi un commandement pour les colonies, si aucune de ses demandes n’est satisfaite.
- Le Sultan, qui est un souverain habile a déjà signé des traités de commerce avec le Danemark, l’Angleterre, la Suède et Venise. Avec la France, le traité prévoie la libre navigation des navires français et marocains et leur libre accès dans les ports de ces pays. Des tarifs douaniers sont instaurés, un consulat de France est ouvert à Salé, des dispositions sont prises pour le rachat et la libération des captifs français détenus au Maroc. Rémi Monaque, op. cit., p.94. Suffren en aurait profité pour tracer des plans des côtes du Maroc et surtout de l'Algérie en vue d’une future invasion. Bulletin de la Société de géographie, 2e série, t. XIV.
- A cette date il est reçu par Choiseul-Praslin, qui a récupéré le portefeuille de la marine que lui a cédé entre-temps Choiseul en échange des Affaires étrangères...
- Rémi Monaque, ibidem.
- Lettre du 3 octobre 1769, depuis Toulon, Archives Nationale, Marine, C7 314, plaquette no 1.
- Archives de Malte, ARCH 6430, l’Italien étant la langue de l’Ordre. Cités par Rémi Monaque, op. cit., p.71.
- Rémi Monaque, ibidem, mais qui prend bien soin de préciser qu’il s’agit d’une pure hypothèse.
- Le texte, en latin, a été traduit par le professeur Alain Blondy pour Rémi Monaque. Archives de Malte, ARCH 573, fol. 173 v°. La chapelle, quant à elle, a été détruite pendant la Révolution. Le bâtiment actuel, rue de La Palud, date de la fin du XIXe siècle. Rémi Monaque, op. cit., p.72.
- Les galères espagnoles sont expulsées de l’Atlantique au début du XVIIe siècle par les vaisseaux néerlandais, puis sont battues en Méditerranée pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648) et de Hollande (1672-1678) par les escadres de Louis XIII et de Louis XIV. Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.15, 21 et 25.
- « Ces immenses bâtiments manœuvrent tous à force de rames et on les fait mouvoir avec beaucoup de régularité. L’amiral marche le premier et les autres ensuite par ordre suivant leur rang. La mer était couverte par une multitude de bateaux et les murailles et fortifications de la ville remplis de spectateurs. Le port retentissait de tous côtés du bruit des canons auxquels répondaient les galères et les galiotes qui sortaient du havre (port). » John Brydon, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.74-75.
- Sur ces 300 hommes de chiourme, on compte 200 esclaves, 80 volontaires et 20 forçats. Au côté de Suffren se trouve aussi 24 chevaliers avec leurs laquais, 9 officiers, 4 conseillers de maistrance, 4 canonniers, 4 timoniers, 43 mariniers, 7 prouiers, 31 remplaçants pour la chiourme et 5 mousses. Composition donnée par Claire-Eliane Engel, « Les galères de Malte », Neptunia, n°73, 1964. La promiscuité est totale. L’odeur est épouvantable, presque tout le monde dors habillé, y compris chez les officiers.
- Rémi Monaque, op. cit., p.75.
- Extrait du Journal du chevalier de Villages, enseigne de vaisseau à bord de la Provence. Son journal se trouve dans les archives de Malte car, comme Suffren, il sert alternativement dans la marine royale et dans celle de Malte. La « Religion » est une autre appellation courante pour désigner l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, lequel est aussi couramment appelé, comme on le voit au début de l’extrait « ordre de Malte », sans doute par soucis d’abréviation. Archives de Malte, ARCH 780.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p. 76. La Turquie, suzeraine théorique du Bey de Tunis, est aussi en théorie une vieille alliée du roi de France contre l’Autriche. Mais la France et l’Autriche sont en paix et la Turquie est à ce moment-là en guerre contre la Russie pour la domination de la mer Noire, sans que la France ne réagisse pour l’aider... De son côté, le Bey, Ali II Bey fait courir depuis Tunis le bruit que les Chrétiens ont lancé une nouvelle guerre de religion pour s’emparer de pays musulmans, en citant précisément la guerre Russo-Turque, mais aussi les autres bombardements venus des puissances maritimes européennes. Précisons, pour finir sur ce point que les bombardements des villes d’Afrique du Nord en représailles aux captures par les corsaires musulmans ne sont pas une spécificité française, mais sont régulières depuis le XVIIe siècle. Toute l’Europe navale défile régulièrement pour bombarder les cités « barbaresques » : Anglais, Hollandais, Espagnols, Français, Danois, Vénitiens... Ces expéditions vont durer jusqu’au premier tiers du XIXe siècle. On rencontre même une escadre américaine en expédition sur Tripoli en 1803-1804 et en 1815. On peut consulter aussi l'article "Barbary Corsairs" (en anglais)
- 31 Corses sont ainsi libérés. Sur le détail : les armateurs français doivent recevoir un dédommagement des préjudices causés. Le privilège de pêche est renouvelé à la Compagnie royale d’Afrique qui doit aussi recevoir une indemnité en raison de l’interruption du traité et du renvoi des bateaux. Le commerce entre les deux pays est rétabli et le blocus imposé aux ports tunisiens est levé. L’escadre française reste jusqu’au 24 octobre devant Tunis pour maintenir la pression sur le Bey jusqu’à la fin du processus de ratification du traité de paix. Rémi Monaque, op. cit., p.79.
- Rémi Monaque, op. cit., p.74.
- Un rameur doit consommer 7 à 8 litres de liquide par jour pour soutenir ses efforts sous le soleil. Compte-tenu de sa taille, la galère ne peut emporter que pour 7 jours d’eau fraîche. Contrairement à l’idée que l’on s’en fait sous l’effet des vieux films hollywoodiens, le fouet sur le dos de la chiourme enchaînée -même s’il est réellement présent à bord- n’est pas le moteur essentiel de la galère, mais c'est la qualité de la nourriture et de l’eau, même si le sort de la chiourme reste tout sauf enviable. Calcul fait par René Burlet, « Les galères du musée de la marine », Neptunia n°174, 2ème trimestre 1989. On ne meurt pas de scorbut à bord des galères. C’est sans doute le seul point positif que ce navire conserve par rapport au vaisseau de ligne.
- Un seul témoignage nous est parvenu sur Suffren à propos de cette expédition. Il est anecdotique et nous est donné par un enseigne de vaisseau français qui arrive à Malte le 9 octobre 1770, juste après les opérations. Il se plaint de la froideur avec laquelle le bailli de Flachslanden, général des galères, reçoit les chébecs français en escale, mais raconte-t-il : « Monsieur le chevalier de Suffren qui commandait une galère mouillée à proximité fut autrement plus aimable. Nous sommes descendus sur le quai où il nous attendait et où il nous a fait servir des glaces. En le quittant, sa galère nous salua de cris appuyés de "Vive Saint-Jean". » Extrait des Journaux de campagne de Toussaint de Lambert (1740-1799). Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.80.
- Lettre du 21 septembre, B.N., Manuscrits, collection Margry, NAF 9431.
- Lettre de Bourgeois de Boynes du 13 janvier 1772, B.N., Manuscrits, collection Margry, NAF 9431. On note que Suffren, prudent a pris langue dès le 10 mai avec le nouveau ministre arrivé en poste le 9 avril 1771.
- Lettre du 12 août 1772. Archives nationales Marine, C7 314, Plaquette n°1.
- Lettre du 28 octobre 1772, B.N. Collection Margry, NAF 9431.
- Rémi Monaque, op. cit., p.97.
- Lettre du 28 décembre 1772, A.N. B4 119.
- Lettre du 28 décembre. Ibidem.
- Lettre de De Blotfier du 5 avril 1773 à Suffren, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.101.
- Lettre de Suffren au ministre, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.344.
- L'historien anglais N. Rodger a calculé qu'au milieu du XVIIIe siècle un vaisseau anglais est en moyenne 60% du temps à la mer contre 15% pour un vaisseau français. Cité par P. Villiers et J.-P. Duteil, op. cit., p.104.
- Rémi Monaque, op. cit., p.103.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.104-105.
- Parmi les officiers en formation, elle embarque le jeune lieutenant de vaisseau Bruny d’Entrecasteaux qui s’illustrera plus tard en recherchant la mission Lapérousse, Ibidem.
- Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, éditions Perrin, 2005, p.374.
- Lettre du 21 novembre 1772. B.N. Manuscrits, Collection Margry, NAF 94 31.
- Rémi Monaque, op. cit., p.108. La France et l’Autriche sont alliées depuis le renversement des alliances de 1756. Outre les entretiens avec Louis XVI, Joseph II est venu rendre visite à sa sœur la jeune reine Marie-Antoinette.
- Lettre du 20 novembre 1777, A.N. Marine, B4 130, fol. 149.
- Archives de Malte, ARCH 6431.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.390.
- Cité par Jean-Christian Petitfils, ibidem.
- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.128 et Etienne Taillemite, Louis XVI ou le navigateur..., op. cit., p.150.
- Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, op. cit., p.401. Etienne Taillemite, Dictionnaire. op. cit.
- Rémi Monaque, op. cit., p.131.
- Rémi Monaque, ibidem, p.136.
- Voici sa composition : À l’avant-garde, le Zélé de 74 canons, le Tonnant (80 canons), le Provence (64), et le Vaillant (64). Le corps de bataille au centre : Le Marseillais (74), le Languedoc (90) navire amiral de d’Estaing, l’Hector (74), le Protecteur (74). l’arrière-garde : le Fantasque (64), le Sagittaire (50), le César (74), le Guerrier (74). Les frégates : l’Engageante (36), la Chimère (36), l’Aimable (32), la Flore (32) et l’Alcmène (32). D’après Charles Marie Cunat, op. cit., p.36.
- Cité par Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur, op. cit., p.154.
- « Le peu de connaissances qu’avait M. d’Estaing de ces mers, et son opiniâtreté surtout à ne vouloir suivre les conseils de ceux qui étaient plus instruits que lui, lui fit prendre la seule mauvaise route qui est celle de la latitude de 36°à 38° où règnent des calmes et des vents variables. M. D’Estaing était très méfiant et en tant qu’intrus dans le corps de la marine, il pensait qu’on devait le tromper » raconte François Palamède de Suffren, un cousin du bailli qui embarque comme enseigne de vaisseau sur le Fantasque. Mémoires inédits cités par Rémi Monaque, op. cit., p.139.
- Lettre du 5 aout 1778, A.N. Marine, B4 144.
- L'addition des navires détruits et cités dans la lettre de Suffren reproduite ci-dessus donne 6 frégates détruites, mais traditionnellement les historiens n'en retiennent que 5. Il est vrai que Suffren, un peu plus bas dans la lettre (le passage n'est pas cité ici) fait un total de 5, puis de 9, avec les informations transmises par Albert de Rion, ce qui complique un peu le décompte.
- Rémi Monaque, op. cit., p.145.
- D'après la page Wikipédia Languedoc (navire). C'est l'arrivée de Suffren qui aurait mis en fuite le vaisseau anglais.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.402.
- Cité par Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur..., op. cit., p.156.
- Rémi Monaque, op. cit., p.146.
- Lettre sans date de Suffren à d'Estaing, probablement de l'extrême fin du mois d'août ou de début septembre, puisque le bailli propose de lancer l'attaque vers le 8 septembre. A.N., B4, 144.
- Jean-Pierre Duteil, Patrick Villiers, op. cit., p.126.
- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.129.
- « Délibéré que Son Excellence monsieur le comte d’Estaing a constamment agi en brave et sage officier ; que Son Excellence, les officiers, matelots et soldats sous ses ordres ont rempli tout ce à quoi les États-Unis pouvaient s’attendre de l’expédition, autant que les circonstances et le genre de services l’ont pu admettre, et qu’ils ont tous de puissants titres à l’estime des amis de l’Amérique. » Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.149.
- Lettre du 19 décembre, écrite à bord du Fantasque, A.N. B4, 144. Extrait : « L’escadre française étant désarmée, elle n’est ni en état de manœuvrer, ni en état de combattre. Que serait-ce si l’escadre de l’amiral Byron arrivait ? Que deviendraient les vaisseaux surpris sans monde, sans général ? Leur défaite entrainerait la perte de l’armée et de la colonie. (...) Il est du devoir d’un capitaine à qui le roi a fait l’honneur de confier un vaisseau de représenter qu’ayant 150 hommes de moins de son équipage, il n’est ni en état de manœuvrer ni de combattre.»
- « Détruisons cette escadre. L’armée de terre [anglaise] manquant de tout dans un mauvais pays sera bien obligée de se rendre. Que Byron vienne après, il nous fera plaisir. » Ibidem.
- Rémi Monaque, op. cit., p.149.
- En 1782, c’est ici que la grande escadre de Rodney fera escale avant d’attaquer victorieusement les forces de De Grasse aux Saintes. Sainte-Lucie restera par ailleurs anglaise après la guerre. Ibidem, p.154-155.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.403.
- Extrait de la lettre du 5 janvier 1779 adressée à Madame d’Alais, citée par J.-S. Roux, Le Bailli de Suffren dans l’Inde, Marseille, 1862, p.17.
- Lettre du 8 février 1779, citée par J.-S. Roux, op. cit., p.18.
- Rémi Monaque, op. cit., p.155. L’addition des unités lui donne 23 vaisseaux, mais Jean-Christian Petitfils en compte 25, peut-être en y incluant les frégates. Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.403.
- Extrait du rapport rédigé par Suffren le 10 juillet 1779 sur le Fantasque. 62 hommes de son équipage sont tués ou blessés. Cité par J.-S. Roux, op. cit., p.21. Le plan d'engagement de la bataille nous indique cependant que le Fantasque est le deuxième sur la ligne, ce qui ne change cependant pas grand chose au déroulement du combat.
- Manuscrit de François-Palamède de Suffren, enseigne de vaisseau sur le Fantasque, op. cit., p.40.
- Il s’agit des HMS, Lion, Grafton, Cornwall et Monmouth. Jean-Claude Castex, op. cit., p.198-199.
- Rémi Monaque, op. cit., p.159.
- Extrait de la lettre écrite le 10 juillet à Mme de Seillans. Cité par J.-S. Roux, op. cit., p. 21.
- Cité par Jean-Claude Castex, op. cit., p.199. The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783. Little, Brown & Co, New York 1890, Dover Publications, 1987 (Repr.). ISBN 0-486-25509-3
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.404.
- « Le zèle, les talents et la valeur qui caractérise M. le commandeur de Suffren m'avait décidé à le charger de cette opération. Il regrette de n'avoir eu l'occasion de prouver son exactitude en la remplissant aussi promptement, et en empêchant qu'il ait été commis le plus petit désordre dans des lieux qui se rendaient à discrétion. » Lettre du 21 juillet 1779, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.160.
- Le Fantasque, l'Artésien, la Provence pour les vaisseaux, la Fortunée, la Blanche et la Chimère pour les frégates. Effectifs donnés par Rémi Monaque alors que la plupart des historiens ne donnent traditionnellement à cette division que 2 vaisseaux et 3 frégates. Rémi Monaque, op. cit., p.162.
- Charles Marie Cunat, op. cit., p.40.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.401.
- Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur..., op. cit., p.177.
- Martine Acerra, Jean Meyer, Histoire de la marine française... op. cit., p.122. Si aucun succès décisif n'a été enregistré, on peut malgré tout détailler les pertes infligées en navires, qui sont loin d'être symboliques : 6 frégates détruites ou brûlées, 12 corvettes ou corsaires qui subissent le même sort, 10 navires de guerre capturés avec 4 corsaires et 106 navires de commerce pour 2 405 000 livres tournois. Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.136.
- Lucien Bély, op. cit., p.623-624.
- Le HMS Ardent avait été capturé par les frégates Junon et Gentille. Le 9 octobre, au large d’Ouessant, la Surveillante du chevalier Charles Louis du Couëdic de Kergoaler avait mené un combat meurtrier contre le HMS Québec et qui s’était terminé par l’explosion du navire anglais. Le commandant français était lui mort de ses blessures quelques jours plus tard. Un monument lui fut dédié à Brest et le peintre Rossel de Quercy reçu commande d'un tableau du combat pour les écoles navales. Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.408-409.
- Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur, op. cit., p.180-183
- Etienne Taillemite, Dictionnaire..., op. cit.
- En mars 1780. Document cité par Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.429-430.
- Patrick Villers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.129.
- André Zysberg, La Monarchie des Lumières, op. cit., p.387.
- Courrier cité dans sa totalité par Charles Marie Cunat, op. cit., p.44. Sur le doublage en cuivre, on peut aussi consulter Martine Acerra, André Zysberg, L’essor des marines de guerre européennes..., op. cit., p.55-56. Suffren avait peu de temps avant cette affaire écrit au ministre pour pousser les Espagnols au doublage en cuivre : "On ne doit rien négliger pour engager nos alliés à faire de même : ils marchent si mal en général qu'il est vraiment impossible de faire la guerre avec eux avec quelques espérances de succès." Courrier cité par Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur, op. cit., p.139. Suffren préconise aussi d'équiper les vaisseaux de pompes à incendie, de doter les mâts du "conducteur électrique de M. Franklin" (paratonnerre) et d'avoir à bord 5 ou 6 canots.
- Lucien Bély, op. cit., p.626. Notons que l'Angleterre dispose de près de 30 000 hommes rien que dans le secteur voisin de New York.
- Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.130.
- Lettre du 11 février 1781, citée par Rémi Monaque, op. cit.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.429, Etienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, op. cit., Lucien Bély, op. cit., p.630.
- Propos non datés mais probablement de 1782-1783, rapportés dans l’ouvrage de Minnigerode Meade, Hommes de mer français, Paris, Payot, 1931, et repris par Rémi Monaque, op. cit., p.389. La taille a été calculée d'après les mesures anglaises, légèrement différentes des françaises pour les pieds et les pouces.
- Rôle du Héros, Archives du port de Toulon, 1 C 63.
- Op. cit., p.429.
- Raoul Castex, Les idées militaires de la marine du XVIIIe siècle, « Les traces de l'œuvre de Suffren », Revue maritime, t.1, 1911, p.357.
- Rémi Monaque, op. cit., p.111.
- Rémi Monaque, op. cit., p.176.
- Archives Nationales Marine, C7 314, plaquette n°1.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.309.
- Rémi Monaque, op. cit., p.125-126 et p.167.
- Lettre du 30 janvier 1766 à propos du Maroc, B4 109, fol. 197.
- Au retour de la campagne d’Amérique fin 1779 le Fantasque a été frappé par la foudre, faisant un mort et une soixantaine de blessés. Une forte odeur de soufre a fait penser un moment à un début d’incendie. François Palamède de Suffren raconte la réaction de son parent : « le bailli de Suffren qui avait vu trente combats dit qu’il n’avait jamais eu de sa vie un quart d’heure plus pénible ». Manuscrit de François-Palamède de Suffren, op. cit., p.43.
- Lettre du 17 octobre 1775 au chevalier d’Oisy, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.104. Lettre du 30 juillet 1775, Archives Nationales Marine, C7 314, plaquette n°1.
- Lettre citée par Rémi Monaque, op. cit., p.392.
- Archives des Affaires étrangères, Mémoires et documents, Asie 7, 16, 17, 18. Deux lettres du ministre seulement ont été retrouvées. Roger Glanchant, Suffren et le temps de Vergennes, Paris, France-empire, 1976.
- Le dossier contenant les lettres dormait dans les archives de Colombo sous la cote 1/3406 depuis plus de deux siècles. Rémi Monaque qui y consacre de longues pages de son ouvrage. Op. cit., Annexe IV, p.421-434.
- Théodore Ortolan, « Lettres inédites du bailli de Suffren », Moniteur universel, 1-2 et 5 novembre 1859.
- Rémi Monaque, op. cit., p.115.
- Lettre de 1866 à l’archiviste Margry, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.113.
- Au dire d’une lettre de Suffren écrite en 1786 où il dit à son amie « depuis 34 ans que vous avez dû me connaître », ce qui fait remonter la relation à 1752. Lettre conservée au musée Suffren de Saint-Cannat et publiée par Rémi Monaque. Selon Frédéric Mireur, qui le tient d'un de ses arrières-neveux qui l'avait ouï-dire à ses ascendants, Mme d'Alès « possédait tous les agréments de corps et d'esprit qui en faisaient une personne accomplie. Aux grâces de son sexe, elle joignait une intelligence très vive, non seulement des choses du monde, mais encore des évènements et des affaires ». Le portrait qu'il nous livre, une miniature, montre une jeune femme à la taille de guêpe, coquette, au regard vif, tenant dans sa main gauche un masque noir dans une tenue de bal d'une élégante simplicité. Ce portrait, à ce jour, n'a pas encore été numérisé. Frédéric Mireur, Les rues de Draguignan et leurs maisons historiques, t.VI, Draguignan, imp. Du Var, 1924, pp.126-131.
- L’acte de baptême de l’enfant et de décès du père figurent dans le même registre paroissial, à quelques jours d’intervalle. Paroisse de Fayence, Archives départementales du Vars, 7E59/5.
- Extraits cités par Rémi Monaque, op. cit., p.115.
- Rémi Monaque, op. cit., p.119. Ces affaires d'argent sont traitées en fin d'article, dans les paragraphes concernant la mort de Suffren.
- Anecdotes citée par Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.429.
- Margry rapporte cet entretien dans une note conservée à la Bibliothèque Nationale, Manuscrits NAF 9432.
- Op. cit., p.111.
- Dictionnaire d’Histoire Maritime, op. cit., p.1003.
- Rappelons que la plus célèbre mutinerie de la Royal Navy, celle de la Bounty n’a pas seulement pour cause l’autoritarisme du capitaine Bligh, mais aussi une rupture amoureuse entre lui et son second, Christian Fletcher.
- « Demander une place qui suppose les plus grands talents, c’est peut-être un excès d’amour propre. Si cette place exige le travail le plus assidu, l’application la plus constante, le sacrifice de sa liberté, s’offrir pour la remplir c’est donner une preuve de son zèle. C’est à ce titre que je m’offre pour remplacer le comte de Grasse dans la compagnie des gardes de Toulon. Vous serez sollicité, Monseigneur, pour une infinité de sujets, vous ne le serez point par moi. Je crois que pour un emploi de cette nature, l’on peut s’offrir, mais l’on ne doit point solliciter. Le mérite seul déterminera le choix d’un ministre juste et éclairé. Si vous daignez m’en charger, je prends l’engagement le plus solennel de me dévouer entièrement à l’éducation de la jeunesse, l’espérance de la marine. L’espoir flatteur de faire le bien de l’État en formant des sujets dignes de le servir me soutiendra dans cette pénible carrière. Le zèle suppléera aux talents. Je suis avec respect, Monseigneur, votre très humble et obéissant serviteur. » Signé : Le commandeur Suffren. Lettre du 12 août 1772. Archives nationales Marine, C7 314, Plaquette n°1.
- Anecdote donnée par Jean de la Varende en 1948, hélas sans citer ses sources. Op. cit., p.73.
- C’est lui qui raconte l’anecdote des décennies plus tard, lorsqu’il est devenu ministre de Louis XVIII. Vitrolles (baron de), Souvenirs autobiographiques d’un émigré, Paris, Emile-Paul Frères, 1924.
- Rémi Monaque, op. cit., p.178.
- « Je n’ai eu aucun malade et j’aurais la satisfaction de ramener tout mon équipage sans le malheur que j’ai eu de perdre le nommé Joseph Causse, fils à mon premier maître qui est tombé à la mer et qu’on n’a pu sauver. Ce jeune homme commençait à aider son père qui est chargé d’une nombreuse famille et qui par son zèle, sa capacité et une attention scrupuleuse aux intérêts du roi mériterait qu’on eût égard à sa triple situation en l’aidant, soit par une gratification, soit par tout autre moyen. » Extrait du rapport sur l’armement du Fantasque, le 20 novembre 1777. A.N., Marine, B4 130, fol.149.
- En raison de leur costume écarlate : veste, culotte, parement et même les bas.
- Ibidem, p.15, p.394.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.102.
- Louis XVI, op. cit., p.429.
- Rémi Monaque, op. cit., p.87.
- Ibidem, p.97.
- Lettre du 13 avril 1778, Archives Nationales Marine, B3 657, fol. 97.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.177.
- L'Espagne dispose de 64 vaisseaux en 1779 (mais 48 seulement sont armés), ce qui en théorie met la flotte ibérique presque au niveau de la marine française. Les vaisseaux espagnols, construits en bois de cèdre par les chantiers navals de La Havane sont très solides, mais aussi très lourds, lents et peu manœuvrant. Ces gros navires portent souvent plus de 100 canons, mais ceux-ci sont généralement d'un calibre inférieur à ceux utilisés par les Français et les Anglais. Cette artillerie est aussi de facture inférieure et s'enraye au bout d'une quarantaine de coups. Les équipages sont insuffisants, mal entrainés et souvent mal commandés. Étienne Taillemite, Louis XVI ou le navigateur immobile, op. cit., p.167-168.
- Sur ce paragraphe, on peut consulter le chapitre 7 de l’ouvrage d’Étienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur immobile, p.125-139 : « L’Espagne, allié ou poids mort ? ».
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.414-417.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.416-417
- Jean-Christian Petitfils, ibidem.
- En 1782, avec 189 millions de livres tournois pour la flotte, contre 118 millions pour l’armée. Le budget de la Marine, qui oscillait entre 20 et 25 millions de l.t. à la fin du règne de Louis XV passe à plus de 40 millions en 1777, puis 100 millions en 1779 et 110 millions en 1780 (155 avec le budget des colonies). André Zysberg, op. cit., p. 379-380.
- Au Canada et aux treize colonies. Chiffres cités par André Zysberg, La monarchie des Lumières..., op. cit., p. 387.
- Pour le seul budget de la marine, les dépenses anglaises passent de 105 millions de l.t. en 1777 à 207 millions en 1780. C'est grosso modo le double des dépenses françaises citées dans la note précédente), quelle que soit l'année. Jean-Pierre Duteil, Patrick Villiers, op. cit., p.130.
- Rémi Monaque, op. cit., p.181.
- Lettre du 17 mars 1781 à Suffren, Archives nationales, Marine, B4 216, fol.205.
- Martine Acerra et Jean Meyer, Histoire de la Marine..., op. cit., p.125.
- Rémi Monaque, op. cit., p.180
- Rémi Monaque, ibidem, p.177.
- Ibidem, p.178.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.182.
- Ibidem, p.183.
- Johnstone avait quitté Spithead le 13 mars. Il était là depuis 5 jours.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.311.
- "Her Majesty Ship" (Navire de Sa Majesté).
- « Persuadé fermement qu’on n’attaquerait pas les ennemis, il n’avait fait qu’un léger branle-bas ; des malades, des bœufs étaient encore dans les batteries et personne n'était à son poste qu'on tirait déjà sur le vaisseau ; on sent bien qu'il devint très difficile pour ne pas dire impossible de les y faire mettre sous un feu aussi vif et qui le devint encore plus lorsque les ennemis s'aperçurent qu'on ne leur ripostait pas ou du moins bien faiblement » note Suffren dans le journal de bord du Héros. NB : La présence d'animaux s'explique par les besoins en viande fraîche, œufs ou lait du bateau. Tous les vaisseaux de guerre emportent une véritable ferme et son fourrage, logée dans les ponts, au milieu des hommes et des armes. Rémi Monaque, op. cit., p.187.
- Cité par Rémi Monaque, ibidem, p.190.
- Rémi Monaque, op, cit., p.187.
- Les récits des historiens divergent au sujet de ces deux navires. Selon Rémi Monaque, Suffren ordonne à la corvette la Fine, d’amariner le navire anglais, mais la corvette qui s’estime trop faible pour mettre sur le navire un équipage de prise se contente de prendre à bord son capitaine avec 15 hommes et ordonne au navire de le suivre. Celui-ci ne tarde pas de s’échapper à la première occasion. Jean-Claude Castex ne signale pas la capture et la perte de ce bâtiment. L’autre navire saisit par l’Artésien n’a pas un meilleur sort. Cette fois, c’est l’équipe de prise, insuffisante, sans officiers et sans pilote qui est submergée par l’équipage anglais... Mais selon Jean-Claude Castex, c’est Suffren qui donne l’ordre d’abandonner la prise, ce qui aurait provoqué à une énorme fausse manœuvre : le capitaine de l’Artésien, trop pressé de se débarrasser du navire aurait coupé les liens en abandonnant à bord l’équipage de prise, soit 22 marins français qui sont fait prisonniers. Cette dernière version semble toutefois peu probable. Rémi Monaque, op. cit., p.188 et Jean-Claude Castex, op. cit., p.313.
- Rémi Monaque, op. cit., p.184.
- Rémi Monaque, ibidem, p.188.
- Jean Meyer, Martine Acerra, op. cit., p.126.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.430.
- Lettre du 10 août 1781, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.192.
- La neutralité portugaise est en fait largement favorable à l’Angleterre depuis les traités que les deux pays ont signé en 1702 lors de la Guerre de Succession d’Espagne. Les canons portugais n’avaient guère réagi pour protéger de la capture ou l’incendie les navires français réfugiés sur la côte lusitanienne.
- Mémoire du colonel Gordon du 15 septembre 1781, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.197.
- Rémi Monaque, ibidem, p.198-199.
- Cité par Jean Meyer, Martine Acerra, ibidem.
- Rémi Monaque, ibidem, p. 200.
- Avec 6 vaisseaux et 3 frégates La Motte-Picquet intercepte le 1er mai le convoi de Rodney chargé du pillage de Saint-Eustache et s’empare de 22 navires richement chargés. Etienne Taillemite, Dictionnaire... op. cit. Les anglais avaient un compte à régler avec cette île qui trafiquait avec les Révolutionnaires américains et qui leur vendait des armes. Ce qui explique sans doute l’acharnement du pillage, fait d’arme qui n’est guère à l’honneur de Rodney. L'île est aussi délivrée en septembre 1781 par un débarquement français sous les ordres du marquis de Bouillé.
- Bernard Fay, Louis XVI, ou la fin d’un monde, Amiot-Dumont, Paris, 1955, p.213. Il s'agit là d'une véritable petite révolution mentale lorsque l'on connait la hargne antifrançaise des Provinces-Unies depuis les guerres de Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes.
- Le 9 mai, pour la Floride, avec 5 vaisseaux français et 10 vaisseaux espagnols. Le 19 août pour Minorque, avec une grande escadre combinée de 20 vaisseaux français partis de Brest sous les ordres de Guichen et rejoints par 51 navires de transports de troupes espagnols, avec 18 vaisseaux d’escorte, 2 vaisseaux de bombardement et plus de 20 navires auxiliaires. Patrick Villiers, Jean-Pierre Duteil, op. cit., p.131 et la page Wikipédia (en anglais) « Invasion of Minorca, 1781 ».
- Une partie des villes et des pays de l'Océan indien ont changé de nom. Par respect historique nous conservons cependant les appellations du XVIIIe siècle.
- Rémi Monaque, op., cit., p.203.
- Lettre du 15 novembre 1781, citée par Rémi Monaque, ibidem, p. 204.
- Lettre du 4 décembre à Blouin, citée par Régine Pernoud, La Campagne des Indes, lettres inédites du bailli de Suffren, Mantes, imprimerie Du Petit Mantais, 1941. Suffren qui tient cependant à ménager d'Orves parlera plus tard, dans une lettre à De Castrie écrite après la bataille de Sadras de l'« excessive bonté » du vieux chef qui avait accoutumé ses capitaines à ne pas être commandés. Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.211.
- « Il est revenu à Sa Majesté que vous lui aviez ôté le commandement [à Morard de Galles] sur la représentation de ses anciens et qu'ils vous l'avaient demandé en vous annonçant qu'ils donneraient leur démission si leur ancienneté ne prévalait pas. Le roi n'a pu croire ni qu'une telle manœuvre ait pu vous être faite et encore moins que vous y ayez cédé... » Lettre du 8 avril 1782, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.204.
- « La victoire de M. de Suffren à St Iago (La Praya), avait donné de lui l’opinion la plus avantageuse. Elle produisit chez une foule de sujets de tout état un enthousiasme qui servit la cause publique. Un très grand nombre se proposèrent en qualité de volontaires, tant dans la marine, que dans les troupes de ligne, et furent acceptés en majeure partie » note un jeune officier de l’Ajax. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de 1780 des Français et des Anglais dans l’Inde. Chevalier Barthélémy Huet de Froberville, Blois, 1786, p.8.
- Lettre du 4 décembre 1781, citée par Régine Pernoud, op. cit.
- Les noms des navires qui s’agrègent à ceux arrivés de Brest : L’Orient (74 canons), le Sévère (64), le Bizarre (64), l’Ajax (64), le Brillant (64), le Flamand (56) pour les vaisseaux, la Pourvoyeuse (38), la Fine (36), la Bellone (32) pour les frégates, la Subtile (24) la Sylphide (12), le Diligent (10), le Pulvérisateur (6 ou 4 canons) pour les corvettes et les très petites unités (comme le Pulvérisateur qui est un brûlot). Notons que la corvette la Fortune (16) qui faisait partie de la division partie de Brest n’est plus signalée dans l’escadre ce qui indique sans doute qu’elle est repartie vers la France avec les dépêches. Le décompte des forces n’est pas facile, car les toutes petites unités ne sont pas toujours signalées par les historiens et les corvettes sont souvent par commodité rangées dans le classement des frégates, ce qui brouille les listes. Listes qui de toute façon changent sans arrêt car c’est le propre des petites unités d’aller et venir en mission de reconnaissance ou pour faire circuler les ordres. Composition fournie par Rémi Monaque, op. cit., p.207.
- Instructions parvenues à la fin du mois de juillet, avant l’arrivée de Suffren, et qui explique sans doute l’ordre de d’Orves (reçu au Cap le 15 août, voir plus haut) à Suffren de le rejoindre le plus vite possible. Mémoire du roi servant d’instructions pour MM. Le vicomte de Souillac (gouverneur de l’île) et le comte d’Orves A.N., Marine, B4 196, fol. 228.
- (Meyer et Acerra 1994, p. 128)
- Lucien Bély, op. cit., p. 629.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p. 430. Un officier français de cavalerie présent en Inde en 1782 en fait cette curieuse description : « D’une bonne taille, il est fort puissant quoique montant encore fort bien à cheval. Il a la figure pleine et très noire, l’œil méchant, fier et faux, souriant fort aisément et paraissant assez honnête. Il ne porte ni sourcil ni barbe et en guise de moustache une royale quasi imperceptible. Il se rase lui-même de peur d’être égorgé. » Bibliothèque Nationale, Manuscrits, NAF 9370.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.285.
- Rémi Monaque, op. cit., p.210.
- 217 matelots et 100 soldats, sans compter les officiers. Ce qui ne va pas sans mal, les autres navires renâclant à lâcher du personnel, et ne cédant que les plus mauvais éléments. Rémi Monaque, op. cit., p.212.
- Lettre du 23 novembre 1781, citée par Régine Pernoud, op. cit.
- Rémi Monaque, op. cit., p.213.
- Au risque aussi d’endommager la cohésion de celle-ci estime Rémi Monaque. Ibidem, p.241. Tromelin n’est cependant pas inquiété pour le commandement de l’Annibal.
- Il avait combattu à Toulon en 1744 comme Suffren, puis avait servi au Canada sous les Ordres de Boscawen à Louisbourg puis de Sauders à Québec. De 1773 à 1777, il avait commandé l’escadre britannique des Indes avant de rentrer brièvement en Angleterre puis de revenir servir sur le même théâtre d’opération avec le grade de contre-amiral. Rémi Monaque, op. cit., p.220.
- L’historien et amiral anglais G. A. Ballard y voit même une ruse de Suffren pour obliger Hugues à accepter une bataille, ce que rien dans les témoignages et archives de l’époque ne montre cependant. « The last Battlefleet struggle in the bay of Bengal », The Mariner’s Mirror, vol.13, 1927.
- Il y a plus de 1 000 scorbutiques d’après Jean-Claude Castex, op. cit., p. 339.
- Rémi Monaque, op. cit., p. 219.
- Compte-rendu de la bataille de mars 1782 au ministre, A.N., Marine, B4 207, fol.9.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.342.
- Jean-Claude Castex, ibidem, p.342.
- Rémi Monaque, op. cit., p.226.
- Lettre du 4 avril 1782, de Hugues à M. Stephens, A.N., Marine, B4 197, fol. 326.
- Chiffres cités par Rémi Monaque, (op. cit,. p.227), mais Jean-Claude Castex donne des pertes plus élevées, presque équivalentes à celles de la Navy, soit 130 tués et 364 blessés (op. cit., p.343), ce qui est possible aussi car la bataille a été très longue et fort discutée pour les navires engagés.
- Cité par Roger Glanchant, Suffren et le temps de Vergennes, Paris, France-Empire, 1976, p.289.
- Lettre du 6 février 1782, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.223.
- Rémi Monaque, ibidem, p.222.
- Ibidem p.225.
- Roger Glanchant, op. cit., p.281.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.224.
- Rémi Monaque, ibidem, p.227.
- Le chevalier Huet de Froberville en fait une triste description. Pondichéry « n’est plus maintenant qu’un bourg informe qui présente au milieu d’un tas de ruines quelques maisons éparses cà et là, qui sont encore le signe de son ancienne splendeur. Les fortifications sont détruites. Le gouvernement, l’intendance, quelques hôtels appartenant aux plus riches particuliers, sont toutes abandonnées, et ne sont plus l’asile que de misérables pêcheurs. » Op. cit., p. 31.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p. 343.
- Pour mémoire, rappelons que le 7 décembre 1781, l’escadre avait quitté l’île-de-France accompagnée de 10 navires de transport dont 1 aménagé en hôpital et embarquant à peu près 3 000 hommes de troupe et d’artillerie.
- Lettre du 1er avril 1782 à Vergennes, citée par Roger Glanchant, op. cit., p.291. Détermination affichée aussi dans la lettre du 12 mars 1782 au ministre de Castrie, A.N. Marine, B4 207, fol.9.
- Rémi Monaque, op. cit., p.231.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.315.
- Rémi Monaque, op. cit., p.233. La ligne anglaise s’engage comme suit : l’Exeter (64 canons), le Sultan (74), l’Eagle (64), le Burford (74), le Montmouth (64), le Superb (74) monté par Hughes, le Monarch (74, appelé aussi le Monarca), le Magnanime (64), l’Isis (56), le Hero (74), le Worcester (54). Jean-Claude Castex, op. cit., p.317.
- Jean-Claude Castex, ibidem.
- Compte-rendu du 16 avril 1782 au ministre de la marine, A.N. Marine, C7 314.
- « Je crus le vaisseau perdu » note le bailli dans son rapport. Ibidem.
- Ibidem. L’officier capturé, l’enseigne de vaisseau Goy de Bègue va rester prisonnier jusqu’à la fin de la guerre. Le Chevalier de Froberville explique la trêve entre les deux navires qui se sont abordés par la présence à bord de la Fine d’un important contingent de prisonniers anglais. Ces derniers, bien traités, se sont entremis entre les deux commandants. Op. cit., p.64.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.318.
- Ce tout petit port sur la côte est de Ceylan est d'une orthographe incertaine, en fonction des époques, des traductions, des cartes et des historiens. Il n'est pas rare de la voir orthographié "Baticaloa" ou "Baticaola" ou encore "Balacalo" comme sur cette carte ancienne publiée par histoire-genealogie.com
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.431.
- Lettre de Suffren à son ami Blouin du 23 avril 1782, publiée par Régine Pernoud, op. cit.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.238.
- Chiffres fournis par Rémi Monaque, ibidem.
- Extrait de la lettre de Suffren à son ami Blouin du 29 septembre 1782, citée par Régine Pernoud, op. cit.
- Rémi Monaque trouve des excuses à ces officiers en arguant du caractère très difficile de Suffren qui a du mal à communiquer avec ses subordonnés et à se faire comprendre d’eux. Op. cit., p. 233-237. Etienne Taillemite juge sévèrement les officiers qui s’opposent à Suffren. Il note que l’Océan indien est « peu connu et guère apprécié des officiers de la marine royale, qu’une telle affectation éloignait pour longtemps des entours de la Cour et des bureaux où l’on pouvait trouver des protections. On faisait là-bas plus de commerce que de guerre et le doux paradis de l’île-de-France n’était pas fait pour développer les ardeurs belliqueuses. (...) L’indiscipline des officiers y semblait spécialement marquée. Comme les officiers servant dans l’Océan indien n’avaient jamais participé aux escadres d’évolutions armées en Europe, ils manquaient très souvent d’entrainement et d’esprit combatif. Certains d’entre eux s’ennuyaient beaucoup dans les eaux du golfe du Bengale et ne songeaient qu’à rentrer à l’île-de-France. » Louis XVI, ou le navigateur immobile, op. cit., p.212-213. Comme on constate d’après la lettre précédemment citée que tous les officiers de Suffren veulent rentrer, faut-il en conclure que les officiers arrivés de Brest avec le commandeur se sont laissés « contaminer » par leurs confrères de l’Océan indien ? C’est aller vite en besogne. On peut donc dire que la thèse de Rémi Monaque sur le caractère de Suffren est exacte, mais qu’on doit sans doute y ajouter l’épuisement de ces hommes qui ont quitté Brest depuis plus d’un an et qui font une campagne dont ils ne comprennent pas les enjeux. D’où leur ralliement progressif à leurs confrères de l’île-de-France, ce qui n’excuse en rien leur comportement. Rappelons que dans la Royal Navy une telle démarche collective se terminerait immanquablement par la cour martiale.
- Lettre complémentaire au rapport au ministre sur la bataille du 16 avril 1782, op. cit., p.236. Lettre du 29 septembre 1782 à Blouin, citée par Régine Pernoud, op. cit.
- Lettre au comte de Vergennes, écrite peu de temps après la bataille et citée par Roger Glanchant, op. cit., p.293-294. Suffren s’exprime en des termes quasi identiques dans sa lettre complémentaire au combat de Provédien à destination du ministre de la marine, op. cit., p.239.
- Jean Meyer, Martine Acerra, Histoire de la Marine..., op. cit., p.128.
- Rémi Monaque, op. cit., p.240.
- Falk est né à Colombo en 1736 dans une famille qui a déjà fourni de nombreux cadres à la Compagnie des Indes Néerlandaises. Après un séjour aux Provinces-Unies pour terminer sa formation à l’université d’Utrech, il est retourné aux Indes orientale où sa carrière a été rapide. Devenu gouverneur de Ceylan en 1765 il a réussi à conclure un traité de paix avec un souverain de l’intérieur de l’île en lutte contre l’autorité hollandaise depuis 25 ans. Il mourra à son poste en 1785. Renseignements réunis par Rémi Monaque, op. cit., p. 241.
- La découverte de cette correspondance est récente. Le dossier contenant les lettres échangées entre Suffren et Falk dormait dans les archives de Colombo sous la cote 1/3406 depuis plus de deux siècles. Il n’a été exhumé qu’en février 2008 par Rémi Monaque qui y consacre de longues pages de son ouvrage. Op. cit., Annexe IV, p.421-434.
- Les équipages ne semblent pas avoir reçu de solde pendant la campagne, mais seulement des avances sur les prises comme l’indique le chevalier de Froberville dans ses Mémoires, op. cit., p.88 et 170.
- Dès sa première lettre du 12 mars 1782, citée par Rémi Monaque, op. cit., p. 423-424.
- Extrait de la campagne du vaisseau l’Artésien, commandé par le chevalier de Cardaillac, Service historique de la Défense, section marine, G 198, p. 50.
- Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit. L'un de ces navires arrive de Sumatra, envoyé par la régence de Batavia, porteur de 200 000 florins ce dont Suffren remercie vivement Falk.
- Rémi Monaque, op. cit., p.244.
- Il s’agit du Raikes, un transport de l’escadre anglaise, du Resolution, ancien navire du capitaine Cook (le célèbre explorateur) mais doublé de cuivre, du Yarmouth et du Fortitude, deux navires de la Compagnie des Indes anglaise. Ibidem, p.244-245. Notons aussi pour que le tableau logistique soit complet que l’Artésien et le Vengeur sont allés chercher du biscuit à Pondichéry.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.269.
- Il s’en explique au ministre, sachant sans doute que cette décision lui sera forcément reprochée. Lettre sans date, Archives Nationales, B4 207, fol.175. Dans l'escadre cette décision provoque l’indignation de plusieurs officiers, comme le capitaine de vaisseau Trublet de Villejégu, qui parle "d’un procédé inhumain", mais le bailli ne se laisse pas fléchir. Suffren n'a pas non plus oublié les conditions de détention épouvantables sur les pontons, lesquelles rendent les protestations anglaises bien hypocrites. On ne connait pas le nombre exact de ces prisonniers. Suffren parle de 300 hommes, mais une lettre sans signature du 28 juillet 1782 écrite à bord de l’Ajax parle de 800 hommes. Peut-être ce chiffre comprend-il des Indiens au service des Anglais.
- Les deux escadres se présentent dans l’ordre suivant : côté français, le Flamand (60 canons), suivi de l’Annibal (74), puis du Sévère (64), le Brillant (64), le Héros toujours monté par Suffren (74), le Sphinx (64), le Petit Annibal (50), l’Artésien (64), le Vengeur (64), le Bizarre (64), l’Orient (74), accompagnés des frégates la Bellone (32) et la Fine (36). Côté anglais on trouve les HMS Exeter (64), Hero (74), Isis (56), Burford (74), Sultan (74), Superb toujours monté par Hughes (74), Monarch (70), Worcester (54), Montmouth (64), Eagle (64) et Magnanime (64) sans compter les frégates. Composition des forces données par Rémi Monaque, op. cit., p.249, et Jean-Claude Castex, op. cit., p.269. Notons que le Monarch, en fonction des historiens et des batailles est doté de 70 ou 74 canons, ce qui dans les deux cas donne toujours un net avantage à Hughes.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.271.
- Rémi Monaque, op. cit., p.252.
- Pas très fair play, mais efficace, et on peut y voir un prêté pour un rendu après les fourberies du précédent conflit, entre autres devant Louisbourg lorsque l’amiral anglais Boscawen affirmait aux navires français être en paix à voix haute pour ouvrir ensuite le feu par surprise.
- Anecdote rapportée par Jean-Claude Castex, op. cit., p.271.
- Lettre du 15 juillet à Mr. Stephens (A.N. Marine, B4 197, fol.306.
- En faisant passer un Mémoire au ministre par l’intermédiaire du comte d’Hector qui commande le port de Brest. Rémi Monaque, op. cit., p.252-253.
- Citons leurs noms pour mémoire : M.M. Dieu et Rosbo, tous deux capitaines de brûlot. Archives Nationales, C1 16.
- Rémi Monaque, op. cit., p.254.
- Ibidem, p.244 et 255.
- Cet officier issu de la noblesse provençale voisinait et cousinait avec la famille des Suffren. La famille Forbin avait donné à Louis XIV un de ses plus grands capitaines, le chevalier Claude de Forbin (1656-1733).
- Op. cit., p.98.
- Cité par Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur, op. cit., p. 211.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.250.
- Récit daté du 30 octobre 1782, hélas sans signature. A.N. Marine, B4 207, fol.175.
- Lettre à son ami Blouin du 29 septembre 1782, publiée par Régine Pernoud, op. cit.
- « Il [le nabab] a reçu M. de Suffren avec la plus grande considération et lui a dit les choses les plus flatteuses. Le commandeur lui ayant témoigné ses regrets de ce qu’il n’était pas à portée de voir l’escadre, Haider lui a répondu qu’il aimerait mieux voir celui qui la commandait et qui ma commandait si glorieusement ». Journal de bord du Héros, tenu par Moissac, le principal officier de Suffren, cité par Rémi Monaque, op. cit., p. 257.
- Un « lac » est une mesure monétaire indienne. Moissac dans le journal de bord du Héros se montre un peu gêné par ces pratiques et éprouve le besoin de s’en justifier : « ces présents sont d’usage dans toutes les Cours de l’Inde et ne peuvent être refusés ». Cité par Rémi Monaque, op. cit., p. 257. Tradition n’est pas corruption… Le nabab fait aussi cadeau à Suffren d'une cassette de diamants, il est vrai non taillés. Le présent ne sera dévoilé par le bailli à sa famille qu'à son retour en Europe. Il y en aurait eu un « pied cube »... C'est le baron de Vitrolles, alors âgé de 10 ans au moment du retour de Suffren, qui raconte cet épisode dans ses Mémoires. Vitrolles (baron de), Souvenirs autobiographiques d'une émigré, Paris, Emile-Paul frères, 1924.
- Lettre du 31 juillet 1782, Archives Nationales, Manuscrits, NAF 9432.
- Jean-Chritian Petitfils, op. cit., p.431. On peut aussi examiner les possessions exactes de Haidar Alî sur cette carte anglaise du début du XXe siècle. Le royaume d'Haidar Alî semble tourner littéralement le dos à la côte de Coromandel.
- La Bellone qui était allé prévenir les Hollandais du retour de l’escadre et a bien failli succomber face à un adversaire plus petit, mais très combatif qui lui a causé de lourdes pertes outre les deux officiers tués. Rémi Monaque, op. cit., p.263.
- C’est peu, mais ce n’est qu’un début, Falk promet l’arrivée d’autres troupes malaises venues des différentes garnisons de l’île, soit à peu près 780 hommes. Suffren le remercie chaleureusement car ces troupes sont de bonne qualité. Ibidem, p.430-431.
- Ibidem, p.425.
- 18 hommes au total qui finalement sont réintégrés dans leur régiment d’origine. La pénurie d’homme est telle qu’on ne peut se montrer regardant. Rémi Monaque, op. cit., p.455.
- Cette rencontre nous vaut un portrait de Suffren qui a fait forte impression à l’Anglais. Ce dernier trouve Suffren « en chemise, donnant des ordres pour l’assaut, il était logé sous un arbre, un hamac pendu aux branches, une table, un pliant et son secrétaire. Cet officier fut décontenancé de cet accoutrement d’un général, il vit qu’il avait affaire à un guerrier, sa réputation lui en avait déjà imposé, il capitula aux mêmes conditions que le fort d’en bas [le fort Frederick] ». Extrait d’un article paru dans le Mariner’s Mirror (Cary captain L.H.S.C.), « Trincomali », vol 17, 1931.
- Mariner’s Mirror, op. cit.
- Lettre du 29 septembre, publiée par Régine Pernoud, op. cit.
- Rémi Monaque, op. cit., p.424.
- Jean-Claude Castex (op. cit., p.399-402) et Rémi Monaque (op. cit., p.267.) font deux récits assez différents de ce combat.
- Rémi Monaque, op. cit., p.268.
- Une série de trois croquis, réalisés dans les jours suivants par un officier du Héros (sans doute Moissac, le principal officier de Suffren) reconstitue assez fidèlement la bataille. Le premier croquis, portant la mention « première position du combat à peu près » nous donne l’ordre d’engagement. En tête, l’Artésien (64 canons), suivi de l’Orient (74), puis du Saint-Michel (64), du Sévère (64) du Brillant (64) du Sphinx (64), du Petit Annibal (50), du Héros (74), de l’Illustre (74), de l’Ajax (64) du Flamand (60), de l’Annibal (74), du Bizarre (64), du Vengeur (64) et de la Consolante (36). Curieusement, l’Ajax n’est pas signalé dans le premier croquis avant de faire son apparition au milieu de la bataille dans le deuxième. Archives Nationales, Marine, B4 207, fol.93. Hughes dispose des mêmes vaisseaux que lors de la précédente bataille et a reçu le renfort d’une unité, le HMS Sceptre (64 canons). L’ordre d’engagement de la ligne anglaise n’est cependant pas connu avec précision, même si on sait qu’en tête on trouve le HMS Exceter (64) suivit de l’Isis (56 ou 50), puis trois autres unités, puis du Burford (74 ou 70), du Superb (74) monté par Hughes, du Monarca (74 ou 70) du Eagle (64), puis d’une autre unité, puis du Montmouth (64) et enfin du Worcester (64). Les 4 unités dont on ne connait pas l’emplacement sont le Hero (74), le Sultan (74), le Magnanime (64) et le Sceptre (64). Ordre d’engagement anglais reconstitué en croisant le récit de Jean-Claude Castex, op. cit., p.399-400 et Rémi Monaque, op. cit., p.270. L’article Wikipédia en anglais sur cette bataille ne donne aucune précision sur l’ordre choisi par Hughes pour sa ligne. On peut terminer sur ce point en comparant les puissances de feu respectives. Les additions donnent à peu près 940 canons à Suffren et 800 à Hughes. A peu près seulement, car en fonction des Historiens la puissance de feu des vaisseaux n’est pas rapportée de la même façon. C’est ainsi que plusieurs vaisseaux anglais sont signalés à 74 ou 70 canons, et il n’est pas rare que les vaisseaux à 64 canons soient signalés simplement à 60, de même que les 56 canons donnés à 50. Jean-Claude Castex, qui ne semble pas trop s’être relu donne même le HMS Isis à 56 canons à Négapatam puis à 74 canons à Trinquemalay... L’article Wikipédia en anglais donne ce vaisseau à 50 canons.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.400-401.
- Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.273.
- Anecdote citée par Jean-Claude Castex, op. cit., p.401.
- Relation faite au ministre de la marine le 29 septembre 1782, A.N. Marine, B4 207, fol. 124.
- Tableau des pertes dressé par Rémi Monaque, 5 vaisseaux n’ont aucune perte (l’Orient, le Sévère, le petit Annibal, le Sphinx, l’Annibal) et les autres un très faible nombre de morts et de blessés. Op. cit., p.273-274.
- Les trois premiers sont signalés « en panne » sur le premier croquis de la bataille déjà cité plus haut. Archives Nationales, Marine, B4 207, fol.93. Ces vaisseaux sont sur l’arrière garde, alors que Jean-Claude Castex signale que la zone de calme se trouve sur l’avant-garde. Le récit de cette bataille continue à garder sa part de confusion, plus de deux siècles après.
- Lettre du 30 septembre 1782 écrite à Madras, A.N., Marine, B4 197, fol. 312.
- Orienter les voiles pour faire reculer le navire.
- Rémi Monaque, op. cit., p.277.
- Dans le rapport sur l’état de l’escadre après la bataille, Suffren note sur la tenue au combat des commandants : « Très bien, on ne peut mieux » pour Bruyère et « Très bien » pour Beaumont. Presque tous les autres officiers ont droit à l’apostille « mal » (cinq, dont Saint-Félix sur l’Artésien qui n’est intervenu que dans la deuxième partie du combat), ou « très mal » (trois, dont Tromelin sur l’Annibal), ou « mal comme toujours » (La Landelle sur le Bizarre), voire pour finir « mal à cause d’un accident » (Cuverville sur le Vengeur qui a perdu un de ses mâts). Le commandant de la Consolante (De Péant) tué au début du combat échappe à la critique et en partie celui de l’Orient (La Pallière) qui a droit à un « bien au commencement »… Archives Nationales, B4 207, fol.93.
- « Il faut que je vous dise Monseigneur, [le ministre], que des officiers depuis longtemps à l’île-de-France ne sont ni marins, ni militaires. Points marins parce qu’on n’a point navigué, et l’esprit mercantile d’indépendance et d’insubordination les maîtres y ont consacré un esprit de rapine qu’il est impossible de réprimer. Vous ne pourriez imaginer, Monseigneur, toutes les petites ruses qu’on a employées pour me faire revenir. Vous n’en serez pas surpris si vous savez qu’à l’île-de-France l’argent vaut 18% et quand on fait des affaires infiniment plus ; et pour cela il faut y être. MM. De Tromelin, de La Landelle, de Saint-Félix, de Galles ont demandé à quitter leurs vaisseaux. J’ai été trop mécontent d’eux pour ne pas le leur accorder avec plaisir. » Ibidem.
- Rémi Monaque, op. cit., p.275.
- Lettre du 3 novembre 1782, A.N. Marine, B4 207, fol. 183.
- C'est-à-dire sans pension de retraite. Archives nationales, Marine, C7 40.
- Anecdote donnée par la page Wikipédia en anglais, "Battle of Trincomalee".
- Suffren note dans son courrier au ministre : « Si je ne change pas plusieurs autres [officiers] c’est faute d’avoir des personnes en état de commander des vaisseaux. Il est affreux d’avoir pu quatre fois détruire l’escadre anglaise et qu’elle existe toujours. Le choix des officiers pour l’Inde est des plus essentiels parce qu’on n’est pas à même de les changer. Je ne crois pas avoir les talents qu’il faudrait. Je ne suis rassuré que par votre confiance en moi, mais en vérité, si ma mort ou ma santé faisait vaquer le commandement, qui me remplacerait ? » Archives Nationales, B4 207, fol.93.
- Rémi Monaque, op. cit., p.282.
- Suffren redoute que son commandant n’ait pas eu le temps de détruire les codes de l’escadre qu’il va maintenant falloir changer. Ibidem.
- La ville se nomme actuellement Banda Aceh et a beaucoup fait parler d’elle à l’occasion du tsunami de 2004 qui l’a complètement ravagée.
- Extrait du Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.285.
- Rémi Monaque, op. cit., p.287.
- Moissac, qui tient le journal de bord du Héros note que « mes malades ont augmenté au lieu de diminuer ; cela vient peut-être des marais dont le pays est rempli ». Ce qui est sans doute vrai, mais même avec des vivres et de l’eau fraiche on ne peut guère s’attendre à une amélioration de la situation sanitaire en gardant presque tout le monde entassé à bord sous un soleil qui reste tropical, même pendant l'hiver.
- Il s'agit peut-être de 5 vaisseaux de la compagnie des Indes, qui arborent toujours un armement important. Le commandant se défend en communiquant son journal à Suffren, mais celui-ci n'est pas convaincu, tout comme les matelots qui ajoutent à l'affaire de lourdes plaisanteries sur leur officier. Anecdote rapportée par C.-M. Cunat, op. cit., p.250.
- Un convoi de troupes et de vivres, partis de Brest escorté par 19 vaisseaux de ligne sous les ordres de Guichen -un bon commandant jusque là invaincu- perd 15 bateaux de son convoi après l’attaque du commodore Kempenfeld qui n’a pourtant que 12 vaisseaux. La tempête qui s’en mêle disperse le reste du convoi. Lucien Bély, op. cit., p.630.
- 7 vaisseaux français sont coulés ou capturés, dont le navire amiral et De Grasse lui-même. La guerre aux Antilles s’est donc terminée sur une victoire anglaise, heureusement sans grandes suites car Rodney n’a pas donné la poursuite au reste de l’escadre française et au convoi marchand qui ont pu rejoindre les forces espagnoles.
- « Tout le poids de la guerre porte uniquement sur nous et l’Espagne semble n’y prendre part qu’à titre de spectatrice » gémissait Vergennes. Madrid demande la présence de 40 vaisseaux français, ce que refuse Louis XVI qui n’est de toute façon pas en mesure de les fournir, vu les besoins pour les Antilles et les Caraïbes, mais il accepte d’envoyer du renfort en hommes et en matériel sous les ordres de son cousin le duc de Bourbon et de son frère, le comte d’Artois. Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.426-428.
- L’idée de ces batteries flottantes revenait à l’ingénieur militaire français, Jean-Claude Le Michaud d'Arçon. Elle n’était pas mauvaise, mais simplement trop en avance sur son temps, le blindage de chêne ne pouvant pas résister aux boulets rouges. Les terrifiantes explosions soufflent toutes les vitres d'Algésiras, de l'autre côté de la baie. L’idée de batteries flottantes refera surface 65 ans plus tard, lors de la Guerre de Crimée, pour réduire –avec succès- les bastions de la forteresse de Sébastopol. Entre temps, la Révolution industrielle sera passée par là, avec du blindage de fer, des moteurs à vapeur, des canons rayés... Ibidem.
- Etienne Taillemite, très sévère pour Louis XVI et son ministre des affaires étrangères, Vergennes, estime que dans cette affaire la France se retrouve « à la remorque de l'Espagne ». Etienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur immobile, op. cit., p.167, chapitre IX.
- Ce dont Suffren après la guerre se plaindra vivement alors qu'il pensait avoir la confiance et l'appui de Vergennes sur ce point. Rémi Monaque, op. cit., p.129.
- Document cité dans l’article de Philippe Haudrère, « La Révolution de l’Inde n’aura pas lieu », in Chaline Olivier, Bonnichon Philippe, Vergennes Charles-Philippe, La France et l’Indépendance américaine, Paris, PUDS, 2008. Archives Nationales, C2, 161, fol.12 à 18.
- Cet échec a déjà été relaté un peu plus haut. Selon R. Monaque 18 transports ont été capturés, mais il ne parle là sans doute que des transports pour les Indes. Un vaisseau, le Pégase a aussi été capturé ainsi que 1 500 hommes de troupes. R. Monaque, op. cit. p.288. Cet épisode est souvent relaté de façon très rapide voire superficiel par les Historiens, et en donnant des chiffres très variables sur les navires perdus. Lucien Bély parle de 15 bateaux perdus. Op. cit. p.630. Etienne Taillemite parle de 24 transports capturés mais sans citer aucune perte en vaisseau de guerre. Dictionnaire des marins français, op. cit., p.230. Selon l'historien Charles Cunat, qui écrit dans la première moitié du XIXe siècle, ce sont quatre convois qui partent de France pour les Indes, faiblement escortés et qui sont tous à des degrés divers insultés par la Royal Navy et les tempêtes. Op. cit., p.184.
- Chiffre fourni par le très médiocre article Wikipédia sur Charles Joseph Patissier de Bussy-Castelnau.
- Lettre sans date de la fin de 1782 à M. Blouin, publiée par Régine Pernoud, op. cit. Le décompte anglais tient compte des renforts qui viennent de parvenir à Hughes.
- Lettre du 30 novembre 1782 au ministre des affaires étrangères, citée par Roger Glanchant, op. cit. p.313.
- R. Monaque, op. cit., p.289.
- R. Monaque, ibidem, p.291.
- Chiffre donné par Etienne Taillemite, Dictionnaire des marins Français, op. cit. C’est le seul historien à fournir ce décompte, qui concerne probablement toute la campagne de Suffren, les autres ouvrages étant muets sur ce sujet. Les marines de guerre pratiquent toutes la guerre de course et font même largement concurrence aux corsaires habituels qui sont des entrepreneurs privés ayant une autorisation de l'État pour pratiquer l’activité (sinon c'est de la piraterie). A titre d'exemple, en 1778-79, l'armée navale de d'Estaing capture 106 navires de commerce et 6 corsaires anglais. Sur l'ensemble de la guerre, la Marine royale fait au moins 900 prises, dont 406 lors des escortes de convois dans l'Atlantique. A ce chiffre il faut ajouter celui des prises faites par les entrepreneurs corsaires depuis la façade atlantique et qui dépasse les 1 000 captures. Le chiffre exact n'est pas connu avec précision, car depuis les ports français opèrent aussi des corsaires américains qui revendent leurs prises essentiellement à Lorient. Au total, les corsaires "insurgents" auraient fait 600 prises de 1776 à 1782. La revente des prises permet de payer une partie des soldes des équipages. La Royal Navy n'est pas en reste puisqu'elle capture 942 navires auxquels s'ajoutent les 1 296 prises des entrepreneurs corsaires privés, soit un total de plus de 2 300 navires pris. On ne sait rien de la course espagnole. Ces statistiques sont un peu "hors-sujet" dans cet article, mais elles permettent de recadrer Suffren dans un cadre plus global. Voir les pages éclairantes de P. Villiers, J.-P. Duteil, op. cit. p.133-138.
- Lettre du 26 mars 1783, citée par R. Pernoud, op. cit. Précisons aussi, pour que le tableau militaire soit complet, qu'un petit renfort de troupes provenant du Cap est arrivé fin février-début mars sur un petit vaisseau de 50 canons, l'Apollon. Il s'agit d'un détachement du régiment d'Austrasie que Suffren s'est empressé de faire passer à Gondelour sur la frégate la Fine.
- J.-C. Petitfils, op. cit., p.432. Roger Glanchant, de son côté le traite de « vieux-beau ». Bussy a alors 63 ou 65 ans. On ne connait pas sa date de naissance avec précision.
- Lettre du 11 avril 1783 à Vergennes, citée par R. Glanchant, op. cit., p.337-338.
- R. Monaque, op. cit., p.294. Le problème du commandement des opérations combinées est resté un casse-tête jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.
- Lettre « pour vous seul » du 24 mars 1783. Archives Nationales, Marine, B4 197.
- Les vaisseaux le Héros, le Fendant, l’Argonaute, le Sphinx, l’Artésien, le Petit Annibal, le Saint-Michel, les frégates la Cléopâtre, la Fine, le Coventry, la Bellone et la Fortune.
- Anecdote contée en 1801 par Villaret dans une lettre citée par C. Cunat, op. cit., p.381-382.
- Le capitaine du HMS Sceptre, dont le vaisseau a beaucoup souffert, est le premier à lui rendre hommage : « vous nous livrez, Monsieur un beau bâtiment de guerre, mais vous nous l’avez vendu bien cher ». Rapporté par C. Cunat, op. cit., p.276-277. Sur la combativité des officiers de l'océan indien, nous avons déjà fait un peu plus haut la même remarque concernant M. de Saint-Félix à propos de sa démission au lendemain de la bataille de Négapatam.
- Lettre du 4 ou 5 juin à son ami Blouin publiée par Régine Pernoud, op. cit.
- Lettre du 24 janvier 1783 de Suffren à Falk, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.431. Suffren promet d'utiliser ces unités de commerce armée en guerre « de manière à être engagés que relativement à leur moyen de défense. » D'autres courriers sont échangés pour mettre au point les modalités de cette coopération navale qui ne verra pas le jour.
- Lettre du 26 mars 1782 à son ami Blouin, ibidem.
- Lettre de Falk du 14 mai 1783, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.429.
- Rémi Monaque, op. cit., p.299. Les Cipayes sont un corps de soldats indiens armés et entrainés à l'européenne. Ils ont été créés au début du XVIIIe siècle par les Français. Leur efficacité leur vaut d'être copiés par les Anglais qui ont leur propre corps de Cipayes. Les Lascars sont des matelots indiens.
- Lettre du 9 octobre 1782 de De Launay au ministre, B.N., Manuscrit, NAF 9372.
- Il dispose d'à peu près 3 800 soldats venus d'Angleterre, le reste de la troupe étant constituée de troupes indiennes.
- Lettre du 4 juillet 1783 au ministre de Castrie, A.N., Marine, B4 268, fol.58.
- Journal de bord du Héros, tenu par Moissac, le principal officier de Suffren, cité par R. Monaque, op. cit., p.301.
- Le gouverneur Falk en informe Suffren par une lettre du 14 mai 1783, suite à l'arrivée de gazettes de décembre 1782 parlant des préliminaires de paix. Cité par R. Monaque, op. cit., p.426-427.
- Sur cette nouvelle disposition, Suffren précise tout de même au ministre : « Je m’y conformerai autant que je penserai la chose utile au bien du service. Ce serait mal remplir l’esprit de cet ordre que d’en profiter pour ne pas donner l’exemple que doit un chef dans les occasions où il peut commander de son vaisseau tout aussi bien qu’ailleurs. » Lettre du 11 avril 1783. Archives Nationales, Marine, B4 268, fol.58. Cette mesure qui s’applique à tout chef d’une escadre de plus de 9 vaisseaux sera abandonnée après la guerre.
- R. Monaque, op. cit., p.381.
- Cet ordre de bataille nous est parfaitement connu grâce à un croquis qui figure dans le journal du Fendant Il donne l’ordre d’engagement suivant (pour les 64 et le 56 canons) : le Sphinx, le Brillant, le Vengeur, l’Artésien, le Flamand (56), l’Ajax, le Sévère, le Hardi, ce dernier vaisseau devant commencer à se rapprocher de la ligne anglaise entre son douzième et son treizième vaisseau. Puis viennent les 74 canons : l’Argonaute, le Héros, l’Illustre, le Fendant et l’Annibal qui doivent concentrer leur feu sur les derniers navires anglais, secondés par le Saint-Michel (60), le Petit Annibal (50) et la frégate la Consolante (36) qui doivent doubler la ligne anglaise sur sa gauche et prendre entre deux feux les trois derniers navires anglais. Service historique de la Défense, section marine, ms 254.
- Amiral G.A. Ballard, « The last Battlefleet struggle in the bay of Bengal », The Mariner’s Mirror, vol.13, 1927.
- R. Monaque, op. cit., p.308.
- Les effectifs de Bussy sont difficiles à connaître avec précision. Au dire de l’article Wikipédia sur la bataille de Gondelour il dispose de 3 000 soldats européens et 2 200 cipayes soit 5 200 hommes, mais on compte aussi 900 malades (ou 700 selon les auteurs). Les effectifs anglais sont incertains également. Stuart disposerait de 3 800 européens, 13 000 cipayes et 1 800 « cavaliers noirs » (c'est-à-dire d’Indiens issus du sud du pays à la peau très sombre, contrairement à la population de la vallée du Gange à la peau très claire...), ce qui ferait un total pour Stuart de 18 600 hommes, ce qui semble très exagéré. Rémi Monaque parle de 15 000 hommes (op. cit., p. 308) et Jean-Christian Petitfils retient de son côté l’effectif de 16 000 hommes (op. cit., p.432.). La vérité est sans doute entre les deux, compte tenu des pertes, désertions et maladies qui frappent aussi le contingent anglais. Ces deux auteurs, prudents, ne donnent aucun chiffre sur les effectifs dont dispose Bussy enfermé dans Gondelour.
- Rémi Monaque, op. cit., p.309.
- Propos de Suffren cité par Rémi Monaque, op. cit., p.310.
- Journal de bord du Héros cité par Rémi Monaque, op. cit.
- Au dire des historiens anglais qui ont étudié cette longue phase d’approche. Richemond, vice-admiral sir Herbert W., « The Hughes-Suffren campaigns », et l’amiral G. A. Ballard, « The last Battlefleet struggle in the bay of Bengal », The Mariner’s Mirror, vol.13, 1927.
- Cette frégate a semble-t-il été réarmée pour l’occasion car elle était signalée immobilisée sans équipage dans le port de Trinquemalay au moment de la réorganisation de l’escadre en mai (voir plus haut). Suffren envoie par la suite le Conventry prévenir la Consolante de ne combattre le dernier vaisseau anglais qu’à grande portée pour ne pas prendre de risque. R. Monaque, op. cit., p.311. Notons que la Pourvoyeuse est plus armée (38 canons), mais peut-être est-elle moins manœuvrante que la Consolante (36) ou alors Suffren tient simplement compte de la pénurie de personnel.
- Journal de bord du Héros, cité par R. Monaque.
- J.-C. Castex, op. cit., p.189.
- Témoignage du père Delphini présent au combat à bord du Flamand, Bibliothèque Nationale, NAF 9370.
- Les deux escadres s’engagent dans l’ordre suivant : côté français, à l’avant-garde se suivent le Sphinx (64 canons), le Brillant (64), le Fendant (74), le Flamand (56 ou 50 canons), l’Ajax (64), le Petit Annibal (50) ; au centre arrivent l’Argonaute (74), le Héros (74), l’Illustre (74), le Saint-Michel (60), et sur l’arrière-garde le Vengeur (64), le Sévère (64), l’Annibal (74), le Hardi (64), l’Artésien (64) et la frégate la Consolante (36). Hors de la ligne, notons aussi les frégates comme la Cléopâtre qui sert de navire amiral et le Conventry (28) qui tient compagnie au brûlot la Salamandre. Côté anglais ont trouve en tête le HMS Defense (74), suivi de l’Isis (50), du Gibraltar (84), de l’Inflexible (64), de l’Exeter (64), du Worcester (64), de l’Africa (64), du Sultan (74), du Superb (74), du Monarch (70), du Burford (70), du Sceptre (64), du Magnanime (64), du Eagle (64), du Hero (74), du Bristol (50), du Montmouth (64), du Cumberland (74), accompagné semble-t-il de deux ou trois frégates. Suffren dispose d’à peu près 960 canons sur sa ligne contre un peu plus de 1 200 pour Hughes. Composition des escadres obtenue en croisant les informations de Rémi Monaque, (op. cit, p.312-313) et Jean-Claude Castex (op. cit., p.186), ce dernier confirmant son statut d’historien qui ne se relit guère, puisqu’il oublie l’Argonaute dans la liste des unités engagées, présenté à 14 vaisseaux, mais passant à 15 sur le plan de la page d’à côté, sans donner son nom, ce qui nous vaut la présence d’un navire anonyme en queue de ligne, tous les noms des autres étant décalés d’une place depuis le septième navire, position de l’Argonaute dans la ligne.
- Anecdote citée par Jean-Claude Castex, op. cit., p.189-190.
- Jean-Claude Castex affirme cependant que les navires français se lancent à la poursuite des Anglais et que Suffren a beaucoup de peine à les en empêcher, mais cette affirmation semble peu plausible, compte-tenu du contexte du combat et de l’autorité maintenant bien établie de Suffren sur l’escadre. Ibidem.
- Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.312.
- Jean-Claude Castex, op. cit., p.190.
- Moissac, qui tient le journal de bord du Héros rend compte ainsi de la journée : « L’intention du général [Suffren] a été d’abord de chasser les ennemis, mais nous faisant réflexion à leur marche supérieure et au parti qu’ils avaient pris décidément de fuir, puisque, après s’être ralliés, ils avaient mis le cap à l’est-nord-est toutes voiles dehors, à l’inquiétude d’ailleurs où l’on devait être à Gondelour sur les suites de notre combat tant qu’on ne nous verrait pas arriver, il s’est décidé à faire route pour cette place. » Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.314.
- Amiral G.A. Ballard, The Mariner’s Mirror, vol.13, 1927, op. cit.
- Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit., p.316.
- Lettre du 26 juin 1783, Service historique de la Défense, section Marine, G198, p.122.
- J.-C. Castex, op. cit, p. 188. Rappelons que les corvettes et les frégates anglaises, toutes doublées de cuivre sont plus rapides que leurs homologues françaises pour porter les dépêches d’Europe vers l’Inde.
- Jean Meyer, Martine Acerra, op. cit., p.129.
- Pour être précis il faut il ajouter les huit loges de Balassore, Kassimbazar, Yougdia, Dacca, Patna, Mazulipatam, Calicut et Surat. Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.438.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.435. Sur le plan territorial ce conflit n’est marqué que par de faibles gains pour la France, mais il convient de rappeler que dès le départ cette guerre n’était pensée par le jeune Louis XVI que comme un conflit de revanche destiné à restaurer l’honneur et la puissance de la France très atteint par les défaites de la Guerre de Sept Ans tout en rabaissant les prétentions anglaises à la domination des mers. Honneur effectivement restauré par la victoire en Amérique du nord et dont le retentissement a été immense en Europe. Les conquêtes françaises dans les Antilles-Caraïbes, à peine compromises par la défaite des Saintes permettent le passage sous souveraineté françaises d’une île à sucre mais ce n’était pas l’objectif essentiel au début du conflit (Il s’agit de Tobago, qui est acquise contre la restitution de la Dominique. Il y a aussi les droits de pêche qui sont étendus autour de Saint-Pierre et Miquelon, on garde le Sénégal avec l’île de Gorée et en métropole la France récupère la pleine et entière souveraineté sur Dunkerque que l’on va pouvoir fortifier). Benjamin Franklin qui participe aux très longues négociations de paix, note dans son journal que « l’Angleterre avait redouté que la France n’émette des prétentions qui l’humilieraient. Vergennes avait répondu à cela que le dessin de la France n’était pas d’humilier sa voisine mais de négocier une paix générale conforme à son honneur national. » (Cité par J.-C. Castex, op. cit., p.185.) On était plus au temps de Louis XIV et de ses guerres de conquête, Louis XVI étant un prince pacifique et qui soutenait l’idée alors nouvelle d’équilibre entre les puissances pour conserver la paix. Ce qui explique pourquoi les résultats de ce conflit ont souvent été jugés décevant pour la France, tant il est vrai que dans l’opinion publique (et chez les Historiens) les conquêtes sont un des marqueurs forts de la victoire. On peut presque résumer cette guerre en disant qu’elle a été faite pour l’honneur côté français, au grand bénéfice de la jeune République américaine, de l’Espagne, de la Hollande, de la liberté de circulation sur les mers et de l’équilibre européen... Jean-Christian Petitfils estime que l’Espagne qui a gagné les deux Florides (orientale et occidentale) et Minorque tout en conservant la Louisiane que lui avait donné Louis XV, est le grand vainqueur territorial de la guerre (op.cit., p.438-439). Voir aussi Lucien Bély, Les relations internationales... op. cit., p.631-633, et A. Zysberg, La monarchie des Lumières, op. cit., p.390.
- En 1782 et 1783, 22 vaisseaux et frégates ont été pris ou victimes de naufrages. Ces chiffres représentent 47% des pertes de l'ensemble des disparitions militaires du conflit, preuve par les chiffres que la Royal Navy, ébranlée par les défaites de 1781 a nettement retrouvé son mordant par la suite. La paix a été signée à temps pour une flotte qui atteignait ses limites, selon A Zysberg et M. Acerra, même si par ailleurs le colossal effort de construction français permet de combler largement les pertes d'une flotte dont les effectifs progressent, puisqu'on est passé de 103 vaisseaux et frégates en 1776 à 110 en 1783. L'essor des marines de guerre..., op. cit., p.95.
- Au 20 janvier 1783, date que cite Hughes dans sa lettre il ne s’agissait que des préliminaires de paix suivi d’un armistice général proclamé en février, les négociations se poursuivant en détail sur plusieurs mois. Il y a en fait trois traités. Le traité de Paris qui règle le conflit entre l'Angleterre et les "États-Unis", le traité de Versailles le même jour pour le conflit entre la France l'Angleterre et l'Espagne en Europe, en Asie et dans les îles. Le dernier traité, signé le 20 mai 1784 achève la guerre entre la Hollande et l'Angleterre. Les délégués anglais refusent de poser pour le tableau après la signature du traité, comportement qui nous montre que l’Angleterre se considère malgré tout comme vaincue et humiliée par la perte de ses 13 colonies américaines.
- R. Monaque, op. cit., p.318.
- Lettre du 24 avril 1783. B.N., Manuscrits, NAF 9432.
- Il y mourra en 1785.
- Falk lui fait des adieux chaleureux. La lettre se termine ainsi : « Voilà une lettre trop longue. Elle me tiendra lieu de l'abouchement tant désiré. Vous me conserverez toujours votre cher souvenir. Soyez persuadé des sentiments respectueux et affectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'être...» Lettre du 3 septembre 1783, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.423.
- Lettre du 24 avril 1783, op. cit.
- Journal de bord du Héros, cité par Rémi Monaque, op. cit., p. 322.
- Cité par Claude des Presles, Suffren dans l’océan indien, (1781 - 1783), Economica, 1999, p.155.
- Cité par Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d'Histoire Maritime, collection Bouquins, éditions Robert Laffont, 2002, p.1201.
- Anecdote citée par l’amiral Ballard, The Mariner’s Mirror, vol.13, 1927, op. cit.
- Courrier d'Avignon, livraison du 2 avril 1782, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.327. Cette gazette très bien informée profite d'une certaine indépendance car Avignon, terre papale, ne fait alors pas partie du territoire français. Elle va suivre Suffren jusqu'à Paris et constitue une précieuse source d'information.
- Il n'est pas inintéressant d'examiner l'état de l'équipage qui a été profondément remanié après trois ans de campagne au bout du monde. Sur les 19 officiers et gardes de la marine partis de Brest, 8 seulement reviennent à Toulon à bord du Héros, 8 ont été débarqués pendant la campagne, 2 ont été tués au combat et un troisième est mort de ses blessures. Pour le reste du personnel on note que 88 hommes ont été tués au combat, 99 sont morts en mer de maladie ou de leurs blessures, 399 ont été hospitalisés au moins une fois dont 41 sont morts à l'hôpital, nombre sans doute sous-estimé. 49 hommes ont déserté. Le total des pertes définitives ou momentanées se montre à 635, nombre à comparer aux 712 hommes présents au départ de Brest. Sans pouvoir donner de pourcentage exact, on peut estimer à 40% environ les personnel parti de Brest et manquant à l'appel à l'arrivée à Toulon. Chiffres donnés par Rémi Monaque d'après une étude du rôle de l'équipage du Héros, sachant que les Cipayes, Lascars, ou esclaves n'ont été notés nulle part alors qu'ils ont constitué à certains moments une forte proportion de l'équipage. Op. cit., p.322-323.
- Cette halte à Aix est connue en détail grâce au récit qu’en a donné le fils du conseiller, futur baron de Vitrolles et ministre de Louis XVIII dans ses Mémoires. Il avait 10 ans au moment du passage à Aix de Suffren et garda un souvenir émerveillé de son grand-oncle. Vitrolles (baron de), Souvenirs... op. cit.
- Courrier d’Avignon, Livraison du 16 avril 1784.
- Cette scène un brin vulgaire est rapportée par Vitrolles, le neveu de Suffren aux consuls d’Aix. André Auzoux, « Les dernières années de la vie de Suffren », Revue des études historiques, avril-juin 1917.
- Courrier d’Avignon, Livraison du 23 avril 1784.
- Mémoire du 2 avril 1784, Archives Nationales, C7 314, plaquette n°1.
- Il est jugé par un long conseil de guerre à Lorient qui termine ses débats au moment de l’arrivée de Suffren. Voir la dernière partie de l’article François Joseph Paul de Grasse.
- Commentaire cité sur le brouillon du premier article concernant Suffren, mais dont l'origine n'est hélas pas signalée.
- Malaga n’étant par ailleurs pas une défaite, mais un match nul. De Castrie ne fait pas référence aux défaites de Lagos et des Cardinaux, pourtant plus récentes (1759) et extrêmement douloureuses, mais ces batailles ont eu lieu sous le règne précédent, et le ministre, prudent sait aussi que Louis XVI aimait beaucoup son grand-père Louis XV...
- Histoire de la Marine française, op. cit., p.136.
- L’argumentation de De Castrie sur ce point est un modèle de cynisme qui mérite d’être citée : « Il est encore vrai que les principes d’une administration éclairée impose l’obligation de laisser toujours quelque chose à désirer à l’homme dont il importe de tirer de nouveaux services. Mais si l’art de l’administration consiste à faire faire le plus possible en accordant le moins qu’on peut, la justice distributive de Votre Majesté exige une balance plus équitable entre les récompenses et les services rendus. » Mémoire du 2 avril 1784, op. cit.
- Grandes Entrées, dans sa chambre, honneur réservé aux officiers de la Couronne, au grand chambellan, au grand-maître de la garde-robe, au premier valet de garde-robe et à quelques rares très grands seigneurs
- C'est Napoléon III qui offrira à la ville une statue de Suffren en 1866. À l'inauguration de la statue, la foule aurait chanté la chanson de Mireille pour honorer la mémoire de ce cadet de Provence. Jean Boutière, Correspondance de Frédéric Mistral, p. 229.
- "Pierre-André de Suffren Saint-Tropez, grand-croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, capitaine des vaisseaux du roi, sort de Brest le 22 mars 1781, sauve le cap de Bonne-Espérance, livre plusieurs combats dans les mers de l'Inde, souvent vainqueur, jamais vaincu, même avec des forces inférieures, fait respecter les armes de la France, protège ses alliés, prend Trincomalé, délivre Gondelour, répare et approvisionne ses vaisseaux sans autre ressource que son génie ; rappelé par la paix, arrive à Toulon le 25 mars 1784, reçoit de la nation de justes éloges, du roi le grade de vice-amiral et le cordon de ses ordres. La ville de Salon, berceau de ses ancêtres lui a consacré ce monument." Le buste est l’œuvre du sculpteur Jean-Joseph Foucou et aurait coûté à la ville de Salon 3 758 livres. R. Monaque, op. cit. p.335.
- Courrier d’Avignon, livraison du 5 novembre 1784.
- Voir la Galerie à la fin de l'article.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.338.
- Suffren revient à sept reprises sur cette idée dans sa correspondance avec Vergennes en poussant ce dernier à entreprendre des négociations avec les Néerlandais à ce sujet. R. Glanchant, op. cit., p.350.
- Lettre du 3 mars 1785 publiée par Théodore Ortolan, op. cit.
- Lettre du 4 juillet 1785, Archives Nationales, M 962.
- Journal du Héros cité par Rémi Monaque, op. cit., p.458.
- Gazette de France du 25 février 1785.
- Courrier d’Avignon du 22 avril 1785.
- Rémi Monaque, op. cit., p.343.
- Courrier d’Avignon, 16 septembre 1785.
- Rémi Monaque, op. cit., p.345-346.
- Lettre du 11 avril 1786, publiée par Rémi Monaque, op. cit., p.121.
- Ferreol de Ferry, article « Le bailli de Suffren ambassadeur de l'ordre de Malte à Paris », La Provence historique, fasc.180, 1995.
- Rémi Monaque, op. cit., p.347.
- Lettre du 27 janvier 1789, Archives Nationales, M. 962.
- Rémi Monaque, op. cit., p.348.
- Lettre du 6 juillet 1786, Archives Nationales de Malte, ARCH 1622.
- Rémi Monaque, op. cit., p.349.
- Lettre du 24 octobre 1787, Archives de Malte, ARCH 1622.
- Rémi Monaque, op. cit., p. 350.
- Rémi Monaque, op. cit., p.353.
- Lettre du 18 mars 1786, Archives nationales, M966.
- Lettre du 30 mars 1786, ibidem.
- Lettres du 19 août 1786 et du 19 avril 1787, Archives Nationales, M962.
- Propos rapportés par Rohan dans sa lettre à Suffren du 19 août 1786, ibidem.
- Lettre du 3 juillet 1788 à Rohan, Archives Nationales, M962.
- Lettre du 27 mars 1787, Archives Nationales, M968, fol.160.
- En novembre 1788 Cibon écrit en parlant du bailli : « Il vous rendra compte bientôt, Monseigneur, de l’affaire des chanoinesses qui va enfin être terminée, mais sa modestie ne lui permettra pas de dire à Votre Altesse Éminentissime, c’est que sans son activité et sa prudente fermeté, c’était une affaire manquée par tous les obstacles qu’on lui a suscités et auxquels il ne pouvait et ne devait pas s’attendre. » Archives Nationales, M950.
- C'est le cas par exemple lors de l'affaire du collier de la reine, question sensible pour l'ambassadeur de Malte, car le cardinal de Rohan impliqué dans le scandale est un cousin du Grand Maître. Suffren y fait preuve d'un jugement éclairé en montrant que le cardinal n'a rien à se reprocher, ce que les historiens ont largement confirmé depuis. Rémi Monaque, op. cit., p.123.
- Rémi Monaque, op. cit., p.355.
- Rémi Monaque, op. cit., p.360.
- Lettre du 5 octobre 1786 à Mme d’Alès, Musée de Saint-Cannat
- Puimoisson dispose de beaucoup d’attraits. Le palais du gouverneur, flanqué de seize tours était splendide. Quant à la communauté villageoise, elle se félicitait « d’avoir pour seigneur le héros du siècle ». Marie-Joseph Maurel, Histoire de la commune de Puimoisson et de la commanderie des chevaliers de Malte, Paris, 1897.
- Cité par Rémi Monaque, op. cit., p.360.
- Malgré les viscitudes de l’histoire, une grande partie des constructions romanes sont parvenues jusqu'à nous. Rémi Monaque, op. cit., p.360.
- Il s’agit de vignes, de châtaigniers, mais surtout de mûriers pour l'élevage de vers à soie. Ibidem.
- Ibidem, p.360-361.
- Lettre du 9 octobre 1786 à Mme d’Alès, Musée de Saint-Cannat.
- Lettre du 29 septembre 1787 à Mme d’Alès, Musée de Saint-Cannat.
- Rémi Monaque, op. cit., p.356.
- Jean-Christian Petitfils, op. cit., p.429.
- Au XVIIIe siècle, on emploie le terme dîner pour ce qui correspond à notre actuel déjeuner. Lettre du 18 juillet 1787 à Mme d’Alès. Musée de Saint-Cannat.
- Rémi Monaque, op. cit., p.118.
- Lettre du 9 août 1786, musée de Saint-Cannat.
- Rémi Monaque, op. cit., p.355-356.
- Ibidem. La loge compte aussi, pour être précis, 23 associés libres et 231 membres dans la loge féminine d’adoption, soit un total de de 613 personnes.
- Rémi Monaque, auteur de la dernière biographie n’en souffle strictement rien. La nomination à ce poste est donnée par Etienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, op. cit. Information reprise par Michel Vergé-Franceschi, Dictionnaire d’Histoire Maritime, op. cit.
- Rémi Monaque, op. cit., p.122.
- « Il nous coûtera cher, [mais] au reste c’est juste que ceux qui ont payent. » Lettre du 22 février 1787, musée de Saint-Cannat.
- Rémi Monaque, op. cit., p.362.
- Lettre du 27 septembre 1788, Archives Nationales, Marine, C7 314, plaquette n°1.
- Lettres conservées au musée de Saint-Cannat.
- Témoignage cité par Rémi Monaque (op. cit., p.363), tiré de l’ouvrage médical d’Alfonse Leroy publié en 1805 et qui cite la mort de Suffren en exemple. Manuel des goutteux et des rhumatisants, Paris, chez Mequignon l’ainé, an XIII.
- Lettre du 22 décembre 1788, Archives municipales de Saint-Tropez, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.363. Sylvain se trompe sur la présence du frère de Suffren car l’acte de décès ne mentionne pas la présence de l’évêque de Sisteron lors des obsèques. Il semble qu’il ait confondu avec le vicaire général du diocèse d’Aix, Charles Eugène de Pierrevert, neveu de Suffren, présent à ce moment-là.
- Extrait de la procédure de scellé après décès, citée par Rémi Monaque, op. cit., p.365.
- Rémi Monaque, op. cit., p.365.
- « Entre le docteur Leroy et le cafetier Dehodencq, entre le récit médical de 1805 et le roman de 1832-1845, le doute n’est pas possible. Suffren mourut de mort naturelle, de la goutte remontée au cœur. (…) Dehodencq est un imposteur dont les motifs nous échappent : l’ancien domestique, devenu cafetier, a fabriqué, je ne sais pourquoi un récit auquel il a peut-être finit par croire lui-même, surtout quand il a vu la créance qu’il inspirait. Mais c’est une cote qui ne tient pas debout. » Georges Lacour-Gayet, « Suffren n’est pas mort en duel », Revue Armée et Marine du 5 janvier 1905.
- Etienne Taillemite (Dictionnaire des marins français, op. cit.) et Michel Vergé-Franceschi (Dictionnaire d'Histoire maritime, op. cit.) n'en font même plus mention, mais le rédacteur de l'article « Suffren de Saint-Tropez » du Dictionnaire des personnages historiques y croit encore, en soutenant que le bailli est mort « vraisemblablement à la suite d'un duel, encore que la version officielle (sic) ait évoqué une crise d'apoplexie. » La Pochothèque, éditions Le Livre de Poche, 1995. On trouve encore cette l'affirmation sur la fiche biographique que propose le site de l'encyclopédie en ligne Larousse. Même chose sur le site worldlingo.com, basé sur une mauvaise traduction d'un article en anglais lui même tiré de l'Encyclopaedia Britannica qui donne des « détails » sur le duel... La version plus ou moins originale de cet article peut se lire aussi sur la biographie Wikipedia en anglais consacrée au bailli. Le site Histoire du monde soutient aussi l'affirmation, même s'il estime prudent de signaler une possible mort naturelle. Le site e-corpus reprend le même texte mot pour mot, sans que l'on sache qui a copié sur l'autre...
- Rémi Monaque, op. cit., p.366.
- Dépouille de Monsieur le bailli de Suffren, Archives Nationales, M 907.
- Rémi Monaque, op. cit., p.367.
- On trouve dans le tiroir de son secrétaire 43 louis d'or et d'autres monnaies pour une somme totale de 1 212 livres et 12 sols. Le meuble contient aussi « 34 reconnaissances d'échange de bulletin de la loterie des primes de l'emprunt de 24 millions » et 40 actions de la Compagnie de la traite de la gomme au Sénégal d'une valeur de 1 000 livres chacune. Il y a aussi des bijoux, des œuvres d'art et un mobilier semble-t-il important. Le compte-rendu de la prisée ne nous est pas parvenu. Rémi Monaque, op. cit., p. 368.
- Archives de Malte, ARCH 1623. Document découvert en 2008 par Rémi Monaque, op. cit., p.367-368.
- L'Ordre lui propose des actions de la Compagnie du Sénégal, probablement celles trouvées dans le secrétaire de Suffren au lendemain de sa mort. Ibidem. Avec le retour de la guerre en 1792 et l'effondrement du commerce colonial français, ces actions ne devaient plus avoir grande valeur.
- Guy de Rambaud, Pour l'amour du Dauphin, p. 131
- (Glachant 1976, p. 379)
- Caron, Amiral F., Suffren, Vincennes, 1996
- Jean Boutière, Correspondance de Frédéric Mistral, p. 229
Voir aussi
Bibliographie
- Martine Acerra et André Zysberg, L’essor des marines de guerre européennes, 1680-1790, éditions Sedes, 1997
- Michel Antoine, Louis XV, éditions Hachette, coll. « Pluriel » (no 8571), 1989, 17e éd.
- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe (XVIIe – XVIIIe siècle), éditions PUF, 1992
- Amiral François Caron, Le Mythe de Suffren, Vincennes, Service historique de la Marine, 1996
- Robert Castagnon, Gloires de Gascogne, Villaret de Joyeuse (en partie), éditions Loubatière
- Charles Cunat, Histoire du bailli de Suffren [lire en ligne]
- Roger Glachant, Suffren et le temps de Vergennes, éditions France-Empire, 1976
- Charles-Armand Klein, Mais qui est le bailli de Suffren Saint-Tropez ?, éditions Équinoxe, coll. « Mémoires du Sud », 2000
- (en) Alfred Mahan, The Influence of Sea Power upon History, New York, Dover Publications (repr.), Little, Brown & Co (original), 1890, 1987 (repr.), 1660-1783 (original) (ISBN 0-486-25509-3)
- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française, Rennes, éditions Ouest-France, 1994
- Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, éditions Sedes, 1993
- Rémi Monaque, Suffren : un destin inachevé, édition Tallandier, 2009
- Colonel Henri Ortholan, L’amiral Villaret-Joyeuse : Des Antilles à Venise 1747-1812, Bernard Giovanangeli, 26 janvier 2006, 286 p. (ISBN 2909034852)
- Monique Le Pelley-Fonteny, Itinéraire d’un marin granvillais : Georges-René Pléville le Pelley (1726-1805), Neptunia
les mémoires un autre grand marin naviguant à la même époque.
- Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, éditions Perrin, 2005
- Claude des Presles, Suffren dans l’océan Indien : (1781–1783), Economica, 1999
- Joseph Siméon Roux, Le Bailli de Suffren dans l’Inde [lire en ligne]
- Pierre André de Suffren (préf. le vice-amiral Edmond Jurien de La Gravière, Henri Moris), Journal de bord du bailli de Suffren dans l’Inde (1781-1784), Paris, Challamel, 1888
- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, éditions Tallandier, 2002
- Étienne Taillemite, Louis XVI, ou le navigateur immobile, éditions Payot, 2002
- Raymond d’ Unienville, Hier Suffren, Mauritius Printing, 1972
- Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle, SEDES, 1996
- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », 2002
- Mme J. Vidal-Mégret, Lettres du Bailli de Suffren de Saint-Tropez (1729-1788) : concernant la Campagne en Inde (1782-1783)
- Patrick Villiers et Jean-Pierre Duteil, L’Europe, la mer et les colonies (XVIIe – XVIIIe siècle), Hachette supérieur, coll. « Carré Histoire », 1997
- Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l'Histoire, Marines Editions, 2011
Liens externes
Catégories :- Naissance en Provence
- Naissance en 1729
- Décès en 1788
- Personnalité de la franc-maçonnerie initiée avant 1800
- Personnalité française de la Guerre d'indépendance des États-Unis
- Personnalité française du XVIIIe siècle
- Personnalité provençale historique
- Noble français
- Amiral français
- Chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
- Ordre du Saint-Esprit
Wikimedia Foundation. 2010.