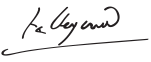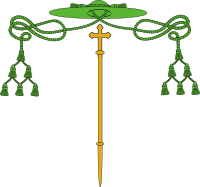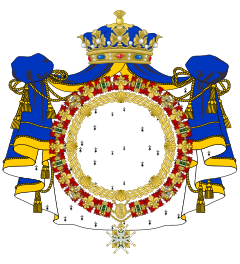- Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
-
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, communément nommé Talleyrand[N 1], est un homme d'État et diplomate français, né le 2 février 1754 à Paris, mort dans cette même ville le 17 mai 1838.
Issu d'une famille de la haute noblesse, boiteux, il est orienté vers la carrière ecclésiastique à la suite de son oncle, l'archevêque de Reims : il devient prêtre puis évêque d'Autun, avant de quitter le clergé pendant la Révolution pour mener une vie laïque.
Talleyrand occupe des postes de pouvoir politique durant la majeure partie de sa vie et sous la plupart des régimes successifs que la France connaît à l'époque : il est notamment agent général du clergé et député aux États généraux sous l'Ancien Régime, président de l'Assemblée nationale et ambassadeur pendant la Révolution française, ministre des Relations extérieures sous le Directoire, le Consulat puis sous le Premier Empire, ambassadeur, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres sous la Restauration, ambassadeur sous la Monarchie de Juillet. Il assiste aux couronnements de Louis XVI (1775), Napoléon Ier (1804), Charles X (1825) et Louis-Philippe Ier (1830) [N 2].
Il intervient fréquemment dans les questions économiques et financières, pour lesquelles son acte le plus fameux est la proposition de nationalisation des biens du clergé. Toutefois, sa renommée provient surtout de sa carrière diplomatique exceptionnelle, dont l'apogée est le congrès de Vienne. Homme des Lumières, libéral convaincu, tant du point de vue politique et institutionnel que social et économique, Talleyrand théorise et cherche à appliquer un « équilibre européen » entre les grandes puissances.
Réputé pour sa conversation, son esprit et son intelligence, il mène une vie entre l'Ancien Régime et le XIXe siècle. Décrit comme le « diable boiteux »[N 3], un traître cynique plein de vices et de corruption, ou au contraire comme un dirigeant pragmatique et visionnaire, soucieux d'harmonie et de raison, admiré ou détesté par ses contemporains, il suscite de nombreuses études historiques et artistiques.
Sommaire
Origine et jeunesse
Le père de Charles-Maurice, Charles-Daniel de Talleyrand-Périgord (1734-1788), chevalier de Saint-Michel en 1776, lieutenant général en 1784, appartient à une branche cadette de la maison de Talleyrand-Périgord, famille de haute noblesse, même si sa filiation avec les comtes de Périgord est contestée[2]. Il vit à Versailles, désargenté, avec sa femme Alexandrine de Damas d'Antigny (1728-1809)[N 4],[3]. Talleyrand a surtout pour oncle Alexandre Angélique de Talleyrand-Périgord (1736-1821), archevêque de Reims, cardinal et archevêque de Paris. Il compte parmi ses ancêtres notamment Jean-Baptiste Colbert et Étienne Marcel[4].
Né le 2 février 1754[N 5] au numéro 4 de la rue Garancière à Paris, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est baptisé le même jour[5].
Avant la parution de ses mémoires, plusieurs versions circulent déjà sur l'enfance de Talleyrand, en particulier sur l'origine de son pied-bot[6]. Depuis leur divulgation en 1889, ces mémoires sont la source d'informations la plus exploitée sur cette partie de sa vie ; la version donnée par Talleyrand est cependant contestée par une partie des historiens.
Selon la version donnée par ses mémoires, il est immédiatement remis à une nourrice qui le garde quatre ans chez elle dans le faubourg Saint-Jacques, ce qui n'est pas le cas de ses frères. Toujours selon l'intéressé, il serait tombé d'une commode à l'âge de quatre ans, d'où son pied-bot : cette infirmité lui vaut de ne pas pouvoir accéder aux fonctions militaires et d'être destitué de son droit d'aînesse par ses parents qui le destinent alors à une carrière ecclésiastique. Son frère cadet Archambault prend sa place (l'aîné des fils étant mort en bas âge).
Selon Franz Blei, dans ses mémoires, Talleyrand « évoque ses parents avec une surprenante antipathie »[7] :
« Cet accident a influé sur tout le reste de ma vie ; c'est lui qui, ayant persuadé à mes parents que je ne pouvais être militaire, ou du moins l'être sans désavantage, les a portés à me diriger vers une autre profession. Cela leur parut plus favorable à l'avancement de la famille. Car dans les grandes maisons, c'était la famille que l'on aimait, bien plus que les individus, et surtout que les jeunes individus que l'on ne connaissait pas encore. Je n'aime point m'arrêter sur cette idée… je la quitte. »
— Mémoires de Talleyrand[8]
Une partie des biographes, comme Jean Orieux, donnent raison à Talleyrand, qui laisse entendre que ses parents ne l'aimaient pas, ne tolérant pas qu'il fût « simultanément pied bot et Talleyrand »[9]. De leur côté, ses deux frères cadets, Archambaud (1762-1838) et Boson (1764-1830), se marient avec de riches héritières de la noblesse de finance[N 6],[10].
Il séjourne de 1758 à 1761 chez sa bisaïeule et « femme délicieuse », Marie-Françoise de Rochechouart, au château de Chalais, période dont il garde un souvenir ému. Il est ensuite envoyé au collège d'Harcourt (futur Lycée Saint-Louis) de 1762 à 1769, puis chez son oncle archevêque, où on l'incite à embrasser la carrière ecclésiastique ; il obtempère[11].
Cette version de son enfance est contestée par plusieurs biographes. Si Michel Poniatowski parle d'un pied-bot de naissance, Emmanuel de Waresquiel va plus loin et affirme que Talleyrand souffre d'une maladie héréditaire (un de ses oncles en étant affecté), le syndrome de Marfan[12]. Toujours selon Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand est devenu prêtre non pas à cause d'un manque d'affection de ses parents, mais de la volonté de le placer dans la succession du richissime et puissant archevêché de Reims détenu par son oncle (perspective susceptible de vaincre ses réticences), son âge le plaçant comme le seul en mesure de le faire au sein de sa fratrie[13]. Ainsi, Talleyrand n'aurait blâmé ses parents que dans le contexte de la rédaction de ses mémoires, où il devait faire apparaître sa prêtrise comme ayant été contrainte[14].
C'est ce qui amène Georges Lacour-Gayet à parler d'un « prétendu abandon »[15]. Pour Franz Blei, s'il est exact qu'il « n'a pas eu de maison paternelle pleine de sécurité et d'affection », il se montre injuste envers sa mère, qui n'a fait que suivre les usages d'éducation de l'époque, avant la mode de l’Émile de Jean-Jacques Rousseau[16] ; ses parents ont aussi des charges très prenantes à la cour.
Carrière ecclésiastique
En 1770, âgé de seize ans, il entre au séminaire Saint-Sulpice, où, selon ses mémoires, il fait preuve de mauvaise humeur et se retranche dans la solitude[17].
Le 28 mai 1774, il reçoit les ordres mineurs. Le 22 septembre 1774, il obtient un baccalauréat[N 7] en théologie à la Sorbonne. Sa thèse est acquise grâce à sa naissance plutôt qu'à son travail : elle est rédigée au moins en partie par son directeur de thèse de la Sorbonne, Charles Mannay[N 8],[N 9],[18], et il obtient une dispense d'âge qui lui permet de la présenter à 20 ans au lieu des 22 requis[19]. À 21 ans, le 1er avril 1775, il reçoit le sous-diaconat, premier ordre majeur, en dépit de ses avertissements : « On me force à être ecclésiastique, on s'en repentira[20] », fait-il savoir. Peu après, le 3 mai, il devient chanoine de la cathédrale de Reims, puis, le 3 octobre, abbé commendataire de Saint-Denis de Reims, ce qui lui assure un revenu confortable[21].
Le 11 juin 1775, il assiste au sacre de Louis XVI, auquel participent son oncle comme coadjuteur de l'évêque consécrateur et son père comme otage de la sainte Ampoule[22]. Cette année-là, en dépit de son jeune âge, il est député du second ordre et surtout promoteur de l'assemblée du clergé[23].
En mars 1778, alors qu'il est licencié en théologie[24], il rend visite à Voltaire, qui le bénit devant l'assistance[25]. La veille de son ordination, Auguste de Choiseul-Gouffier raconte l'avoir découvert prostré et en pleurs. Son ami insiste pour qu'il renonce mais Talleyrand lui répond : « Non, il est trop tard, il n'y a plus à reculer »[26] ; cette anecdote serait une invention, d'après Emmanuel de Waresquiel[27]. Il est ordonné prêtre le lendemain, 18 décembre 1779. Le surlendemain, il célèbre devant sa famille sa première messe, et son oncle le nomme vicaire général de l'évêché de Reims[28].
L'année suivante, au printemps 1780, il devient, toujours grâce à son oncle, agent général du clergé de France, charge qui l'amène à défendre les biens de l'Église face aux besoins d'argent de Louis XVI. Il fait ainsi accepter en 1782 un « don gratuit » au roi de plus de 15 millions de livres pour couper court aux menaces de confiscation venant de la couronne[29]. Il intervient également dans la crise de la Caisse d'escompte de 1783[30] et doit gérer la colère du bas-clergé en maniant la carotte et le bâton. Tous ces travaux lui permettent de s'initier à la finance, aux affaires immobilières et à la diplomatie ; il prend connaissance de l'étendue de la richesse du clergé et noue de nombreuses relations parmi les hommes d'influence de l'époque. Élu secrétaire de l'Assemblée générale de 1785-1786, il est félicité par ses pairs à l'occasion de son rapport final[31].
Il fréquente et anime les salons libéraux proches des Orléans et noue de nombreuses relations dans ce milieu. Installé rue de Bellechasse, il a pour voisin Mirabeau : les deux hommes se lient d'amitié, de politique et d'affaires. Il est alors proche de Calonne, ministre impopulaire de Louis XVI[32] ; il participe à la négociation du traité de commerce avec la Grande-Bretagne conclu en 1786[33]. Il fait ainsi partie des rédacteurs du plan de Calonne pour réformer complètement les finances du royaume et qui reste à l'état de projet en raison de la crise financière et du départ du ministre[34].
Son statut d'ancien agent général du clergé doit en principe le propulser rapidement à l'épiscopat[35] alors que croissent ses besoins d'argent[36] ; pourtant, la nomination tarde à venir. L'explication généralement donnée par les historiens est sa vie dissolue, avec son goût pour le jeu, pour le luxe, et ses maîtresses, ce qui indispose Alexandre de Marbeuf, évêque d'Autun et responsable des nominations[37], et qui choque Louis XVI. Emmanuel de Waresquiel conteste cette analyse[38], expliquant cette attente par la notoriété de ses amitiés orléanistes hostiles au clan de la reine et par la perte d'influence de sa famille[39].
Le 2 novembre 1788, il est finalement nommé évêque d'Autun, grâce à la requête que son père mourant a adressée à Louis XVI. « Cela le corrigera », aurait déclaré le roi en signant la nomination. Le 3 décembre, il reçoit également le bénéfice de l'Abbaye Royale de Celles-sur-Belle[40]. Il est sacré le 16 janvier 1789 par Mgr de Grimaldi, évêque de Noyon[41]. Ernest Renan raconte, parlant d’un de ses professeurs à Saint-Sulpice :
« M. Hugon avait servi d'acolyte au sacre de M. de Talleyrand à la chapelle d'Issy, en 1788. Il paraît que, pendant la cérémonie, la tenue de l'abbé de Périgord fut des plus inconvenantes. M. Hugon racontait qu'il s'accusa, le samedi suivant, en confession, « d'avoir formé des jugements téméraires sur la piété d'un saint évêque ». »
— Ernest Renan, Souvenirs d’enfance et de jeunesse
Après une campagne courte et efficace, il est élu le 2 avril député du clergé d'Autun aux états généraux de 1789. Le 12 avril au matin, un mois après être arrivé et esquivant la messe de Pâques, Talleyrand quitte définitivement Autun et rentre à Paris[42] pour l'ouverture des états généraux, le 5 mai, qui marque le début de la Révolution française.
Révolution
Constituante
Durant les états généraux, Talleyrand se rallie au tiers état le 26 juin[43], avec la majorité du clergé et la veille de l'invitation de Louis XVI à la réunion des ordres[44]. Le 7 juillet, il demande la suppression des mandats impératifs ; le 14 juillet 1789 (renouvelé le 15 septembre), il est le premier membre nommé au comité de constitution de l'Assemblée nationale[45]. Il est ainsi signataire de la Constitution présentée au roi et acceptée par celui-ci le 14 septembre 1791 et est l'auteur de l'article VI de la déclaration des droits de l'Homme, qui lui sert de préambule :
« La loi est l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »
— Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789[46]
Le 10 octobre 1789, il dépose une motion auprès de l'Assemblée constituante, qui propose d'utiliser « les grands moyens » pour renflouer les caisses de l'État : la nationalisation des biens de l'Église[47]. Selon lui :
« Le clergé n'est pas propriétaire à l'instar des autres propriétaires puisque les biens dont il jouit et dont il ne peut disposer ont été donnés non pour l'intérêt des personnes mais pour le service des fonctions[48]. »
Défendu par Mirabeau, le projet est voté le 2 novembre[49]. Fêté par Le Moniteur, couvert d'injures dans des pamphlets[50], « faisant l'horreur et le scandale de toute sa famille[51] », Talleyrand devient pour une partie du clergé celui qui a trahi son ordre, son ancien poste de brillant Agent général le rendant d'autant plus détestable à ceux pour qui il est « l'apostat »[52]. Le 28 janvier 1790, il propose d'accorder le statut de citoyen aux juifs, ce qui donne de nouveaux arguments aux pamphlétaires[53]. Le 16 février, il est élu président de l'Assemblée avec 373 voix[54] contre 125 à Sieyès. Alors que la Constitution va être adoptée, Talleyrand et les royalistes constitutionnels sont alors à l'apogée de leur influence sur la Révolution[55].
Talleyrand propose à l'Assemblée constituante le 7 juin 1790 le principe d'une fête célébrant l'unité des Français, où les gardes nationaux serviraient de représentants[56] : la fête de la Fédération, sur le Champ-de-Mars. Nommé à cet office par le roi[57], il célèbre la messe devant 300 000 personnes le 14 juillet 1790, même s'il est peu familier de l'exercice[N 10],[58] ; montant sur l'estrade supportant l'autel, il aurait dit à La Fayette : « Par pitié, ne me faites pas rire »[N 11].
En mars 1790, il propose l'adoption du système d'unification des mesures[54].
Le 28 décembre 1790, Talleyrand prête serment à la constitution civile du clergé, puis démissionne de sa charge épiscopale au milieu du mois de janvier 1791[59], sous le prétexte de son élection comme administrateur du département de Paris[60]. Pourtant, comme les deux premiers évêques constitutionnels (Louis-Alexandre Expilly de La Poipe, évêque du Finistère, et Claude Marolles, évêque de l'Aisne[N 12]) n'arrivent pas à trouver d'évêque pour les sacrer, Talleyrand est obligé de se dévouer. Il manœuvre deux évêques (les prélats in partibus de Lydda, Jean-Baptiste Gobel et de Babylone, Jean-Baptiste Miroudot du Bourg[61]) pour l'assister : le sacre a lieu le 24 février 1791, suivi par quatorze autres[62], les nouveaux évêques étant parfois appelés « talleyrandistes ». Peu après, dans le bref Quod aliquantum du 10 mars 1791, puis Caritas du 13 avril 1791, le pape Pie VI exprime sa douleur devant cet acte schismatique et prend en compte la démission de Talleyrand de sa charge[63], le menaçant d'excommunication sous quarante jours s'il ne revient pas à résipiscence[64].
Durant l'année 1791, alors que meurt son ami Mirabeau, il dirige la rédaction d'un important rapport sur l'instruction publique, qu'il présente à l'assemblée constituante juste avant sa dissolution, les 10, 11 et 19 septembre et qui provoque la création de l'Institut de France[65].
Alors qu'il n'est plus député[N 13], du 24 janvier au 10 mars 1792, Talleyrand est envoyé en mission diplomatique à Londres, pour des achats de chevaux et afin de prendre la température sur une possible neutralité des Britanniques[66]. Il y retourne le 29 avril avec François Bernard Chauvelin. En dépit de l'atmosphère hostile, ils obtiennent la neutralité le 25 mai[67]. Talleyrand rentre à Paris le 5 juillet et, le 28, démissionne de son poste d'administrateur du département de Paris[68].
Exil
À la suite de la journée du 10 août 1792, anticipant la Terreur, il demande à être renvoyé à Londres. Le 7 septembre, il arrache un ordre de mission à Danton[69], en pleins massacres de Septembre, sous le prétexte de travailler à l'extension du système de poids et de mesures. Cela lui permet de prétendre qu'il n'a pas émigré : « Mon véritable but était de sortir de France, où il me paraissait inutile et même dangereux pour moi de rester, mais d'où je ne voulais sortir qu'avec un passeport régulier, de manière à ne m'en pas fermer les portes pour toujours[70] ». Il part le 10 septembre[71].
Le 5 décembre, un décret d'accusation est porté contre le « ci-devant évêque d'Autun » après l'ouverture de l'armoire de fer qui révèle les liens entre lui, Mirabeau et la famille royale[72] ; se gardant bien de revenir en France, Talleyrand est porté sur la liste des émigrés à sa parution, par arrêté du 29 août 1793[73].
Affirmant être là pour vendre sa bibliothèque[74], il vit paisiblement à Kensington « pendant toute l'effroyable année 1793 », fréquente les constitutionnels émigrés, noue des relations avec des Anglais influents[75] et souffre à la fois du manque d'argent et de la haine des premiers émigrés[76]. Fin janvier 1794, on lui annonce que le roi George III ordonne son expulsion, en vertu de l'alien bill (« loi sur les étrangers »)[77]. Il part en mars 1794 et se réfugie aux États-Unis pendant deux ans, vivant à Philadelphie[78], New York[79] et Boston[80]. Là, il cherche à faire fortune, grâce à la spéculation sur les terrains[81], prospectant dans les forêts du Massachusetts[82]. Il arme même un navire pour commercer avec l'Inde, mais pense surtout à revenir en France[83].
Juste après la Terreur, il adresse à la Convention thermidorienne, le 15 juin 1795, une pétition plaidant sa cause[84] ; dans le même temps, Germaine de Staël, avec qui Talleyrand correspond[N 14], fait en sorte que Marie-Joseph Chénier réclame son retour à l'Assemblée[85]. Par un discours du 4 septembre 1795, ce dernier obtient la levée du décret d'accusation à l'encontre de Talleyrand. Il est rayé de la liste des émigrés et, après avoir fait escale à Hambourg et Amsterdam, retrouve la France du jeune Directoire le 20 septembre 1796[86].
Directoire
Peu après son arrivée, Talleyrand entre à l'Institut de France, où il a été élu le 14 décembre 1795 à l'Académie des sciences morales et politiques avant même son départ des États-Unis ; il publie deux essais sur la nouvelle situation internationale, fondés sur ses voyages hors de France[87]. Il participe à la fondation du Cercle constitutionnel, républicain, en dépit de ses amitiés orléanistes et de l'hostilité des conventionnels, qui voient en lui un contre-révolutionnaire[88].
N'arrivant pas à se faire nommer ministre des Relations extérieures à la place de Charles Delacroix, envoyé comme ambassadeur auprès de la République batave, il fait jouer l'influence de plusieurs femmes, surtout son amie Germaine de Staël[89]. Cette dernière fait le siège de Barras, le plus influent des directeurs, qu'elle supplie dans des scènes enflammées, finissant par obtenir son accord[90]. Talleyrand préfère raconter dans ses mémoires[91] qu'arrivant pour dîner chez Barras, il le découvre effondré par la noyade de son aide de camp et le console longuement, d'où la bienveillance du directeur à son égard. Dans le jeu des nominations du remaniement du 16 juillet 1797, qui intervient dans les prémices du coup d'État du 18 Fructidor[92], Barras obtient l'accord des autres Directeurs, qui sont pourtant hostiles à l'ancien évêque[93].
Lors de sa nomination, Talleyrand aurait dit à Benjamin Constant : « Nous tenons la place, il faut y faire une fortune immense, une immense fortune[94] ». De fait, et dès cet instant, cet « homme d'infiniment d'esprit, qui manquait toujours d'argent »[95] prend l'habitude de recevoir d'importantes sommes d'argent de l'ensemble des États étrangers avec lesquels il traite. Fin 1797, il provoque même un incident diplomatique en faisant demander des pots-de-vin à trois envoyés américains : c'est l'affaire XYZ qui provoque la « quasi-guerre ».
« M. de Talleyrand évaluait lui-même à soixante millions ce qu'il pouvait avoir reçu en tout des puissances grandes ou petites dans sa carrière diplomatique. »
— Charles-Augustin Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis[96]
Dès sa nomination, Talleyrand écrit à Napoléon Bonaparte :
« J'ai l'honneur de vous annoncer, général, que le Directoire exécutif m'a nommé ministre des Relations extérieures. Justement effrayé des fonctions dont je sens la périlleuse importance, j'ai besoin de me rassurer par le sentiment de ce que votre gloire doit apporter de moyens et de facilité dans les négociations. Le nom seul de Bonaparte est un auxiliaire qui doit tout aplanir. Je m'empresserai de vous faire parvenir toutes les vues que le Directoire me chargera de vous transmettre, et la renommée, qui est votre organe ordinaire, me ravira souvent le bonheur de lui apprendre la manière dont vous les aurez remplies. »
— Lettre de Talleyrand à Napoléon Bonaparte[97]
Séduit par le personnage, Bonaparte écrit au Directoire pour lui signifier que le choix de Talleyrand « fait honneur à son discernement »[98]. Une importante correspondance suit ; dans celle-ci, Bonaparte exprime très tôt le besoin de renforcer l'exécutif[99]. Il n'en fait qu'à sa tête en Italie : le traité de Campo-Formio est signé le 17 octobre 1797 et Talleyrand le félicite malgré tout[100]. Le 6 décembre, les deux hommes se rencontrent pour la première fois[101], alors que Bonaparte revient couvert de gloire de la campagne d'Italie. Le 3 janvier 1798, Talleyrand donne une fête somptueuse en son honneur en l'hôtel de Galliffet, où est installé le ministère[102]. Il incite Bonaparte à tenter l'expédition d'Égypte et favorise son départ[103], tout en refusant de s'y impliquer activement, ne se rendant pas comme convenu avec Bonaparte à Constantinople, et provoquant ainsi la colère du général[104].
Le Directoire, en particulier Jean-François Reubell qui déteste Talleyrand, traite lui-même les affaires importantes et l'utilise comme un exécutant[105]. La politique de Talleyrand, qui va parfois à l'encontre même de celle des directeurs, a pour but de rassurer les États européens et d'obtenir l'équilibre et la paix ; il fait part de ses réserves sur la politique de « libération » des pays conquis[106]. Il prend possession de l'administration des Affaires étrangères, qu'il garnit d'hommes travailleurs, efficaces, discrets et fidèles[107], même si c'est le Directoire qui choisit les ambassadeurs, sans même le consulter[108].
Il prend des contacts avec Sieyès et avec les généraux Joubert qui meurt peu après, Brune, puis Bonaparte lorsqu'il revient d'Égypte, dans l'optique du renversement du Directoire[109]. Le 13 juillet 1799, prenant pour prétexte les attaques menées contre lui par la presse[110] et par un obscur adjudant-général qui lui intente un procès et le gagne[111], il démissionne du ministère[112] qu'il quitte le 20 juillet[113]. Il se consacre à la préparation du coup d'État du 18 Brumaire (9 novembre 1799) en conspirant contre le Directoire avec Bonaparte et Sieyès. Le jour dit, il est chargé de réclamer sa démission à Barras : il y parvient si bien qu'il conserve par-devers lui la compensation financière qui était destinée à ce dernier[114].
Période napoléonienne
Consulat
 « La destruction des canonnières françaises » ou « le petit Boney et son ami Talley dans une grande joie », caricature britannique montrant Napoléon, assis sur l'épaule de « Talley », scrutant joyeusement (à travers un grand document roulé en longue-vue nommé « le plan de Talleyrand pour envahir la Grande-Bretagne ») la Manche, où la flotte française se fait détruire par les boulets des navires britanniques.
« La destruction des canonnières françaises » ou « le petit Boney et son ami Talley dans une grande joie », caricature britannique montrant Napoléon, assis sur l'épaule de « Talley », scrutant joyeusement (à travers un grand document roulé en longue-vue nommé « le plan de Talleyrand pour envahir la Grande-Bretagne ») la Manche, où la flotte française se fait détruire par les boulets des navires britanniques.
Après le coup d'État, il retrouve son rôle de ministre face aux cours européennes peu mécontentes de la fin du Directoire. Bonaparte et Talleyrand s'accordent sur le fait que les affaires étrangères relèvent du domaine exclusif du Premier Consul : le ministre ne rend compte qu'à Bonaparte[115]. Pour François Furet, Talleyrand est « pendant presque huit ans [...] le second rôle du régime[116] ».
Bonaparte accède aux vues de Talleyrand et écrit amicalement au roi de Grande-Bretagne, puis à l'empereur d'Autriche, qui refusent de façon prévisible les propositions de réconciliation[117], sans même accuser réception des lettres[118]. Le tsar de Russie Paul Ier se montre plus favorable : un traité est négocié et signé. Cependant, Paul Ier est assassiné en 1801 par un groupe d’ex-officiers[N 15]. Son fils Alexandre Ier lui succède.
Les traités de Mortefontaine du 30 septembre 1800 pour la pacification des relations avec les États-Unis, et de Lunéville du 9 février 1801 pour la paix avec l'Autriche vaincue à Marengo, ainsi que la paix d'Amiens du 25 mars 1802 avec le Royaume-Uni et l'Espagne, sont négociés principalement par Napoléon et Joseph Bonaparte : d'après Mme Grand, « le Premier Consul a tout fait, tout rédigé »[119]. Même s'il désapprouve la méthode brutale de négociation, Talleyrand approuve la paix générale, dont les négociations lui permettent de surcroît de gagner beaucoup d'argent, grâce à des trucages et pots-de-vin divers[120]. Il manœuvre les Italiens afin qu'ils élisent Bonaparte président de la République italienne[121]. Les espoirs du ministre sont cependant déçus :
« La paix d'Amiens était à peine conclue, que la modération commença à abandonner Bonaparte ; cette paix n'avait pas encore reçu sa complète exécution, qu'il jetait déjà les semences de nouvelles guerres qui devaient après avoir accablé l'Europe et la France, le conduire lui-même à sa ruine. »
— Mémoires de Talleyrand[121]
La même année, il achète le château de Valençay, encore sur injonction de Bonaparte et avec son aide financière. Le domaine s'étend sur environ 200 km2[122], ce qui en fait l'une des plus grandes propriétés privées de l'époque. Talleyrand y séjourne régulièrement, en particulier avant et après ses cures thermales à Bourbon-l'Archambault[123].
En 1804, face à l'augmentation du nombre d'attentats perpétrés par des royalistes contre Bonaparte, Talleyrand joue un rôle d'instigateur ou de conseiller dans l'exécution du duc d'Enghien, rôle dont l'importance suscitera un débat durant la Restauration suite aux accusations de Savary : selon Barras, Talleyrand conseille à Bonaparte de « mettre entre les Bourbons et lui un fleuve de sang[124] » ; selon Chateaubriand, il « inspira le crime »[125]. Le 21 mars, alors que l'arrestation du duc n'est pas encore connue, Talleyrand déclare à l'assistance, à deux heures du matin : « Le dernier Condé a cessé d'exister[126] ». Dans ses mémoires, Bonaparte indique que « c'est Talleyrand qui [l]'a décidé à arrêter le duc d'Enghien », mais revendique l'exécution comme sa décision personnelle[127]. À la Restauration, en 1814, Talleyrand fait disparaître tous les documents se rapportant à cette affaire[128] ; il nie par la suite avoir pris part à cette exécution, dans une annexe de ses mémoires[129].
Empire
Nommé grand chambellan le 11 juillet 1804, Talleyrand, qui a poussé Bonaparte à instituer l'hérédité du pouvoir[130], assiste le 2 décembre au sacre de Napoléon Ier. Il est également nommé grand cordon de la Légion d'honneur le 1er février 1805, dans la première promotion[131].
En 1805 commence la campagne d'Autriche. Talleyrand suit l'empereur dans ses trajets à travers l'Europe. À son arrivée à Strasbourg, il assiste à une violente crise de ce dernier[132], qui pour Georges Lacour-Gayet s'apparente à une crise d'épilepsie[133]. Au lendemain de la victoire d'Ulm, il envoie de Strasbourg un rapport à l'empereur sur la nécessaire modération à observer vis-à-vis de l'Autriche afin d'instaurer un équilibre entre les quatre (France, Royaume-Uni, Autriche, Russie — auxquels il ajoute la Prusse)[134],[135],[136]. Après l'éclatante victoire d'Austerlitz et l'écrasante défaite de Trafalgar, Talleyrand signe à contrecœur (selon Metternich, il commence à envisager sa démission[137]) le traité de Presbourg (26 décembre 1805), annonçant la création de la Confédération du Rhin, qu'il rédige sur ordre de l'empereur mais où il essaie d'adoucir les conditions imposées à l'Autriche. En accordant dix pour cent de rabais et des délais sur les sanctions financières[138], il mécontente Napoléon, qui le suspecte d'avoir été corrompu :
« L'Autriche, dans l'état de détresse où elle était réduite, ne pouvait que subir les conditions imposées par le vainqueur. Elles étaient dures, et le traité fait avec M. d'Haugwitz rendait pour moi impossible de les adoucir sur d'autres articles que celui des contributions. […] [Napoléon] m'écrivit à quelque temps de là : "Vous m'avez fait à Presbourg un traité qui me gêne beaucoup." »
— Mémoires de Talleyrand[139]
En 1806, il reçoit le titre de « prince de Bénévent », État confisqué au pape où il ne se rend pas une seule fois, se contentant d'envoyer un gouverneur[140]. Le 12 juillet de la même année, il signe le traité créant la Confédération du Rhin, prolongeant la volonté de Napoléon par ses nombreuses négociations[141]. Amorçant la critique de la politique guerrière de ce dernier sans oser le défier, toujours déçu dans ses conseils de modération et étant en contact permanent avec l'Autriche dans l'espoir d'un rapprochement[142], il commence à communiquer des informations au tsar Alexandre Ier via son ami le duc de Dalberg[143]. En 1807, après une série de victoires de Napoléon (Eylau, Dantzig, Heilsberg, Guttstadt, Friedland), il rédige (se « content[ant] de tenir la plume »[137]) et signe le traité de Tilsit. Il se déclare « indigné »[144] par le traitement réservé aux vaincus, en particulier la reine de Prusse, et mécontent d'être un « ministre des Relations extérieures sans emploi »[145]. Il prend certainement à cette occasion la décision de démissionner de son poste de ministre à son retour de Varsovie, voire l'annonce dès cet instant à Napoléon[137]. Cela ne l'empêche pas de favoriser le rapprochement entre ce dernier et Marie Walewska[146],[147]. Sa démission est effective le 10 août 1807. Le 14, il est nommé vice-grand-électeur de l'Empire.
 Nicolas Gosse, Napoléon reçoit à Erfurt l’ambassadeur d’Autriche, sous le regard de Talleyrand, entre eux deux.
Nicolas Gosse, Napoléon reçoit à Erfurt l’ambassadeur d’Autriche, sous le regard de Talleyrand, entre eux deux.
Talleyrand se détache peu à peu de l'empereur, mais reste cependant son conseiller[148] : il lui déconseille fortement d'entamer la guerre en Espagne, « en exposant l'immoralité et les dangers d'une pareille entreprise »[149]. L'empereur ne tient pas compte de l'avertissement et capture par la ruse les infants d'Espagne, puis confie leur garde à Talleyrand, qui les loge durant sept ans à Valençay, hospitalité qui se révèle agréable aux prisonniers[150].
En septembre 1808, Napoléon le charge de le seconder à l'entrevue d'Erfurt avec le tsar de Russie, sans ignorer que Talleyrand est hostile à l'alliance qu'il cherche, lui préférant la voie autrichienne[151]. Pendant les discussions en marge des entrevues entre les deux empereurs, Talleyrand va jusqu'à déconseiller à Alexandre de s'allier avec Napoléon, en lui déclarant : « Sire, que venez-vous faire ici ? C'est à vous de sauver l'Europe, et vous n'y parviendrez qu'en tenant tête à Napoléon. Le peuple français est civilisé, son souverain ne l'est pas ; le souverain de la Russie est civilisé, son peuple ne l'est pas ; c'est donc au souverain de la Russie d'être l'allié du peuple français », puis « le Rhin, les Alpes, les Pyrénées sont la conquête de la France ; le reste est la conquête de l'Empereur ; la France n'y tient pas »[152]. C'est la « trahison d'Erfurt », « fourberie » (pour Georges Lacour-Gayet[153]) qu'il détaille longuement dans ses mémoires, affirmant avoir manœuvré l'un et l'autre empereur pour préserver l'équilibre européen[154] (« à Erfurt, j'ai sauvé l'Europe d'un complet bouleversement[155] ») et qui lui vaudra plus tard l'inimitié des bonapartistes. Pour l'heure, Napoléon, qui ignore le sabotage, est surpris du manque de réussite de ses discussions avec Alexandre, et l'alliance ne se fait pas, la convention étant devenue « insignifiante »[156].
Alors que l'on reste sans nouvelles de l'empereur depuis l'Espagne, où la guérilla fait rage, et que la rumeur de sa mort se répand, Talleyrand intrigue au grand jour avec Joseph Fouché pour offrir la régence à l'impératrice Joséphine, en cherchant le soutien de Joachim Murat[157]. Le 17 janvier 1809, en Espagne, Napoléon apprend la conjuration et accourt à Paris, arrivant le 23[157]. Le 28, durant trente minutes[158], il abreuve Talleyrand d'injures ordurières à l'issue d'un conseil restreint de circonstance (la phrase célèbre « vous êtes de la merde dans un bas de soie » n'est peut-être pas prononcée en cette circonstance[N 16]), l'accuse de trahison et lui retire son poste de grand chambellan[159]. Talleyrand est convaincu d'être arrêté, mais reste impassible : il aurait dit à la sortie dudit conseil : « Quel dommage, Messieurs, qu'un aussi grand homme ait été si mal élevé[160] ». Au contraire de Fouché qui joue profil bas, il se présente toujours à la cour et ce dès le lendemain de la fameuse scène[161], fait jouer les femmes auprès de Napoléon[162] mais ne dissimule pas son opposition :
 Talleyrand en habit de grand chambellan (détail), par Pierre-Paul Prud'hon, portrait version rouge de 1807 (Musée Carnavalet de Paris)
Talleyrand en habit de grand chambellan (détail), par Pierre-Paul Prud'hon, portrait version rouge de 1807 (Musée Carnavalet de Paris)
« Napoléon avait eu la maladresse (et on en verra plus tard la conséquence) d'abreuver de dégoût ce personnage si délié, d'un esprit si brillant, d'un goût si exercé et si délicat, qui, d'ailleurs, en politique lui avait rendu autant de services pour le moins que j'avais pu lui en rendre moi-même dans les hautes affaires de l'État qui intéressaient la sûreté de sa personne. Mais Napoléon ne pouvait pardonner à Talleyrand d'avoir toujours parlé de la guerre d'Espagne avec une liberté désapprobatrice. Bientôt, les salons et les boudoirs de Paris devinrent le théâtre d'une guerre sourde entre les adhérents de Napoléon d'une part, Talleyrand et ses amis de l'autre, guerre dont l'épigramme et les bons mots étaient l'artillerie, et dans laquelle le dominateur de l'Europe était presque toujours battu. »
— Mémoires de Joseph Fouché[163]
Menacé d'exil avec son comparse, voire dans sa vie, il n'est finalement pas inquiété, conserve ses autres postes et l'empereur le consulte toujours. Pour Jean Orieux, il est pour Napoléon « insupportable, indispensable et irremplaçable »[164] : Talleyrand travaille à son divorce et à son remariage, en lui suggérant le « mariage autrichien »[165], qu'il plaide dans le conseil extraordinaire du 28 janvier 1810[166]. Il est alors gêné financièrement, du fait de la perte de ses charges et du coût de l'hébergement des infants d'Espagne, que la dotation de Napoléon ne couvre pas complètement[167]. La faillite de la banque Simons, dans laquelle il perd un million et demi, le met alors dans une position si délicate qu'il sollicite en vain un prêt au tsar. Il reçoit cependant toujours des pots-de-vin et finit par vendre une nouvelle fois sa bibliothèque[168]. En 1811, Napoléon finit par le sortir de ses ennuis financiers en lui achetant l'hôtel Matignon ; deux ans plus tard, Talleyrand déménage dans l'hôtel de Saint-Florentin[169].
En 1812, dans le cadre de la préparation de la campagne de Russie, Napoléon pense emprisonner préventivement Fouché et Talleyrand, tout en envisageant d'envoyer ce dernier comme ambassadeur en Pologne[170]. Talleyrand accueille la nouvelle de la retraite de Russie en déclarant : « c'est le commencement de la fin[171] » ; il intensifie ses relations d'intrigue[172]. En décembre 1812, Talleyrand incite sans succès Napoléon à négocier la paix et à accorder d'importantes concessions ; il refuse le poste de ministre des Relations extérieures que lui propose à nouveau l'empereur[173]. Il écrit à Louis XVIII via son oncle, début d'une correspondance qui dure toute l'année 1813[174] ; la police impériale intercepte certaines lettres et l'empereur pense l'exiler et le poursuivre en justice[175]. Pourtant Napoléon suit toujours ses conseils : en décembre 1813, il accepte sur ses instances le retour des Bourbons sur le trône d'Espagne[176], et lui propose de nouveau le poste de ministre des Relations extérieures, se voyant opposer un nouveau refus[177]. Le 16 janvier 1814, Napoléon, durant une nouvelle scène, est sur le point de le faire arrêter[178] ; le 23 janvier, il le nomme pourtant au conseil de régence. Ils se voient pour la dernière fois le surlendemain, à la veille du départ de l'empereur pour une campagne militaire désespérée[179].
Le 28 mars 1814, alors que les Alliés menacent Paris, le conseil de régence décide l'évacuation de la cour, qui a lieu les deux jours suivants[180]. Le 30 mars au soir, Talleyrand exécute une manœuvre habile pour rester, et en maître, à Paris : il fait en sorte qu'on l'empêche de passer la barrière de Passy[181] puis, durant la nuit, négocie la capitulation du maréchal Marmont[182], qui dirige la défense de la ville. Le lendemain, 31 mars, Talleyrand dévoile son « 18 Brumaire à l'envers »[183], alors que les Alliés entrent dans Paris : ce soir-là, le roi de Prusse et le tsar arrivent à son hôtel particulier, et ce dernier y loge[184]. Il plaide auprès d'eux le retour des Bourbons[185] et, répondant à leurs doutes, propose de consulter le Sénat :
« Le tsar acquiesça ; la Restauration était faite. »
— Georges Lacour-Gayet, Talleyrand[186]
Restauration
Première Restauration
Le 1er avril 1814, le Sénat conservateur élit Talleyrand à la tête d'un « gouvernement provisoire »[187] qui fait dire à Chateaubriand qu'« il y plaça les partners de son whist »[188]. Le lendemain, le Sénat déchoit l'empereur de son trône, ce dernier négociant encore avec les Alliés pour une abdication en faveur de son fils et une régence de Marie-Louise. Napoléon Bonaparte est finalement perdu par la défection de Marmont et abdique le 6 avril. Talleyrand fait saisir toute sa correspondance avec ce dernier[189].
Il applique immédiatement ses idées libérales et fait en sorte de rétablir une vie normale pour le pays :
« Il fait rendre les conscrits des dernières levées napoléoniennes à leur famille, libérer les prisonniers politiques et les otages, échanger les prisonniers de guerre, il rétablit la liberté de circulation des lettres, facilite le retour du Pape à Rome et celui des princes espagnols à Madrid, rattache les agents de la police générale de l'Empire, devenus odieux, à l'autorité des préfets. Il s'efforce surtout de rassurer tout le monde et maintient autant que faire se peut tous les fonctionnaires dans leur poste. Deux préfets seulement sont remplacés. »
— Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand, le prince immobile[190]
Sa position est difficile, surtout à Paris : les Alliés occupent la ville, les royalistes et les bonapartistes ne reconnaissent pas le gouvernement provisoire. Il use d'expédients pour financer ce dernier[191].
Pendant les premiers jours d'avril, lui, son gouvernement et le Sénat rédigent à la va-vite une nouvelle constitution, qui consacre une monarchie parlementaire bicamérale, organise l'équilibre des pouvoirs, respecte les libertés publiques et déclare la continuité des engagements contractés sous l'Empire[192].
Le 12 avril, le comte d'Artois entre dans Paris et s'installe, en même temps que le gouvernement, aux Tuileries (à cette occasion, Talleyrand lui fait attribuer la déclaration selon laquelle il n'y a « qu'un Français de plus »[193]). Le 14, le Sénat défère l'autorité formelle sur le gouvernement provisoire au comte d'Artois, qui accepte pour son frère « les bases » de la Constitution[194], mais annonce des futures réserves de la part de ce dernier[195].
Après le traité de Fontainebleau du 11 avril, Talleyrand signe le 23 la convention d'armistice avec les Alliés, dont il juge les conditions « douloureuses et humiliantes »[196] (la France revient aux frontières naturelles de 1792 et abandonne 53 places fortes[197]), mais sans alternative, dans une France « épuisée d'hommes, d'argent et de ressources »[196].
Le gouvernement provisoire ne dure qu'un mois. Le 1er mai, Talleyrand rejoint Louis XVIII à Compiègne, où celui-ci lui fait faire antichambre plusieurs heures[198], puis lui déclare au cours d'un entretien glacial : « Je suis bien aise de vous voir ; nos maisons datent de la même époque. Mes ancêtres ont été les plus habiles ; si les vôtres l'avaient été plus que les miens, vous me diriez aujourd'hui : prenez une chaise, approchez-vous de moi, parlons de nos affaires ; aujourd'hui, c'est moi qui vous dis : asseyez-vous et causons. »[199] Dans la même conversation, Louis XVIII lui aurait demandé comment il a pu voir la fin de tant de régimes, ce à quoi Talleyrand aurait répondu :
« Mon Dieu, Sire, je n'ai vraiment rien fait pour cela, c'est quelque chose d'inexplicable que j'ai en moi et qui porte malheur aux gouvernements qui me négligent. »
— Charles-Maxime Villemarest, M. de Talleyrand[200].
Louis XVIII n'accepte pas la Constitution sénatoriale : il préfère accorder à ses sujets la Charte constitutionnelle qui reprend les idées libérales proposées mais rejette l'équilibre des pouvoirs, le roi en accordant aux deux chambres[201]. Le 13 mai, Talleyrand est nommé président du Conseil des ministres (il n'a pas l'autorité d'un Premier ministre) et ministre des Affaires étrangères[202].
Le 30 mai, il signe le traité de Paris, qu'il a négocié : la paix entre la France et les Alliés, le retour aux frontières de 1792 (plus quelques villes, une part de la Savoie et les anciens comtats pontificaux)[203] et l'annonce du congrès de Vienne[204], dont les bases sont posées. Parmi les dispositions, la France s'engage à abolir la traite négrière dans les cinq ans[N 17],[205] et les œuvres d'art pillées par Bonaparte restent en France ; il est fait chevalier de l'ordre de la Toison d'or[206] (no 868). La principauté de Bénévent (it) est rendue au pape : le roi le fait « prince de Talleyrand »[207] et pair de France.
Le 8 septembre, il défend le budget devant la chambre des pairs. Pour la première fois, comme en Angleterre, l'État se voit dans l'obligation de payer toutes les dettes qu'il contracte[208].
Congrès de Vienne
 Le congrès de Vienne, par Jean-Baptiste Isabey (Talleyrand est le deuxième homme assis en partant de la droite)
Le congrès de Vienne, par Jean-Baptiste Isabey (Talleyrand est le deuxième homme assis en partant de la droite)
Louis XVIII le charge logiquement de représenter la France au congrès de Vienne et approuve les « instructions » que Talleyrand a proposées[209] ; il part avec quatre objectifs, les dispositions concernant la France ayant déjà été réglées par le Traité de Paris[210] :
- prévenir les vues de l'Autriche sur la Sardaigne ;
- faire en sorte que Naples revienne à Ferdinand IV de Bourbon ;
- défendre la Pologne face à la Russie ;
- empêcher la Prusse de mettre la main sur la Saxe et la Rhénanie[211].
Le 16 septembre 1814 débute le congrès de Vienne. Talleyrand, qui y est assisté par le duc de Dalberg, le marquis de la Tour du Pin et le comte de Noailles[212], y arrive le 23 septembre[213], l'ouverture étant prévue pour le 1er octobre. Tenu à l'écart des principales réunions qui ont lieu entre les quatre pays (Royaume-Uni, Autriche, Prusse, Russie) qui ont déjà approuvé un protocole le 22 septembre, il est cependant invité à une discussion le 30 septembre où Metternich et Hardenberg emploient les mots « puissances alliées ». Il réagit alors :
« Alliées…, dis-je, et contre qui ? Ce n'est plus contre Napoléon : il est à l'île d'Elbe… ; ce ne n'est plus contre la France : la paix est faite… ; ce n'est sûrement pas contre le roi de France : il est garant de la durée de cette paix. Messieurs, parlons franchement, s'il y a encore des puissances alliées, je suis de trop ici. […] Et cependant, si je n'étais pas ici, je vous manquerais essentiellement. Messieurs, je suis peut-être le seul qui ne demande rien. De grands égards, c'est là tout ce que je veux pour la France. Elle est assez grande par ses ressources, par son étendue, par le nombre et l'esprit de ses habitants, par la contiguïté de ses provinces, par l'unité de son administration, par les défenses dont la nature et l'art ont garanti ses frontières. Je ne veux rien, je vous le répète ; et je vous apporte immensément. La présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout l'ordre social. […] Si, comme déjà on le répand, quelques puissances privilégiées voulaient exercer sur le congrès un pouvoir dictatorial, je dois dire que, me renfermant dans les termes du traité de Paris, je ne pourrais consentir à reconnaître dans cette réunion aucun pouvoir suprême dans les questions qui sont de la compétence du congrès, et que je ne m'occuperais d'une proposition qui viendrait de sa part. »
— Mémoires de Talleyrand[214]
Talleyrand provoque la colère des quatre (Metternich déclare : « nous aurions mieux fait de traiter nos affaires entre nous ! »). Le 3 octobre, il menace de ne plus assister à aucune conférence[215], se pose en défenseur des petites nations[216] qui assistent à partir de ce moment aux délibérations et exploite les divisions qui se font jours entre les quatre[215]. Appuyé par le Royaume-Uni et l'Espagne, il obtient ainsi que les procès-verbaux des précédentes réunions soient annulés[217]. Le congrès s'ouvre finalement le 1er novembre. Pour Jean Orieux, aucun sujet important n'est abordé dans les réunions officielles (tout se passe dans les salons) ; les petites nations se lassent et finissent par ne plus y assister. Talleyrand reste alors que les véritables délibérations commencent (il intègre le comité des grandes puissances le 8 janvier[218]) : « C'est ainsi que le comité des Quatre devint le comité des Cinq[219]. »
Allié à l'Autriche et au Royaume-Uni (un traité secret est signé le 3 janvier 1815), il s'oppose à la Prusse et à la Russie[220],[N 18] : la première n'obtient qu'un morceau de la Saxe et la seconde qu'une partie de la Pologne, qu'elles se partagent. En effet, Talleyrand est partisan d'une Allemagne fédérale qui soit le centre d'équilibre entre les différentes puissances[221], en particulier la Prusse et l'Autriche. La Prusse et la France se retrouvent avec une frontière en commun, ce qui lui est reproché par une partie des biographes comme la source des guerres franco-allemandes futures ; il est défendu par d'autres[N 19]. Talleyrand signe l'acte final du congrès le 9 juin 1815.
En échange de la restitution de la principauté de Bénévent, Talleyrand obtient également une compensation financière et le titre de duc de Dino (du roi rétabli Ferdinand des Deux-Siciles), qu'il transmet à son neveu, et par là à sa nièce Dorothée, qui a brillé durant le congrès.
Seconde Restauration
Au terme du Congrès, la France conserve ses conquêtes de 1792, mais Napoléon Ier revient de l'île d'Elbe, porté en triomphe par les Français, ce qui ruine l'opinion des Alliés à leur sujet. Talleyrand est approché par Montrond, chargé par Napoléon de le joindre à sa cause ; il refuse[222], bien qu'il soit en très mauvais termes avec Louis XVIII, désormais en exil. Attendant la défaite de Napoléon (« c'est une question de semaines, il sera vite usé[223] »), il tarde cependant à rejoindre le roi à Gand[224].
Après la bataille de Waterloo, le 23 juin, il arrive à Mons où se trouve le roi. D'après Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand presse le roi, au cours d'une réunion orageuse, de renvoyer son conseiller Blacas, d'accepter une constitution plus libérale et de se distinguer des Alliés, mais n'obtient que le départ de Blacas[225] ; d'après Georges Lacour-Gayet, il refuse de se rendre chez le roi, Chateaubriand jouant les intermédiaires[226]. Prenant de court Talleyrand qu'il disgracie[227] (de colère, ce dernier en perd son calme habituel[228]), Louis XVIII rejoint les bagages de l'armée alliée et rédige une proclamation réactionnaire. Cela provoque l'inquiétude des Britanniques qui contraignent le roi à rappeler Talleyrand à la tête du conseil des ministres. À l'issue de la séance du 27 juin, marquée par des affrontements verbaux, le ministre l'emporte sur le comte d'Artois et le duc de Berry (chefs du parti ultra) et une proclamation libérale est adoptée[229].
Fouché, président du gouvernement provisoire, tient Paris, appuyé par les républicains. Pour Georges Lacour-Gayet et Franz Blei, Talleyrand convainc Louis XVIII de nommer Fouché, qui a voté la mort de son frère, ministre de la Police[230],[231]. D'après les Mémoires de Talleyrand[232] et pour Emmanuel de Waresquiel, les réticences de Louis XVIII cèdent le pas à la nécessité politique, et c'est Talleyrand qui ne souhaite pas s'encombrer d'un homme comme Fouché[233]. Dans tous les cas, Talleyrand négocie avec Fouché qui livre Paris au roi, et il organise une rencontre[234]. Dans un passage fameux de ses mémoires, Chateaubriand raconte la scène :
« Ensuite, je me rendis chez Sa Majesté : introduit dans une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne trouvai personne ; je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup une porte s'ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur ; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr ; l'évêque apostat fut caution du serment. »
— François-René de Chateaubriand, Mémoires d'Outre-tombe
Talleyrand conserve son poste, et, le lendemain de l'arrivée du roi aux Tuileries, le 9 juillet 1815, il est nommé de surcroît président du Conseil des ministres, malgré l'opposition des ultras[235]. Il réussit à constituer, contrairement à 1814, un gouvernement qu'il dirige et est solidaire sur la politique libérale choisie : il entame une révision de la Charte par une ordonnance du 13 juillet pour organiser le partage du pouvoir entre le roi et les chambres (la chambre des pairs devenant héréditaire, Talleyrand composant la liste des pairs[236]), une libéralisation des élections (baisse du cens, de l'âge minimal), une libéralisation de la presse[237], etc.
Le gouvernement tente aussi en vain d'empêcher les armées alliées, qui occupent toujours le pays, de reprendre les œuvres d'art pillées dans toute l'Europe par Napoléon[238]. Il essaie de renvoyer ces armées hors du royaume ; les souverains européens exigent des conditions exorbitantes pour signer la paix, que Talleyrand parvient à diminuer en abaissant par exemple les réparations de 100 à 8 millions de francs[239] ; la France perd cependant ses conquêtes de 1792.
Il entre en conflit avec Fouché (qui a besoin de donner des gages aux royalistes) sur les débuts de la Terreur blanche dans le Midi (Talleyrand est contraint de rétablir la censure[240]) et sur les listes de bonapartistes (Ney, Huchet de la Bédoyère, etc.) à juger[241]. Le ministre de la Police paie de son poste cette divergence de vues, ce qui réjouit le roi et les ultras. Cela ne suffit pas : après les élections qui amènent la « Chambre introuvable », remportée par ces derniers, Talleyrand présente le 19 septembre sa démission afin d'obtenir un refus et le soutien du roi. Ce dernier, sous la pression des ultras et du tsar Alexandre (qui reproche à Talleyrand de s'être opposé à lui à Vienne[242]), l'accepte le 23 septembre et change de ministère[243], appelant un gouvernement mené par le duc de Richelieu.
Talleyrand est nommé grand chambellan de France le 28 septembre 1815[244]. Pour la première fois depuis son retour des États-Unis, il n'est pas au pouvoir, se répandant contre son successeur, le duc de Richelieu (qui pourtant fait en sorte que les titres de Talleyrand, qui n'a pas de fils légitime, soient transmissibles à son frère[245]), certain d'être rappelé au pouvoir[246]. Au printemps 1816, il se retire à Valençay, où il n'avait pas été depuis huit ans[247], puis revient un temps à Paris à l'annonce de la dissolution de la Chambre introuvable[248]. Le 18 novembre 1816, sa critique d'Élie Decazes, ministre de la Police, dépasse les bornes (il le traite de « maquereau »[249]) : il est interdit de se présenter à la cour[250], disgrâce qui dure jusqu'au 28 février 1817[251]. Son opposition au gouvernement entraîne même une approche des ultras, opposés à Richelieu et Decazes qui poursuivent en partie la politique libérale de Talleyrand[252]. En 1818, il a une occasion de revenir au pouvoir, mais le roi, qui ne l'« aime [ni ne l'] estime[253] », lui préfère Jean Dessolle, puis Decazes, puis à nouveau Richelieu en 1820. Il est désormais convaincu que le roi ne veut plus de lui[254].
 François Gérard, Le sacre de Charles X. Talleyrand est au premier plan, coiffé d'un chapeau à plume[255].
François Gérard, Le sacre de Charles X. Talleyrand est au premier plan, coiffé d'un chapeau à plume[255].
Alors que les ultras sont de plus en plus influents, Talleyrand, désormais proche des doctrinaires, en particulier de Pierre-Paul Royer-Collard qu'il a pour voisin à Valençay[256], se place pour le reste de la Restauration dans l'opposition libérale : il prononce le 24 juillet 1821, puis en février 1822 des discours à la Chambre des pairs pour défendre la liberté de la presse[257], puis le 3 février 1823 contre l'expédition d'Espagne, voulue par Chateaubriand[258]. Il est alors d'autant plus détesté par les ultras que son rôle dans l'assassinat du duc d'Enghien est révélé par Savary, qui est alors exilé par Louis XVIII, lequel souhaite protéger l'honneur de son grand chambellan[259].
En septembre 1824, alors que le poids de ses 70 ans se fait sentir, son poste fait qu'il assiste longuement à l'agonie de Louis XVIII[260], puis à son enterrement[261] et au sacre de son successeur[262]. L'avènement de Charles X, chef du parti ultra, lui enlève ses derniers espoirs de retour au pouvoir. Durant une cérémonie, un nommé Maubreuil l'agresse et le frappe à plusieurs reprises[263]. Il se rapproche du duc d'Orléans et de sa sœur, Madame Adélaïde[264]. En quelques années, le jeune journaliste Adolphe Thiers a su devenir un familier : Talleyrand l'aide à monter son journal, Le National[265], d'orientation libérale et offensive contre le pouvoir. Le National se retrouve au cœur de la contestation des Ordonnances de Juillet qui provoque les Trois Glorieuses et la chute de Charles X.
Monarchie de Juillet
En juillet 1830, alors que l'incertitude règne[N 20], Talleyrand expédie le 29 juillet un billet à Adélaïde d'Orléans pour son frère Louis-Philippe, lui conseillant de se rendre à Paris :
« Ce billet qui amena sur les lèvres de Madame Adélaïde une exclamation soudaine : "Ah ! ce bon prince, j'étais bien sûre qu'il ne nous oublierait pas !" dut contribuer à fixer les indécisions du futur roi. Puisque M. de Talleyrand se prononçait, Louis-Philippe pouvait se risquer. »
— Charles-Augustin Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis[266]
Louis-Philippe revient à Paris le lendemain, se rend pour entretien chez Talleyrand[267] et prend son parti. Celui-ci l'aide par l'entremise d'Adolphe Thiers[268].
Une fois roi, Louis-Philippe, après avoir souhaité faire de Talleyrand son ministre des Affaires étrangères[269], le nomme rapidement à sa demande ambassadeur extraordinaire à Londres, afin de garantir la neutralité du Royaume-Uni vis-à-vis du nouveau régime. La décision est critiquée à Paris[N 21], mais approuvée à Londres, où Wellington et Aberdeen sont ses amis depuis longtemps[270]. Il est accueilli de manière grandiose le 24 septembre et reçoit le logis de William Pitt[271] ; sa nomination rassure les cours d'Europe, effrayées par cette nouvelle révolution française[272], alors qu'éclate la révolution belge.
Talleyrand s'oppose au ministre Louis-Mathieu Molé : les deux hommes essayent de mener une politique sans tenir compte l'un de l'autre, le ministre menaçant de démissionner[273]. Talleyrand prône par exemple contre Molé l'évacuation de l'Algérie, que souhaitent les Britanniques ; Louis-Philippe choisit de s'y maintenir. Molé est cependant remplacé par Horace Sébastiani, qui ne gêne pas Talleyrand[274].
Talleyrand argumente auprès des Britanniques pour un concept qu'il forge de « non-intervention » en Belgique, alors que l'armée hollandaise est repoussée[275]. Des conférences entre les cinq grands s'ouvrent le 4 novembre 1830[276]. Après avoir refusé l'idée d'une partition de la Belgique[277], puis avoir envisagé un temps une telle idée[278], il plaide pour la création d'un État fédéré neutre sur le modèle de la Suisse[279] : il signe les protocoles de juin 1831, puis le traité du 15 novembre 1831, qui officialisent celle-ci[280]. Il va jusqu'à passer sur ses instructions en acceptant, et même en négociant, la préservation des frontières du pays et le choix de Léopold de Saxe-Cobourg comme souverain du nouveau pays neutre[281]. Il approuve la décision du nouveau Premier ministre, Casimir Perier, de soutenir militairement cette neutralité, menacée par les Pays-Bas. Le nouveau pays fait démanteler les forteresses à la frontière française.
 The lame leading the blind (« Le boiteux guidant l'aveugle », John Doyle, 1832), caricature anglaise représentant Talleyrand et Lord Palmerston
The lame leading the blind (« Le boiteux guidant l'aveugle », John Doyle, 1832), caricature anglaise représentant Talleyrand et Lord Palmerston
Talleyrand travaille sur le projet qui lui tient à cœur depuis longtemps : le rapprochement du Royaume-Uni et de la France, base de l'Entente cordiale. Les deux pays interviennent conjointement pour obliger le roi des Pays-Bas à respecter la nouvelle indépendance de la Belgique[282]. Il reçoit régulièrement Alphonse de Lamartine et entretient de bons rapports avec son ami Wellington et l'ensemble du cabinet. Son nom est applaudi au Parlement britannique, son raffinement et son habileté deviennent fameux à Londres ; il reçoit fréquemment Prosper Mérimée[283]. L'opposition anglaise accuse même le gouvernement d'être trop influencé par lui, le marquis de Londonderry déclarant à la tribune : « Je vois la France nous dominant tous, grâce à l'habile politique qui la représente ici, et je crains qu'elle n'ait dans ses mains le pouvoir de décision et qu'elle n'exerce ce que j'appellerai une influence dominante sur les affaires européennes[284]. »
Pendant ce temps, en France, si Talleyrand bénéficie d'une estime importante parmi les élites politiques et auprès du roi (ce dernier le consulte sans cesse, lui propose le poste de Premier ministre, proposition qu'il esquive[285]), sa réputation est au plus bas : « Le prince a évité à la France le démembrement, on lui doit des couronnes, on lui jette de la boue »[286]. C'est en effet à cette époque que s'exacerbe la haine généralisée des partis à son encontre. Il devient le « diable boiteux », celui qui a trahi tout le monde.
« On l'appelait "Protée au pied boiteux", "Satan des Tuileries", "République, empereur, roi : il a tout vendu", lisait-on dans ce poème à la mode du jour, écrit avec une plume arrachée à l'aigle de l'ange exterminateur, intitulé "Némésis" ("la Vengeance"). Son seul mérite fut de provoquer une admirable réponse de Lamartine. »
— Jean Orieux, Talleyrand ou le sphinx incompris[287]
Talleyrand reste en poste jusqu'en 1834 et la conclusion du traité de la Quadruple-Alliance, signé le 22 avril[288]. Fatigué des difficultés de négociation avec Lord Palmerston, il quitte son poste, après avoir signé une convention additionnelle au traité le 18 août. Il arrive le 22 à Paris ; on parle de compléter les alliances en l'envoyant à Vienne. Il renonce à la présidence du conseil, qui est confiée à Thiers (Talleyrand participe à la formation du gouvernement)[289], puis à la scène publique et se retire dans son château de Valençay. Il en a déjà été nommé maire de 1826 à 1831, puis conseiller général de l'Indre[290], jusqu'en 1836[291]. Il conseille toujours Louis-Philippe, en particulier en 1836 sur la neutralité à adopter dans le problème de la succession espagnole, contre l'avis de Thiers, qui y perd son poste[292].
Son activité politique décroît cependant. Il reçoit, outre de nombreuses personnalités politiques[293], Alfred de Musset et George Sand (cette dernière le remerciant par un article injurieux[N 22],[294]), Honoré de Balzac[295] et met la dernière main à ses mémoires. En 1837, il quitte Valençay et retourne s'installer dans son hôtel de Saint-Florentin à Paris.
À l'approche de la mort, il doit négocier un retour à la religion pour éviter à sa famille le scandale d'un refus de sacrements et de sépulture comme a dû subir Sieyès[296]. Après un discours d'adieu à l'Institut le 3 mars[297], ses proches confient à l'abbé Dupanloup le soin de le convaincre de signer sa rétractation et de négocier le contenu de celle-ci[298]. Talleyrand, qui joue une fois de plus sur le temps[299], ne signe que le jour de sa mort, ce qui lui permet de recevoir l'extrême-onction. Au moment où le prêtre doit, conformément au rite, oindre ses mains avec le saint-chrême, il déclare : « N'oubliez pas que je suis évêque » (car on devait en pareil cas l'oindre sur le revers des mains et non sur les paumes), reconnaissant ainsi sa réintégration dans l'Église[300]. L'événement, suivi par le tout-Paris, fait dire à Ernest Renan qu'il réussit « à tromper le monde et le Ciel[301] ».
Lorsqu'il apprend que Talleyrand est à l'agonie, le roi Louis-Philippe décide, contrairement à l'étiquette, de lui rendre visite. « Sire, murmure le mourant, c'est un grand honneur que le roi fait à ma Maison[302]. » Il meurt le 17 mai 1838, à 15 h 35[303] ou 15 h 50[304], selon les sources.
Des funérailles officielles et religieuses sont célébrées le 22 mai[305]. Embaumé à l'égyptienne[306], son corps est placé dans la crypte qu'il a fait creuser sous la chapelle de la maison de charité qu'il a fondée en 1820 à Valençay, où il est ramené de Paris le 5 septembre[307] ; ce lieu devient la sépulture de ses héritiers et le reste jusqu'en 1952.
Jusqu'en 1930, une vitre laisse voir son visage momifié[308]. La plaque de marbre qui recouvre une face du sarcophage de marbre noir placé dans un enfeu porte : « Ici repose le corps de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince duc de Talleyrand, duc de Dino, né à Paris le 2 février 1754, mort dans la même ville le 17 mai 1838[309]. »
Regards contemporains et postérité
 « L'homme aux six têtes » (Le nain jaune, 15 avril 1815), caricature de Talleyrand le présentant avec six têtes, criant respectivement : « Vive le Roi ! », « Vive l'Empereur ! », « Vive le 1er Consul ! », « Vive la Liberté ! », « Vive les notables ! », « Vive !... »
« L'homme aux six têtes » (Le nain jaune, 15 avril 1815), caricature de Talleyrand le présentant avec six têtes, criant respectivement : « Vive le Roi ! », « Vive l'Empereur ! », « Vive le 1er Consul ! », « Vive la Liberté ! », « Vive les notables ! », « Vive !... »
« Talleyrand (Prince de) : s'indigner contre. »
— Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues[310]
« On dit toujours de moi ou trop de mal ou trop de bien ; je jouis des honneurs de l'exagération. »
— Talleyrand[311]
Talleyrand était surnommé le « diable boiteux » en raison de son infirmité et de la haine que lui vouaient certains de ses ennemis, en particulier au sein des factions : « ultras » (pour qui il était un révolutionnaire), Église catholique (se souvenant de la confiscation des biens de l'Église), jacobins (pour qui il était un traître à la Révolution), bonapartistes (qui lui reprochaient la « trahison d'Erfurt »), etc.
François-René de Chateaubriand a souvent côtoyé Talleyrand durant sa carrière diplomatique et politique. Politiquement opposé au prince (Chateaubriand est un chef ultra, tandis que Talleyrand est libéral, et ce dernier s'est opposé à « sa » guerre d'Espagne), il exprime à chaque occasion dans ses mémoires tout le mal qu'il pense de Talleyrand :
« Ces faits historiques, les plus curieux du monde, ont été généralement ignorés, c'est encore de même qu'on s'est formé une opinion confuse des traités de Vienne, relativement à la France : on les a crus l'œuvre inique d'une troupe de souverains victorieux acharnés à notre perte ; malheureusement, s'ils sont durs, ils ont été envenimés par une main française : quand M. de Talleyrand ne conspire pas, il trafique. »
— François-René de Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe[312]
De la même façon, Victor Hugo, dont le parcours politique est un chemin du légitimisme au républicanisme, écrit à l'occasion de sa mort :
« C’était un personnage étrange, redouté et considérable ; il s’appelait Charles-Maurice de Périgord ; il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. On pourrait dire que tout en lui boitait comme lui ; la noblesse qu’il avait faite servante de la république, la prêtrise qu’il avait traînée au Champ de Mars, puis jetée au ruisseau, le mariage qu’il avait rompu par vingt scandales et une séparation volontaire, l’esprit qu’il déshonorait par la bassesse. […]
Il avait fait tout cela dans son palais et, dans ce palais, comme une araignée dans sa toile, il avait successivement attiré et pris héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Mme de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, Alexandre de Russie, Guillaume de Prusse, François d’Autriche, Louis XVIII, Louis-Philippe, toutes les mouches dorées et rayonnantes qui bourdonnent dans l’histoire de ces quarante dernières années. Tout cet étincelant essaim, fasciné par l’œil profond de cet homme, avait successivement passé sous cette porte sombre qui porte écrit sur son architecture : Hôtel Talleyrand.
Eh bien, avant-hier 17 mai 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle, cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d’hommes, construit tant d’édifices, conduit deux révolutions, trompé vingt rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré, il a vu ce qu’ils avaient laissé : Tiens ! Ils ont oublié cela. Qu’en faire ? Il s’est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue, il y est allé, et a jeté le cerveau dans cet égout. »
— Victor Hugo, Choses vues
Ainsi, une anecdote circule à l'époque selon laquelle, Louis-Philippe étant venu le voir sur son lit de mort, Talleyrand lui aurait dit : « Sire, je souffre comme un damné. » « Déjà ! » aurait murmuré le roi. Le mot est invraisemblable, mais il a couru très tôt. L'anecdote rappelle ce mot par lequel le Diable aurait accueilli Talleyrand en enfer : « Prince, vous avez dépassé mes instructions. »[313],[314]
 Inscription murale sur l'hôtel de Saint-Florentin, Paris 1er, où vécut Talleyrand à partir de 1812 et où il mourut le 17 mai 1838
Inscription murale sur l'hôtel de Saint-Florentin, Paris 1er, où vécut Talleyrand à partir de 1812 et où il mourut le 17 mai 1838
De son vivant, Talleyrand se défendait rarement lui-même des attaques, mais il arrivait que ses amis le fassent pour lui, comme Alphonse de Lamartine (voir plus haut) ou Honoré de Balzac :
« Certain prince qui n'est manchot que du pied, que je regarde comme un politique de génie et dont le nom grandira dans l'histoire. »
— Honoré de Balzac, Le contrat de mariage[315]
Cependant, en dehors des opinions tranchées (pour Goethe, il est le « premier diplomate du siècle »[316]), la complexité du personnage intrigue très tôt :
« Le problème moral que soulève le personnage de Talleyrand, en ce qu'il a d'extraordinaire et d'original, consiste tout entier dans l'assemblage, assurément singulier et unique à ce degré, d'un esprit supérieur, d'un bon sens net, d'un goût exquis et d'une corruption consommée, recouverte de dédain, de laisser-aller et de nonchalance. »
— Charles-Augustin Sainte-Beuve[96]
Pour François Furet et Denis Richet (1965), Talleyrand a été « trop critiqué après avoir été trop loué »[317] : le XXe siècle a vu, dans l'ensemble, une nouvelle analyse de Talleyrand qui lui fait quitter l'habit du traître parjure et du « diable boiteux »[N 23], en particulier par ses nombreux biographes qui, en général, ont vu une continuité politique dans sa vie.
Doctrine
Emmanuel de Waresquiel analyse la philosophie politique de Talleyrand, dès son action comme agent général du clergé, comme caractéristique de la philosophie des Lumières : un réformisme conservateur (« que tout change pour que rien ne change ») et une rationalisation « que l'on pourrait appeler l'esprit des Lumières »[318]. Même s'il insiste sur le contexte de la rédaction des mémoires, Emmanuel de Waresquiel relève ainsi[43] que dans celles-ci, Talleyrand distingue l'œuvre « réformiste et libérale » de 1789 de la souveraineté du peuple et de l'égalité, pour lui « chimériques »[319]. Talleyrand privilégie ainsi le consensus, la constitution et la conciliation[225]. Par les moyens de l'« habileté » et de la « prévoyance », il souhaite ainsi favoriser l'intérêt mutuel bien compris et « la paix générale »[320], permise par un « équilibre européen ».
Le libéralisme
« Les monarques ne sont monarques qu'en vertu d'actes qui les constituent chefs des sociétés civiles. Ces actes, il est vrai, sont irrévocables pour chaque monarque et sa postérité tant que le monarque qui règne reste dans les limites de sa compétence véritable ; mais si le monarque qui règne se fait ou tente de se faire plus que monarque, il perd tout droit à un titre que ses propres actes ont rendu ou rendraient mensonger. Telle est ma doctrine, je n'ai jamais eu besoin de la renier pour accepter, sous les divers gouvernements, les fonctions que j'ai remplies. »
— Testament politique[321]
Les historiens soulignent la constance du libéralisme des idées de Talleyrand tout au long de sa vie, même s'il lui est arrivé de devoir le mettre, par réalisme, entre parenthèses (en particulier sous l'Empire, ce qui fait dire à Napoléon : « Talleyrand est philosophe, mais dont la philosophie sait s'arrêter à propos[322] »). La formation mondaine et politique de Talleyrand se déroule durant le Siècle des Lumières (Georges Lacour-Gayet, suivi par Franz Blei et Jean Orieux, raconte comment Talleyrand va se faire bénir par Voltaire[25]) : lorsque la Révolution éclate, c'est un homme fait qui est à la pointe des idéaux de 1789. C'est dans ce contexte qu'il rédige les cahiers de doléances de l'évêché d'Autun, d'après Georges Lacour-Gayet « l'un des plus importants manifestes provoqués par le mouvement de 1789[323] », véritable synthèse des ambitions des hommes des Lumières inspirée du système britannique. Ce « discours remarquable », d'après Sainte-Beuve[323], prône une monarchie parlementaire assurant l'égalité devant la loi et l'impôt, propose de supprimer les archaïsmes économiques issus de l'époque féodale, comme les douanes entre régions ou les corporations, points qu'il avait déjà abordés lors des projets de réformes de Calonne. Il demande encore que soit assurée la liberté de la presse[324] :
« La liberté d'écrire ne peut différer de celle de parler ; elle aura donc la même étendue et les mêmes limites ; elle sera donc assurée, hors les cas où la religion, les mœurs et les droits d'autrui seraient blessés ; surtout elle sera entière dans la discussion des affaires publiques, car les affaires publiques sont les affaires de chacun. »
— Extrait du cahier des délibérations du clergé assemblé à Autun
Dans deux grands discours sous Louis XVIII, il défend de nouveau la liberté de la presse[257].
Sous la Révolution, il est de tous les clubs et de toutes les réformes destinées à mettre fin à l'Ancien Régime. Il souhaite s'inspirer du régime britannique, au point qu'il pousse Bonaparte à monter sur le trône pour se rapprocher de ce système de monarchie parlementaire, qu'il souhaite voir doté d'un parlement bicaméral[325]. C'est aussi la raison pour laquelle il contribue ensuite à la Restauration et tente de la marier avec un tel système[326]. Seule l'influence des ultras sur Louis XVIII empêche que cette idée soit menée complètement à bien. Cependant, lors des deux Restaurations, il se retrouve un temps à la tête du pays, et applique ses idées libérales[327]. Son gouvernement provisoire lui vaut même les félicitations de Benjamin Constant (avec qui il est pourtant en froid depuis le 18 Brumaire) et ses remerciements pour « avoir à la fois brisé la tyrannie et jeté les bases de la liberté »[328]. En effet :
« Dès les premiers jours, Talleyrand imprime à son gouvernement une touche très libérale. Par conviction mais aussi très habilement, il tente d'imposer la force de son autorité en supprimant tout ce que le despotisme napoléonien avait de plus insupportable. »
— Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand, le prince immobile[190]
Sa proximité avec les idées libérales est matérialisée par le parti qui les incarne : le parti d'Orléans. Il reste proche de la famille d'Orléans durant la plus grande partie de sa carrière[329],[264],[330],[331]. C'est à la fin de celle-ci, lorsque Louis-Philippe se retrouve, avec l'appui de Talleyrand, sur le trône, que ce dernier possède la latitude politique qui lui a toujours manqué, au sein d'une monarchie de Juillet qui correspond à ses vœux. Ses rapports avec le roi, un homme qu'il connaît depuis longtemps, sont excellents[332].
« Qui aurait pu croire que cet aristocrate entre les aristocrates qui menait à Valencay, en plein XIXe siècle la vie seigneuriale la plus intacte, enseignait avec la conviction la plus profonde que, du 14 juillet 1789, dataient "les grands changements dans la vie moderne" ? Changements qu'il avait voulu réaliser en 1789 et auxquels il restait attaché en 1830 ? [...] Il maintenait "l'Ancien Régime" des mœurs et de la civilité mais il refusait celui des institutions. [...] En lui, la France, sans fissure, passait d'Hugues Capet aux temps démocratiques. »
— Jean Orieux, Talleyrand ou le sphynx incompris[333]
L'instruction publique
Les biographes de Talleyrand insistent sur son rôle dans les débuts de l'instruction publique en France, ceci en dépit du fait que (pour Jean Orieux) « le XIXe siècle s'est bien chargé d'étouffer »[334] le souvenir de son travail dans le domaine.
Agent général du clergé, il adresse aux évêques le 8 novembre 1781 un questionnaire relatif aux collèges et touchant aux méthodes d'enseignement[335]. C'est durant l'année 1791 qu'aidé par Pierre-Simon de Laplace, Gaspard Monge, Nicolas de Condorcet, Antoine Lavoisier, Félix Vicq d'Azyr, Jean-François de La Harpe, entre autres[336], il rédige un important rapport sur l'instruction publique, « avec la plus entière gratuité parce qu'elle est nécessaire à tous[337] ». L'une des conséquences de ce rapport est la création de l'Institut de France, à la tête d'un système éducatif destiné à toutes les couches de la société, embryon de l'Éducation nationale.
Ce rapport de Talleyrand, dans lequel il est affirmé que les femmes ne devraient recevoir qu'une éducation à caractère domestique[338],[339], suscite la critique de Mary Wollstonecraft, alors qu'en Grande-Bretagne se développe la controverse révolutionnaire, débat public autour des idées nées de la Révolution française. Elle y voit un exemple du double standard, le « double critère » favorisant les hommes au détriment des femmes, jusque et y compris dans le domaine essentiel pour elle qu'est l'éducation. Aussi est-ce le rapport de Talleyrand qui la pousse à lui écrire[340], puis, en 1792, à publier son ouvrage A Vindication of the Rights of Woman.
Pour Emmanuel de Waresquiel, dans ce rapport, les hommes de la Révolution prônent une instruction « progressive, des écoles de canton aux écoles de départements, et complète : « physique, intellectuelle, morale ». Elle a pour but de perfectionner tout à la fois l'imagination, la mémoire et la raison »[341]. « Un des monuments de la Révolution française » d'après les propos de François Furet[342], le plan de Talleyrand, appelant une instruction publique nécessaire, universelle mais transitoire et perfectible, gratuite et non obligatoire, est pour Gabriel Compayré « digne de l'attention de la postérité et de l'admiration que lui témoignèrent souvent les écrivains de la Révolution »[343].
Pour son rôle dans sa création, Talleyrand devient membre de l'Institut. C'est là qu'il délivre son dernier discours avant sa mort[344],[345].
La finance moderne
Les principes d'économie et de finances de Talleyrand sont marqués par l'admiration pour le système libéral anglais[346]. Avant la Révolution, c'est sa spécialité (d'après Jean Orieux, il tente même de devenir ministre[347]), et ses interventions aux débuts de la Révolution portent surtout sur ce sujet[348],[349].
Talleyrand entre dans le monde des affaires en devenant Agent général du clergé. En une époque de crise financière, il défend les biens qui lui sont confiés, et cède au roi lorsque c'est nécessaire, anticipant la demande de la couronne en proposant un don conséquent[350]. Il cherche à rationaliser la gestion des biens colossaux du clergé, marquée par une importante inégalité entre ecclésiastiques. Il obtient l'augmentation de la portion congrue[351].
Avant la Révolution, Talleyrand, en compagnie de Mirabeau, entre dans le monde des affaires, sans qu'il reste beaucoup de traces de ces tentatives ; Emmanuel de Waresquiel signale la connaissance profonde qu'il a de la spéculation sur la fluctuation de la monnaie[352]. Influencé par Isaac Panchaud, Talleyrand s'implique dans l'établissement d'une caisse d'amortissement : la Caisse d'escompte est créée par Panchaud en 1776 ; Talleyrand devient actionnaire[353].
Durant toute sa carrière, Talleyrand insiste sur la certitude que les prêteurs doivent avoir sur le fait que l'État paie toujours ses dettes[354], afin de permettre aux gouvernants de recourir à l'emprunt, cet « art moderne de procurer à l'État, sans forcer les contributions, des levées extraordinaires d'argent à un bas prix, et d'en distribuer le fardeau sur une suite d'années[355] ». Pour lui, les créanciers de l'État « ont payé pour la nation, à la décharge de la nation : la nation ne peut dans aucune hypothèse se dispenser de rendre ce qu'ils ont avancé pour elle[356] », « autrement dit[357] », « une nation, comme un particulier, n'a de crédit que lorsqu'on lui connaît la volonté et la faculté de payer[358] ». Talleyrand finit par instaurer lui-même cette garantie en 1814, lorsqu'il est président du Conseil des ministres. Pour Emmanuel de Waresquiel, la proposition de nationaliser les biens du clergé est alors « logique[359] », Talleyrand connaissant leur étendue, ayant prévu de les recenser dès l'élaboration des cahiers de doléances[360].
Talleyrand et Isaac Panchaud élaborent la partie concernant la caisse d'escompte du plan de Charles Alexandre de Calonne. Talleyrand apporte également sa contribution à plusieurs parties de ce plan, qui vise à rétablir les finances du royaume, en supprimant les barrières douanières intérieures, en simplifiant l'administration, en libérant le commerce et en rationalisant les impôts[361]. Calonne étant remercié, ce plan n'est jamais mis en application. Talleyrand, qui n'a pas oublié de profiter financièrement de sa proximité avec le ministre des Finances[362], reprend largement les propositions économiques et financières du plan de Calonne lors de la rédaction des cahiers de doléances de l'évêché d'Autun[324].
Pour Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand appartient à l'école prônant la liberté de commerce, contre les « préjugés[363] ». Cette liberté doit être permise par la paix[364], en particulier avec les Britanniques (avant la Révolution, Talleyrand défend déjà le traité de commerce avec la Grande-Bretagne, auquel il a mis la main[346]), pour le bénéfice de toutes les parties[363].
L'équilibre européen
« J'essaie d'établir la paix du monde en équilibre sur une révolution. »
— Talleyrand à Lamartine[365]
L'intérêt de Talleyrand pour la chose diplomatique commence sous l'influence d'Étienne François de Choiseul (oncle de son ami Auguste de Choiseul), dont il reprend la manière de mener les affaires d'État : gouverner en sachant déléguer les tâches techniques à des travailleurs de confiance, afin de se laisser le temps de nouer des relations utiles[366].
Dès ses premières missions vers la Grande-Bretagne, durant la Révolution, Talleyrand inaugure sa méthode de négociation, fameuse au point d'en faire « le prince des diplomates »[367], méthode mesurée et sans précipitation, pleine de réalisme et de compréhension à la fois du point de vue de son interlocuteur et de la situation de la France[67].
Pour Metternich, Talleyrand est « politique au sens le plus éminent, et comme tel c'est un homme à systèmes »[368], ces systèmes ayant pour but de rétablir un équilibre européen (prôné dès ses débuts diplomatiques en 1791[369]), qui pour lui a été détruit par les traités de Westphalie de 1648[370] :
« Une égalité absolue des forces entre tous les États, outre qu'elle ne peut jamais exister, n'est point nécessaire à l'équilibre politique et lui serait peut-être, à certains égards, nuisible. Cet équilibre consiste dans un rapport entre les forces de résistance et les forces d'agression réciproques des divers corps politiques. [...] Une telle situation n'admet qu'un équilibre tout artificiel et précaire, qui ne peut durer qu'autant que quelques grands États se trouvent animés d'un esprit de modération et de justice qui le conserve. »
— Instructions pour les ambassadeurs du Roi au congrès[371], rédigées par Talleyrand[372]
Parmi ces « systèmes », selon Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand se méfie de la Russie[373] et cherche à établir un équilibre pacifique entre l'Autriche et la Prusse. De là vient l'idée, plusieurs fois reprise, de créer des fédérations de petits États princiers dans le « ventre mou de l'Europe » qui serviraient de tampon entre les deux[374] — et qui constituent autant de possibilités de pots-de-vin pour Talleyrand[375]. Il souhaite qu'il soit mis fin à l'hégémonie britannique sur les mers, tant militaire que commerciale[376].
Pour lui, dès ses débuts diplomatiques, contre l'opinion du Directoire[377],[378] et celle de Bonaparte, l'équilibre européen passe par l'alliance entre la France et l'Angleterre[142], la paix avec celle-ci pouvant être « perpétuelle »[379] :
« Une alliance intime entre la France et l'Angleterre a été au début et à la fin de ma carrière politique mon vœu le plus cher, convaincu comme je le suis, que la paix du monde, l'affermissement des idées libérales et les progrès de la civilisation ne peuvent reposer que sur cette base. »
— Mémoires[380]
Il cherche aussi l'alliance avec l'Autriche[381],[382], à l'opposé d'une alliance avec la Prusse[383]. Il se décrit en plaisantant comme un petit peu autrichien, jamais russe et toujours français[384], affirmant que « les alliés ne se conservent qu'avec du soin, des égards et des avantages réciproques »[385].
Il s'oppose à la « diplomatie de l'épée »[386], cette politique d'exportation de la Révolution par la conquête, pour lui « propre à [...] faire haïr » la France[387]. De manière symptomatique, le Directoire envoie d'anciens constitutionnels comme ambassadeurs[388] et Bonaparte des généraux[N 24],[389], malgré les critiques du ministre. À cela, il préfère l'idée de régimes stables et dont les puissances s'équilibrent, garantie de la paix : « un équilibre réel eut rendu la guerre presque impossible »[390]. Il théorise également la non-intervention[N 25] (« la véritable primatie... est d'être maître chez soi et de n'avoir jamais la ridicule prétention de l'être chez les autres »[391]). Cet état de fait doit être associé à un « droit public »[392] qui évolue avec les traités et l'état des forces économiques.
La mise en œuvre de ces principes, sous Napoléon, est difficile[393]. Il aide ce dernier, en bon courtisan, en allant à leur encontre pendant plusieurs années, pensant convaincre en flattant[394]. Après Austerlitz, il sent que Napoléon préfère soumettre que faire alliance, en dépit de ses tentatives vis-à-vis d'une Angleterre pourtant toujours conciliante (elle l'était déjà sous le Directoire[395]). Il démissionne[396], alors que Napoléon applique l'inverse de ses idées : déséquilibre entre l'Autriche et la Prusse, humiliation de ces dernières, rapprochement avec la Russie, hostilité envers l'Angleterre, le tout par la force de l'épée[137].
Bien que persévérant auprès de Napoléon[397], ce n'est qu'après la Restauration qu'il peut mettre en pratique ses principes, en tout premier lieu durant les traités de Paris et de Vienne. Cet équilibre européen qu'il prône en est le principe directeur[398]. L'alliance avec l'Angleterre, cette « alliance de deux monarchies libérales, fondée l'une et l'autre sur un choix national » (telle que décrite par de Broglie[399]), qui ouvre la voie à l'Entente cordiale, est scellée durant son ambassade[400]. De même, le principe de non-intervention, même imposé à d'autres puissances, est inauguré à l'occasion de la révolution belge[401]. À l'heure de sa retraite, à la signature du traité de la Quadruple-Alliance qui en est l'aboutissement, Talleyrand fait le bilan de cette ambassade :
« Dans ces quatre années, la paix générale maintenue a permis à toutes nos relations de se simplifier : notre politique, d'isolée qu'elle était, s'est mêlée à celle des autres nations ; elle a été acceptée, appréciée, honorée par les honnêtes gens et par les bons esprits de tous les pays. »
— Lettre de Talleyrand au ministre des Affaires étrangères, 13 novembre 1834[402]
Talleyrand et les femmes
Être étudiant au séminaire n'empêche pas Talleyrand de fréquenter ostensiblement une actrice de la Comédie-Française, Dorothée Dorinville (Dorothée Luzy pour la scène)[403], avec qui il se promène sous les fenêtres du séminaire[404]. Cette relation dure « pendant deux années, de dix-huit à vingt ans »[405] :
« Ses parents l'avaient fait entrer malgré elle à la comédie ; j'étais malgré moi au séminaire. […] Grâce à elle, je devins, même pour le séminaire, plus aimable, ou du moins plus supportable. Les supérieurs avaient bien dû avoir quelque soupçon […] mais l'abbé Couturier leur avait enseigné l'art de fermer les yeux. »
— Mémoires de Talleyrand[406]
Les femmes prennent très tôt une grande importance dans la vie de Talleyrand, importance qui sera constante, intimement, socialement et politiquement jusqu'à sa mort[407]. Parmi ces femmes, il entretient toute sa vie une amitié teintée d'amour avec un « petit globe »[408] à qui il reste fidèle. Ainsi, ses mémoires ne mentionnent l'avènement de Louis XVI que sous cet angle :
« C'est du sacre de Louis XVI que datent mes liaisons avec plusieurs femmes que leurs avantages dans des genres différents rendaient remarquables, et dont l'amitié n'a pas cessé un moment de jeter du charme dans ma vie. C'est de madame la duchesse de Luynes, de madame la duchesse de Fitz-James, et de madame la duchesse de Laval que je veux parler. »
— Mémoires de Talleyrand[409]
De 1783 à 1792, Talleyrand a pour maîtresse (entre autres) la comtesse Adélaïde de Flahaut, avec qui il vit presque maritalement et qui lui donne au grand jour un enfant en 1785, le fameux Charles de Flahaut[410].
Madame de Staël a une brève aventure avec lui ; Talleyrand dira plus tard « qu’elle lui a fait toutes les avances »[411]. Sollicitée des États-Unis par Talleyrand (qui scandalise la société de Philadelphie en se promenant au bras d'« une magnifique négresse »[412]) pour l’aider à rentrer en France, c’est elle qui obtient, grâce à Marie-Joseph Chénier, qu’il soit rayé de la liste des émigrés, puis qui, en 1797, après lui avoir prêté 25 000 livres, le fait nommer par Barras ministre des Relations extérieures[N 26]. Lorsque Madame de Staël se brouille avec Bonaparte, qui l'exile, Talleyrand cesse de la voir et ne la soutient pas. Elle considérera toujours cette attitude comme une étonnante ingratitude[413].
À son retour d'Amérique, Talleyrand demande en mariage Agnès de Buffon, qui lui oppose un refus[414], ne pouvant se résoudre à épouser un évêque[415].
Quelques historiens, comme Jean Orieux, affirment qu'Eugène Delacroix est le fils de Talleyrand. Il avancent que Talleyrand est l'amant de Victoire Delacroix, que Charles Delacroix (ministre dont il prend la place en 1797) souffre, jusque six ou sept mois avant la naissance, d'une tumeur aux testicules, qu'Eugène Delacroix offre une certaine ressemblance physique avec Talleyrand et que ce dernier le protège durant sa carrière[416]. Si Georges Lacour-Gayet estime « impossible » que Charles Delacroix soit son père et « possible » que Talleyrand le soit[417], et si Maurice Sérullaz ne se prononce pas[418], une autre partie des biographes du peintre[419] et de ceux de Talleyrand[420],[421] contestent cette théorie, affirmant que la relation n'a jamais eu lieu, et que la naissance, prématurée, intervient logiquement à la suite de la guérison de Charles Delacroix. Enfin, leur principal argument est qu'il n'existe qu'une source sur cette paternité, les Mémoires de Madame Jaubert, ce qui fait dire à Emmanuel de Waresquiel :
« Tous ceux qui ont aimé à forcer le trait de leur personnage, à commencer par Jean Orieux, se sont laissé tenter, sans se soucier du reste, ni surtout des sources ou plutôt de l'absence de sources. Une fois pour toutes, Talleyrand n'est pas le père d'Eugène Delacroix. On ne prête qu'aux riches... En juillet 1797, il est ministre de la République, ce qui n'est pas si mal. »
— Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand, le prince immobile[422]
Durant les négociations du concordat de 1801, pour lesquelles Talleyrand met de la mauvaise volonté[423], Bonaparte souhaite que la situation de son ministre se normalise et qu'il quitte ou épouse sa maîtresse[424], l'ex-Mme Grand. Elle-même, qui ne demande que cela, se plaint de sa situation auprès de Joséphine[425] — d'après Lacour-Gayet, Talleyrand lui-même le souhaite[426]. Après de vifs désaccords, le pape, dans un bref, permet à Talleyrand de « porter l'habit des séculiers » mais lui fait rappeler qu'« aucun évêque sacré n'a été dispensé, jamais, pour se marier[427] ». Sur l'ordre de Bonaparte, le Conseil d'État interprète à sa façon ce bref papal et rend Talleyrand à la « vie séculière et laïque » le 18 août 1802[428]. Le 10 septembre 1802, il se marie donc à l'hospice des Incurables, rue de Verneuil à Paris, avec Catherine Noël Worlee, qu'il connaît depuis trois ans. Les témoins sont Pierre-Louis Roederer, Étienne Eustache Bruix, Pierre Riel de Beurnonville, Maximilien Radix de Sainte-Foix et Karl Heinrich Otto de Nassau-Siegen. Le contrat est signé par Bonaparte et Joséphine, les deux autres consuls, les deux frères de Talleyrand et par Hugues-Bernard Maret ; Roederer affirme qu'un mariage religieux a lieu le lendemain[429]. De Catherine Noël Worlee, Talleyrand a sans doute une fille, Charlotte, née en 1799 et déclarée de père inconnu, qu'il adopte en 1803 et marie en 1815 au baron Alexandre-Daniel de Talleyrand, son cousin germain[244]. Séparés depuis longtemps, Talleyrand et Catherine divorcent en 1815, après sa démission de la présidence du Conseil[430].
En 1808, durant l'entrevue d'Erfurt, si Napoléon ne parvient pas à séduire le tsar, Talleyrand obtient de ce dernier le mariage de son neveu Edmond de Périgord avec Dorothée de Courlande, âgée de quinze ans, « un des meilleurs partis d'Europe »[431]. Sa mère, la duchesse de Courlande, s'installe à Paris et devient l'une des intimes et la maîtresse de Talleyrand, s'installant dans le « petit globe ».
Au congrès de Vienne, Dorothée de Périgord a 21 ans et voit sa vie transformée (« Vienne. Toute ma vie est dans ce mot. ») : elle brille dans le monde par son intelligence et son charme. Faite duchesse de Dino, elle prend définitivement place aux côtés de son oncle par alliance, devenant probablement sa maîtresse peu après[432] (sans qu'il cesse d'avoir de tendres rapports avec sa mère[433]) ; outre les enfants de son mariage, sa fille Pauline est vraisemblablement de Talleyrand[434]. Malgré ses amants, elle vit avec ce dernier à l'hôtel Saint-Florentin, à Londres ou à Valençay jusqu'à sa mort, soit durant 23 ans. Dépositaire par testament de ses papiers, elle devient pendant 20 ans la « gardien[ne] de l'orthodoxie » de la mémoire (et des Mémoires) de Talleyrand[435].
Ouvrages
- Rapport sur l'instruction publique, fait au nom du Comité de constitution à l'Assemblée Nationale, les 10, 11 et 19 Septembre 1791, Paris, Imprimeries de Baudouin, 1791 [lire en ligne]
- Essai sur les avantages à retirer des colonies nouvelles
- Mémoire sur les relations commerciales des États-Unis avec l'Angleterre
- Mémoires ou opinion sur les affaires de mon temps (4 tomes) (ISBN 2743301708) (Imprimerie nationale française) :
- Tome 1 (1754 - 1807) La Révolution (ISBN 2849091103)
- Tome 2 (1807 - 1814) L'Empire (ISBN 2849091111)
- Tome 3 (1814 - 1815) Le congrès de Vienne (ISBN 2849091243)
- Tome 4 (1815) La Restauration (ISBN 2849091472)
Est parue début 2007 une compilation d'écrits de Talleyrand, présentée par Emmanuel de Waresquiel (voir bibliographie), contenant les mémoires, mais aussi les lettres de Talleyrand à la duchesse de Bauffremont :
- Mémoires et correspondances du prince de Talleyrand, Éditions Robert Laffont, collection Bouquins (ISBN 2221105087)
Armoiries
Cinéma et théâtre
Une adaptation de Sacha Guitry le met en scène dans Le Diable boiteux.
La pièce de théâtre Le Souper, de Jean-Claude Brisville, relate un souper — imaginaire ? — entre Joseph Fouché et Talleyrand, la veille du retour de Louis XVIII sur le trône, le 6 juillet 1815. Cette pièce à succès (critique et public) a été adaptée au cinéma en 1992 par Édouard Molinaro, avec les deux mêmes interprètes : Claude Rich dans le rôle de Talleyrand, rôle pour lequel il obtint le César du meilleur acteur en 1993, et Claude Brasseur dans celui de Fouché.
Cinéma
Sacha Guitry met plusieurs fois en scène Talleyrand dans ses films, le jouant même deux fois, confiant aussi le rôle à Jean Périer, qui récidive dans le même rôle deux ans plus tard. Parmi les acteurs ayant joué son personnage, on trouve aussi Anthony Perkins, Stéphane Freiss, Claude Rich ou John Malkovich[440],[441].
FilmsRéalisateur Titre Année Acteur jouant Talleyrand Notes Bert Haldane Brigadier Gerard 1915 Fernand Mailly Film muet Gérard Bourgeois Un drame sous Napoléon 1921 Paul Jorge Film muet Alexander Butler A Royal Divorce 1923 Jerrold Robertshaw Film muet Donald Crisp The fighting eagle 1927 Sam De Grasse Film muet, produit par Cecil B. DeMille Éric Boyer et Jean Charell Le congrès s’amuse 1931 Jean Dax Film parlant John G. Adolfi Alexander Hamilton 1931 John T. Murray Victor Saville The iron duke 1934 Gibb McLaughlin Karl Hartl So endete eine Liebe 1934 Edwin Juergenssen Alfred L. Werker The House of Rothschild 1934 Georges Renavent Franz Wenzler Hundert Tage 1935 Alfred Gerasch Sacha Guitry et Christian-Jaque Les Perles de la couronne 1937 Robert Pizani Clarence Brown Conquest, Maria Walewska 1937 Reginald Owen Doug Shultz A Royal Divorce 1938 Frank Cellier Remake du film de 1923 ? Duilio Coletti La Sposa dei re 1938 Achille Majeroni Sacha Guitry Le Destin fabuleux de Désirée Clary 1941 Jean Périer Carol Reed The young mister Pitt 1942 Albert Lieven Pierre Blanchar Un seul amour 1943 Jean Périer D'après Honoré de Balzac Sacha Guitry Le Diable boiteux 1948 Sacha Guitry Georg Marischka Der Fidele Bauer 1951 Karl Eidlitz Harry W. Smith Louisiana Territory 1953 Leo Zinser Henry Koster Désirée 1954 John Hoyt Sacha Guitry Napoléon 1955 Sacha Guitry Audu Paden Pinky and the Brain 1955 Richard Libertini Épisode 8 : « Napoleon Brainaparte » ? The Count of Monte Cristo 1956 Malcolm Keen Épisode 22, « The Talleyrand Affair » Wolfgang Liebeneiner Königin Luise 1957 Charles Régnier Abel Gance Austerlitz 1960 Jean Mercure Géza von Radványi Le Congrès s'amuse 1966 Paul Meurisse Titre original : Der Kongreß amüsiert sich Rolf Thiele Komm nach Wien, ich zeig dir was! 1970 Tilo von Berlepsch Jean-Paul Roux Talleyrand ou Le sphinx incompris (TV) 1972 Raymond Gérôme D'après la biographie de Jean Orieux Jonathan Alwyn, Derek Bennett, Reginald Collin, Don Leaver Napoleon and Love 1972 Peter Jeffrey Pierre Cardinal Les Fossés de Vincennes 1972 Alain Nobis Robert Mazoyer Joséphine ou la comédie des ambitions 1979 Robert Rimbaud André Castelot Talleyrand à la barre de l’histoire 1980 François Maistre Marion Sarraut Marianne, une étoile pour Napoléon 1983 Bernard Dhéran Richard T. Heffron Napoleon and Josephine: A Love Story 1987 Anthony Perkins Robert Enrico La Révolution française 1989 un figurant Vincent de Brus Les Jupons de la Révolution 1989 Stéphane Freiss Épisode 2 : « Talleyrand ou Les lions de la revanche » Édouard Molinaro Le Souper 1992 Claude Rich D'après la pièce de Jean-Claude Brisville Yves Simoneau Napoléon 2002 John Malkovich Éric Civanyan Il ne faut jurer de rien ! 2005 Henri Garcin Comédie française Doug Shultz Napoleon's Final Battle 2006 Dorin Andone Jean-François Delassus Austerlitz, la victoire en marchant 2006 John Bobrynine Théâtre
- Jean-Claude Brisville : Le Souper (1989)
- Sacha Guitry : Le Diable boiteux (1948)
- Sacha Guitry : Théâtre : Beaumarchais, Talleyrand, monsieur Prudhomme a-t-il vécu ? (1962)
- Robert Hossein : C'était Bonaparte (2002)
Annexes
Bibliographie
Biographies de référence :
- Georges Lacour-Gayet (préf. François Furet), Talleyrand, Payot, 1990 (1re éd. 1930) (ISBN 2228882968)

- Emmanuel de Waresquiel[N 28], Talleyrand : Le Prince immobile, Fayard, 2003 (ISBN 2213613265)

Autres biographies :
- (de) Franz Blei (trad. René Lobstein), Talleyrand : homme d'État [« Talleyrand oder der Zynismus »], Payot, 1936 (1re éd. 1932)

- (en) Duff Cooper (trad. Daniel B. Roche), Talleyrand : Un seul maître : la France, Alvik Éditions, 2002 (1re éd. 1932) (ISBN 2914833016)
- Jean Orieux, Talleyrand : Le sphinx incompris, Flammarion, 1970 (ISBN 2080676741)

- Louis Madelin, Talleyrand, Paris, Tallandier, 1979
- André Beau (préf. Michel Poniatowski), Talleyrand : Chronique indiscrète de la vie d'un prince, Royer, coll. « Saga », 1992 (ISBN 2908670046)
- André Castelot, Talleyrand ou le cynisme, Perrin, 1997 (ISBN 2262022909)
- André Beau, Talleyrand : L'Apogée du sphinx, Royer, 1998
- Michel de Decker, Talleyrand : Les Beautés du Diable, Belfond, coll. « La vie amoureuse », 2003 (ISBN 978-2714438805)
- Georges Bordonove, Talleyrand : Prince des diplomates, Pygmalion, 2007 (ISBN 978-2756401201)
- Jean Tulard, Talleyrand : la douceur de vivre, Sem, 2009 (ISBN 978-2357640177) ; Bibliothèque des Introuvables, Paris, 2011 (ISBN 978-2-84575-343-3)
Autre ouvrages sur Talleyrand :
- Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, 1870, « M. de Talleyrand »

- Paul Lesourd, L'âme de Talleyrand, Paris, Flammarion, 1942
- Olivier de Brabois, Talleyrand à Autun, A Contrario, coll. « Un homme, un lieu », 2004 (ISBN 2-7534-0016-4)
- Emmanuel de Waresquiel (dir.), Talleyrand ou le miroir trompeur : catalogue de l'exposition, Somogy, 2005 (ISBN 2-85056-906-2)

Autres ouvrages :
- Achille de Vaulabelle, Chute de l'Empire - Histoire des deux Restaurations jusqu'à la chute de Charles X, Paris, Perrotin, 1867
- François Furet et Denis Richet, La Révolution Française, Hachette, coll. « Pluriel », 1973 (1re éd. 1963) (ISBN 978-2-01-278950-0)

- Yvert Benoît (dir.), Premiers ministres et présidents du Conseil : Histoire et dictionnaire raisonné des chefs du gouvernement en France (1815-2007), Perrin, 2007
- (en) Gary Kelly, Revolutionary Feminism: The Mind and Career of Mary Wollstonecraft, New York, St. Martin's, 1992 (ISBN 0-312-12904-1)
- (en) Virginia Sapiro, A Vindication of Political Virtue: The Political Theory of Mary Wollstonecraft, Chicago, University of Chicago Press, 1992 (ISBN 0-226-73491-9)
Une ensemble de 1 500 « volumes, lettres, autographes, manuscrits, médailles, gravures et affiches » relatifs à Talleyrand réunis par un collectionneur sur 36 mètres de sa bibliothèque, est vendue à l'hôtel des ventes de Vendôme le 4 février 2002[442].Liens
Liens internes
- Décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation
- Famille de Talleyrand-Périgord
- Liste des ministres français des Affaires étrangères
- Principauté de Bénévent (it)
Lien externe
Notes
- [talʁɑ̃] ou [talɛʁɑ̃]. Voir Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, p. 104.
- À celui de Louis XVI, son père a le premier rôle, à celui de Napoléon Ier il occupe la fonction de grand chambellan, comme on le voit sur le tableau du sacre, de David), à celui de Charles X il est de nouveau grand chambellan et enfin celui de Louis-Philippe Ier. Louis XVIII n'ayant jamais été couronné.
- D'après le titre d'un roman de Lesage, Le Diable boiteux.
- « Mais il est temps d'en venir à l'Abbé de Talleyrand. Sa mère et son père, qui était cadet de leur famille, habitaient Versailles, et ils étaient si démunis qu'ils y vivaient des buffets de la cour, au détriment des profits du grand-commun. Ils avaient, en guise de maître-d'hôtel, une sorte de Maître-Jacques, qui s'en allait tous les jours chercher leur provende à la desserte des tables royales, dont les officiers avaient ordre de le traiter favorablement. Ainsi l'on pourrait dire que M. de Talleyrand a été nourri des miettes qui tombaient du buffet de Versailles. » Souvenirs de la Marquise de Créquy
- D'après l'ensemble des biographies consultées. Pour sa part, François-Auguste Mignet affirme qu'il est né le 13 février 1754 (Auguste Marcade, Talleyrand: prêtre et évêque , Paris, 1883, (lire en ligne), pp. 9)
- L'un avec Sabine Olivier de Sénozan (1764-1794), l'autre en 1801 avec Charlotte de Beauffin de Puisigneux
- Il s'agit de l'ancienne forme du diplôme (cf. Dictionnaire de l'Académie française, 1re édition de 1694, p. 75)
- Quaenam est scientia quam custodient labea sacerdotis : « Quelle est la science que doivent garder les lèvres du prêtre »
- Georges Lacour-Gayet raconte que ce M. Mannay sera hébergé plus tard, sur la fin de ses jours, à Valençay.
- Comme il n'a eu l'occasion de célébrer la messe qu'une poignée de fois (dont sa première en tant que prêtre et sa première en tant qu'évêque), Mirabeau, qui a suivi la messe du temps où il était en prison, le guide dans ses répétitions.
- Le mot est maintes fois cité, adressé d'ailleurs suivant les sources à des personnes différentes. L'Encyclopédie Larousse évoque par exemple de l'abbé Louis, diacre à cette cérémonie et d'une piété aussi douteuse. Dans Monsieur de Talleyrand, publié à Paris par la Librairie Lecointe et Pougin en 1835, alors que l'ancien évêque d'Autun était encore en vie, Charles Maxime Catherinet de Villemarest écrit : « Nous bornerons donc à raconter la part que prit l'évêque d'Autun à cette cérémonie imposante pour les spectateurs, mais qui peut-être parut ridicule à ceux qui en furent les acteurs. On sait qu'au moment où il se rendit à l'autel pour y célébrer la messe, l'évêque ayant aperçu le commandant de la garde nationale, M. de Lafayette, placé près de lui, lui dit tout bas : « Ah ça ! je vous en prie, ne me faites pas rire. »
- Les évêchés avaient été redessinés en suivant les départements ; la plupart des évêques ayant refusé la constitution civile, leur poste était réputé vacant.
- Robespierre a fait voter une disposition interdisant aux députés de 1789 de se faire réélire comme députés de l'assemblée de 1791, cf. Furet et Richet 1973, p. 145.
- La correspondance entre Mme de Staël et Talleyrand a été publiée par M. de Broglie en même temps que les mémoires de Talleyrand.
- Un doute subsiste quant à l'implication du cabinet anglais, inquiet de ce renversement d'alliance, dans l'assassinat de Paul Ier.
- Le lieu, la date et l'identité de celui qui la prononce sont incertains, cf. Waresquiel 2003, note 5 p. 400.
- Voir aussi la note de Waresquiel : Talleyrand, partisan de l'abolition, aménage cependant celle-ci pour ne pas heurter le lobby colonial.
- Dans ses mémoires, Talleyrand joint de nombreuses lettres entre Louis XVIII et lui, qui donnent de précieux détails sur les négociations.
- Mignet, Chateaubriand, Sorel, Madelin, Lacour-Gayet, Orieux le lui reprochent, Thiers, de Broglie, Waresquiel le défendent.
- Talleyrand le 28 juillet : « Écoutez le tocsin ! Nous triomphons." - "Nous ? lui demanda quelqu'un, qui, nous ? - Chut ! Pas un mot, je vous le dirai demain. », Colmache, Revelations of the life of prince Talleyrand, p. 37, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 1070
- Prononcée par le Conseil des ministres du 3 septembre 1830, cette nomination suscite la polémique. Le jeune duc d'Orléans, qui professe des opinions libérales avancées, s'y oppose et Victor Hugo déplore qu'on n'ait pas choisi La Fayette car, selon lui, on aurait « dételé [sa] voiture de Douvres à Londres avec douze cent mille Anglais en cortège » et « Wellington eût été paralysé devant La Fayette. Qu'avons-nous fait ? Nous avons envoyé Talleyrand. Le vice et l'impopularité en personne, avec cocarde tricolore. Comme si la cocarde couvrait le front […] À toutes les cicatrices que nos divers régimes ont laissées à la France, on trouve sur Talleyrand une tache correspondante. »
- Par exemple : « [...] Laissez-moi maudire cet ennemi du genre humain, qui n'a possédé le monde que pour larronner une fortune, satisfaire ses vices et imposer à ses dupes dépouillées l'avilissante estime de ses talents iniques. Les bienfaiteurs de l'humanité meurent dans l'exil ou sur la croix. Et toi, tu mourras lentement et à regret dans ton nid, vieux vautour chauve et repu... [...] » George Sand, « Le Prince », Revue des deux Mondes du 15 octobre 1834 Lire sur Wikisource
- On trouve ainsi des « rue Talleyrand » à Reims et Périgueux, mais aussi à Paris, à proximité de l'hôtel des Invalides où se trouve le tombeau de Napoléon Bonaparte ; c'est dans cette rue de Talleyrand que se trouve l'ambassade de Pologne.
- Lors d'une séance de travail, Bonaparte donne à Talleyrand, en fait déjà informé, le nom d'Antoine François Andréossy, nommé ambassadeur à Londres : « j'enverrai Andréossy — Vous voulez nommer André aussi ? Quel est donc cet André ? — Je ne vous parle pas d'un André, je vous parle d'Andréossy. Pardieu, Andréossy ! Général d'artillerie. — Andréossy ! Ah ! oui, c'est vrai. Je n'y pensais pas. Je cherchais dans la diplomatie et ne l'y trouvais pas. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai : il est dans l'artillerie. »
- Alors qu'on lui en demande le sens, il répond : « C'est un mot métaphysique et politique qui signifie à peu près la même chose qu'intervention. », cité par Waresquiel 2003, p. 576
- En retour, Talleyrand veut prendre Constant, le nouvel amant de Mme de Staël, comme secrétaire (mais sa qualité d’étranger constitue un obstacle) et obtient la désignation du baron de Staël comme ambassadeur extraordinaire de son pays, la Suède, auprès de la République française.
- Lors de sa prestation de serment, il aurait dit à Louis-Philippe :
Source : Charles Maurice de Talleyrand-Périgord sur thierry.pouliquen.free.fr« Sire, c'est le treizième ; j'espère que ce sera le dernier. »
- Voir aussi Emmanuel de Waresquiel : face-à-face avec Talleyrand [interview], propos recueillis par I. Delage, sept. 2003 (texte en ligne) ; Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand, le prince immobile [conférence], sur canalc2.tv (6e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois) (vidéo en ligne).
Références
- Cf. Edmond de Goncourt, Catalogue raisonné de l'œuvre peint, dessiné et gravé de P. P. Prud'hon, Paris, 1876, p. 37, réf. 14 (texte en ligne) ; repr. Genève, Paris, 1986 (Œuvres complètes, t. 6) (ISBN 2-05-100708-X) : « propriété du duc de Valençay ». Voir aussi Divers documents relatifs à Talleyrand.
- Waresquiel 2003, p. 26
- Waresquiel 2003, p. 31
- voir ancêtres de Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord sur la base de Roglo.
- Lacour-Gayet 1930, p. 15
- Auguste Marcade, Talleyrand prêtre et évêque, 1883, (lire en ligne), pp. 7-8
- Blei 1932, p. 7
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 123
- Orieux 1970, p. 79
- Waresquiel 2003, p. 34
- Lacour-Gayet 1930, p. 18-31
- Waresquiel 2003, p. 40
- Waresquiel 2003, p. 46-47
- Waresquiel 2003, p. 44
- Lacour-Gayet 1930, p. 21
- Blei 1932, p. 8
- Lacour-Gayet 1930, p. 32
- Lacour-Gayet 1930, p. 39-40
- Lacour-Gayet 1930, p. 40
- Lacour-Gayet 1930, p. 40-41
- Waresquiel 2003, p. 56-57
- Lacour-Gayet 1930, p. 43-44
- Lacour-Gayet 1930, p. 47
- Lacour-Gayet 1930, p. 49
- Blei 1932, p. 15
- Lacour-Gayet 1930, p. 54
- Waresquiel 2003, p. 66
- Lacour-Gayet 1930, p. 54-55
- Waresquiel 2003, ch. 10
- Waresquiel 2003, ch. 15
- Lacour-Gayet 1930, p. 67
- Orieux 1970, p. 121-124
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 141-143
- Orieux 1970, p. 102-103
- Waresquiel 2003, p. 84
- Orieux 1970, p. 137
- Lacour-Gayet 1930, p. 90
- Waresquiel 2003, p. 111
- Waresquiel 2003, p. 85-87
- Lacour-Gayet 1930, p. 94
- Lacour-Gayet 1930, p. 95-96
- Lacour-Gayet 1930, p. 105-106
- Waresquiel 2003, p. 120
- Furet et Richet 1973, p. 79
- Lacour-Gayet 1930, p. 121
- Lacour-Gayet 1930, p. 123
- Lacour-Gayet 1930, p. 124
- Le texte complet sur PoliText
- Lacour-Gayet 1930, p. 126
- Lacour-Gayet 1930, p. 127
- Lacour-Gayet 1930, p. 151
- Waresquiel 2003, p. 134
- Lacour-Gayet 1930, p. 128
- Lacour-Gayet 1930, p. 130
- Waresquiel 2003, p. 139
- Furet et Richet 1973, p. 113
- Lacour-Gayet 1930, p. 112-113
- Lacour-Gayet 1930, p. 113
- Lacour-Gayet 1930, p. 135
- François Furet, préface au Talleyrand de Lacour-Gayet, p. viii
- Lacour-Gayet 1930, p. 137
- Waresquiel 2003, p. 143
- Succession apostolique de Mgr de Talleyrand sur Catholic Hierarchy.org
- Lacour-Gayet 1930, p. 139
- Lacour-Gayet 1930, p. 144
- Lacour-Gayet 1930, p. 156-160
- Waresquiel 2003, p. 161
- Lacour-Gayet 1930, p. 165
- Lacour-Gayet 1930, p. 169-170
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 203
- Lacour-Gayet 1930, p. 170
- Waresquiel 2003, p. 151
- Lacour-Gayet 1930, p. 177
- Lacour-Gayet 1930, p. 178
- Lacour-Gayet 1930, p. 183
- Lacour-Gayet 1930, p. 185
- Lacour-Gayet 1930, p. 186
- Lacour-Gayet 1930, p. 193
- Lacour-Gayet 1930, p. 198
- Lacour-Gayet 1930, p. 199
- Lacour-Gayet 1930, p. 204
- Orieux 1970, p. 216-217
- Orieux 1970, p. 222-223
- Lacour-Gayet 1930, p. 211
- Waresquiel 2003, p. 197
- Lacour-Gayet 1930, p. 223
- Lacour-Gayet 1930, p. 225-227
- Lacour-Gayet 1930, p. 235-236
- Lacour-Gayet 1930, p. 238
- Mémoires de Barras, Paleo, Sources de l’Histoire de France, 3T, 2004, (aussi éditées en 2005 dans la collection Le Temps retrouvé, Mercure de France)
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 219
- Furet et Richet 1973, p. 355
- Lacour-Gayet 1930, p. 243-244
- Lacour-Gayet 1930, p. 244
- Stendhal, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 244-245
- Charles-Augustin Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, « M. de Talleyrand » (1870) Encyclopédie de l'Agora
- Correspondance inédite et officielle de Napoléon Bonaparte avec le Directoire, les ministres, etc., 1819, 7 volumes, in 8°, cité par le Duc de Broglie, éditeur des mémoires de Talleyrand
- Lacour-Gayet 1930, p. 253
- Furet et Richet 1973, p. 490
- Lacour-Gayet 1930, p. 269
- Lacour-Gayet 1930, p. 270
- Lacour-Gayet 1930, p. 279-291
- Furet et Richet 1973, p. 418
- Waresquiel 2003, p. 243
- Lacour-Gayet 1930, p. 293
- Lacour-Gayet 1930, p. 308
- Lacour-Gayet 1930, p. 294-297
- Lacour-Gayet 1930, p. 349
- Waresquiel 2003, p. 257
- Lacour-Gayet 1930, p. 339-340
- Lacour-Gayet 1930, p. 342
- Lacour-Gayet 1930, p. 353
- Lacour-Gayet 1930, p. 360
- Orieux 1970, p. 363
- Lacour-Gayet 1930, p. 381-383
- Lacour-Gayet 1930, préface, p. XII
- Lacour-Gayet 1930, p. 435
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 234
- Lacour-Gayet 1930, p. 438
- Lacour-Gayet 1930, p. 448-458
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 241
- Lacour-Gayet 1930, p. 496-498
- Lacour-Gayet 1930, p. 502
- Mémoires de Barras, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 513
- Mémoires d'Outre-tombe, livre 16, chapitre 7 (voir aussi les précédents) Gallica
- Blei 1932, chapitre XVII, « déportations et exécutions »
- Lacour-Gayet 1930, p. 513
- Lacour-Gayet 1930, p. 787
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 1334-1349
- Lacour-Gayet 1930, p. 529
- Lacour-Gayet 1930, p. 531
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 245-245
- Lacour-Gayet 1930, p. 545
- Lacour-Gayet 1930, p. 548-550
- Blei 1932, p. 129-130
- Orieux 1970, p. 434
- Waresquiel 2003, p. 373
- Lacour-Gayet 1930, p. 558-559
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 249
- Lacour-Gayet 1930, p. 560-571
- Lacour-Gayet 1930, p. 575
- Waresquiel 2003, p. 350
- Orieux 1970, p. 451
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 257
- Waresquiel 2003, p. 375
- Blei 1932, p. 140
- Orieux 1970, p. 459
- Lacour-Gayet 1930, p. 607
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 263
- Lacour-Gayet 1930, p. 615-620
- Lacour-Gayet 1930, p. 630
- Cité Lacour-Gayet 1930, p. 634-635
- Lacour-Gayet 1930, p. 637
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, quatrième partie
- Lacour-Gayet 1930, p. 627
- Lacour-Gayet 1930, p. 640
- Waresquiel 2003, p. 398
- Waresquiel 2003, p. 400
- Lacour-Gayet 1930, p. 661
- Lacour-Gayet 1930, p. 662
- Lacour-Gayet 1930, p. 663
- Lacour-Gayet 1930, p. 664
- Éd. Jean de Bonnot, p. 276
- Orieux 1970, p. 467
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 340
- Lacour-Gayet 1930, p. 684-686
- Lacour-Gayet 1930, p. 616-617
- Lacour-Gayet 1930, p. 688-692
- Lacour-Gayet 1930, p. 696
- Lacour-Gayet 1930, p. 703
- Lacour-Gayet 1930, p. 698
- Lacour-Gayet 1930, p. 707-710
- Lacour-Gayet 1930, p. 710-711
- Lacour-Gayet 1930, p. 714
- Lacour-Gayet 1930, p. 715
- Lacour-Gayet 1930, p. 720-721
- Lacour-Gayet 1930, p. 722
- Lacour-Gayet 1930, p. 725-726
- Waresquiel 2003, p. 432
- Waresquiel 2003, p. 439
- Lacour-Gayet 1930, p. 751-752
- Waresquiel 2003, p. 441
- Waresquiel 2003, p. 433
- Blei 1932, p. 200
- Lacour-Gayet 1930, p. 762
- Lacour-Gayet 1930, p. 765
- Lacour-Gayet 1930, p. 773-774
- Mémoires d'Outre-tombe, tome III, lire sur Gallica
- Lacour-Gayet 1930, p. 785
- Waresquiel 2003, p. 451
- Waresquiel 2003, p. 451-452
- Waresquiel 2003, p. 452-453
- Lacour-Gayet 1930, p. 790-792
- Waresquiel 2003, p. 456
- Lacour-Gayet 1930, p. 794
- Mémoires, p. 435
- Waresquiel 2003, p. 464
- Blei 1932, p. 214-215
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 432-433
- Charles-Maxime Villemarest, Monsieur de Talleyrand, IV p. 335, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 810
- Waresquiel 2003, p. 460
- Lacour-Gayet 1930, p. 812
- Lacour-Gayet 1930, p. 814-815
- Lacour-Gayet 1930, p. 821
- Waresquiel 2003, p. 466
- Lacour-Gayet 1930, p. 817
- Lacour-Gayet 1930, p. 827
- Waresquiel 2003, p. 462
- Lacour-Gayet 1930, p. 823-824
- Waresquiel 2003, p. 472
- « Instructions pour les ambassadeurs du roi au congrès » Mémoires, p. 474
- Lacour-Gayet 1930, p. 826
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 476
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 479
- Waresquiel 2003, p. 474
- Orieux 1970, p. 600
- Blei 1932, p. 227-228
- Waresquiel 2003, p. 485
- Orieux 1970, p. 601
- Lacour-Gayet 1930, p. 832
- Waresquiel 2003, p. 474-475
- Lacour-Gayet 1930, p. 837-838
- Orieux 1970, p. 622
- Lacour-Gayet 1930, p. 841
- Waresquiel 2003, p. 499
- Lacour-Gayet 1930, p. 843-846
- Waresquiel 2003, p. 500
- Lacour-Gayet 1930, p. 847
- Waresquiel 2003, p. 501-502
- Lacour-Gayet 1930, p. 856
- Blei 1932, p. 247
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 733 et suivantes
- Waresquiel 2003, p. 506
- Lacour-Gayet 1930, p. 857
- Lacour-Gayet 1930, p. 860
- Lacour-Gayet 1930, p. 869
- Waresquiel 2003, p. 510-511
- Lacour-Gayet 1930, p. 872-873
- Blei 1932, p. 250
- Waresquiel 2003, p. 516
- Lacour-Gayet 1930, p. 868
- Lacour-Gayet 1930, p. 860-861
- Lacour-Gayet 1930, p. 874-878
- Lacour-Gayet 1930, p. 883
- Lacour-Gayet 1930, p. 889
- Waresquiel 2003, p. 525
- Lacour-Gayet 1930, p. 890
- Lacour-Gayet 1930, p. 899
- Lacour-Gayet 1930, note 1, p. 903
- Lacour-Gayet 1930, p. 901-905
- Lacour-Gayet 1930, p. 910
- Lacour-Gayet 1930, p. 939
- Lacour-Gayet 1930, p. 935
- Waresquiel 2003, p. 528-531
- Lacour-Gayet 1930, p. 1005
- Lacour-Gayet 1930, p. 968-975
- Waresquiel 2003, p. 550
- Waresquiel 2003, p. 552
- Lacour-Gayet 1930, p. 985-993
- Lacour-Gayet 1930, p. 999
- Lacour-Gayet 1930, p. 1000
- Lacour-Gayet 1930, p. 1004
- Lacour-Gayet 1930, p. 1020-1029
- Waresquiel 2003, p. 553
- Waresquiel 2003, p. 561
- Charles-Augustin Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis, « M. de Talleyrand » (1870) (lire en ligne)
- Waresquiel et 2003 567
- Orieux 1970, p. 739
- Waresquiel 2003, p. 575
- Lacour-Gayet 1930, p. 1085
- Waresquiel 2003, p. 574
- Lacour-Gayet 1930, p. 1080-1081
- Waresquiel 2003, p. 578
- Lacour-Gayet 1930, p. 1096
- Lacour-Gayet 1930, p. 1101
- Lacour-Gayet 1930, p. 1104
- Lacour-Gayet 1930, p. 1106-1107
- Lacour-Gayet 1930, p. 1120
- Lacour-Gayet 1930, p. 1111
- Lacour-Gayet 1930, p. 1123
- Blei 1932, p. 288-289
- Waresquiel 2003, p. 593
- Orieux 1970, p. 768-771
- Cité par Waresquiel 2003, p. 580
- Waresquiel 2003, p. 592
- Honoré de Balzac, Le Père Goriot, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 1194
- Orieux 1970, p. 761
- Lacour-Gayet 1930, p. 1143
- Waresquiel 2003, p. 599
- Lacour-Gayet 1930, p. 1152-1153
- Lacour-Gayet 1930, p. 1194
- Waresquiel 2003, p. 600
- Lacour-Gayet 1930, p. 1167
- Lacour-Gayet 1930, p. 1164-1167
- Lacour-Gayet 1930, p. 1193
- Waresquiel 2003, p. 605
- Lacour-Gayet 1930, p. 1212-1220
- Lacour-Gayet 1930, p. 1229-1232
- Lacour-Gayet 1930, p. 1239
- Lacour-Gayet 1930, p. 1246-1251
- Ernest Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse
- cité par Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Fayard, 2002, p. 792
- Waresquiel 2003, p. 614
- Le Figaro, 18 mai 1838 voir sur Gallica, sur Gallica2
- Lacour-Gayet 1930, p. 1262
- Lacour-Gayet 1930, p. 1259
- Lacour-Gayet 1930, p. 1265-1267
- Waresquiel 2003, p. 616
- R.P. Raoul, Guide Historique de Valençay, 1960, p. 26-29
- voir sur Wikisource
- cité en exergue de Talleyrand de Lacour-Gayet
- les Mémoires d'outre-tombe, 2 L23 Chapitre 11 voir sur Gallica
- Orieux 1970, p. 817
- Blei 1932, p. 305
- Honoré de Balzac, « Le contrat de Mariage », Paris, septembre-octobre 1835. Lire sur wikisource
- Conversations avec Goethe, 1826, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 625-626
- Furet et Richet 1973, p. 413
- Waresquiel 2003, p. 71
- Citation restaurée d'après l'édition (par Waresquiel) des Mémoires, p. 196
- Portrait du duc de Choiseul, in Mémoires, p. 43 - Talleyrand ajoute après cette digression : « je m'arrête ici, étonné de n'avoir su résister à l'attrait des aperçus généraux ».
- Waresquiel 2003, p. 812
- Lacour-Gayet 1930, p. 1089
- Lacour-Gayet 1930, p. 103
- Waresquiel 2003, p. 115
- Waresquiel 2003, p. 268
- Orieux 1970, p. 574
- Mémoires, p. 723
- Mémoires de Benjamin Constant, tome II, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 777
- Orieux 1970, p. 250
- Orieux 1970, p. 727
- Mémoires, p. 93
- Waresquiel 2003, p. 572
- Orieux 1970, p. 729
- Orieux 1970, p. 169
- Lacour-Gayet 1930, p. 66
- Mémoires et correspondance du prince de Talleyrand, Bouquins, p. 198
- Lacour-Gayet 1930, p. 146
- Talleyrand 1791, p. 120.
- Talleyrand, Rapport sur l'instruction publique, reproduit dans Mary Wollstonecraft 1997, p. 394-395.
- Gary Kelly 1992, p. 107 ; Virginia Sapiro 1992, p. 26-27.
- Waresquiel 2003, p. 154
- Préface au Talleyrand de Lacour-Gayet, p. x
- Gabriel Compayré, « Talleyrand et la réforme de l'éducation sous la Révolution française », dans Histoire critique des doctrines de l'éducation en France depuis le XVIe siècle, Paris, Hachette, tome 2, 7e édition, Lire sur l'encyclopédie de l'Agora
- Orieux 1970, p. 805
- Waresquiel 2003, p. 607-608
- Orieux 1970, p. 115
- Orieux 1970, p. 179
- Furet et Richet 1973, p. 66
- Orieux 1970, p. 152
- Waresquiel 2003, p. 70
- Waresquiel 2003, p. 72
- Waresquiel 2003, p. 91
- Waresquiel 2003, p. 95
- Waresquiel 2003, p. 93
- Mémoires, p. 170
- Cité par Emmanuel de Waresquiel : Motion de M. l'évêque d'Autun sur la proposition d'un emprunt, faite à l'Assemblée nationale, par le premier ministre des Finances, et sur la consolidation de la dette publique du 27 août 1789. À Versailles, chez Baudoin, s.d., p. 8
- Waresquiel 2003, p. 133
- Cité par Emmanuel de Waresquiel : Opinion de M. l'évêque d'Autun sur les banques et sur le rétablissement de l'ordre dans les finances à l'Assemblée nationale, le vendredi 29 décembre 1789, et imprimée sur son ordre. À Paris, chez Baudoin, 1789, p. 19
- Waresquiel 2003, p. 135
- Orieux 1970, p. 142
- Waresquiel 2003, p. 101-104
- Orieux 1970, p. 123
- Mémoires, p. 143
- Waresquiel 2003, p. 92
- Raconté par Lamartine dans l'article « La question d'Orient, la guerre, le ministère » dans le Journal de Saône-et-Loire, relevé par Jérôme Louis, La Monarchie de Juillet et la question d'Orient (thèse de doctorat), cité par Waresquiel 2003, p. 803
- Waresquiel 2003, p. 75-77
- Voir par exemple France Inter - les chroniques,L’Union européenne: la démesure, etc.
- Cité par Blei 1932, p. 154
- François Furet, préface au Talleyrand de Lacour-Gayet, p. x
- Waresquiel 2003, p. 272-273
- Mémoires, p. 467
- Waresquiel 2003, p. 470-471
- Waresquiel 2003, p. 273
- Waresquiel 2003, p. 274
- Orieux 1970, p. 448-449
- Waresquiel 2003, p. 274-275
- Furet et Richet 1973, p. 419
- Orieux 1970, p. 292
- Waresquiel 2003, p. 358
- cité par Orieux 1970, p. 772
- Orieux 1970, p. 386
- Blei 1932, p. 153
- Waresquiel 2003, p. 369
- Blei 1932, p. 155
- Cité par Orieux 1970, p. 295
- Waresquiel 2003, p. 276
- cité par Orieux 1970, p. 293
- Orieux 1970, p. 349-350
- Lacour-Gayet 1930, p. 443
- Mémoires, p. 411
- Cité par Orieux 1970, p. 385
- Mémoires, p. 463
- Waresquiel 2003, p. 344
- Waresquiel 2003, p. 345
- Blei 1932, p. 64
- Waresquiel 2003, p. 360
- Waresquiel 2003, p. 418-419
- Waresquiel 2003, p. 470
- Préface aux Mémoires, p. 16
- Orieux 1970, p. 752
- Talleyrand, p. 554
- Mémoires, p. 1309
- Lacour-Gayet 1930, p. 39
- Orieux 1970, p. 94-95
- Lacour-Gayet 1930, p. 38
- Mémoires, p. 132
- Waresquiel 2003, p. 62-64
- Orieux 1970, p. 215
- Mémoires, p. 133
- Un site consacré à Charles de Flahaut recense 45 biographes sur 50 consultées estimant que Talleyrand est son père.
- Journal de Chênedollé, p. 9
- Orieux 1970, p. 214
- Ghislain de Diesbach, Madame de Staël, Perrin, 1997.
- Lacour-Gayet 1930, p. 469
- Mémoires de la Comtesse de Boigne, née d'Osmond, Paris, Mercure de France, 1971 – Tome 1, p.165
- Orieux 1970, p. 270 et suivantes : « Naissance d'un étoile »
- Lacour-Gayet 1930, p. 262-264
- Delacroix, Maurice Sérullaz, p. 203
- P. Loppin, Eugène Delacroix, l'énigme est déchiffrée, cité par Emmanuel de Waresquiel
- Léon Noël, Talleyrand, cité par Emmanuel de Waresquiel
- Casimir Carrère, Talleyrand amoureux, cité par Emmanuel de Waresquiel
- Waresquiel 2003, p. 209
- Lacour-Gayet 1930, p. 460
- Orieux 1970, p. 405
- Blei 1932, p. 110
- Lacour-Gayet 1930, p. 470
- Bref du 29 juin 1802 ; voir les mémoires, p. 238 ; Lacour-Gayet 1930, p. 463-467
- Le Moniteur du 2 fructidor an X, cité par Lacour-Gayet 1930, p. 469
- Lacour-Gayet 1930, p. 472-474
- Lacour-Gayet 1930, p. 493-494
- Waresquiel 2003, p. 392-395
- Waresquiel 2003, p. 479-482
- Lacour-Gayet 1930, p. 891-892
- Orieux 1970, p. 689
- Waresquiel 2003, p. 19
- Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments
- Source : www.heraldique-europeenne.org
- Alcide Georgel, Armorial de l'Empire français : L'Institut, L'Université, Les Écoles publiques, 1870 [lire en ligne]
- Nicolas Roret, Nouveau manuel complet du blason ou code héraldique, archéologique et historique : avec un armorial de l'Empire, une généalogie de la dynastie impériale des Bonaparte jusqu'à nos jours, etc..., Encyclopédie Roret, 1854, 340 p. [lire en ligne (page consultée le 16 nov. 2009)]
- Le personnage Talleyrand sur IMDB
- Waresquiel 2003, p. 772-774
- C. Bedel, Le Monde du 1/02/2002
Chronologies
Précédé par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord Suivi par Joseph Fouché Président du Conseil des ministres 9 juillet 1815 - 26 septembre 1815 Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu Précédé par Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord Suivi par Charles Joseph Mathieu Lambrechts 
Ministre de la Marine (par intérim) 
7 mars 1799 - 2 juillet 1799 Marc Antoine Bourdon de Vatry Charles Delacroix de Constant Ministre français des affaires étrangères
1797-1799Charles-Frédéric Reinhard Charles-Frédéric Reinhard Ministre français des affaires étrangères
1799-1807Jean-Baptiste Nompère de Champagny Antoine de Laforêt Ministre français des affaires étrangères
1814-1815Armand Augustin Louis de Caulaincourt Louis Pierre Édouard Bignon Ministre français des affaires étrangères
1815-1815Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu - Portail de la Révolution française
- Portail de la France au XIXe siècle
- Portail du Premier Empire
- Portail du Morvan
- Portail de la politique française

La version du 5 novembre 2010 de cet article a été reconnue comme « article de qualité », c'est-à-dire qu'elle répond à des critères de qualité concernant le style, la clarté, la pertinence, la citation des sources et l'illustration. Catégories :- Académie des inscriptions et belles-lettres
- Académie des sciences morales et politiques
- Député français du clergé en 1789-1791
- Religieux catholique excommunié
- Ministre du Premier Empire
- Ministre français des Affaires étrangères
- Ministre français de la Marine
- Premier ministre de France
- Ambassadeur français
- Directoire
- Émigré sous la Révolution française
- Grand Dignitaire de l'Empire
- Pair de France sous la Restauration
- Ministre de la Restauration
- Personnalité de la monarchie de Juillet
- Famille de Talleyrand-Périgord
- Prince de Bénévent
- Évêque d'Autun
- Naissance en 1754
- Naissance à Paris
- Décès en 1838
- Personnalité politique du Morvan
- Personnalité de Saône-et-Loire
- Grand-croix de la Légion d'honneur
- Chevalier de l'Ordre de Saint-André
- Chevalier de l'ordre espagnol de la Toison d'Or (XIXe siècle)
- Ordre de Saint-Janvier
- Ordre du Saint-Esprit
- Diplomate du Premier Empire
- Diplomate de la Révolution française
Wikimedia Foundation. 2010.