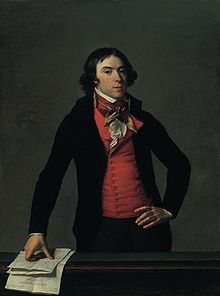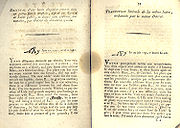- Barère de Vieuzac
-
Bertrand Barère de Vieuzac
 Pour les articles homonymes, voir Vieuzac.
Pour les articles homonymes, voir Vieuzac.Barère de Vieuzac Portrait de Barère (1793-1794)
par Jean-Louis LaneuvilleNom de naissance Bertrand Barère de Vieuzac Naissance 10 septembre 1755
TarbesDécès 13 janvier 1841 (à 85 ans)
TarbesNationalité  France
FranceProfession(s) Avocat et homme politique Autres activités Représentant du Tiers État de la sénéchaussée de Bigorre aux Etats Généraux et député des Hautes-Pyrénées à la Convention nationale. Bertrand Barère de Vieuzac, resté célèbre sous le simple nom de Barère, né le 10 septembre 1755 à Tarbes où il est mort le 13 janvier 1841, est un homme politique et juriste français.
Barère commença sa carrière politique avec la Révolution comme député du tiers état des Hautes-Pyrénées aux États généraux, puis membre de la Convention nationale. Son action au cours de la Terreur dont il fut l’inspirateur, l’âme et le metteur en œuvre lui valut, du penseur contre-révolutionnaire Edmund Burke, le surnom d’« Anacréon de la guillotine », de Camille Desmoulins celui de « Janus à trois faces »[1] et de Robespierre celui d’« Équivoque »[2]. Pendant la guerre, il affecta de vouer l’Angleterre aux gémonies, tout en correspondant en grand secret avec lord Stanhope, le beau-frère de William Pitt et cousin par alliance de lord Grenville, directeur du Foreign office[3]. Après les événements terrifiants dont il fut le responsable et dont une certaine historiographie[4] continue par calcul ou par aveuglement d’accabler la mémoire de Robespierre, Barère, agent d'influence du gouvernement Pitt, avait beau jeu de parler de « cette terrible Révolution dont les despotiques résultats seront si funestes à mon pays[5] ».
Origine
Bertrand Barère de Vieuzac était petit-fils de Laurent Barère (1695-1750), notaire à Bernac-Debat. Celui-ci eut un premier fils, Bertrand Barère, époux de Grantianne Dambarrère, oncle du conventionnel, qui fut notaire à Tarbes, et joua par la suite un rôle important dans les mouvements d’argent entre les différents membres du clan Barère, et un autre fils, Jean Barère (1728-1788), marié à Catalina Marrast de Nays, issue de la bourgeoisie, dont il eut deux garçons - Bertrand et Jean-Pierre - et trois filles. Consul et échevin puis Procureur du sénéchal de Tarbes. Jean Barère, qui possédait par sa femme un domaine féodal dans la vallée d’Argelès à Vieuzac, transmit plus tard à son fils Bertrand, outre cette seigneurie, dont celui-ci porta le nom au début de la Révolution, des biens situés dans la Bigorre, notamment des fermages très importants à Mauvezin, Vignerie, Abedeille, Nébouzan, etc., issus de la succession du prince Camille de Lorraine[6].
À quinze ans, le jeune Bertrand Barère obtint une dispense d’âge pour commencer ses études de droit à Toulouse où il avait grandi, prêta serment (1775) et devint avocat au Parlement de Toulouse, postulant en la Sénéchaussée de Bigorre[7]. Élevé comme un gentilhomme dont il avait les manières, assure Félicité de Genlis dans ses Mémoires, il était « l’homme de toutes les académies, l’homme de tous les salons ». Primé à Montauban pour un panégyrique du roi de France Louis XII, membre de l’Académie des Sciences de Toulouse pour avoir étudié une vieille pierre avec trois mots d’inscription latine, il fut reçu en 1788 membre de l’Académie des Jeux floraux pour ses petites pièces de vers et fit partie de la loge maçonnique « l’Encyclopédique »[8]. Deux ans plus tôt, le 14 mai 1785, il avait épousé à Vic-de-Bigorre la très jeune (12 ans !) Catherine-Elisabeth (1772-1852), fille de noble Antoine de Monde et Thérèse de Briquet[9], dont il semble avoir eu un fils, mais dont il vécut séparé[10]. Doué d’une solide culture historique et politique, d’un esprit supérieur à la moyenne, Barère parlait couramment l’anglais – il a laissé plusieurs traductions – et l’italien. C’était enfin un ennemi des philosophes, si on lit son panégyrique de Lefranc de Pompignan – célèbre antagoniste de Voltaire et des Lumières –, sensible aux arts et extrêmement sociable[11]. Mais il ne faut pas s’arrêter à ce seul éloge académique. Bertrand Barère a également écrit un éloge de Louis XII pour les Jeux Floraux de 1782, de Georges d'Amboise pour ceux de 1785, de Jean-Jacques Rousseau (dont il ne voit que le créateur de la sensibilité de la fin du XVIIIe siècle et qu'il admire surtout en tant qu'écrivain[12]) pour ceux de 1787, du chancelier Séguier pour l'Académie des belles-lettres de Montauban en 1784[13] et de Montesquieu pour l'Académie de Bordeaux en 1788[14],[15].
En 1788, il partit à Paris pour suivre un procès familial, y passant une partie de l’hiver. Ayant appris la mort de son père, il revint chez lui au début de 1789. Quelques semaines plus tard, il participait à la rédaction des cahiers de doléances où il se fit remarquer. Il présenta sa candidature pour représenter la noblesse aux États généraux, mais, comme il voulait étendre la fiscalité à la noblesse d’épée, elle ne fut pas acceptée, ce qui l’humilia profondément. Il ne fut « que » député du tiers état de la sénéchaussée de Bigorre, et il repartit pour Versailles, où s’ouvraient les États généraux[16].
Assemblée constituante
Il se fit remarquer dans l’Assemblée nationale par sa participation à divers débats et par des propositions de réforme des institutions judiciaires, des finances et de l’administration. Il prit part à la discussion sur la dénomination de la première assemblée parlementaire et souscrivit à la proposition de Legrand, qui proposa la formule « assemblée nationale ». Il entra au Comité des lettres de cachet que présidait Mirabeau, puis au comité des domaines et de féodalité où il mit à l’ordre du jour la question de la restitution des biens confisqués aux Protestants depuis la révocation de l'édit de Nantes, ce qui n’était pas de nature à alléger la dette de l’état.
Il avait créé le Point du Jour, ou Résultat de ce qui s’est passé la veille à l’Assemblée, un journal dont il se flattait qu’il fût le premier quotidien. La publication en avait commencé le 19 juin 1789, mais il fit précéder l’édition complète de ce journal, qui cessa le 21 octobre 1791, d’un « discours préliminaire » faisant l’historique de la Révolution depuis le 27 avril 1789 jusqu’à la constitution des communes en Assemblée nationale (17 juin 1789). Ce quotidien rend compte des discussions et décrets de la première assemblée et se caractérise par sa modération. Il y avait associé l’abbé Nicolas Madget à qui il confia la traduction des articles pour l’Angleterre.
Les opinions de Barère l’inclinent à penser dès cette époque que le modèle politique et économique de l’Angleterre est celui qui convient à la France, c’est-à-dire la monarchie constitutionnelle et le bicamérisme. Barère fit l’éloge de Necker en 1789, fut reçu dans le salon de Mme Necker dont il flatta l’esprit, fréquenta le comte et la comtesse de Guibert, et fut un zélateur de Mirabeau qui fut pour lui une sorte de modèle à suivre. C’est d’ailleurs lui qui devait prononcer son oraison funèbre en avril 1791. Après les événements du 6 octobre 1789 et le retour de l’Assemblée nationale à Paris, il prit un logement dans l’hôtel particulier du maire de Paris Jean-Sylvain Bailly avec lequel il semble avoir eu une intimité, « assez grande pour disposer des loges de théâtre dont sa femme jouissait aux divers spectacles de Paris ».
Il avait été introduit dès 1789 au Palais-Royal, résidence du duc d’Orléans, cousin de Louis XVI, par l’intermédiaire de la princesse de Rohan-Rochefort qui avait été témoin à son mariage. Cette princesse, connue pour son originalité, était née Rothelin, et elle appartenait donc à la famille d’Orléans. Elle avait un salon et des relations étendues dans le monde aristocratique et il est probable qu’elle fut l’indispensable marche-pied de Barère pour accéder au cercle fermé des familiers du duc d’Orléans.
Il effectua un premier voyage à Londres, probablement pendant l’été 1790 accompagné de sa femme et de leur fils, sans doute pour bénéficier des ouvertures politiques et relations ministérielles du duc d’Orléans lui-même exilé en Angleterre suite aux événements du 6 octobre 1789[17]. Il fut reçu membre honoraire de la société constitutionnelle de Londres qui devait passer sous l’influence des Tories. Il prit un logement dans le quartier de Westminster, et y installa son épouse qui y vivait apparemment toujours en 1793 sous un nom d’emprunt[18]. Barère lui fera dès lors parvenir une pension par l’intermédiaire de Perregaux qu’il protégea au temps de la Terreur. D’après quelques témoignages recueillis par Thomas Macaulay, Mme Barère n’était pas heureuse et cette séparation dut la satisfaire.
De retour à Paris, Barère de Vieuzac fréquenta les cercles maçonniques, notamment le Cercle social et d’autres lieux comme le club de Valois où, pratiquement, toutes les opinions étaient représentées, puis il eut ses habitudes à Monceau et au château du Raincy, près de Paris, où venaient les intimes du duc d’Orléans.[19]. Il connut ainsi Agnès de Buffon, la maîtresse du duc d’Orléans - qui le sollicita vainement sous la Terreur pour son mari-, le comte de Pestre de Seneffe, Antoine Omer Talon et son oncle Maximilien Radix de Sainte-Foix, le docteur Geoffroy Seiffert, les marquis de Travanet, de Sillery et de Livry, ou encore Nathaniel Parker-Forth, l’un des agents d’influence - on ne parlait pas encore de lobbying politique, du gouvernement britannique en France. L’un des salons où il était habituellement convié était celui de la comtesse Genlis à Bellechasse, dans le Faubourg Saint-Germain où le futur Louis-Philippe Ier l’y voyait souvent. Là, brillaient la fille du duc, Adélaïde et ses probables demi-sœurs, Henriette et Paméla, que, probablement, le duc avait eu autrefois de sa liaison avec Mme de Genlis et qu’il avait fait adopter par l'intermédiaire de Nathaniel Parker-Forth. À l’époque où il entra au club des Feuillants, Barère obtint la charge de « tuteur » de Melle Pamela, la future Mrs. Fitz-Gerald (en 1792)[20]. À ses importants revenus et fermages, s’ajoutèrent désormais les revenus de la rente correspondant à cette charge, d’un montant de 12 000 livres formant les intérêts annuels d’un capital de 240 000 livres qui était une donation déguisée. Par la suite, en 1793, Barère de Vieuzac essaira d’effacer toute trace de ce cadeau princier en détournant[21] des papiers provenant du duc d’Orléans dont l’exécution fut précipitée par ses soins empressés malgré les promesses qui avaient été faites de l’épargner[22].
À l’Assemblée, depuis son retour de Londres, il parut avoir gagné en assurance et ses interventions furent plus consistantes. En février 1791, il défendit le principe d’un jury populaire au civil et ne fut pas suivi puisque la Constituante réserva le jury aux seules procédures criminelles (septembre 1791). Avec Barnave, Merlin de Douai - avec lequel il lia - et quelques autres, il proposa un décret - ajourné pour examen- qui prohibait et punissait l’émigration, prenant ainsi quelques distances avec Mirabeau[23].
Il appartint à d’autres commissions dont celle qui fut chargée de préparer la création de son département d’origine, les Hautes-Pyrénées ou soutint d’autres projets de loi, notamment sur la fiscalité (27 août). Lors du débat sur l’abolition de la peine de mort, il prit une position inverse de Robespierre, et justifia le maintien du châtiment suprême en ces termes :
« Sommes-nous dans les circonstances, sommes-nous dans le degré de perfection sociale qui puisse appeler l’abolition de la peine de mort ? Cette peine est-elle, dans l’état actuel des choses et dans la situation où sont les esprits, une peine moins réprimante que celle de la perte de l’honneur et de la liberté ? ». D’un autre côté, il se déclare maintenant clairement un admirateur de Voltaire et de son œuvre et, afin que nul ne doute de ses opinions, insiste pour être un des députés qui seront chargés d’assister le 12 juillet suivant à la cérémonie de transfert des cendres du philosophe à l’église Sainte-Geneviève devenue le Panthéon. Ce jour là, il fut accompagné de Garat[24] et de Vadier, son vieux complice, qui, comme lui, sont devenus des « aristocrates révolutionnaires » invoquant à tour de bras la philosophie des lumières pour justifier leurs actions.
Avec Antoine Barnave, Bertrand Barère de Vieuzac fut l’un des commissaires chargés par l’Assemblée de ramener le roi Louis XVI à Paris, après son arrestation à Varennes, mais, lors des débats houleux qui suivirent le retour du roi, il ne joignit pas sa voix à ceux qui demandaient la destitution du monarque. Cette position, ce choix politique révélateur, devait entraîner son départ du club des Jacobins.
Le Feuillant
Membre du club des Jacobins dans sa version initiale, il se démarqua des Républicains favorables à la déchéance de Louis XVI, et il rejoignit le club royaliste des Feuillants dont il fut président dans les semaines qui suivirent sa création à la fin du mois de juin 1791. Contrairement à Condorcet, à Camille Desmoulins ou à Maximilien de Robespierre qui se sont publiquement révélés républicains dès cette époque, Barère est donc lui, ouvertement royaliste. La porte du club des Jacobins lui sera dorénavant fermée et, pour des raisons tactiques, il fera tout pour y être admis à nouveau. En vain. C’est seulement sous la grande Terreur que, sûr de son pouvoir de vie et de mort sur n’importe quel citoyen, il forcera la porte des Jacobins pour mieux contrôler le dernier lieu de (relative) libre expression politique face aux comités tout puissants.
Au club des Feuillants se retrouvaient les membres de l’aristocratie marchande et de nombreux propriétaires coloniaux comme les Lameth et des gens de finance qui avaient soutenu Necker, Barère noue de nouvelles relations avec les milieux de la banque. Il noua en particulier des relations étroites avec Charles Pierre Paul Savalette de Lange, homme de finances issu d’une famille extrêmement fortunée, et dont la personnalité le fascinait. Pendant plusieurs années, il occupa un appartement dans le somptueux hôtel Savalette rue Saint-Honoré (restes à l’actuel n°350). Paul de Savalette de Lange était président de la loge maçonnique des « Amis réunis », et comme beaucoup de maçons de cette époque un mélomane, protecteur du grand compositeur Dallayrac, de Langlé et autres musiciens; il disposait d’un théâtre privé dans son château de la Chevrette à Saint-Ouen, et il jouissait d’une fortune considérable constituées non seulement de sa terre gigantesque de Magnanville, mais de celle de Lange dans l’Ain, ou encore à Longjumeau et de biens immobiliers nombreux – immeubles et domaines en Île de France –, accrus d’acquisitions nouvelles de biens nationaux comme le domaine de Boisville. Mais après sa banqueroute provoquée de 1791 qui ruina ses petits clients, – dont le musicien Dallayrac –, il plaça l’essentiel de sa fortune à l’étranger, probablement en grande partie à la City de Londres avec les grandes fortunes française comme celle du duc d’Orléans. Chose assez peu connue c’est cet ami paradoxal de Barère qui finança discrètement l’émigration du comte d’Artois, frère de Louis XVI, à raison de trois millions audacieusement gagés sur l’espoir d’un retour prochain du prince[25]. Les intérêts colossaux de cette somme, qui vont continuer de courir pendant vingt-cinq ans, jusqu’à la Restauration, ne seront jamais remboursés en totalité. On se rappelle que, dans la séance du 9 juillet 1791, c’était Barère qui avait réclamé avec véhémence des mesures à prendre contre les biens des Émigrés. Grâce à Savalette, la fortune de Barère est parfaitement gérée.
En dehors de l’Assemblée, Barère n’est donc autre, à cette époque, qu’un « muscadin » appartenant à la cour dorée de Savalette dont il est le commensal, et ses discours, à l’Assemblée constituante, n’illusionnent guère ceux qui le connaissent intimement. Mais Barère pratique le cloisonnement, il a l’art de donner le change et il sait être convaincant. Au reste, il est opportuniste, et bien malin qui peut dire, sinon Savalette qui l’hébergera toujours en l’an III, ce qu’il sera demain.
1792
Retourné à la « vie civile » après la fin de la Constituante, Barère, qui avait abandonné le 20 octobre 1791 la rédaction de son journal Le Point du Jour, ne se désintéressa pas pour autant des affaires politiques. On le voit ainsi adresser, le 15 novembre 1791, une lettre en faveur du général Valence, gendre de la comtesse de Genlis, dont il fréquente le salon. Il est établi qu’il répondit aux avances de la Cour et notamment Radix de Sainte-Foix[26], Talon et les conseillers secrets des Tuileries qui, cherchant à s’attacher en secret des complicités nouvelles, distribuaient à cet effet des fonds importants de la Liste civile des Tuileries. Son nom figure dans les papiers trouvés dans l’armoire de fer, mais, écrit le ministre Bertrand de Molleville dans ses Mémoires, les éléments matériels ne furent pas suffisants, après le 10 août, pour l’inculper[27]. Selon d’autres sources, il avait perçu de l’argent du comte de Narbonne, ministre de la guerre[28], toujours dans le même but de l’attacher au parti de la cour. Il promit, mais sa promesse n’engagea que ceux qui étaient portés à lui faire confiance.
Pendant la Législative, l’ancien constituant semble avoir accompli un voyage, certainement dans sa province, où il acheta des biens nationaux – notamment l'abbaye de Saint-Lézer, non loin du Gers, qu'il fit démanteler pour en vendre les matériaux –, et peut-être aussi en Angleterre où vivait son épouse.
En juillet 1792, il était à Paris, affectant de soutenir la politique menée par les Girondins et nommément Brissot qui fut l’artisan de la déclaration de guerre contre l’avis exprimé par Robespierre au club des Jacobins. Il entretient d’excellentes relations avec Dumouriez, alors ministre de la Guerre, et qui fait doter son ministère de fonds extraordinaires, des fonds secrets dont il n’a pas à justifier l’emploi et dont le vote ou l’utilisation furent, jusqu’en l’an II, l’objet d’âpres controverses.
Après les événements du 10 août 1792, auxquels il ne participa pas, Barère, fortement recommandé par son ami Target, entra au conseil de justice sous le ministère Danton (comité des jurisconsultes patriotes). Il reprocha à cette époque à Jacques-Guillaume Thouret, magistrat qui fit décréter la division administrative de la France en départements et qui était alors président de la cour de cassation, de l’avoir traité avec peu de faveur, en l’obligeant à choisir entre rester membre du tribunal de cassation ou secrétaire du ministre de la justice Danton. Il ne devait pas oublier ce qu’il considéra comme une offense faite à sa personne.
Député des Hautes-Pyrénées, lors de la formation de la nouvelle assemblée - la Convention nationale - qui succéda le 22 septembre à la Législative, il en était le président lorsque le procès de Louis XVI s’ouvrit. Lorsque Malesherbes vint le voir pour lui faire part de son intention de défendre Louis XVI, il répondit : « Je briguerais moi-même une si noble tâche si je n’étais président de l’Assemblée nationale ! »
Après que son ami toulousain Mailhe eut lu l’acte énonciatif des faits reprochés au monarque, il procéda le 11 décembre à l’interrogatoire du roi à la Convention, et, par la suite, il entraîna le Centre hésitant à voter la condamnation.
Aussitôt après qu’il fut descendu de la tribune, la clôture de la discussion avait été prononcée. Il vota la mort du roi sans sursis après avoir proclamé, reprenant une phrase de Thomas Jefferson suite à la répression sanglante de la Révolte de Shays, durant la Révolution américaine, en 1787[29] : « L’arbre de la liberté croît lorsqu’il est arrosé du sang des tyrans. » Il eut plus de part qu’aucun de ses collègues à la condamnation du roi déchu, contre l’avis de Brissot et de Paine, qui cherchèrent vainement à justifier le sursis. Sa ligne, pendant tout le procès, a été de représenter Louis XVI « comme une victime qu’on est forcé d’immoler à la Concorde ». Les mois suivants, la guerre totale et les graves déchirements intérieurs tinrent lieu de « concorde ».
Son rôle au Comité de salut public
Bertrand Barère de Vieuzac fut le premier député à avoir été élu au Comité de salut public, dès sa création le 6 avril 1793. Il remplit les fonctions de rapporteur de cette commission qu’il appela plus tard la « fosse aux lions » mais qu’il contribua à avilir par une extraordinaire surenchère terroriste. Il en fut membre inamovible pendant dix-sept mois, Carnot arrivant au second rang avec quatorze mois.
Ayant d’abord cherché à défendre les projets fédéralistes des Girondins, il prétendit combattre le pouvoir grandissant de la Commune en oubliant qu’il avait appuyé son ami le ministre de la justice Garat lorsque celui-ci enterra les procédures engagées contre les auteurs des massacres du 2 au 6 septembre 1792. C’est donc Barère, qui, en mai 1793, proposa et fit nommer la fameuse commission des douze, d’inspiration girondine, « pour la recherche des complots et l’examen des arrêtés de la Municipalité de Paris »[30], laquelle fit procéder à l’arrestation provisoire de Jacques-René Hébert et instruisit contre Panis et Sergent, deux conventionnels alors administrateurs de police accusés d’avoir instrumenté de façon crapuleuse les massacres de septembre.
Le Comité de salut public qui comprenait plusieurs divisions, était chargé d’examiner les projets qui devaient être présentés à la Convention nationale laquelle, avec le temps, les valida quasi-automatiquement, dès lors que le Comité de salut public s’arrogea le pouvoir - exercé avec les députés dit Girondins puis ceux dits Dantonistes, etc. - d’envoyer des députés en prison, et par la suite, de les faire exécuter de façon révolutionnaire, hors débat ou sans procès. Ce point extrêmement important, cette épée de Damoclès, explique le mécanisme d’homologation, par la Convention, des dérives de la Terreur[31].
Au Comité de salut public, Barère fut tour à tour ou en même temps chargé des Affaires étrangères et de l’espionnage, de la Marine et des Colonies, de l’Instruction publique, des affaires militaires et surtout de la répression, en concertation avec son confident Vadier qui avait une influence prépondérante au Comité de sûreté générale, la police politique de l’an II, le bras armé du gouvernement, dont il était le patron. Ce Comité de s^reté générale, sous Vadier, fut le principal pourvoyeur du Tribunal révolutionnaire.
Rapporteur, Barère fit de terribles rapports sur la nécessité absolue de la guerre et les dépenses qu’elle entraînait, les dangers immenses de la Vendée, le rôle prétendu des Espagnols et des Gênois dans l’incendie de la flotte française à Toulon, la nécessité de détruire la ville de Lyon, l’urgence du renvoi de Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire, la confiscation des biens des suspects, la culpabilité supposée de Danton et Desmoulins, les expéditions punitives dans le Midi - et Orange en particulier -, le danger représenté par les anciens constituants, les anciens parlementaires, les anciens fermiers généraux, les complots prétendus des prisons, les complots réels et imaginaires, les victoires vraies ou fausses des armées et de la marine, etc. Barère qui, en matière de discours politique, maîtrisait l’art de faire prendre une signification pour une autre, est restée célèbre pour ses « carmagnoles », un mot qui est entré dans le vocabulaire français. Il a en tout cas trompé ses contemporains, certains de ses collègues qui lui ont fait confiance comme Robespierre, les conventionnels et, ce qui est très étrange, des générations d’historiens, universitaires ou non, qui méconnaissant le contexte, continuent d’analyser sans recul, au premier degré, les « carmagnoles » de Barère.
Après le renouvellement du premier Comité de Salut Public, qui vit l’éviction de son ancien collègue Danton, seuls Bertrand Barère et Robert Lindet y furent maintenus. Le comité, composé de neuf membres, se substituant peu à peu aux ministères anciens - à l’exception de Cambon qui, de façon exclusive, dirigea les affaires financières -, Barère eut ainsi la haute main sur les Affaires étrangères - Chemin-Deforgues, le ministre en titre qui était à sa dévotion était consulté après coup ou pour la forme. Outre Robert Lindet - le rédacteur de la tristement célèbre loi du 22 prairial an II- , Barère savait aussi pouvoir compter sur Jean-Marie Collot d'Herbois, Billaud-Varenne et Lazare Carnot qui ont pratiquement toujours voté comme lui. En revanche, Georges Couthon, Antoine de Saint-Just et Maximilien Robespierre ne le suivaient pas toujours et se sont désolidarisés certaines fois - et de plus en plus souvent à partir de l’hiver 1793-94 - de leurs autres collègues, surtout dans certaines affaires de répression et plus généralement sur l’opportunité, pour eux, de ralentir la Terreur et d’ouvrir des négociations avec les neutres, les deux étant liés.
La question des signatures des registres, et donc des responsabilités individuelles ou collectives, souvent invoquée, bien qu’au cœur de la réalité des faits, est une question sans réponse satisfaisante car plusieurs registres et non des moindres ont, selon le comte d’Allonville et d’autres contemporains, été falsifiés dès le 9 thermidor an II, et plusieurs doubles ont été enlevés par Bertrand Barère avec l’aval de Joseph Fouché, l'artisan avec Collot d'Herbois du massacre de centaines de Lyonnais[32] ou même Lazare Carnot – déjà attentif à consolider sa légende d’organisateur de la victoire, fabriquée pour lui par Barère, et que fixera son fils Hyppolite, au prix de gros mensonges –, et on ne sait pas ce qu’ils sont devenus. En conséquence, la présence ou non de telle ou telle signature sur un registre ou un document doit être envisagée avec circonspection. Il en est de même concernant les registres du Comité de sûreté générale qui sont lacunaires.
L’historiographie thermidorienne – dont s’inspire sur ce point l’historiographie communiste –, comme l’historiographie royaliste, a toujours insinué que Robespierre avait eu une influence prépondérante au Comité de salut public, en perdant de vue que Barère, dont les ressources financières semblaient inépuisables, qui était cultivé, déterminé, capable de duplicité et certainement beaucoup plus psychologue que ne l’était son collègue Robespierre, avait su asseoir sa domination au sein des comités et dans une partie de la Convention. Pour Louis Blanc et d’autres historiens moins souvent cités comme Hamel, l’influence de Robespierre était, au contraire, très contestable et très contestée[33]. Il n’était « que » populaire, très populaire, certainement aux Jacobins et dans les sections, c’est-à-dire dans la rue, et c’était le souci majeur de Barère qui, bien que principal inspirateur des mesures ultra-violentes, sentait qu’il était de moins en moins suivi sur cette voie. Robespierre, Saint-Just et Couthon contribuèrent à la formation d’un relatif contre-pouvoir au sein du grand comité, et ils obtinrent la création d’un Bureau de police en pensant que, dégagé de la sphère d’influence du Comité de sûreté générale à qui non sans raison ils attribuaient les premiers « dérapages » de la Terreur, celui-ci permettrait de mieux cadrer les activités de répression. Ce contre-pouvoir était encore trop pour Barère qui ne laissa jamais rien paraître. Avec sa garde rapprochée (Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Lazare Carnot, André Amar et Vadier) il imagina d’ailleurs que, une fois Robespierre éliminé, la Terreur survivrait au 9 thermidor et se développerait plus que jamais[34].
Au Comité de salut public, Barère a fait passer un certain nombre de mesures très spectaculaires, infléchissant chaque fois un peu plus la politique du gouvernement dans la voie de l’exagération révolutionnaire, damant le pion aux « exagérés » de la Commune hébertiste, la question étant toujours de savoir si ces mesures ont eu une réelle utilité pour le pays.
Pour fêter la prise des Tuileries du 10 août 1792, lors de la séance du 31 juillet 1793, Barère, proposa de détruire des tombeaux de la basilique Saint-Denis (instigateur du décret qui ordonna que les tombeaux des rois seraient ouverts et leurs cendres jetées au vent).
Il proposa et fit passer la loi dite du maximum avec l'appui de Cambon, le grand argentier de la République en l'an II, son compatriote toulousain et son protégé. La politique économique de Cambon fut critiquée par Robespierre qui la jugeait inefficace ce qui ajouta aux divisions au sein du Comité de salut public
Le 1er août 1793, à la Convention, Barère avait fait un terrible réquisitoire contre la Vendée, exagérant le pouvoir de nuisance de cette province et de ses habitants, puis à nouveau, le 25 septembre, il harangua la Convention, évoquant la nécessité de requérir une armée de 400 000 hommes. Quoi qu’il en soit, ses diatribes provoquèrent la destruction totale de l’armée vendéenne à Savenay le 23 décembre 1793. Malgré cette défaite, au lieu de commencer la pacification, il exhorta ses concitoyens à anéantir les populations et à brûler les villages, ce dont se chargea, parmi d’autres, le général Turreau de Linières. C’est lui, et non Robespierre, qui décida du renvoi de Marie-Antoinette devant le Tribunal révolutionnaire. Par la suite, à nouveau contre la volonté de Robespierre, il poussa avec Siéyès au renvoi de Madame Elisabeth devant le Tribunal révolutionnaire[35].
Le grand orateur de la Gironde Vergniaud, quoique arrêté depuis le 2 juin avec ses amis, suite au coup de force du bras armé de la Commune héberto-maratiste contre la Convention, et en instance de comparaître au Tribunal révolutionnaire, le présenta dans une brochure publiée le 23 juin 1793, soit trois semaines après son arrestation, comme un « imposteur » doublé d’un « assassin »[36].
Un mois après cette publication qui fut plus ou moins censurée - les exemplaires en sont très rares -, Barère arrachait un décret à la Convention pour mettre en jugement neuf députés girondins et en envoyer seize autres directement à la guillotine. Il joua un rôle de premier plan dans l’arrestation et le « procès » à huis-clos puis l’exécution de vingt et un députés ayant en commun de s’être opposés à l’installation de la dictature du Comité de salut public: en fait, Barère ne produisit jamais le rapport argumenté sur lequel il prétendait se fonder pour justifier leur châtiment. Pendant plusieurs mois, les Girondins illégalement arrêtés, avaient néanmoins été présentés à l’opinion publique française, sans apporter de preuves, comme des factieux, fauteurs de troubles et « instigateurs de guerre civile », ce qui n’a jamais été prouvé mais entériné aux yeux de l’histoire par le procès truqué du 30 octobre 1793[37]. Barère a co-signé le décret renvoyant le duc d’Orléans, son ancien protecteur, au Tribunal révolutionnaire. Il a cherché à étouffer toute preuve ou tout témoin de ses propres engagements politiques du temps de la Constituante. Imaginant que la pièce « Paméla » montée par les artistes du Théâtre national français était une allusion déguisée à son rôle de tuteur grassement rémunéré de Melle Paméla, la fille du duc d’Orléans, il fit envoyer François de Neufchâteau, l’auteur de cette pièce, et tous les comédiens en prison. La mort de l’ancien maire Bailly, tenu responsable des fusillades du Champ de Mars le 17 juillet 1791, au terme d’un procès « révolutionnaire », obéit à cette même logique selon laquelle, selon ses propres mots, « les morts ne reviennent pas ».
Surpris par certaines de ses mesures, mais confiant dans la sincérité de ses principes jusqu’à la fin de l’hiver 1794, Robespierre avait toutefois fini par le nommer « l’Équivoque »[38]. Une guerre d'influence, un bras de fer avait commencé au sein du Comité de salut public où Robespierre, généralement suivi par Saint-Just et Couthon, n'avait pas la majorité des voix.
Barère et l’Angleterre : la « Lettre anglaise »
Les rapports de Barère sur William Pitt et l’Angleterre sont à mettre en parallèle avec des décisions essentielles qu’il a cherché et souvent réussi à faire passer au Comité de salut public et à la Convention, décisions qui semblent véritablement avoir été de nature à satisfaire le premier ministre anglais. Sur la question de l’Espagne, William Pitt avait diligenté à Paris des agents d’influence pour intervenir auprès des membres des commissions parlementaires chargées d’élaborer de futurs décrets dans les matières sensibles, entre autres la diplomatie. C’est ainsi que Mirabeau avait été approché pour obtenir la suppression du pacte de famille qui, depuis 1761, était non pas seulement une alliance dynastique mais une alliance politique et commerciale, une sorte de pacte de non agression entre la France et l’Espagne. Ce pacte avait prouvé son utilité pendant la guerre d’Amérique. Or, en 1793, Camille Desmoulins s’est étonné que ce soit Barère qui ait fait déclarer la guerre à l’Espagne, « sans savoir dans quelle position étaient nos frontières de ce côté ». « Il me parut facile, ajoute-t-il, de voir que Barère n’avait pas même parcouru les pièces »[39].
Pour le gouvernement anglais qui avait rejoint la coalition en même temps que l’Espagne, sans avoir l’air d’avoir voulu déclarer la guerre à la France, il fallait compter non seulement sur la cohésion et la force des puissances coalisées - pas un état d’Europe ne devait manquer à l’appel, mais favoriser en France même une guerre civile qui affaiblirait le pays. Le projet a donc été, pour le gouvernement britannique, de favoriser, autant que faire se peut, toutes les entreprises à caractère « contre-révolutionnaire » qui permettraient de justifier une surenchère dans la répression laquelle appellerait de nouveaux soulèvements et toujours plus de sang. Ce « programme de guerre », rarement cité, a pourtant été reconnu, validé et publié par la Convention, suite à la découverte inopinée, à Lille, d’un document manuscrit en langue anglaise, de premier ordre, publié sous le titre la Lettre anglaise. Il émanait d’une autorité politique supérieure, susceptible de coordonner diverses entreprises en divers lieux, et dont le but avoué était de créer des foyers de sédition ou de désorganisation un peu partout sur le territoire, des attentats contre les biens - fabriques de poudre ou autres - ou diverses actions de sabotage[40]. Il n’était pas prévu que cette lettre privée tombât par hasard entre les mains du gouvernement français. Prévenu, Barère s’en saisit le premier et se chargea de la présenter aux députés. Faute de pouvoir incriminer les Girondins, il ne manqua pas d’attribuer ces projets aux royalistes vivant encore en France, coupables de tous les maux - par exemple au baron de Batz, ancien député, ou au général Arthur Dillon, alors en réserve de la République[41] -, cherchant à justifier contre eux une surenchère dans la répression. Cette répression outrancière ne manqua pas de se produire avec la Terreur que Barère se chargea lui-même de mettre à l’ordre du jour le 5 septembre 1793. Il en donna une traduction législative immédiate avec la loi des suspects concoctée par lui sous le direction du grand juriste Merlin de Douai.
Or, beaucoup de royalistes s’étaient détournés de l’Angleterre, surtout depuis la prise de Toulon, car le gouvernement britannique, par la voix de ses commissaires à Toulon, avait clairement laissé entendre que le rétablissement des Bourbons ne pourrait se faire que sous condition (amputation d’une partie du territoire)[42]. Ces subtilités n’étaient pas à l’ordre du jour, et la répression contre les royalistes de Lyon, de Vendée ou d’ailleurs promettait d’être impitoyable, au-delà du nécessaire ainsi que l’on admit les esprits raisonnables, comme le général Gourgaud et beaucoup d’autres contemporains. Certains positionnements de Barère qui n’étaient pas d’une grande lisibilité sur le moment, et d’autres décisions ou commentaires étranges[43], qui apparaissent en grande contradiction avec ses déclamations sur Pitt et l’Angleterre, ont permis plus tard à Laurent Lecointre, Saladin et autres députés de l’accuser, avec vraisemblance, d’avoir favorisé en tout point la politique du cabinet britannique.
Barère et les représentants en mission
Lorsque la ville de Lyon se souleva, Dubois-Crancé y fut envoyé pour contrôler la situation, une mission au terme de laquelle il put écrire: « Cette ville (Lyon) est rentrée le 9 octobre dans l’obéissance : j’en suis parti le 12 et je n’ai plus eu, depuis ce temps, rien de commun avec ses malheureux habitants ». À son retour, Barère l’accusa de tiédeur et le persécuta pour ce motif et aussi, souligne Dubois-Crancé, pour avoir cherché à « sauver le Midi et la Bretagne d’une guerre civile qui eût entraîné la perte de la France entière »[44]. Quand on lit le rapport de Barère sur le projet de décret aboutissant à raser Lyon et son enthousiasme de rapporteur du Comité de salut public en imaginant la beauté de cette mesure, on croyait, dit Camille Desmoulins, entendre N. dans Voltaire : - Bâtir est beau mais détruire est sublime ![45]
A leur tour envoyés à Lyon où il se signalèrent par des exactions sans nombre, assassinats en masse et dilapidations, Fouché, Collot d’Herbois et Javogues eurent Barère comme meilleur avocat aux Jacobins et à la Convention: contrôlant toute la communications politique sur la répression ou ce qui en tenait lieu, s’appuyant sur des rapports pipés, il alarmait les députés en exagérant les dangers de la contre-révolution, ne rendait pas compte fidèlement des missions en cours, à Lyon ou ailleurs, et insistait sans répit sur la nécessité du « salut public ».
Pendant l’hiver 1793-1794, il justifia les exactions des généraux Fayau, Westermann ou Thureau - metteurs en œuvre des colonnes infernales - et, contre l’avis de Robespierre favorable à la pacification, réclame une mise à feu et à sang de la région Vendée. Imité en cela par Collot d’Herbois et Billaud-Varenne, mais aussi par Carnot qui avaient dressé un rapport infidèle à la Convention sur les cruautés de Joseph le Bon, représentant sanguinaire et sadique à Arras, en les déguisant, Barère insista avec force pour son maintien en place, contre l’avis de Robespierre :
« Le Comité de salut public applaudit aux mesures que vous avez prises, avaient ils écrit à Le Bon - de sinistre mémoire pour les arrageois-, toutes vos mesures sont non seulement permises, mais encore commandées par votre mission: rien ne doit faire obstacle à votre marche révolutionnaire. Abandonnez-vous à votre énergie, vos pouvoirs sont illimités »[46]. Dégoûté par les tueries de Le Bon, telles que sa sœur Charlotte[47] les lui avait rapportées, Robespierre et Couthon ont provoqué le rappel de cet homme sanguinaire qui, s’il a répondu à une convocation en pluviôse an II, repartit quelques jours plus tard en vertu d’un nouvel ordre arraché par Barère et ainsi conçu : « Le Comité de salut public arrête que le citoyen Lebon retournera dans le département du Pas-de-Calais en qualité de représentant du peuple pour y suivre les opérations déjà commencées. Il pourra les suivre dans les départements environnants..( Signé Barère, Collot, Carnot) »[48]. De retour à Arras Lebon fit régner de plus belle la Terreur. Les citoyens Boissard, Triboulet et Langlet, membres de la Société populaire d’Arras, s’adressèrent plus tard, en désespoir de cause, à la Convention, s’élevant contre le protection qu’avait trouvé auprès de Barère le « tigre-prêtre ». Lors de ses passages à Paris, Le Bon faisait, écrivent-ils, « perpétuellement antichambre chez Barère avec lequel il se concerta pour son rapport dans lequel il associe aux héros de Fleurus le bourreau de notre contrée; où (Barère) proclame sauveur du Nord celui qui avait mis le patriotisme en deuil ». Et ils ajoutent : « Barère vint vous arracher un décret qui renvoyait à leur mandat d’arrêt tous ces fonctionnaires publics courageux du sang desquels Joseph Lebon était altéré »[49]. Malgré la loi du 30 germinal an II qui supprimait les tribunaux révolutionnaires en province, Le Bon avait obtenu, grâce à l’appui de Barère, de maintenir celui d’Arras et d’en créer un second à Cambrai[50]. Barère prit la défense d’autres représentants sanguinaires dont Roux-Fazillac et généralement tous ceux qu’il avait lui-même appuyés dans des missions punitives en province.
Pour la guerre à outrance
Pendant l’hiver 1793-1794, tandis que le gouvernement britannique faisait voter au parlement un budget considérable pour la poursuite de la guerre, le Comité de salut public faisait procéder à l’arrestation en série des anciens cadres de l’armée et de la marine, souvent les plus expérimentés. Non seulement les cadres de l’armée de terre, comme Houchard, Lamarlière, Brunet, Chamron, Donadieu, Granges de La Ferrière, Buchold, Lazare Hoche [51] étaient destitués sous des prétextes divers, et arrêtés mais également les cadres de la marine[52] Dans une lettre datée Toulon le 26 ventôse an II, le citoyen Roubaud déplore que les officiers de la marine de guerre, royalistes d’origine, comme la plupart des cadres de l’armée, sont « presque tous émigrés, guillotinés - comme Kersaint, Grimouard ou d’Estaing - ou en état d’arrestation ». Ce sont, ajoute-t-il, « les hommes les plus expérimentés dans l’art de la navigation, les hommes les plus exercés dans les détails immenses des arsenaux maritimes... »[53]. Pour remédier à la pénurie d’officiers, force fut d’en prendre issu de rangs inférieurs.
Barère a ainsi produit, tout le temps qu’il a été au Comité de salut public, une série de rapports à la Convention, prséentés au nom du Comité de Salut public ou des comités réunis: « sur le mouvement des armées sur les frontières du Nord », « sur la prise de Bruxelles », « sur le progrès des armées de la République », « sur la prise de Charleroi », « sur la suite des évènements du siège d'Ypres », « sur l’héroïsme des Républicains montant le vaisseau le Vengeur », « sur les succès de l’armée du Rhin ». Ses rapports sont, on l’a dit, restés célèbres car ils dénaturaient la réalité des choses et on les appelés des « Carmagnoles ». Le mot a été utilisé jusque sous l’Empire pour désigner les discours prononcés par Regnaud de Saint-Jean d’Angély au Sénat lorsque l’Empereur chargeait celui-ci de justifier la levée d’un nombre grandissant chaque année de conscrits. Barère « taillait des Carmagnoles » dans le but de maintenir l’illusion, auprès de la Convention et de l’opinion, de la justesse de la politique de guerre épuisante qu’il préconisait, et de la nécessité des dépenses gigantesques décidées au Comité de salut public et que la Convention avalisait à l’image de ce que fit plus tard le Sénat napoléonien.
Cependant, les sommes englouties pour la diplomatie secrète et la guerre n’étaient pas rigoureusement justifiées. Barère met par exemple à la disposition du ministre de la marine un million de numéraire, et plus en cas de succès, pour envoyer un agent secret pour financer les indépendantistes écossais - qui ne virent jamais cet argent -, et 400 000 livres pour un agent pour l’Irlande chargé de la même mission impossible. Ces missions se soldèrent dans les deux cas par un échec puisque les agents secrets irlandais ou plus rarement écossais « indépendantistes », employés par la France, étaient dénoncés au gouvernement anglais par Charles Marien Somers, lui-même renseigné par Nicolas Madgett, agent britannique de haute volée installé par Barère au service des traductions du Comité de salut public [54]. En fait les discours alambiqués de Barère ont souvent peu à voir avec la réalité des faits tels qu’ils se sont produit, ainsi qu’on peut encore le constater en comparant par exemple le rapport de Renaudin et celui de Barère sur le combat naval où sombra le navire « le Vengeur »[55]
Camille Desmoulins fut un des tout premier à user de sa notoriété pour élever publiquement des doutes sur la sincérité et la loyauté de Barère, et il s’en était fait l’écho dans son journal le Vieux Cordelier : Barère y est regardé comme un « scélérat et un Tartuffe »[56], reprenant à son compte les doutes argumentés par Vergniaud. Camille Desmoulins devait être arrêté avant d’avoir pu envoyer à son imprimeur, le citoyen Desenne[57], l’épreuve corrigée de son dernier numéro du Vieux Cordelier où il appelait à la vigilance républicaine sur Barère[58].
Barère et l’affaire Danton, Desmoulins, Philippeaux
Pour faire cesser les violences et les crimes commis par les « colonnes infernales » en Vendée, Pierre Philippeaux avait rédigé, ce même hiver 1793-94, une lettre sur la Vendée que, selon Barras, Danton aurait pu lui-même publier: « Lisez donc le mémoire de Philippeaux, disait Danton aux comités de gouvernement, il vous fournira les moyens de terminer cette guerre de Vendée que vous avez perpétuée pour rendre nécessaires vos pouvoirs ». Vadier, Voulland, Barère et Amar accusèrent alors Danton d’avoir lui-même fait imprimer et distribuer ce mémoire. Danton leur répondit seulement: « Je n’ai point à m’en défendre » et, signant son arrêt de mort, il menaça de les accuser de malversation et de tyrannie à la Convention nationale [59]. Témoin de ces scènes, Barras dit à Brune, le général d’Empire, très proche du couple Desmoulins: « Veillez sur Danton, il a menacé au lieu de frapper. »
Dès lors, comme Philippeaux, comme Desmoulins, Danton était perdu. Les motifs pour le perdre ne sont pas exactement ceux en rapport avec la Vendée, comme on pouvait s’y attendre, mais une vague mention de Danton dans le long rapport de Antoine de Saint-Just, sur les menaces intérieures et le complot de l'étranger. Cette affirmation de Antoine de Saint-Just, reprise imprudemment d’une dénonciation du 11 germinal an II[60] selon laquelle Danton avait été vu dans un restaurant où venaient parfois des contre-révolutionnaires, a été montée en épingle par Barère et Vadier, et a, à elle seule, « justifié » l’arrestation du député, sans qu’on lui ait laissé le loisir de s’expliquer sur ce déjeuner rue Grange-Batelière chez le traiteur Rose[61]. Robespierre s’est étonné de l’empressement avec lequel Barère et son bras armé - Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Vadier, Amar et le reste du Comité de sûreté générale - a voulu faire condamner Danton et son « complice » Desmoulins. Cette précipitation tient d’abord au fait que le mandat d’arrêt le frappant avec Desmoulins et Pierre Philippeaux n’annonce aucun motif et n’est pas signé, mais surtout, que le véritable motif de l’arrestation de Danton tenait aux soupçons fondés, par au moins une lettre datée Whitehall le 13 (septembre 1793) qu’il possédait[62] - il y en avait probablement d’autres qui furent saisies et détruites entre deux levées de scellés chez lui -, selon lesquelles l’Angleterre distribuait de l’argent par l’intermédiaire du banquier Perregaux, du ministre des affaires étrangères Michel Chemin-Deforgues, créature de Barère, et l’anglais Worsley, son correspondant. Pour arriver à ses fins, il repoussa violemment l’idée émise par Robespierre de permettre à Danton de se justfifier à la Convention de l’accusation inepte qui le frappait et qui lui aurait offert l’occasion de contre-attaquer en soulevant la grave question des « fuites » et d’une éventuelle trahison au sein du Comité de salut public[63].
Pour forcer le destin et obtenir l’élimination rapide et « silencieuse » de Danton et de ses co-accusés, Barère intrigua avec Vadier[64], et, trompant la Convention sur la réalité de la situation réelle, il obtint qu’elle vote un décret mettant les accusés hors débat, au prétexte d’une fausse conspiration dans la prison du Luxembourg où se trouvaient déjà Lucile Desmoulins- placée au secret par Dossonville depuis le 14 germinal - et le général Arthur Dillon, dont il voulait également se débarrasser. Ainsi, il obtint que la fin du procès de Danton et consort fût jugé à huis clos, comme l’avaient été les Girondins et comme le furent tous ceux qui l’avaient connu et eussent pu articuler quoi que ce soit sur sa conduite passée et présente.
Danton et Camille Desmoulins, à qui on avait agrégé à dessein des députés prévenus par décret du 29 ventôse d’être impliqués dans des affaires de pots-de-vin versés par des administrateurs de la Compagnie des Indes ou des personnes menacées d’arrestation, furent guillotinés avec autant de précipitation qu’on en avait mis fin octobre 1793 pour les députés Girondins. Huit jours plus tard, le général Arthur Dillon et Lucile Desmoulins comparurent à leur tour au Tribunal de Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, et, sans être interrogés, ils furent guillotinés au prétexte d’avoir fomenté une révolte dans la prison du Luxembourg. On leur adjoignit le député Philibert Simond qui, le 20 nivôse an II, avait prononcé un discours courageux, aux Jacobins, sur la nécessité d’arrêter la guerre, contrariant largement l’argumentation de Barère. Il avait surtout mis ses amis en garde ses compatriotes sur la distinction essentielle entre les conspirations chimériques et celles, d’une autre ampleur, ourdies « dans les brouillards de la Tamise ». Ce positionnement qui risquait d’ouvrir les yeux de ses compatriotes sur les véritables dangers, représentait un risque pour Barère et ses employeurs[65]. Ils se connaissaient fort bien et, d’après la correspondance de l’ambassadeur à Milan Francis Drake[66] à lord Grenville[67], lord Mulgrave correspondait avec les espions infiltrés dans les rouages du gouvernement français. Par ailleurs, Barère avait une correspondance avec lord Stanhope qui n’était autre que le gendre de Grenville et le beau-frère de William Pitt[68]. Avec Dillon, Simond et Mme Desmoulins périrent ce jour là des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles et qui passèrent aux yeux de l'opinion pour avoir conspiré dans la prison.
Robespierre pouvait-il résister sans risquer le sort de Danton ?
Alors que Robespierre désire un retour progressif à la paix en négociant avec les états disposés à reconnaître la République, Barère qui a la majorité des voix pour lui au Comité de salut public, maintient le principe de la guerre à outrance et, dans le même temps, il s’efforce de rendre la République « hideuse » par la Terreur en Vendée, à Lyon, à Paris, etc.
Barère et l’Irlande
Selon Lewis Goldsmith, l’« ami de trente-trois ans » de Barère[69], Bertrand Barère a recruté des membres du contre-espionnage britannique et notamment Nicolas Madget et Charles Marien Somers, devenu le premier agent d’espionnage en France après le départ de Georges Munro au moment du procès de Louis XVI[70]. Les documents d’archives français et anglais confirment son assertion.
Les projets français de descente en Irlande pour soutenir les indépendantistes avaient pris une nouvelle importance avec la guerre (février 1793).
La nécessité, pour l’Angleterre, de neutraliser tous les projets français à destination de l’Irlande, son talon d’Achille, était vitale.
Barère et l’abbé Nicolas Madget, qu’il avait autrefois connu à Toulouse, entretiennent des liens étroits et discrets. Nicolas Madget avait été employé en 1789 au quotidien de Bertrand Barère le Point du Jour pour les « articles de Londres »[71] Barère devait ensuite le proposer comme tuteur ou précepteur du fils de Louis XVI et Marie-Antoinette en 1792[72]. Infiltré au sein des collèges irlandais de Paris, l’ancien prêtre avait capté la confiance des Irlandais Unis (indépendantistes) et, jusque sous le Directoire, certains d’entre eux comme Wolfe Tone lui confiaient imprudemment leurs projets[73]. Son rôle était en effet de démanteler les réseaux irlandais sur le continent, aussi Barère le fit-il travailler sous le ministère Chemin-Deforgues - il fut chargé de plusieurs missions -, et le recruta officiellement - mais discrètement - au Comité de salut public, en pluviôse an II.
Madget était associé à son vieil ami Charles Marien Somers, né à la Jamaïque, agent principal de lord Grenville, actif à Paris depuis 1791. Ses missions étaient financées par De Berdt un des secrétaires de William Pitt[74] qui déposait des fonds chez le banquier Gregory - correspondant parisien de Turnbull et Forbes de Londres. Il s’agissait d’un espionnage très organisé, très sophistiqué, que Barère semble avoir été seul à connaître avec sans doute Michel Chemin-Deforgues[75], avec infiltration progressive des ministères Lebrun puis surtout Chemin-Deforgues puis Buchot à qui furent proposés des « agents » pour « opérer la division en Angleterre » ou pour observer l’état de l’opinion en Irlande et en Écosse. Certains d’entre eux étaient, en réalité, à la solde de l’Angleterre : un troisième larron, Richard Ferris, qui joua le rôle de porteur de dépêches, fut imprudemment chargé de mission par Deforgues. Madget et Somers, probablement sur ordre, décidèrent de tendre un traquenard à William Jackson, un des héros de l’indépendance irlandaise, envoyé en mission secrète - qui s'avéra suicidaire - en Grande-Bretagne et en Irlande à la fin de l’hiver 1794. Arrêté pratiquement à son arrivée, Jackson fut jugé, chargé par Charles Marien Somers venu sur place, et condamné à la pendaison (1794). En septembre 1795, Charles Somers revenait d’Angleterre par Brest et, des lettres signées par lui concernant le général Francisco de Miranda[76], ayant été découvertes chez Nicolas Madget son « ami pour la vie »[77], il fut recherché en région parisienne avec le nommés (Georges) Ellis, anglais, « ami de Pitt et du lord Mulgrave »[78],[79]. Recruté par Nicolas Madget comme interprète, pour la 1e division à Brest le sieur Sullivan fut envoyé en floréal an II à Brest. Quelques mois plus tard, il était arrêté et ramené à Paris pour avoir favorisé l’évasion de prisonniers anglais[80].
Tous ceux qui avaient travaillé sous le ministère Lebrun à des projets français relatifs à l’Irlande furent, comme par hasard, guillotinés, tel Le Chapelier qui se livra imprudemment à Barère, ou le député Rabaut Saint-Etienne, ou encore l’écrivain Chamfort qui préféra se suicider: leurs papiers furent évidemment récupérés par Barère qui en fit bon usage[81]. Le célèbre Thomas Paine, célèbre pour son enthousiasme et son amitié pour la France de 1789, fut arrêté à son tour le 2 nivôse an II, sur ordre de Barère, et il était inscrit sur les listes de « conspirateurs » de prisons lorsque le 9 thermidor le sauva miraculeusement[82]. Le général Arthur Dillon, père de Mmes Bertrand et de la Tour du Pin, avait lui-aussi un projet de descente en Irlande remis à Lebrun en décembre 1792/janvier 1793) et qu’il avait préalablement fait connaître à la Convention nationale. Son arrestation fut décidée sur ordre de Barère au prétexte que son nom apparaissait dans la « Lettre anglaise ». C’est du moins ce que le rapporteur du Comité de salut public réussit à faire croire à ses collègues. En fait, il s’agissait du révérend père Dillon, supérieur du collège irlandais de Douai, qui, avec le docteur Gregory Stapelton, président du collège irlandais de Saint-Omer, fut de ces quelques Irlandais qui étaient secrètement à la solde des Britanniques. Depuis sa prison, le général Dillon réussit néanmoins à mettre en garde le couple Desmoulins contre les manœuvres de Barère[83].
Georges-Jacques Danton et Camille Desmoulins éliminés le 5 avril 1794 pour les motifs indiqués ci-dessus, le général Arthur Dillon et Lucile Desmoulins furent renvoyés devant le Tribunal révolutionnaire[84]. On voit mal comment Dillon et Mme Desmoulins pouvaient conspirer ensemble puisqu’ils étaient détenus séparément et elle était au secret depuis son arrestation par Dossonville, sur ordre des comités, le 15 germinal an II. Mais on avait sollicité de faux témoignages pour charger Lucile Desmoulins et ses co-accusés au Tribunal révolutionnaire et ce procédé permit d’expédier son affaire et celle de Dillon sans que cela donne lieu à un débat public, qui eût été gênant pour Barère et les « amis de l’Angleterre »[85]. Il n’était pas question d’attirer l’attention publique, par un procès équitable du général Dillon, sur le vrai débat, celui de la gestion par Barère du dossier Irlande. Car tous les rapports, plans et projets sur l’Irlande furent dorénavant communiqués au ministère britannique, interceptés et copiés au fur et à mesure par Nicolas Madget qui, officiellement recruté depuis le 14 ventôse an II, fut placé à partir du 2 floréal an II[86], a la tête du département des traductions, un excellent poste d’observation et une couverture[87]. Nicolas Madget et Richard Ferris survécurent sous l’Empire, continuant à se voir et à communiquer avec Charles Marien Somers[88]. Ce dernier seul, suite à une erreur fatale - des papiers imprudemment laissés à son domicile le trahiront -, sera arrêté, jugé et condamné à mort pour espionnage au profit de la Grande-Bretagne. Il sera fusillé en 1812 dans la plaine de Grenelle[89].
Au printemps 1794 et pratiquement jusqu’au 18 fructidor an V, grâce à Barère, le contre-espionnage britannique est installé au sein du gouvernement. L’arrestation de Hoche fut, selon Barras l’œuvre de Barère, et à nouveau en service sous le Directoire, le valeureux général de la République éprouva les pires difficultés pour organiser le financement de son expédition projetée en Irlande. Car « toutes les dispositions arrêtées par le Directoire n’étaient exécutées que suivant les opinions ou les convenances des commissaires du Trésor qui se trouvaient à son égard dans une certaine indépendance ».[90].. À cet égard, divers recoupements pourraient laisser supposer que l’inertie calculée de Paul Savalette de Langes, commissaire à la Trésorerie, chez qui Barère logea longtemps, qui était son confident intime, ne fut pas étranger à cet échec[91].
Barère et les services secrets en l’an II
Nicolas Madget n’est pas le seul agent infiltré. Les papiers ministériels anglais et les archives diplomatiques et policières françaises font état de plusieurs agents de renseignements placés comme lui dans les comités de gouvernement. L’un d’eux est désigné dans les archives britanniques comme étant l’un des (nombreux) secrétaires du Comité de salut public : il pourrait en l’occurrence s’agir de Dominique Demerville placé par Bertrand Barère au Comité de salut public, dès sa création, et qui demeura en poste jusqu’au 9 thermidor où il participa activement à l’élimination Robespierre.
Dominique Juveniau, dit Demerville, qui se chargea en effet pour Barère de commissions ou affaires dans lesquelles il ne pouvait pas se permettre d’apparaître directement, était né à Tarbes le 21 avril 1767, fils naturel de Jeanne-Marie Donat. Il fut adopté par Pierre Demerville dont il porta le nom. Venu à Paris avec Barère, il demeura à son service jouant véritablement le rôle d’un Figaro dévoué et astucieux, témoin de toutes ses pensées et actions qu’il avait un intérêt essentiel à dissimuler. En récompense, Barère favorisa sa fortune et le 17 décembre 1793, il devint le propriétaire du fabuleux domaine de Séméac, issu des princes de Bidache, la plus belle propriété disait-on, non seulement du Bigorre mais de toutes les provinces du Languedoc, qui semble avoir été entièrement démantelée avant ou après sa vente par Demerville, sous le Directoire, à Jean-Pierre Barère. Après la déclaration de guerre avec l’Angleterre, Demerville paraît avoir été appelé à jouer le rôle que le général Le Michaud d’Arçon[92] joua pour Carnot au Comité de la guerre, c’est-à-dire qu’il renseignait le ministère anglais, par le moyen de bulletins, sur les travaux hebdomadaires du Comité de salut public, sous une forme habile, qui ne permît pas d’identifier la provenance de ces bulletins. Or si l’on passe en revue les secrétaires du Comité de salut public en l’an II, avec leurs dates respectives d’entrée et de sortie, le profil de Demerville est le seul qui corresponde parfaitement à celui de l’expéditeur de ces bulletins[93]. Lord Stanhope, beau-frère de Pitt et gendre de lors Henry Grenville, lord Portland, lord Mulgrave[94], lord Wyndham, sir Robert Worsley, sir Robert Fiz-Gerald, ambassadeur anglais en Suisse (avant d’être remplacé par sir Wickham), sir Francis Drake et son correspondant le comte Rocco de San Fermo[95] et d’autres encore, étaient au courant de cet espionnage multiforme qui avait été mis en place avant le 2 septembre 1793 si l’on s’en tient aux dépêches adressées par Francis Drake, ambassadeur anglais à Venise et à Gênes, au directeur du Foreign Office, lord Grenville.
L’intérêt de ces informations venant de Paris ne semble pas avoir été remis en cause par lord Grenville, qui, alors, supervisait les opérations britanniques à l’intérieur de la France, en liaison avec ses ambassadeurs et les autres ministres du gouvernement Pitt, qui connaissait l’identité de la personne « employée par ce comité (de salut public) et qui cache ses véritables convictions sous l’apparence du jacobinisme le plus extravagant ». « Lord Mulgrave expliquera à votre Seigneurie, écrivait Francis Drake à lord Grenville, par quelles voies ces communications me sont transmises. Je prie humblement votre seigneurie d’observer que si la note incluse était vue par d’autres que les ministres de sa majesté, sa divulgation aurait les conséquences les plus fatales pour celui qui l’a écrite ».
En fait, il n’y avait pas un seul mais plusieurs informateurs du gouvernement britannique dans différentes sphères de l’administration républicaine, que ce soit à la guerre ou à la marine qui avait en charge les colonies[96]. Parmi ces espions, l’un des plus actifs, au printemps 1794, fut Samuel Baldwyn, ancien maître de langue des comtes de Provence et d’Artois, frères de Louis XVI. Il avait pris la résidence du diplomate anglais Georges Straton, rue du Coq-saint-Honoré, après que ce dernier fût retourné en Angleterre pendant le procès de Louis XVI. Après quelques déconvenues - il fut arrêté deux fois en 1793 mais chaque fois discrètement protégé par Barère -, Samuel Baldwyn obtint un emploi au Comité de salut public (il faisait parvenir ses dépêches à sir Robert Worsley et à Francis Drake qui retransmettaient à Grenville) dont il fut une des « taupes », jusqu’en prairial, époque où, ayant paru suspect, il fut placé en détention à la maison de détention des Écossais. Il avait de fortes protections, notamment celle de Barère qui bien entendu lui évita la guillotine. Il fut libéré après le 9 thermidor et put reprendre ses anciennes occupations.
L’ancien député Bailleul rapporte non sans quelque apparence de raison que Barère faisait placer des « aristocrates » dans tous les rouages de l’administration[97]. Or à l’époque, les personnes intéressées à « surprendre les secrets du gouvernement » avaient intérêt à se doter d’une couverture. Mais depuis la promulgation du décret des 28 et 29 germinal an II sur la résidence des nobles, les personnes indésirables (comme les anciens nobles et les ressortissants étrangers) étaient interdites de séjour à Paris, et obligées de vivre dans les villages de la périphérie. Or c’est Barère qui, avec habileté, avait réussi à faire voter le 13 ventôse an II un texte d’après lequel les ressortissants étrangers auraient, eux, le droit de demeurer à Paris[98]. C’est ainsi que plusieurs espions ou agents d’influence à la solde de puissances étrangères, souvent des gens de finances[99], virent s’ouvrir la possibilité pour eux d’infiltrer certaines sphères de la haute administration républicaine. Un certain abbé d’Alençon, ancien noble, qui avait apparemment pour mission de torpiller les projets des petits réseaux royalistes subsistant à Paris, obtint discrètement de Barère une autorisation de séjour à Paris, avec à la clé, une possibilité de décrocher un poste au département de la Marine et des Colonies, un des ministères clés[100].
Pour servir ses tortueux projets, Barère se servit aussi occasionnellement d’une femme, Pierre-Jeanne dite « Sophie » Charpentier, épouse séparée de Demailly, miniaturiste de Catherine II. Barras assure qu’elle servait l’Angleterre et lui vendait les secrets du Comité de salut public que son amant barère mettait à sa disposition.[101]. Robert Launay juge cela « énorme » et ne va pas plus loin, quant à Léo Gershoy, lui-même ancien agent des services secrets de son pays pendant la guerre froide, il élude la question, et consolide l’image de « pureté » et de patriotisme intransigeant de Barère. Les affirmations de Barras sont, en réalité, fondées sur des rapports adressés au Directoire et dont il a eu connaissance, rapports qui, sans détour, constatent que Mme Demailly rencontra plusieurs fois lord Malmesbury à Paris, mais qu’elle alla à sa rencontre lorsqu’il était à Lille en 1797. D’autres sources, qui citent Grace Elliott, ancienne maîtresse du duc d'Orléans et du prince d’Aremberg, ayant comme Mme Demailly une résidence à Meudon, vont dans le même sens[102]. Elle avait eu de brillantes liaisons, entre autres avec le comte de Cesselès et la tragédienne Mademoiselle Raucourt, qui se soldèrent chaque fois par des passages chez le notaire, puis elle vécut rue de Grammont chez le ci-devant marquis de Travanet. Après les premières lois sur les biens nationaux, ce dernier avait été au centre de ce qu’on a appelé la « bande noire » et il fut probablement lui aussi un des correspondants du gouvernement britannique et peut-être un distributeur d’argent aux conventionnels corrompus, tels que Étienne-Jean Panis, qui logeait également chez lui rue de Grammont, ou encore Armand-Joseph Guffroy[103]. Barère fréquenta Mme Demailly au printemps 1793 alors qu’elle dirigeait le tripot de luxe de la « bande noire » à la chancellerie d’Orléans, hôtel construit par De Wailly sur le modèle de l’Erechteion, qu’elle louait depuis sa confiscation à la famille d’Orléans. Visée par la loi des suspects et une dénonciation du robespierriste Héron, elle fut arrêtée et Barère la fit presque aussitôt libérer ainsi que Travanet, mais il garda Mme Demailly comme maîtresse, ainsi qu’en témoigne leur correspondance[104]. Celle-ci joua désormais pour lui, un rôle d’intermédiaire ou porteur de dépêches, un rôle d’espionnage comparable à celui de Demerville[105]. Grâce à Sophie Demailly, le sieur Parisau, directeur de l’hôtel de Londres, relais essentiel du réseau d’espionnage anglais à Paris, quoique dénoncé et arrêté par Héron, fut discrètement libéré à la demande de Barère, et il alla se faire oublier à Meudon[106].
Si les circonstances ne permirent jamais d’élucider sous la Terreur l’implication de Barère dans les complots de l’Angleterre, c’était de notoriété publique. Les langues se délièrent en l’an III quand il fut question de faire son procès: « Si, écrivait Laurent Lecointre, monsieur Barère de Vieuzac, qui a fait semblant de haïr si fort les Anglais pour mieux les servir, a des relations secrètes avec le cabinet de Saint-James - par l’entremise d’un agent des puissances neutres - bien payé pour cela, il est naturel qu’il s’assure des moyens de n’être pas découvert... »[107].
Barère et les dilapidations
L’Angleterre, cela a été maintes fois démontré[réf. nécessaire], ne souhaitait évidemment pas le rétablissement des Bourbons - dont elle sabotait discrètement les malheureuses et hasardeuses entreprises en Vendée ou ailleurs -, mais un démantèlement de la République et une main-mise sur l’ensemble des colonies françaises[108]. Les agents d’influence diligentés par le ministère britannique étaient, à tous niveaux, chargés d’orienter insidieusement ou d’exagérer, au nom du « salut public », la politique du gouvernement dans un sens conforme aux intérêts supérieurs de la Grande-Bretagne. La répression sanglante, les rodomontades et provocations de Barère - sur l’exécution systématique des prisonniers de guerre, mesure qui donne des arguments à William Pitt[109] - aboutissaient à maintenir l’isolement diplomatique tandis que plusieurs États comme la Turquie, la Suède ou les États-Unis, et même l’Espagne, se disaient prêts à établir des relations diplomatiques avec une France réconciliée avec elle-même. La guerre à outrance occasionnait aussi une extraordinaire déperdition d’énergie, d’abord en hommes, mais aussi du point de vue économique. Avec Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Vadier, Amar, Voulland et David, il fut accusé d’actes ou de décisions contraires aux intérêts de l’État. Une dénonciation du 12 fructidor an II, paragraphe 26, leur reprochait à tous, et Barère en particulier, d’avoir protégé ou employé pour le service de la guerre « des hommes reconnus pour contre-révolutionnaires », tels que Beaumarchais, moins connu comme marchand d’armes en affaires avec la coalition; Lanchères, fournisseur de charrois depuis le ministère Narbonne en 1792, et discrètement protégé par Barère et Carnot après son arrestation en 1794[110]; l’ex-abbé d’Espagnac, fournisseur aux armées sous le ministère Dumouriez et qui, malgré les efforts de Barère pour le faire évader, finit guillotiné pour ses marchés frauduleux et ses relations avérées avec les banquier anglais Walter Boyd, William Ker et William Herries[111]; Emmanuel Haller, banquier et marchand d’armes protégé par Voulland. On reprocha à Barère de leur avoir confié, au nom du Comité de salut public, des marchés considérables pour la fourniture des armées de la République, c’est-à-dire des sommes non moins considérables qu’ils ont systématiquement fait passer à l’étranger en fournissant du matériel de qualité médiocre. S’étant saisi de ce dossier en l’an III, Laurent Lecointre attira l’attention de la Convention sur le rôle de Barère : « En vain Barère vous dit que si l’article 26 avait été rédigé à Londres, il en reconnaîtrait les auteurs. Dieu veuille que je me trompe, Barère, mais je crains bien de dire - aussi vrai que du temps de Narbonne - mon opinion sur toi, Barère, qui nous parle si souvent de (William) Pitt, de Georges (III), de Londres, de Cobourg (...) Il faut avoir toute l’effronterie de Barère pour se jouer aussi impudemment de la crédulité de la Convention nationale et du peuple français. Le temps de l’illusion est passé, Barère. »
Dans ces affaires louches, Barère sut apparemment ramasser quelques épingles comme on disait par euphémisme: ainsi, depuis la décisions par la Constituante de supprimer les anciennes charges vénales s’était posée la question de la liquidation de ces charges, ce qui donna lieu à un extraordinaire trafic d’influence et à des pressions constantes sur les membres du Comité de liquidation (les rapports, sur chaque cas, devaient ensuite être validés par l’Assemblée). Il s’agissait évidemment, pour leurs titulaires, de liquider ces charges le plus avantageusement, également pour ceux qui avaient des créances à exercer sur ces charges anciennes (pour certaines, les intérêts des créances couraient depuis près de cinquante ans), et l’on vit des particuliers spéculer sur le rachat et la liquidation de créances qu’ils avaient racheté. En 1794, il restait encore un certain nombre d’offices à être liquidés, et c’était autant qui disparaissait des caisses de l’état (heureusement remplies au fur et à mesure, selon le mot de Barère, « en battant monnaie sur la place de la Révolution », c’est-à-dire grâce à la guillotine et aux confiscations des biens des condamnés). D’après Joachim Vilate[112] qui fut suffisamment proche de Vadier et donc de Barère pour être invité à ses séjours de campagne à Clichy-la-Garenne, celui-ci aurait empoché une somme considérable dans la liquidation de la charge de Pierre-Armand Vallet de Villeneuve. Ce dernier, ancien receveur des domaines, ancien trésorier de la commune de Paris, fut en effet remboursé en nivôse an II de sa charge par décision de la Convention pour un montant de un millions de livres, ce qui était énorme[113]. Il fut aussitôt arrêté mais, pour éviter la guillotine et la spoliation de ses biens, il se suicida en prison[114]; sa veuve, née Suzanne-Madeleine Dupin de Francueil, qui ne voulait pas risquer sa tête, fit alors passer une partie des fonds au nom de Barère et elle en fut quitte pour la peur[115].
Barère et les colonies
Lorsque tout danger parut écarté après la Terreur, de nombreux citoyens vinrent contester la version de faits importants, tels que Barère avait pris l’habitude de les rapporter à la Convention nationale. Certains d’entre eux, revenus des Antilles, assurèrent que l’assemblée avait été trompée sur l’affaire des colonies et les raisons véritables de la prise de Saint-Domingue par les anglais[116]. Barère de Vieuzac fut ainsi rendu responsable d’avoir sciemment « préparé les événements » permettant aux anglais de s’emparer de l’île. Quelques années plus tôt, la Constituante, pressée par les « Amis des Noirs », avait été amenée à débattre de la question de la suppression immédiate de la traite dans les colonies, idée soutenue par une majorité de citoyens généreux, habités par l’idéal de 1789, et par d’autres, plus calculateurs, qui savaient que cette mesure entrainerait infailliblement des troubles graves. Un certain nombre d’observateurs en avaient même déduit que Brissot, par son insistance à abolir la traite immédiatement et non par étapes, faisait secrètement le jeu du gouvernement anglais[117]. Quoiqu’il en soit, la Constituante - dont était Barère de Vieuzac -, n’avait pas suivi les abolitionnistes, et cette décision était surtout motivée par le fait que plusieurs députés influents - constitués en lobby - avaient aux mêmes des propriétés aux colonies et qu’ils ne voulaient pas risquer désordres et pillages. Dans cette perspective, la décision d’abolir l’esclavage en l’an II, ajoutée à la décision par le Comité de salut public de faire arrêter le commissaire des colons de Saint-Domingue et de transmettre son dossier à Fouquier-Tinville, pourraient bien avoir eu pour effet de précipiter en quelques semaines des violences et la prise de l’île par la marine britannique. La question reste posée.
Les deux complots de l’étranger
Barère, qui finissait par se contredire de temps en temps, a été nommé « l’Équivoque » par Robespierre (voir plus haut). Pourtant celui-ci a tardé à réaliser que, malgré les discours enflammés de son collègue sur les complots de l’intérieur - la main ou l’or de Pitt se glissait partout, aux quatre coins de l’hexagone, affirmait-il, et il appelait à la vigilance et aux dénonciations -, ces conspirations étaient chimériques, que ce soit celles dites la conspiration des prisons ou bien celle dite du baron de Batz ou « de l’étranger ». Il n’a pas compris ou trop tard que ces conspirations chimériques pouvaient cacher une vraie conspiration de l’étranger celle-là, visant à affaiblir la France, et dont les rouages secrets étaient au sein même des comités de gouvernement.
Dans son rapport du 4 prairial an II sur les prétendues conspirations du baron de Batz, projets nébuleux qui n’eurent jamais de commencement d’exécution et qui furent promptement baptisés « conspiration ou complot de l’étranger », un rapport ahurissant de fausseté développé et présenté deux semaines plus tard par Elie Lacoste, Barère mit en cause une poignée de royalistes impuissants et sans grands moyens dont les entreprises et les initiatives, si tant est qu’elles eussent existé, avaient apparemment toujours été vouées à l’échec.. C’est ainsi que cinquante-quatre personnes inconnues les unes aux autres, dont certaines étaient, certes, royalistes par leur naissance, mais d’autres nullement politisés ou incarcérées depuis des mois, furent convaincues d’avoir voulu ébranler l’état par leurs machinations criminelles et condamnées à mort, avant même avoir pratiquement pu articuler un mot pour protester. Tous ces gens furent conduits à l’échafaud revêtus de la chemise rouges des assassins et empoisonneurs[118] au prétexte qu’ils étaient complices de la jeune Cécile Renault transformée pour la circonstance en « vierge rouge » et d’Henri Admirat, supposés assassins des « pères du peuple ».
Impuissant à empêcher de nouveaux crimes, les exécutions massives de messidor et thermidor, Robespierre, en minorité depuis des mois sur la plupart les dossiers traités par les Comité de salut public et de sûreté générale réunis, visait Barère et ses complices[réf. insuffisante] lorsqu’il disait :« Vous tuez la République, vous êtes les fidèles agents de l’étranger qui redoute le système de modération qu’il faudrait adopter ». Le vrai complot de l’étranger à ses yeux, se développait depuis des mois au sein de comités gangrenés par l’argent ou la peur et où, à coups de décrets et d’arrêtés, Barère imposait des décisions qui ne favorisaient ni le succès des forces armées ni l’avenir de la République.
Quelques unes des victimes particulières de Barère
Barère a reçu de la famille de Chaudot, notaire rue Plâtrière à Paris, une somme de 90 000 livres pour faire casser par la Convention le jugement condamnant ce notaire à la peine de mort. De fait, Chaudot obtient un sursis à exécution et se croit sauvé. Il est exécuté quelques jours plus tard[119].
- Dupin, Barère et l’affaire des fermiers généraux[120].
Le 22 germinal an II, les comités envoyèrent Malesherbes et sa famille au Tribunal révolutionnaire, avec quelques personnes dont Rosalie Chodkiewicz, d’origine ukrainienne, mariée au prince polonais Alexandre Lubomirski. En 1791, la princesse Lubomirska quitta soudain Paris, où elle résidait, pour soutenir la révolution nationale polonaise, contre les ambitions de la Prusse et de la Russie. Lorsque les choses tournèrent mal pour ses amis politiques, elle organisa la sauvegarde de certains d’entre eux et sauva la vie du sénateur Thadée Mostowski qui, grâce à elle, parvint sain et sauf à Paris où, fin 1792, il reçut les honneurs de la Convention nationale. La princesse « révolutionnaire » fut néanmoins arrêtée et condamnée à mort au prétexte d’une vague correspondance avec la comtesse du Barry et au prétexte de son émigration. C’était une vraie provocation car étant étrangère, son cas ne ressortissait pas des lois françaises. S’étant déclarée enceinte pour gagner du temps – ce qui était inexact –, elle fut transférée à l’hospice du Tribunal, tandis que le gouvernement polonais, plusieurs personnalités et, principalement, le général Kościuszko, alors mondialement reconnu pour ses idées libérales, intervenaient auprès de la Convention pour la sauver. À Paris, l’abbé de La Trémoille, n’écoutant que son courage, proposa de grosses sommes d’argent à Barère qui le fit emprisonner à la Force, tout en empochant l’argent[121]. Dans une ultime tentative, La Trémoille réussit à se faire transférer de la prison de La Force à l’Hospice, toujours à prix d’argent, où il convainquit la princesse Lubomirska de la nécessité d’un rapport sexuel susceptible de provoquer une grossesse. On dit qu’ils furent surpris. Ils furent décapités l’un après l’autre. La mort de la princesse Rosalie, âgée de vingt-trois ans, fut une nouvelle occasion pour Pitt et sa presse de souligner, en direction des États européens, des États-Unis, de la Russie et de la Turquie, le non-respect élémentaire, par la France, du droit des gens et de refuser toute reconnaissance de la République.
Lazare Carnot, « l’organisateur de la victoire », dont la réputation doit beaucoup aux « carmagnoles » de son ami Barère, a, entre autres victimes, fait exécuter le général Alexandre de Beauharnais et le général Victor de Broglie, ancien président de l’Assemblée constituante, pour des motifs toujours inexpliqués puisqu’ils sont morts sans débats publics. Ce dernier ayant reçu son acte d’accusation, sa famille fit dépêcher auprès de Barère une pianiste concertiste, la plus célèbre de son époque, Mme de Montgerould, qui a raconté au baron de Trémont, célèbre collectionneur d’autographes et de témoignages sur le Révolution, qu’étant venue implorer la grâce de Broglie, Barère lui avait répondu : « C’est impossible ».
« Elle lui peignit en pleurant l’injustice et l’horreur de cette mort.
- Avez vous bien dormi, cette nuit ? demanda-t-il d’un ton léger
- Quelle étrange question !
- Eh bien, ce n’est que cela »[122].
Victor de Broglie fut décapité le 22 messidor an II.Jean-François Pérès, conseiller au parlement de Toulouse, fut traduit avec ses collègues au Tribunal révolutionnaire qui, de façon inespérée, reconnut son innocence. Rendu à la liberté par un décret spécial de la Convention, il fut à nouveau décrété d’arrestation à la demande de Barère - qui avait ses raisons -, puis mis à mort sans jugement le 18 messidor an II. Son nom ne figure dans aucune pièce des suppliciés de ce jour. Sans un certificat du bourreau Sanson, en date du 7 frimaire an III qui affirma l’avoir bien exécuté, on pourrait penser que Jean-François Pérès survécut à la Révolution[123]. C’est encore Barère qui fit révoquer les jurés du Tribunal comme étant contre-révolutionnaires: c’est qu’ils avaient osé acquitter un ancien Constituant, Emmanuel Fréteau, que les nouveaux jurés, dans un second jugement, condamnèrent d’une seule voix à être guillotiné.
Une des plus célèbre victimes de Barère est le poète André Chénier, arrêté par hasard à Passy, alors qu’il se rendait chez Mme de Pastoret, son amie. Dans le dossier de police concernant le poète on voit que la police politique avait ordre de mettre la main sur un dossier qu’il possédait et qui présentait un grand intérêt pour Barère ou une puissance désirant nuire à la réputation de probité des conventionnels. En effet, quelques semaines avant la mort de Louis XVI, la cour d’Espagne, par l’intermédiaire de François Cabarrus, père de la future Thérésa Tallien, et des banquiers Le Couteulx à Paris, avait mis à disposition de quelques royalistes désirant sauver Louis XVI, des fonds importants destinés à acheter les consciences parlementaires. Plusieurs députés furent approchés et reçurent de l’argent sans pourtant toutefois voter comme ils s’y étaient engagé. Au centre de ce dispositif, André Chénier, Richer de Sérizy, Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély et la femme du chargé d’affaires espagnol à Paris José Ocariz, née Lucrèce d’Estat. Après la déclaration de guerre avec l’Espagne, Mme Ocariz était recherchée - son frère et sa sœur venaient d’être guillotinés - et elle avait confié ses papiers à Chénier qu’elle accompagnait à Passy quand ils furent arrêtés. Chénier, qui pensait ne rien redouter par la notoriété de son frère, le conventionnel Marie-Joseph, et les précieux documents qu’il possédait, s’était mis en avant, et elle put s’esquiver. Mais après la loi du 22 prairial, Chénier, qui était détenu à la prison Saint-Lazare, réalisa que son dossier, où se trouvait la liste des conventionnels achetés par l’or espagnol, ne le protégeait plus et, sa mort ayant été programmée - pour paraphraser une formule de Barère « les morts ne parlent pas »[124] -, il fut cité à comparaître au Tribunal du 22 prairial. Barère avait des griefs particuliers contre Chénier qui, parlant du « sot fatras » de Barère à la tribune, « gros de pathos et de douleur », avait composé ces vers:
L’un pousse et fait bondir sur les toits, sur les vitres,
Un ballon tout gonflé de vent,
Comme sont les discours de sept cent plats bélîtres
Dont Barère est le plus savant.
Malgré les efforts de son père et de son frère, qui intercédèrent auprès de Barère pour le sauver, le poète fut compris dans la fausse conspiration de Saint-Lazare et il périt décapité le 7 thermidor an II.9 thermidor
Le but de Barère de Vieuzac était d’aboutir à que les partis s’anéantissent mutuellement, à ce que la Convention timorée, littéralement paralysée par la peur, se détruise par elle-même. C’est sur sa motion qu’elle avait rendu contre elle-même, rappelle Camille Desmoulins[125] le décret le plus inconcevable qu’aucun sénat n’ait jamais rendu[126], le décret suicidaire qui permettait qu’un de ses membres investi de la confiance de milliers de citoyens qu’il représente à l’Assemblée nationale[127], fût conduit en prison sans avoir été entendu, sur le simple ordre des deux comités et, ajoutait Camille Desmoulins « d’après cette belle raison qu’on avait point entendu les Brissotins », mis hors débat sur la motion de Barère lui-même. C’est cela que les amis de Danton redoutaient et particulièrement Courtois, Jean-Lambert Tallien, Fréron, Barras et Louis Legendre lui-même particulièrement menacé pour avoir dit, au sujet de l’apparente versatilité de Barère qui avait successivement trahi tous ceux qu’il avait approché: « Le petit Barère se met toujours en croupe de ceux qui sont le mieux montés ».
Trois mois après la mort de Camille Desmoulins, ces remarques sur la dépendance des députés aux comités de gouvernement trouvèrent encore une illustration avec l’arrestation et l’exécution sans procès de Robespierre, Saint-Just et Couthon.
Jusqu’au 9 thermidor Barère joua double jeu[réf. insuffisante] : aux anciens représentants en mission, qui s’étaient rendus coupables de prévarication et de cruauté, il laissait entendre que la vengeance de Robespierre serait terrible; à Robespierre, il cherchait à signifier que ses ennemis, cachés dans l’ombre, complotaient contre lui. Pour inspirer confiance à l’Incorruptible et l’engager à « frapper » un grand coup, il avait prononcé un discours à sa louange le 5 thermidor. Mais il n’en pensait pas un mot[réf. nécessaire] : le but était de laisser croire à l’Incorruptible qu’il pourrait dégager une majorité au Comité de salut public pour abattre Fouché et ceux qui complotaient avec lui[128]. On[Qui ?] dit que, n’étant pas absolument sûr de la tournure que prendraient ces événements, Barère avait préparé deux discours, l’un en faveur de Robespierre et de ses amis, l’autre destiné à voler au secours des députés qui seraient parvenus à terrasser le « monstre ».
Apparemment, Robespierre n’avait pas suffisamment prêté attention à certaines mises en garde anonymes qui parvenaient jusqu’à lui: « Je crois que tant que Barère et ses complices existeront, écrivait un de ces anonymes à Robespierre peu avant le 9 thermidor, les patriotes, les sociétés populaires, les Jacobins et toi le premier, Robespierre, ne serez point hors de danger. Il viendra un temps où, à défaut d’autres moyens, on te fera assassiner »[129]. Comme on pouvait s’y attendre, Barère, qui ne laissait rien soupçonner de ses intentions, se dévoila soudain et se retourna activement[réf. insuffisante] contre Robespierre, Couthon et Saint-Just, et il participa activement à la curée, avec une idée en tête, poursuivre la Terreur et contrôler au plus près les lettres ou documents qui, tant dans les comités qu’au domicile des condamnés pourraient ultérieurement lui nuire. Cette obsession du contrôle des archives et la tentation qu’il avait de revisiter sans cesse son propre passé - Antoine Dufourny fut exécuté pour avoir osé rappeler que Barère avait autrefois présidé le club des Feuillants -, l’amena assez vite à se servir de ses propres dossiers pour en faire endosser la responsabilité à Robespierre abattu. Une des premières entreprises du genre est en rapport avec un ancien membre du parlement d’Angleterre qui faisait office d’agent de renseignement pour son gouvernement. Malheureusement pour lui, il avait été arrêté. Barère et Carnot, prévenus, l’avaient discrètement fait sortir de la prison des Carmes le 30 messidor an II, et ils lui avaient octroyé un passeport pour s’enfuir à Bâle, en compagnie d’un autre espion, John Hurford Stone[130]. Ils parvinrent ainsi à gagner la Suisse peu avant le 9 thermidor. Quand Robespierre fut terrassé, Barère exhuma soi-disant dans les papiers de l’Incorruptible une lettre que Benjamin Vaughan « espion anglais en Suisse » lui avait adressée, manière d’insinuer une possible trahison auprès de ceux qui étaient disposés à le croire. Cette manipulation est la première d’une dizaine d’autres du même genre, qui, grâce à la saisie d’archives au domicile des condamnés du 10 thermidor, permirent d’accabler la mémoire de l’Incorruptible et de ses amis, tout en éloignant les soupçons susceptibles de peser sur les véritables protecteurs d’espions anglais[131].
Il est admis que, si plusieurs de ceux qui élevèrent les échafauds au prétexte de la guerre les abattirent au lendemain du 9 thermidor, alors que la guerre continuait, ce ne fut nullement par amour de l’humanité, mais par nécessité stratégique et méfiance des uns vis à vis des autres. Barère est le seul à avoir défendu jusqu’au bout, bec et ongles, le Tribunal révolutionnaire dans sa version du 22 prairial avec, comme changements consentis par lui, de remplacer ceux des jurés qui passaient pour avoir été dévoués à Robespierre. Il accusa d’ailleurs au passage celui-ci et Saint-Just d’avoir cherché à « entraver » le Tribunal du 22 prairial. À cette séance du 10 août 1794, Cambacérès appuyait Barère dans son projet lorsqu’un député demanda la destitution de Fouquier-Tinville, contre l’avis de Barère, ce qui fut accordé. Un peu plus tard, un décret fut présenté par quelques députés dont « l’âme s’était ouverte aux regrets »: il prévoyait de limiter les attributions des comités de salut public et de sûreté générale. Là encore, Barère, député inamovile du Comité de salut public depuis sa création[132] s’y opposa de toutes ses forces, mais en vain. ce jour là, un grand pas fut fait et la démocratie respira. Le Comité de salut public a été renouvelé ou pour mieux dire prorogé quatorze fois depuis sa création le 6 avril 1793 jusqu’au 12 thermidor ou 30 juillet 1794, c’est-à-dire quatre jours après la chute de Robespierre. Barère y a siégé dix-sept mois, Carnot quatorze mois. Les renouvellements étaient devenus illusoires parce qu’ils consistaient ordinairement dans la réélection ou la prorogation des mêmes membres. Barère avait d’ailleurs dit : « le grand motif de sa création est la nécessité reconnue d’écraser les aristocrates. Ce comité doit donc être renouvelé rarement afin que ceux qui ont fait les premières informations puissent les continuer: experto crede Roberto ».
Le Directoire
Arrêté en même temps que Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, du Comité de salut public, et Vadier, président du Comité de sûreté générale, Barère fut dénoncé par Lecointre de Versailles, Fréron, Audouin, Châles, Massigeon de Nantes, Courtois et beaucoup d’autres conventionnels, fonctionnaires, gens de plume, souvent par d’anciens amis de Danton qui lui reprochaient sa mort et celle de Desmoulins[133]. Ces accusations presque toujours fondées sur des pièces issues des anciens comités, notamment les arrêtés dirigés contre des individus et revêtus de sa signature, furent publiées dans les semaines précédant le procès qui devait se tenir en germinal an III. Barère rechercha des défenseurs et prit Le Doulcet de Pontécoulant comme avocat. Mais son affaire se présentait mal.
Des émeutes ayant, par chance pour lui, éclaté à Paris, la Convention en tira prétexte pour se dispenser de la publicité d’un procès susceptible d’attiser les passions, mais surtout de la discréditer un peu plus, puisqu’elle avait validé, dans la peur certes, la plupart des décrets liberticides. Les Parisiens disaient que « la Convention se faisait reconnaître coupable en ne jugeant pas définitivement les citoyens Barère, Collot et Billaud, et qu’elle craignait des éclaircissements qu’ils pourraient donner sur leurs complices »[134]. De fait, on préféra un décret de déportation qui fut voté à la sauvette, dans la nuit du 12 au 13 germinal an III, avec la volonté manifeste d’éloigner le plus vite possible les membres gênants des anciens comités qui furent donc condamnés à la déportation en Guyane (la « guillotine sèche »). Les Parisiens furent mécontents, et lorsque Barère, libre jusqu’alors, fut arrêté chez lui rue Saint-Honoré, il manqua d’être lynché par la foule en colère et ne dut son salut qu’à la troupe conduite par Raffet. Plus tard, le cortège eut beaucoup de mal à sortir de Paris et la voiture où se trouvaient Billaud et Barère ne purent sortir des barrières que grâce à une grande escorte de soldats.
Avec ses collègues - à l’exception de Vadier qui s’était bien caché -, les condamnés furent placés dans les prisons d’Oléron en attendant d’embarquer. Mais après l’insurrection du 1er prairial an III à la Convention[135], dont un des motifs avait à voir avec l’indulgence de la Convention pour les terroristes, la Convention fut contrainte de faire rapporter son décret et d’ordonner que les prisonniers seraient traduits devant le Tribunal criminel de la Charente inférieure. Mais quand ce décret arriva, Collot d’Herbois et Billaud-Varenne étaient déjà en route pour la Guyane. Ce départ fit ajourner la procédure et, par la même occasion, sauva Barère qui fut transféré à Saintes.
En vendémiaire an IV, le décret ordonnant sa traduction devant le Tribunal criminel de la Charente inférieure fut annulé par le Directoire, mais sa déportation fut maintenue et ordre fut donné de le transférer à Rochefort en vue de son embarquement pour Madagascar[136]. On allait mettre cette mesure à exécution lorsqu’il s’échappa des prisons de Saintes où il avait été conduit. Barère se cacha à Bordeaux, puis compta sur ses protections à Paris pour tenter, en germinal an V, un retour en politique. Grâce à ses appuis locaux il obtint sans mal un siège de député des hautes Pyrénées, il demanda un passeport pour Paris[137]. mais les deux chambres invalidèrent cette élection le 1er prairial. Dès lors Barère se consacra à ses affaires privées - la gestion de ses domaines et sa fabrique de l’île Louviers -, vivant agréablement chez la comtesse de Guibert son amie qui se partageait entre son hôtel particulier de la rue de Ménars et son château d’Epône.
Grâce à l’appui de son vieil ami Fouché qui ne l’avait pas abandonné, Barère obtint d’être compris dans la liste des anciens Jacobins amnistiés par le coup d'État du 18 brumaire, rendu possible par une coalition d’anciens constituants comme Regnaud de Saint-Jean d’Angély, et de conventionnels comme Siéyès. Mais il fut refusé par le Sénat comme candidat au corps législatif. Il offrit en désepoir de cause ses services à Napoléon Bonaparte qui le chargea de la rédaction d’un bulletin hebdomadaire sur l’état d’esprit de l’opinion publique. Il fut rapidement remercié par Napoléon qui disait de son style: « Beaucoup de rhétorique, peu de fond, des coglionerie enveloppées dans de grands mots » et il lui fit donner congé par Duroc comme à un domestique inutile [138]. Il vécut oublié sous l’Empire, retiré à Epône dans le château de son amie la comtesse de Guibert.
Pendant les Cent-Jours, il fut membre de la Chambre des représentants.
La Restauration
À la Restauration, il fut exilé par les Bourbons comme régicide. Compris dans l’article 2 de l’ordonnance du 24 juillet 1815, il obtint de Fouché, son ami de toujours, un passeport pour la Prusse. Arrivé aux Pays-Bas, il demanda un visa pour Londres. Il fut autorisé à se rendre en Angleterre, à la condition qu’il ne porte pas son nom véritable (son passeport fut établi au nom de « Roquefeuil »). À Londres, le comte Mulgrave (futur lord Normanby)[139], s’intéressa pour lui auprès des lords Sidmouth et Castlereagh: « Ces seigneuries répondirent que Barère pouvait rester à Londres où nul mal ne lui arriverait quand bien même il viendrait à être reconnu ». Pour éviter la confiscation de tous ses biens immobiliers formant une grande fortune, sans compter ce qu’il avait accumulé à l’étranger - au moins sept millions placés en Italie et au Danemark, selon le comte de Montgaillard, son compatriote[140] -, ses parents « s’occupèrent avec assez d’activité de vendre partie des propriétés qu’il avait dans le département des Hautes Pyrénées ». Il avait toujours son frère Jean-Pierre Barère, conseiller de préfecture, son cousin germain Jacques, vice-président du Tribunal de Tarbes qui récupérèrent avantageusement, par l’intermédiaire du notaire Frech, une partie de ces biens. La famille Barère, devint ainsi, selon les travaux de l’historien David Higgs, l’une des plus imposée du département. Quant à Barère, l’année suivante, il ne possédait plus localement, en biens immeubles, qu’une fortune évaluée à 4 000 livres de revenus. Il avait possédé d’autres biens considérables, notamment en Île-de-France : une fabrique et les terrains de l’île Louviers, à Paris (le bras de Seine a été depuis comblé et rattaché au quartier de l’Arsenal), et une propriété d’une dizaine d’hectares à Meudon, provenant du domaine royal, rachetée le 24 prairial an XI à sa maîtresse, Sophie Demailly, sous son prête-nom habituel (« Jean Focquier, rue Le Pelletier »). Montgaillard assure l’avoir entendu dire avoir placé d’autres fonds en Italie et au Danemark[141].
Revenu en France après le départ de Charles X, il réussit à se faire nommer député sous le gouvernement de juillet, puis il finit ses jours président du conseil de son département. Il mourut à Tarbes le 13 juillet 1841 plus qu’octogénaire après avoir écrit, avec l’aide de Carnot, des « Mémoires » sujets à caution - souvent en contradiction avec ce qu’on trouve dans « le Moniteur » - dans lesquels il a abondamment revisité son propre passé et entièrement réinterprété l’histoire de Robespierre sous la Terreur.
Papiers
En homme d’expérience, Bertrand Barère prit toujours grand soin de contrôler les traces écrites de ses actions politiques et privées.
Les papiers des comités révolutionnaires de l’an II ont été considérablement expurgés après le 9-Thermidor, notamment les papiers des comités de salut public et de sûreté générale. Beaucoup de pièces ont été enlevées, d’autres falsifiées (sur quelques ordres d’arrestation, la signature de Robespierre a parfois été rajoutée quand elle ne s’y trouvait pas à l’origine).
Pour ce qui le concerne, Barère avait récupéré un certain nombre de ces archives qu’il conservait précieusement chez lui rue Saint-Honoré, au domicile du banquier Savalette de Lange, son ami, qui eut la haute main sur la Trésorerie nationale au début du Directoire. Lorsque Barère fut arrêté, une partie de ses papiers furent saisis et examinés. Mais, par suite de diverses manœuvres, il n’y eut pas de procès, mais un décret de déportation.
Ayant d’abord échappé à la déportation, Barère, qui, grâce à des complicités monnayées, avait pu ensuite s’évader de sa prison, attendit le moment où Joseph Fouché serait à nouveau au ministère pour recevoir l’autorisation de reprendre une pleine malle de papiers saisis chez lui et notamment les pièces qui devaient servir à rédiger une accusation contre lui[142].
Ni Robert Launay ni Léo Gershoy, les deux biographes de Barère, ni les quelques personnes qui ont publié des articles sur lui dans les revues d'histoire, n’ont eu accès à ces papiers que l’on a cru être les mêmes que ceux laissés par l’ancien député à Tarbes. Or une lettre de Barère à David d’Angers, autrefois publiée dans l'Intermédiaire (N° 529) en dit ceci: « J’ai reçu votre lettre signée David et Carnot, par laquelle vous acceptez mes propositions de vente de mes manuscrits politiques. Mais je vous aurais déjà envoyé le sous-seing, si mon conseil jurisconsulte ne m’avait fait observer que l’acte serait déclaré avoir été signé à Tarbes, tandis que les deux acquéreurs habitent et sont resté à Paris. Je n’ai pas cru devoir accepter l’idée d’une procuration de vous deux envoyée à Tarbes, pour stipuler pour vous la vente, parce qu’il m’importe d’ôter aux Tarbiens litigieux et envieux toute connaissance de mes affaires et volontés, ainsi que leur dérober toute trace de mes papiers, à eux ainsi qu’à tous autres. Vous me comprendrez (..) Je n’ai pas parlé de mon projet de vente de mes manuscrits à vous et à M. Carnot, parce que cela s’ébruiterait dans le pays et que les gens de cette ville sont avides et prétentieux ».
Dans une autre lettre datée du 7 juin 1838 au même, il désire que personne ne sache la vérité sur ceux de ses manuscrits et autographes qu’il a vendus à Hippolyte Carnot. Ce qui reste de ces papiers de première importance pour réaliser une biographie de Barère digne de ce nom, forme un ensemble remarquable sur la Révolution, la Terreur et le Directoire. Quelques unes des pièces ont été utilisées par Hippolyte Carnot dans son essai historique sur Barère (1842) où le but avoué est de laver son père de tous soupçons sur sa participation aux crimes des comités. Quoiqu’il en soit, sur celles des pièces numérotées qui devaient servir à nourrir, en l’an III, une accusation contre Barère, les pièces 5, 6, 9 à 14, 16, 18, 20-23, 25-27 ont disparu. Les pièces existantes, les « notes de la main de Barère », divers extraits et articles de presse de 1789 à 1845 forment une remarquable documentation. Ces documents ont en partie été exploités par Olivier Blanc dans ses travaux publiés entre 1989 et 1995.
Mémoires de Barère
Rédigés par Bertrand Barère et légèrement reprise par Hippolyte Carnot[143] qui a entrepris une révision « profonde » de l’histoire du « grand » Comité de salut public auquel appartenait son père condamné à la déportation en fructidor an V avec les « amis de l’Angleterre ».
L’éditeur, M. Jules Labitte, reconnaît (I, p.216) les « nombreuses erreurs de détail » de cette édition (1842), qu’il ne relève pas systématiquement « pour ne pas fatiguer l’attention du lecteur ».
Lord Macaulay est le premier (1844) à avoir commencé à relever les plus grosses « erreurs de détail » sur Marie-Antoinette, les Girondins, etc. Il justifie chacune de ses remarques et donne les références exactes aux documents officiels qu’il a consultés, ainsi le Moniteur qu’il a dépouillé avec soin. Comme Jules Michelet, Louis Blanc et d’autres historiens du XIXe siècle à qui on ne songe pas à en faire reproche, il ne cache pas son indignation contre le personnage - qui est d’ailleurs son quasi contemporain - et ses procédés, qu’il dénonce.
Historiographie
Il est intéressant de s’attarder sur les études qui ont pu être menées sur Bertrand Barère, c’est-à-dire le sort que lui a réservé l’historiographie, puis sur les recherches concernant l’influence de l’Antiquité sur la Révolution française. Cela dans le but de mettre en perspective ces deux sujets.
Bertrand Barère compte parmi les membres influents du personnel dirigeant de la Révolution française. En cela, il n’a pas laissé les historiens et les commentateurs indifférents ; la polémique se développant de son vivant même: il a été véritablement ostracisé par la société française à partir de 1795, ne parvenant jamais à effacer la réputation effrayante qu'il s'était acquise.
Aujourd’hui encore, les notices bibliographiques et les passages d’ouvrages qui lui sont consacrés restent prudents sur la personnalité de l’individu. À l’inverse de Robespierre ou de Danton, aucune personne ou groupe de personnes ne s’est jamais réclamé d’une filiation politique ou idéologique avec Bertrand Barère, il ne semble pas qu’il existe des « Barèrist »[144], selon l’expression de Leo Gershoy.
Il y a là un point que l’on retrouve fréquemment au sujet de sa personnalité. Il est généralement décrit comme un homme intelligent, cultivé et bon technicien de la politique, doué d’une très grande capacité de travail: « À la suite d’un résumé rapide et lumineux il posait nettement la question et nous n’avions plus qu’un mot à dire pour la résoudre. »[145], comme le dit Carnot, ou encore Robespierre en juillet 1793 : « Barère sait tout, connaît tout, est propre à tout »[146]. Mais on relève sa tendance à suivre la conjoncture politique au gré des mouvements et des renversements qui peuvent avoir lieu. Ainsi Robespierre, à une époque où il avait encore beaucoup d'illusions sur son collègue au Comité de salut public : « Je déclare que j’ai vu dans Barère un homme faible, mais jamais l’ennemi du bien public. […] Je le vis toujours au Comité s’occupant avec ardeur des intérêts de la patrie, cherchant, saisissant tous les moyens qui pouvait conduire au grand but de la rendre heureuse, et depuis que Barère est éclairé sur les crimes d’une faction, dont il n’avait pas d’abord conçu toute la scélératesse, il a trouvé l’occasion de témoigner combien il abhorrait leurs principes ; … »[147].
La « faction », dont il est question ici, est celle des Girondins, qui furent évincés par une autre « faction », minoritaire à la Convention mais soutenue par certains membres des Jacobins et les « Exagérés » de la Commune de Paris qui, en mai 1793, avaient pris la Convention en otage et permis le coup d'État entraînant la proscription et l'arrestation, en deux fois, de plus de cent députés « girondins ».
Ses hésitations politiques ont été remarquées par plusieurs auteurs tels que l’historien américain H. Morse Stephens, qui affirme qu’à l’exception de Marat, aucun homme de la Révolution n’a été si durement jugé: « no prominent statesman, except perhaps Marat, has been so persistently vilified and deliberately misunderstood as Barère »[148].
L'historien britannique Macaulay Thomas Babington, dans son ouvrage biographique sur Bertrand Barère, dans lequel il s'appuie sur des sources connues (le Moniteur), a expliqué la réputation de terroriste sanguinaire que Barère traîna toute sa vie[149] :
« Our opinion then is this, that Barère approached nearer than any person mentioned in history or fiction, whether man or devil, to the idea of consummate depravity. In him the qualities which are the proper objects of hatred and the qualities which are the proper object of contempt, preserve an exquisite and absolute harmony. […] But when we put everything together, sensuality, barbarity, poltroonery, baseness, effrontery, the result is something to which, we venture to say, parallel can’t be found in history. »
Mais cette damnatio memoriae à laquelle Bertrand Barère a été condamné a trouvé ses limites grâce à l’historien américain Leo Gershoy, qui a critiqué Macaulay en ces termes: « His terrible judgement has been quoted in the preface. The vindictive boast with which he terminated his demolition is also worthy of note, not for his acumen of charity but for the accuracy of his prediction. »[150]
Parmi les derniers biographes de Barère, on peut signaler Robert Launay qui a signé une biographie de Bertrand Barère[151] en 1929. Bernard Gainot n’hésite pas à qualifier cet ouvrage de : « très hostile, développe sans recul la légende noire »[152]. Malgré tout, bien que relativement ancien, l'ouvrage de Launay a le mérite de soulever des questions sur le rôle et l’attitude de Bertrand Barère au moment du 9 thermidor an II. S’agit-il de passivité ou au contraire d’une véritable prise de position de Bertrand Barère dans la chute des robespierristes ? Les divisions profondes au sein du Comité de salut public qui se firent jour après la mort de Danton permettent de penser que Barère a été logique avec sa ligne de conduite concernant Robespierre et ses amis, dont il était éloigné.
les historiens issus de la Société des Études robespierristes ont, à l'époque de la Guerre froide, trouvé un auteur américain qui a cherché à réévaluer le rôle de Bertrand Barère, faisant preuve d'une plus grande clémence à son égard.
Ainsi la biographie que Léo Gershoy a consacré à Bertrand Barère reste intéressante, même si l'auteur n'a pas eu accès aux archives laissées par Barère, aujourd'hui conservées dans une collection privée, et il a ainsi été privé d'un éclairage essentiel sur le personnage. Son ouvrage, qui néglige la deuxième partie de la vie de Barère, se concentre sur sa carrière politique de 1789 à 1795. C’est à la période de député des Hautes-Pyrénées à la Convention nationale que Leo Gershoy attache le plus d’importance, même si cela ne suffit pas. La période qui s’écoule de janvier 1793 à juillet 1794 (un an et demi) occupe les chapitres huit à treize, soit six chapitres (113 pages). Son exil de 15 ans en Belgique durant la Restauration n’occupe que 20 pages ! C’est donc le Bertrand Barère conventionnel et membre du grand Comité du Salut Public qui attire l’attention de l’auteur.
C’est aussi un ouvrage qui tente une réhabilitation relativement prudente du député des Hautes-Pyrénées et qui cerne les ambiguïtés du personnage : « He was too much a Montagnard for the Girondins ; for rabid Jacobins he was too lukewarm »[153]. La biographie en français la plus récente, sortie à l’occasion du bicentenaire de 1989, est celle de Jean-Pierre Thomas[154] qui, sans pour autant être marginale, n’est pas la plus complète sur Bertrand Barère. Elle comporte quelques imprécisions concernant la localisation des citations et des sources. Cependant, cet ouvrage a le mérite de faire le point sur quelques aspects déjà connus de la vie de Bertrand Barère. Le personnage de Bertrand Barère peut donc être maintenant abordé de manière apaisée.
Peut-être même de manière trop apaisée. En effet, à l’occasion des 250 ans de sa naissance, a été organisée par les archives municipales une exposition à son sujet. À l’issue de cette exposition a été édité un catalogue, celui-ci est sobrement intitulé Bertrand Barère, un parcours [155]. Le titre en lui-même illustre bien que l’on cherche à évacuer, voire à gommer tous les aspects polémiques du personnage. Dans cet ouvrage, la partie consacrée à la période révolutionnaire (1789-1799) n’excède pas trois pages ! Il en va de même pour le chapitre consacré à sa proscription de 15 ans en Belgique. En revanche son action comme créateur du département des Hautes-Pyrénées est largement valorisée, avec plus de 14 pages. Il faut donc y voir la marque d’un ouvrage à forte coloration locale.
Mis à part cette manifestation, Bertrand Barère n’a laissé que peu de postérité dans son département. Il ne reste de lui que le nom d’une avenue, sans précision de ses fonctions passées et une plaque à la façade de sa maison natale, sur laquelle il est uniquement signalé comme créateur du département des Hautes-Pyrénées. On peut également signaler que, quelques pas plus loin, la statue d’un révolutionnaire célèbre s’élève place de la mairie, il s’agit de… Danton, victime de Barère en germinal an II. Suprême paradoxe quand on connaît la forte animosité qui existe entre les deux personnages. Un autre ouvrage local sur Bertrand Barère fut écrit à l’occasion du bicentenaire de 1789, mais d’un style bien différent du précédent, puisqu’il s’agit d’une pièce de théâtre[156]. Même si hésitations et revirements de Bertrand Barère sont illustrés, l’ensemble lui reste favorable ainsi qu’à Robespierre et Saint-Just.
Il est également utile de relever les travaux les plus récents qui font référence à Bertrand Barère, notamment ceux de Pierre Serna. Il analyse la formation du Centre dans la vie politique. Celui-ci demeure très réactif aux extrêmes, notamment par le rejet des factions et la défense de la République. C’est ce que ce chercheur baptise du néologisme d’« extrême-centre », une expression qui conserve malgré tout toute son obscurité. Selon lui, Bertrand Barère est un cas d’école de ce « Centre » introuvable, il en est l’un des représentants les plus éminents[157]. C’est dans son ouvrage La République des girouettes[158], que Pierre Serna développe son jugement sur Bertrand Barère.
« En soulignant le pire danger de la Révolution, transformée en Terreur, dirigée par des hommes flexibles à toute forme de pouvoir, indifférents à toute espèce d’idéologie, ces « immobiles » qui suivent « l’impulsion du gouvernement du des plus forts », ces techniciens de la guillotine, ces bureaucrates de la Terreur, ces créatures du centre dont Barère est le plus représentatif, ces alliés objectifs de Robespierre, le « vieux » Cordelier [Camille Desmoulins] sait-il qu’il vient de signer son arrêt de mort ? »[159]
À noter que l’on retrouve encore ici la vision de Macaulay ou de Launay d’un Barère opportuniste, sans idéologie et envoyant sans sourciller ses adversaires politiques à la guillotine. En exhumant les papiers Barère, légués par l'intéressés à Hippolyte Carnot, Olivier Blanc, dans trois ouvrages publiés entre 1989 et 1995, renouvelle entièrement les points de vue anciens et pointe les aspects biographiques méconnus ou volontairement délaissés par Léo Gershoy, qui n'a pas eu accès aux archives de Lazare et Hippolyte Carnot. Grâce aux Archives des notaires parisiens et surtout aux papiers Barère conservés depuis le milieu du XIXe siècle, il a découvert les pièces accusatrices que Barère avait saisies de son propre chef, avec l'accord de Joseph Fouché qui a signé une décharge, dans les dépôts de la police et de la justice. Barère a ainsi fait main basse sur les documents qui, en l'an III, devaient servir à son procès et, à la suite d'artifices de procédure, évité des débats redoutés. Or Macaulay, Launay et Gershoy ne connaissaient pas ces documents pas plus que les quelques auteurs d'articles récents. Olivier Blanc a aussi pu mettre en lumière sa posture protéiforme dans divers aspects de son action politique au sein des comités. Barère, qui avait la haute main sur la diplomatie républicaine, sur ses fonds immenses et sur le recrutement de ses agents, fut souvent en contradiction avec son discours - celui adressé à la Convention (cf. les « carmagnoles », un mot fabriqué à son intention) - et la stratégie qu'il prétendait imposer. Son attitude en matière diplomatique et son opposition frontale à Robespierre sur la question essentielle de la poursuite de la guerre au cœur de l'hiver 1793-94 ne laissent pas d'interroger sur la justesse de la qualification d'imposteur dont Pierre Vergniaud le qualifiait en août 1793, et du surnom de « Janus aux trois visages » que Camille Desmoulins, décillé sur son compte, lui appliquait dans un de ses derniers numéros du Vieux Cordelier. Olivier Blanc a enfin montré, preuves à l'appui, que Bertrand Barère, qui réussit à faire illusion auprès de Robespierre, s'est considérablement enrichi pendant la Révolution. Les biens nationaux qu'il acquit dans sa province et dans l'île Louviers, au centre de paris, les fonds qu'il avait placés en Grande-Bretagne - qu'il chercha à récupérer au début de la Restauration - modifient très profondément le regard « sentimental » que certains auteurs posent encore sur l'Anacréon de la guillotine[160].
Rapports
Dans un rapport fait à la Convention nationale, au nom du Comité de Salut public, il se prononça sur « l’éducation révolutionnaire, républicaine & militaire ».
Contre les langues autres que le français Le 27 janvier 1794 (8 pluviôse an II), il avait déclaré dans un discours que « le Français deviendra la langue universelle, étant la langue des peuples ».
« Parmi les idiomes anciens, welches, gascons, celtiques, wisigoths, phocéens ou orientaux, {..} nous avons observé que l’idiome appelé bas-breton, l’idiome basque, les langues allemande et italienne ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination des prêtres, des nobles et des patriciens, empêché la révolution de pénétrer dans neuf départements importants, et peuvent favoriser les ennemis de la France.
Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l’émigration et la haine de la République parlent allemand; la contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreur.
Tandis que les peuples étrangers apprennent sur tout le globe la langue française [...] on dirait qu’il existe en France six cent mille français qui ignorent absolument la langue de leur nation [...] il n’appartient qu’à elle [la langue française] de devenir universelle »
Le despotisme maintenait la variété des idiomes.
D’ailleurs combien de dépenses n’avons nous pas faites pour la traduction des lois des deux premières assemblées nationales dans les divers idiomes parlés en France! Comme si c’était à nous à maintenir ces jargons barbares et ces idiomes grossiers qui ne peuvent servir que les fanatiques et les contre-révolutionnaires !
Laisser les citoyens dans l’ignorance de la langue nationale, c’est trahir la patrie ; c’est laisser le torrent des lumières empoisonné ou obstrué dans son cour; c’est méconnaître les bienfaits de l’imprimerie, car chaque imprimeur est un instituteur public de langue et de législation.
Citoyens, la langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous.
[...].
Précédé par Bertrand Barère de Vieuzac Suivi par Henri Grégoire Président de la Convention 13-27 décembre 1792 Jacques Defermon Publications
Outre plusieurs écrits politiques et de nombreux Discours, Barère est l’auteur de plusieurs écrits littéraires, parmi lesquels des Éloges de Louis XII, de l'Hôpital, de Montesquieu, de Jean-Jacques Rousseau, les Beautés poétiques des Nuits d’Young et les Veillées du Tasse. Ses Mémoires ont été publiés par Lazare Hippolyte Carnot, auteur d’une notice historique, et David d'Angers en 1834.
Sources
Notes et références
- ↑ Le Vieux Cordelier, n° 7 (l’an II).
- ↑ Lombard de Langres, Des jacobins, Paris, 1823, p. 90.
- ↑ (en) Ghita Stanhope and George Peabody Gooch, The Life of Charles, Third Earl Stanhope, 1914, p. 134. Charles Stanhope, qui se présentait comme un ami de la France révolutionnaire, avait épousé Louisa Grenville, fille de sir Henry Grenville, le diplomate.
- ↑ Dans L'Express du 7 juillet 1989, François Furet écrivait : « Dans cette sagesse fin de siècle, Robespierre n’a pas vraiment été réintégré dans la démocratie française. Le droite veille sur cet ostracisme en brandissant les mauvais souvenirs. Mais l’Incorruptible a plus à craindre de ses amis que de ses ennemis. En l’embrassant trop étroitement, l’historiographie communiste l’a entraîné dans un redoublement de désaffection ».
- ↑ Pages mélancoliques, 1797.
- ↑ AN, MC, Et. Gondouin, le 10/3/1783 ; Et. Moreau, le 19 février 1793, etc.; BN, Ms. fichier Charavay (Barère, quittances de 1777 et 1793).
- ↑ AN, MC, Et. XXVII/489.
- ↑ Révolution française, tome XL, 1901, p. 234-270.
- ↑ R. Launay, « le mariage de Barère », le Correspondant, 1929, tome I, p. 737-752.
- ↑ Voir Le Temps du 28 août 1829.
- ↑ Selon Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) pour le 250e anniversaire de sa naissance, Société des études robespierristes, 1963, 208 pages, p. 72, « Barère passe rapidement sur la querelle entre Voltaire et Pompignan », rendant « un hommage dithyrambique au poète ».
- ↑ Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, Société Jean-Jacques Rousseau, Genève, A. Jullien., 1965, vol. 36 (1963-1965), p. 350.
- ↑ Jean-Pierre Thomas, Bertrand Barère: la voix de la Révolution, Éditions Desjonquères, 1989, 343 pages, p. 44.
- ↑ Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) pour le 250e anniversaire de sa naissance, Société des études robespierristes, 1963, 208 pages.
- ↑ Shojiro Kuwase, Les confessions de Jean-Jacques Rousseau en France, 1770-1794: les aménagements et les censures, les usages, les appropriations de l'ouvrage, Champion, 2003, 328 pages, p. 171 (ISBN 2745307509).
- ↑ David Higgs, dans sa thèse, a très bien vu que Barère, tout comme son ami Mailhe, désirait partager les privilèges de la noblesse plutôt que de défendre les principes nouveaux, p. 18.
- ↑ Papiers Carnot.
- ↑ Morning Herald du 3 septembre 1793.
- ↑ C’est à l’influence de ce prince qu’il obtint d’intégrer la cour de cassation.
- ↑ Papiers Carnot, Acte sous seing privé enregistré par le notaire Rouen le 28 juin 1791.
- ↑ Avec Merlin de Douai et Clarke, futur duc de Feltre.
- ↑ Lorsque les comédiens français se chargèrent de monter la pièce « Paméla », de François de Neufchateau, en 1793, Barère y vit une allusion menaçante, et il fit aussitôt envoyer les comédiens français en prison : voyant qu’ils n’étaient toujours pas guillotinés comme prévu en messidor an II, il lancera contre eux une nouvelle accusation dans son discours du 5 thermidor.
- ↑ Le 9 juillet suivant, un décret taxa à triple imposition les émigrés non rentrés avant deux mois : « À l’époque où un citoyen prend ce nom d’émigrant, dit alors Barère, il perd celui de citoyen ».
- ↑ Garat devait son assension politique à la protection de Jean-Joseph de Laborde, ancien trésorier royal et l’une des premières fortunes de France, formant une sorte de parallèle avec l’association Barère/Savalette.
- ↑ New-York, Cornell University Library, et Paris, AN, F7/4386.
- ↑ À qui il évitera la peine de mort sous la Terreur.
- ↑ Voir le Moniteur, tome XIV, pp.639-640, 645 et 678, et Bertrand de Molleville, Mémoires, vol. X.
- ↑ Célèbre pour avoir confié le gigantesque marché des transports militaires et des armes à des entrepreneurs acquis à la contre-révolution monarchique comme Lanchères ou Beaumarchais.
- ↑ La phrase complète de Thomas Jefferson : « L’arbre de la liberté doit être arrosé de temps en temps avec le sang des patriotes et des tyrans. C’est son engrais naturel. »
- ↑ Voir Buchez et Roux, Histoire parlementaire, XXVII, 130-132.
- ↑ Voir les décrets des 25 mars, 6 avril, 4 mai et 10 octobre 1793 sur les attributions exorbitantes du Comité de salut public qui furent balayées par décret du 24 août 1794.
- ↑ Voir plus bas « Papiers de Barère »; voir aussi d’Allonville, Mémoires secrets, III et, sur les falsifications, O. Blanc, Mélanges Michel Vovelle, Paris, 1997; La corruption sous la Terreur, biblio, p.211.
- ↑ Histoire de la Révolution française.
- ↑ Général Gourgaud, p...; comtesse de Bohm, mémoires, p.
- ↑ C'est grâce à Robespierre en revanche, selon les informations qu'avait recueillies lord Grenville, que Madame Elisabeth ne suivit pas immédiatement sa belle-soeur sur l'échafaud. Son exécution n'eut lieu qu'en mai à un moment où Robespierre n'avait plus de moyens d'opposition au sein du Comité de salut public.
- ↑ Vergniaud député du département de la Gironde à Barère et à Robert Lindet, membres du Comité de salut public de la Convention nationale, Paris le 23 juin 1793, de l’imprimerie Robert, cf. AN, AFII/46.
- ↑ Le huit clos avait été obtenu par lui par décret du 8 brumaire.
- ↑ Lombard de Langres, Des Jacobins, Paris, 1823, p.90.
- ↑ AN,446AP/15. Au moment du procès de Louis XVI, Barère alla même jusqu’à anticiper la déclaration de guerre avec l’Angleterre et l’Espagne, pour justifier la nécessité de mettre Louis XVI à mort.
- ↑ La précision des détails, les lieux désignés, la mention des « collèges irlandais », l’énoncé en clair de certains noms comme William Herries, dit, à la française,Hérrissé (d’autres sont cryptés comme K..., c’est à dire le banquier Guillaume Ker dont Albert Mathiez et de nombreux historiens après lui ont étudié le rôle dans les affaires de corruption parlementaire)ne laissent aucun doute, pour qui connaît l’organisation du contre-espionnage britannique en France en 1793 sur l’authenticité du document.
- ↑ Dans une contrefaçon de l’édition de la Lettre anglaise, on trouve ainsi inséré le nom reconnaissable de « B.t.z » qui ne se trouve pas dans la traduction originale.
- ↑ L’Alien bill de 1793 devait, en outre, provoquer l’expulsion de nombreux émigrés français réfugiés à Londres, dont Talleyrand qui partit aux États-Unis.
- ↑ Relevées pour certaines dans le Vieux Cordelier de Camille Desmoulins sur la responsabilité de l’incendie de la flotte à Toulon qu’il attribuait aux Espagnols et aux Napolitains mais non aux Anglais.
- ↑ AN, F/74435.
- ↑ Camille Desmoulins, Œuvres publiées par Albert Mathiez, II, p.293.
- ↑ Cité par Hamel, p.451-452.
- ↑ Elle faillit elle-même être mise en arrestation sur ordre de Le Bon: Annales révolutionnaires, 1939, p.340.
- ↑ Voir l’éloge de Le Bon par Barère dans Révolution française, tome XXII, 2296 (messidor an II).
- ↑ AN, F7/4435.
- ↑ Revue d’Histoire de la Révolution, 1919, p.301.
- ↑ Lazare Hoche qui s’était distingué pour son intrépidité et sa bravoure, qui avait évoqué la nécessité d’un soutien des Irlandais, fut, dit Paul Barras, arrêté sur recommandation de Barère et Carnot, contre l’avis de Robespierre, Mémoires, I, p.340 et Hamel.
- ↑ Tels les contre-amiraux Morard de Galle, Kerguelen, La Touche-Tréville ; les commandants Bruix, Lacrosse, Richery, Bouvet, Blanquet, Du Chayla, etc.
- ↑ Revue rétrospective, 1901(2), p. 427.
- ↑ Révolution française, vol. 54, 1908, p. 160-1.
- ↑ R. (L.), L’histoire et la légende. Le rapport de Barère et le rapport de Renaudin sur le combat du Vengeur, Révolution française, 1881, t. 1, p. 407-419.
- ↑ « C’est cet homme atroce qui, écrivit le conventionnel Courtois, le premier, attaqua Camille Desmoulins au sujet de ses numéros du Vieux Cordelier : il avait comme à Florence le miel à la bouche et le rasoir à la ceinture », in Courtois, « Notes », Révolution française, p. 934 et André Dumont, Compte-rendu, Paris, pluviose an V.
- ↑ Qui fut lui aussi arrêté.
- ↑ La publication ultérieure du n° 7, par l’ex-député Étienne-Jean Panis, proche de Barère avec Rovère, Joseph Fouché, Guffroy et autres, passe pour avoir subi des modifications et est très infidèle au manuscrit original dont l’avocat Matton de La Varenne avait eu copie. Voir les archives et papiers de Camille Desmoulins à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, l’essai d’édition critique par A. Mathiez et H. Calvet et surtout les travaux de Charles Vellay.
- ↑ Barras, Mémoires, I, p.156.
- ↑ Voir la Gazette nationale ou Moniteur du 11 germinal an II: « dans ce temps même, Danton dîna souvent rue Grange-Batelière avec des Anglais, il dînait avec Andres Maria Guzman, Espagnol, trois fois par semaine, et avec l’infâme Sainte-Amaranthe, le fils de Sartines, gendre de la Sainte-Amaranthe, et Lacroix. C’est là que ce sont fait quelques uns des repas à cent écus par tête ».
- ↑ Jean-François Rose, célèbre traiteur installé rue Grange-Batelière n°26. A ne pas confondre avec l'espion anglais Augustus Rose, huissier à la Convention nationale
- ↑ Elle est conservée aux AN, AFII/49 et a été publiée pour la première fois par M. Alger, Atheneum, 1898, II, p.455.
- ↑ Tashereau de Fargues, Robespierre aux enfers, an III, p.17.
- ↑ Le Comité de sûreté générale joue un rôle essentiel dans l’affaire Danton/Desmoulins, et c’est de cette époque que date la méfiance de Robespierre vis-à-vis du Comité de sûreté générale dont il cherchera vainement à limiter la sphère d’influence.
- ↑ Il est vraisemblable qu’un des interlocuteurs privilégiés de Barère au cabinet britannique ait été lord Mulgrave, qui entra à Toulon en septembre 1793, puis fut envoyé en mission aux Pays-Bas
- ↑ Le même dont Bonaparte, grâce à Méhée de Latouche, révéla les intrigues "criminelles" lorsqu'il était ambassadeur à Munich
- ↑ Leveson Gower, comte Grenville, secrétaire des Affaires étrangères sous Pitt. Cité par Claphan, A Royalist Spy during the Reign of Terror, English Historical Review, 1897
- ↑ Cf. The Life of Charles, Third earl of Stanhope, p.134.
- ↑ Papiers Carnot, Lettre de Barère à Lewis Goldsmith du 29/8/1828.
- ↑ Anti-gallican monitor du 14 mars 1813; Olivier Blanc, Les espions de la Révolution et de l’Empire, paris, 1995, p.39, 56-59 et 132.
- ↑ AN, W548.
- ↑ ibid.
- ↑ Sur le sujet voir les travaux de Richard Hayes.
- ↑ Le célèbre ministre était connu par sa détermination anti-française, pendant la révolution et l’Empire, et il ne recula devant aucun moyen pour nuire aux Républicains puis à l’Empereur.
- ↑ Sa Carrière diplomatique s'en ressentit par la suite car on le lui confia jamais de responsabilités importantes. Voir Masson, Le Département des Affaires étrangères sous la Révolution.
- ↑ Ce général originaire d’Amérique du Sud est mort en laissant tous ses papiers - publiés à Caracas en 1930 - révélant son implication pleine, entière et continue d’espion du gouvernement britannique, tant à l’armée de Dumouriez en 1792 que dans le Paris de thermidor, puis chassé, et passé de Londres en Amérique du sud où il avait pour mission de faire tomber le Mexique dans l’escarcelle britannique.
- ↑ AN, W548, dossier Madget.
- ↑ Troisième baron Mulgrave qui accompagna l'amiral Hood à Toulon en 1793
- ↑ AN, F74701/III (8 vendémiaire an III).
- ↑ AN, AFII*226 fol.503 (autorisation de séjour à paris le 11 floréal an II); arrêté à Brest en l’an III.
- ↑ Olivier Blanc, Les espions, op. cit., p. 33-4.
- ↑ F. Rabbe « Thomas Paine », Révolution française, tome XXXVI, 1899, p. 81, et O. blanc, Les Espions, op.cit., p.307.
- ↑ Il écrivit le 4 août 1793 à Desmoulins, demandant à être conduit au Comité de salut public, s’engageant à démontrer en présence d’experts que la fameuse lettre anglaise et les notes du portefeuille imprimés chez Baudouin où son nom se trouvait inscrit sont « fausses, archifausses et controuvées ». Catalogue de lettres de M. J. L. de Nancy, vente du 25/1/1855, BHVP cote 32924. Camille Desmoulins avait alors pensé que Arthur Dillon pourrait se disculper de façon éclatante au Tribunal révolutionnaire sans encore réaliser que le gouvernement révolutionnaire était déjà instrumenté par une poignée d’hommes - tant au Comité de salut public qu'aux Jacobins et à la Convention -, ainsi qu’il eut le loisir de le constater avec le montage du procès des Brissotins (au prétexte de leur comportement Barère les fit juger à huis-clos): Lettre de Camille Desmoulins, député de Paris, au Arthur Dillon-général Dillon en prison aux Magdelonnettes (1793).
- ↑ Comme instigateurs prétendus de conspiration des prisons qui fut montée au Luxembourg, par les soins du Comité de sûreté générale, lors du procès de Danton: Acte d’accusation de Dillon conservé à la BM de Toulouse, Ms.984, fol.165.
- ↑ Cette expression qui désigne les partisans du gouvernement anglais et de son système politique et économique, et non les « amis » de la nation anglaise, sera appliquée sous le Directoire aux membres et sympathisants du parti « Clychiste » dont quelques uns furent déportés après le 18 fructidor an V.
- ↑ AN, AFII60, dos.436,p.51.
- ↑ AN, AFII/60, dos.436, p.51. Barère a également fait recruter le sieur Ganganelli, que l’on disait être le « neveu du pape », dans ce même service.
- ↑ AN, MC Desprès, 11/6/1813, testament de Nicolas Madget qui nomme Ferris son exécuteur testamentaire.
- ↑ Olivier Blanc, La Corruption sous la Terreur, Paris, Robert Laffont, 1989.
- ↑ Sur ce point d’histoire très important, il est essentiel de prendre connaissance des mémoires du duc de Gaëte (p. 37) et de La Revellière-Lépeaux.
- ↑ Il est possible, en outre, que le « Vannelet » en poste à la Trésorerie nationale, cité par Jacques Godechot dans son brillant essai sur la contre-révolution, et Paul Savalette de Lange aient formé une seule et même personne.
- ↑ Nommément cité dans les archives du ministre Grenville conservées au Public record office, voir O. Blanc, Les espions, op.cit., 79-82.
- ↑ Olivier Blanc, Les Espions de la Révolution, Paris, Perrin, 1995, p. 50-1.
- ↑ Henry Phipps, troisème baron Mulgrave colonel du 31 régiment d'infanterie, vice-amiral, qui occupa Toulon en 1793, puis fut chargé de commandement en Hollande
- ↑ Ancien ambassadeur de la République de Venise à Londres puis chargé d’affaires de son gouvernement à Bâle, participant à plusieurs réunions informelles avec des membres du Comité de salut public en septembre 1793, d’après la correspondance de lord Grenville (qui parle curieusement de « Hébert » au lieu de « Barère », cf. Fortescue manuscripts). Il a probablement été l’un des informateurs de Drake et de Grenville.
- ↑ Parmi eux deux royalistes, Lemaître, dénoncé et guillotiné en l’an III, et Sandrier des Pommelles qui recueillit de Mme Blondel à Arcueil le codicille secret au testament de Louis XVI provenant de Malesherbes, qu’il remit en main propre en l’an III en Suisse au comte d’Antraigues, son correspondant, à qui il adressait des bulletins depuis 1791: Léonce Pingaud et Jacques Godechot ont étudié les modifications apportées par d’Antraigues à ces informations avant de les réexpédier aux gouvernements espagnols, russes ou britanniques. Quand d’Antraigues fut assassiné à Londres, probablement par les services secrets britanniques, le gouvernement anglais récupéra aussitôt ses archives. Voir aussi J. H. Claphan, « A royalist spy during the reign of terror », The English Historical Review, vol. 12, n° 45 (janvier 1897) p. 67-84 ; O. Blanc, Les Espions, op. cit..
- ↑ Bailleul, Almanach des bizarreries humaines, p.
- ↑ « La Convention nationale interdit à toute autorité constituée d’attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gouvernements étrangers. Les réclamations qui pourraient s’élever contre eux seront portées au Comité de salut public qui seul est compétent pour y faire droit. »
- ↑ Un registre des archives nationales conserve une liste de ces personnes, parmi lesquelles on trouve aussi bien des interprètes comme Samuel Baldwyn ou les espions Auguste Miles ou encore Sullivan qui fut envoyé à Brest, que des « manieurs d’argent » dont certains avaient des instructions et des fonds ouverts par leurs gouvernements : AN, AFII*226.
- ↑ Arnaud de Lestapis, « Autour d’Admirat », Annales historiques de la Révolution, 1957.
- ↑ Mémoires, III, 257.
- ↑ AN, F7/3036 p.53.
- ↑ Jean-Hoseph-Guy-Henry de Guilhem du Bourguet, marquis de Travanet, ancien banquier de jeu de la reine, administrateur de la Cie des Eaux de Paris, agioteur et spéculateur sur les biens nationaux - il est l’acquéreur, en mai 1791, de l’abbaye de Royaumont pour en faire une carrière de pierres: son exemple sera suivi. Voir Claude Hohl, Contribution à l’histoire de la Terreur, Paris, BN, p.49. Un document publié par Albert Mathiez semble indiquer que le banquier d’origine suisse Jean-Frédéric Perregaux, fut aussi, au début de la Révolution, mêlé aux tentatives de pourrissement de la Convention. L’enrichissement subi de certains conventionnels, indéniable, tient toutefois beaucoup moins à l’or anglais qu’aux détournements de biens confisqués ou aux spéculations sur les biens nationaux.
- ↑ A. Aulard, Cent lettres de Barère, Révolution française, t. 49, 1905.
- ↑ Mme Demailly possédait une imprimerie rue de la Perle à Paris et son frère Gilles, qui en assurait la direction, était dévoué à Barère qui lui confiait d’importantes publications officielles.
- ↑ Fondateur avec l’abbé Arthur Dillon, dit Coquillard, de la Feuille du Jour, journal ultra-royaliste, réchappé avec l’abbé Dillon des prisons de septembre 1792, grâce à Manuel, le citoyen Parisau survécut à la Terreur.
- ↑ Supplément à l’accusation de Laurent Lecointre, Paris, l’an III, p.9.
- ↑ Le principe d'une cession des colonies contre la neutralité de l'Angleterre avait été évoquée par certains députés comme Pétion
- ↑ Lire le Moniteur, vol.XX, p.580 et « ».
- ↑ Barère était déjà en relation le 30 avril 1790 avec l’abbé d’Espagnac, AN, 315AP, IV, dossier 3 (n°20).
- ↑ Dont les écrits sont beaucoup plus exacts qu'on l'avait cru jusqu'à maintenant
- ↑ voir sur ce point l’ouvrage de Foiret, une corporation..., p.440. Le même jour on liquida les charges de Jean Bernard, receveur particulier des impositions de la Ville de Paris, et le 28 pluviôse celle de Benoit Chauchat, payeur de rentes, ou encore de Pierre-Basile Thion de la Chaume, contrôleur des payeurs de rentes de la Ville, et les charges de bien d’autres administrateurs et commissionnaires qui pour beaucoup allèrent en prison.
- ↑ « Il n’a fait que devancer la guillotine » disait Barère avec une pointe de déception. Dépôt de titres et testament déposé chez le notaire Delarue, les 19 et 21 germinal an II.
- ↑ Foiret, Une corporation....; R. Hesdin, op. cit., p....: « au moyen de la femme Villeneuve, de fortes sommes de l’argent public sont passées à Barère ».
- ↑ Le masque de verre ou Notes historiques pour servir au procès qui s’instruit dans l’opinion publique contre Barère de Vieuzac, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois, Paris, de l’Imprimerie des droits du peuple, rue de la Loi, l’an III.
- ↑ Cette idée a été développée par Théveneau de Morande et fut reprise par Camille Desmoulins et autres.
- ↑ article 4, titre Ier, 1re partie, Code pénal de 1791.
- ↑ H. Foignet, Une corporation parisienne..., p..., et Olivier Blanc, Les espions, p.84.
- ↑ AN, DIII/346; évoqué par l’auteur des Mémoires de Vilate, etc.
- ↑ Cité par Montgaillard dans Olivier Blanc, Les espions de la Révolution et de l’Empire, paris, 1995, p. 84, et duchesse d’Abrantès, Les salons... ; Olivier Blanc, La Dernière lettre, Paris, 1985.
- ↑ Revue des Curiosités révolutionnaires, II, 1911-1912.
- ↑ Voir sur cette affaire, Dubedat, Histoire du Parlement de Toulouse, Paris, 1885. Il y eut plusieurs personnes qui furent exécutés sans que leurs noms aient été enregistrés. Il en est ainsi, entre autres, de Rousseau, fameux architecte de la ville de Paris, qui disparut anonymement dans une de ces fausses conspirations de prisons et dont on n’a pas l’extrait mortuaire.
- ↑ « Les morts ne reviennent pas. ».
- ↑ Œuvres publiées par Albert Mathiez, tome II, p. 293.
- ↑ Il s’agit du décret du 10 mars 1793 sur l’inviolabilité des députés: dix jours après la chute de Robespierre, au moment de la réorganisation des comités, on entendit Cambacérès insister avec chaleur pour leur interdire la faculté d’attenter à la liberté des Conventionnels, faculté que le même Cambacérès avait proposé le 10 mars 1793 de leur attribuer dans toute sa latitude.
- ↑ Camille Desmoulins parle évidemment de la Convention. Les Brissotins ont été jugés à l’époque de la Convention nationale (octobre 1793).
- ↑ Il le reconnut lui même dans sa défense publiée en l’an III; Barère de Vieuzac, Défense. Appel à la Convention nationale et aux républicains français. 26 pluviose an III, paris, Charpentier an III.
- ↑ Supplément à l’accusation de Laurent Lecointre. Pièce trouvée dans les papiers de Robespierre (an III), p.7.
- ↑ L’imprimeur anglais Stone qui avait une couverture de patriote ami de la France et de la Révolution, est cité par Lewis Goldsmith comme étant une des « recrues » de Barère[réf. insuffisante], au même titre que Madget et Charles Somers. Avec son frère William, les Stone étaient connus des services de police du Consulat et de l’Empire comme agents d’influence du gouvernement britannique.
- ↑ O. Blanc, Les espions, op. cit., p.63, 66-67, 311.
- ↑ Il y entra dès le début, et Carnot vint l’y rejoindre. Robespierre n’y entra que plus tard.
- ↑ C’est le 7 nivôse an III qu’une commission avait commencé d’instruire la procédure; voir AN, DIII/344 (dénonciations reçues), et Laurent Lecointre, Les crimes de sept membres des anciens comités de salut public et de sûreté générale, Paris, Maret (nivôse) an III (251p.); Suite à l’accusation de Laurent Lecointre, Paris, an III; Jean-baptiste Saladin, rapport... pour l’examen de la conduite des représentants du peuple Billaud-varenne, Collot d’Herbois et Barère (...) Fait le 1é ventôse an III, paris, baudouin, an III; « Le masque de verre ou Notes historiques pour servir au procès qui s’instruit dans l’opinion publique contre Barère de Vieuzac, Billaud-Varenne et Collot d’Herbois », etc.
- ↑ F1c/III/Seine/16.
- ↑ Où périt le député Féraud.
- ↑ AN, AFIV/II/301.
- ↑ F7*/642, n°4951 demande de passeport pour Barère et son frère le 15 pluviose an V.
- ↑ Cuvilliers-Fleury, Portraits politiques et révolutionnaires, Paris, 1852, p.121.
- ↑ Secrétaire d’état pour les affaires étrangères en 1807-1809 et premier lord de l’Amirauté.
- ↑ O. Blanc, Les espions, op. cit., p.84-85.
- ↑ Vraisemblablement à Altona ville frontière à la sortie de Hambourg, mais en territoire danois, plaque tournante de l’espionnage international pendant les guerres de la Révolution et de l’Empire. Roques de Montgaillard, l’État de la France en 1794, p. .
- ↑ AN, F/7/6678/12: Paris, le 12 pluviose an VIII « le ministre de la police générale de la République charge le chef de bureau des archives de remettre au citoyen Barère les papiers qui lui appartiennent et qui proviennent des archives du Comité de sûreté générale » Signé : Fouché et « reçu le 12 pluviôse an VIII, Barère ».
- ↑ Luzzatto Sergio, Mémoire de la Terreur, Lyon, Presse Universitaires de Lyon (pour la traduction française), 1991 (1988 en italien), 223 p.
- ↑ Leo Gershoy, Bertrand Barère, A reluctant terrorist, Princeton, Princeton university press, 1962, p. 293.
- ↑ Cité par Jean-René Suratteau, « Barère », dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989, p. 76.
- ↑ Ibid., p. 76.
- ↑ Maximilien Robespierre, « discours du 4 septembre 1793 » (18 fructidor an I), Œuvres Complètes, Paris, PUF et Société des études robespierristes, 1967, p. 96.
- ↑ Cité par Leo Gershoy, Bertrand Barère, A reluctant terrorist, op. cit, p. IX.
- ↑ Macaulay Thomas Babington, Bertrand Barère, Paris, Dentu, 1888. On trouve encore aujourd’hui des traces de ce rejet sous la plume d’historiens pourtant reconnus : « et les vociférations de Barrère (sic) contre la « race infâme » des Vendéens en 1793. » Emmanuel de Waresquiel, « La Révolution selon Guenniffey », Le Monde, 21 Septembre 2000.
- ↑ Leo Gershoy, Bertrand Barère a reluctant terrorist, op. cit, p. 388.
- ↑ Robert Launay, Barère de Vieuzac, L'Anacréon de la guillotine, Paris, Taillandier, 1929, 325 pages.
- ↑ Bernard Gainot, Dictionnaire des membres du Comité de Salut Public, Paris, Tallandier, 1990, p. 84.
- ↑ Leo Gershoy, Bertrand Barère a reluctant terrorist, op. cit, p. 401.
- ↑ Jean-Pierre Thomas, Bertrand Barère, la voix de la Révolution, Paris, Desjonquères, 1989, 343 pages.
- ↑ Jean-François Soulet (préface de), Bertrand Barère un parcours, Tarbes, Mairie de Tarbes, 2005, 134 pages.
- ↑ René Trusses, Barère à la tribune, Tarbes, Comité Liberté Egalité Fraternité des Hautes-Pyrénées, 1989, 54 p.
- ↑ Pierre Serna, « Barère penseur et acteur d'un premier opportunisme républicain face au directoire exécutif », Annales Historiques de la Révolution française, avril 2003, numéro 332, p. 101-128.
- ↑ Pierre Serna, La République des girouettes, Seyssel, Champ Vallon, 2005, 570 pages.
- ↑ Ibid., p. 363.
- ↑ Voir Olivier Blanc, « Barère Vieuzac », in Les hommes de Londres, Histoire secrète de la Terreur, Paris, Albin Michel, pp. 59-77 et 90-185; « Autour de Barère », in La corruption sous la Terreur, Paris, Robert Laffont, 1992, pp. 98-117; et surtout « les espions du Comité de salut public », in Les espions de la Révolution et de l'Empire, Paris, 2003, pp. 50-72.
Articles connexes
Bibliographie
- Olivier Blanc, La corruption sous la Terreur, Paris, Robert Laffont, 1992 (Autour de Barère, collection « les hommes et l’histoire »).
- Olivier Blanc, Les espions de la Révolution et de l’Empire, Paris, Perrin, 1995.
- Jean-Pierre Boudet, Barère journaliste dans Barère, un parcours, Tarbes, 2005.
- Marie-Thérèse Bouyssy,
- « Barère, la lecture et la Bibliothèque nationale », Paris, Revue de la Bibliothèque nationale, hiver 1990, n° 38, p. 52-60.
- « Fraternité chez Barère en l’an II », Fontenoy St Cloud, colloque CNRS la langue de la Révolution française, 1991.
- « le proscrit, le malheureux, l’infortuné, le pauvre: le libéralisme égalitaire de Bertrand Barère », Mulhouse, IIIe symposium humaniste de Mulhouse, 1991.
- Trente ans après: Bertrand Barère sous la Restauration ou la rhétorique du Ténare, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, mémoire de thèse, 1992.
- « Barère vil gascon, un élément écran de l’historiographie », Lengas, 1993, n° 34, p. 69-109.
- « Barère et le salon imaginaire ou le XXe siècle », Paris, Annales historiques de la Révolution française, avril 1993, n° 292, p. 213-236.
- Bouyssy Maïté, « Loin des idéologues. Apports et références de l’humanisme européen chez Bertrand Barère sous le Directoire », dans Républiques en miroir. Le Directoire devant la Révolution atlantique. Modélisations, confrontations, interréciprocité des républiques naissantes, actes du colloque international organisé les 25 et 26 janvier 2008, à paraître.
- Brunel Françoise, « Les institutions républicaines: projet démocratique, horizon d'attente et/ou utopie (an II, an V) », dans Vovelle Michel (présentation de), la Révolution française, idéaux singularités, influences, Grenoble, Presse Universitaires de Grenoble, 2002, p. 319-328.
- Cubéro José, « Les Hautes-Pyrénées, création révolutionnaire de Barère », Midi-Pyrénées patrimoine, 2007, numéro 10, p. 35-39.
- Dayet M., « Une lettre de Bertrand Barère adressée à Pierre Joseph Briot », Annales Historiques de la Révolution française, 1928, p. 561-566.
- Cuvilliers-Fleury, Portraits politiques et révolutionnaires, Paris, Michel Lévy, 1852.
- Guillaume Garot, La conception de l’État de Bertrand Barère, représentant à la Convention nationale, membre du Comité de Salut Public, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, mémoire de maîtrise sous la direction de Michel Vovelle, 1988, 197 pages.
- Léo Gershoy, Bertrand Barère, a Reluctant Terrorist, Princeton University, 1962.
- Léo Gershoy, Barère, « champion of nationalism in the French Revolution », Political Science Quarterly, septembre 1927, volume 42, numéro 3, p. 419-430.
- Léo Gershoy, « Three letters of Bertrand Barère », Journal of modern History, mars 1929, volume 1, numéro 1, p. 67-76.
- Léo Gershoy, « Barère in the Constituent Assembly », The American Historical Review, janvier 1931, volume 36, numéro 2, p. 295-313.
- Léo Gershoy, « Bertrand Barère, un médiateur de la Révolution », Paris, Annales Historiques de la Révolution française, janvier 1961, numéro 1, p. 1-18.
- Lazare Hippolyte Carnot, Notice historique sur Barère, Paris, Jules Labitte, 1842, 202 p.
- David Higgs, Ultraroyalism in Toulouse, from the origin to the Revolution of 1830, The John hopkins University, Baltimore and london, 1973.
- Floréal Hemery, Le Laudateur, l'orateur et le proscrit, les références à l'Antiquité chez Bertrand Barère, Mémoire de Master sous la direction de Mme Sylvie Mouysset, Université de Toulouse 2 - le Mirail, 2008, 236 p.
- Robert Launay, Barère de Vieuzac, l’Anacréon de la guillotine, 1929.
- Sergio Luzzatto, Mémoire de la Terreur, Lyon, Presse Universitaires de Lyon (pour la traduction française), 1991 (1988 en italien), 223 p.
- Jean-François Soulet (préface de), Bertrand Barère un parcours, Tarbes, Mairie de Tarbes, 2005, 134 pages.
- Suh Jeong Bok, Bertrand Barère, ses idées politiques et sociales, Université de Lille, mémoire de thèse, 1988, 199 pages.
- Jean-Pierre Thomas, Bertrand Barère, la voix de la Révolution, Desjonquères, 1989.
- Pierre Serna, « Barère penseur et acteur d’un premier opportunisme républicain face au directoire exécutif », Paris, Annales Historiques de la Révolution française, avril 2003, numéro 332, p. 101-128.
- Jean-René Suratteau, « Le frère de Barère », Annales Historiques de la Révolution française, 1961, p. 534-536.
- René Trusses, Barère à la tribune, Tarbes, Comité Liberté Égalité Fraternité des Hautes-Pyrénées, 1989, 54 p.
- Michel Vovelle, La Révolution française, image et récit, Paris, Messidor, 1986, tome 3, chapitre 16, p. 300-335 (On peut aussi apprécier le jugement de l'historien Michel Vovelle : « Recrue relativement tardive du parti montagnard, Barère a joué un rôle important dans le gouvernement révolutionnaire... Sa personnalité a été diversement appréciée : on ne peut lui dénier une constance qui en fait au-delà de Thermidor un Montagnard fidèle. » (La Révolution française, images et récit, Paris, Messidor, 1989, tome IV p. 31.)
- Sophie Wahnich, Marc Belissa, « Les Crimes des Anglais, trahir le droit », Annales Historiques de la Révolution française', 1995, no 300, p. 233-248.
- Koichi Yamazaki, « Un discours de Barère prononcé avant la Révolution », Paris, Annales Historiques de la Révolution française, novembre 1985, no 262, p. 500-509.
- Koichi Yamazaki, « Les éloges de Montesquieu par Barère », dans Study Series, Hitotsubashi university, Center for historical science literature, mars 1989, no 18, 49 pages.
Liens externes
- Barère écrivain et Barère journaliste, par Jean-Pierre Boudet
- Biographe de Bertrand Barère
- Barère en Russie par Olga Osipova, ou comment Barère est perçu par des intellectuels russes
- Portail de la Révolution française
- Portail du renseignement
- Portail du Premier Empire
Catégories : Député du tiers-état aux états généraux de 1789 | Membre de l'Assemblée constituante de 1789 | Député de la Convention nationale | Conventionnel régicide | Agent double sous la Révolution française | Membre du Comité de salut public | Député des Cent-Jours | Député de la Monarchie de Juillet | Magistrat français du XVIIIe siècle | Écrivain français du XVIIIe siècle | Académie des Jeux floraux | Personnalité des Hautes-Pyrénées | Ancien conseiller général des Hautes-Pyrénées | Membre du Cercle social | Espion | Naissance à Tarbes | Naissance en 1755 | Décès en 1841
Wikimedia Foundation. 2010.