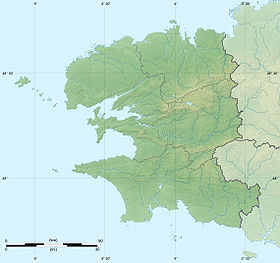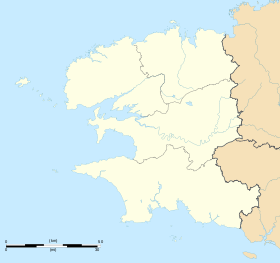- Argol (Finistère)
-
Argol 
Vue depuis la place du village sur l'enclos paroissial d'Argol
DétailAdministration Pays France Région Bretagne Département Finistère Arrondissement Châteaulin Canton Crozon Code commune 29001 Code postal 29560 Maire
Mandat en coursHenri Le Pape
2008-2014Intercommunalité Communauté de communes de la presqu'île de Crozon Site web Site officiel de la commune Démographie Population 815 hab. (2008[1]) Densité 26 hab./km² Gentilé Argolien, Argolienne Géographie Coordonnées Altitudes mini. 0 m — maxi. 191 m Superficie 31,73 km2 Argol est une commune française, située dans le département du Finistère et la région Bretagne, à l'entrée de la presqu'île de Crozon. S'étendant sur 3 320 hectares, Argol est baignée au sud, sur une faible longueur, par la baie de Douarnenez, à l'est par l'estuaire de l'Aulne et au nord par la rade de Brest.
Toponymie
Le nom d'Argol serait lié à la submersion de la ville d'Ys. Argoll signifierait en perdition.
Il existe une autre version sur la signification du mot Argol : Archol et Arcol au XIe siècle. Ce nom pourrait être un composé formé avec le vieux breton coll (coudrier) ou gaulois golsd, gallois et irlandais coll et le préfixe ar (près de).
Histoire
Jusqu'à la fin du XIe siècle, début du XIIe, les religieux exerçaient un ministère actif dans toute la région. À la réforme de Grégoire VII, l'évêché de Cornouaille va prédominer. C'est ainsi que l'abbé de Landévennec revendique le titre de recteur primitif de toutes les paroisses où ses moines exerçaient auparavant le ministère pastoral. Il fut nommé recteur primitif d'Argol, Telgruc, Edern, Dinéault, Châteaulin et Crozon jusqu'en 1363, date à laquelle cette paroisse passa sous l'autorité d'un duc de Rohan qui la remit à l'évêque de Cornouaille.
Argol est connue pour des faits liés à la Révolte des Bonnets Rouges en 1675.
Avant 1982, Argol englobait tout le territoire de Telgruc-sur-Mer, Landévennec, et Trégarvan.
Évolution de la population
Malgré les guerres et les épidémies, la population n'a cessé de s'accroître. De 744 habitants recensés en 1800, on en compte plus de 1 400 en 1901. Cet accroissement résulte de la progression de la médecine à combattre les maladies infantiles. Le taux de la population va rester stable jusqu'en 1914. Les gens demeurent au pays et semblent jouir d'une certaine aisance.
Au cours du XXe siècle, la population d'Argol a fortement diminué. De 1 499 habitants en 1911, on n'en compte plus que 773 en 1976. Cependant, depuis, la population a recommencé à croître, si bien qu'en 2009, Argol a repassé la barre des 1 000 habitants.
L'abandon du costume local s'est produit assez rapidement. Il en est de même des coutumes anciennes qui donnaient à chacune des paroisses un visage particulier.
Population au Moyen Âge
Au début de leur implantation, les Bretons et surtout les chefs religieux rencontrèrent la résistance des druides. Peu à peu, l'esprit chrétien se substitue aux croyances païennes.
Les invasions normandes resserrèrent les liens entre les anciens et les nouveaux occupants du sol.
Le servage proprement dit disparut de Bretagne dès le XIe siècle. Les roturiers jouissaient de la liberté personnelle et ne devaient rien à leur seigneur, que certaines redevances ou services.
Après l'expulsion des Normands, les habitants d'Argol et de la presqu'île eurent à souffrir des incursions des pirates anglais.
Au début de la guerre de Cent Ans, des épidémies désolèrent le pays. La plus redoutable fut la peste noire en 1347. D'après une vieille tradition, lors d'une épidémie, les habitants de ce quartier durement frappés furent visités et soignés par les prêtres. Les paroissiens d'Argol décidèrent leur rattachement à la paroisse de Landévennec.
Au XVe et XVIe siècles, Argol jouit d'une certaine aisance. Les nombreux édifices en témoignent. Les cultures sont abondantes : orge, blé, avoine, seigle et chanvre. Les guerres de la Ligue vont venir troubler ce bien-être. En 1593, les troupes de Sourdéac saccagent les édifices et les cultures. En 1594, les ligueurs brisent la croix du cimetière. En 1595, la disette s'installe et en 1597, c'est la famine. Puis, de 1605 à 1606, Argol subit une invasion de loups.
À la veille de la Révolution
La paroisse d'Argol était paisible. La petite bourgeoisie exerçait des professions libérales : notaires, juges... Les paysans vivaient modestement. Les principales cultures se composaient de céréales : froment, orge, avoine. La pomme de terre, d'apparition récente, semblait d'un bon rapport. L'élevage comptait des vaches et des bœufs. L'industrie de tissage était en déclin. La meunerie avait progressé à la fin du XVIIIe siècle, approvisionnant la Marine.
Pendant la Révolution
En 1790, Argol devient canton du district de Châteaulin avec les communes de Trégarvan, Landévennec et Telgruc. Il est supprimé en 1802 et uni à celui de Crozon. Mais jusqu'en 1853 et probablement plus tard, Argol conservera une perception dont dépend Trégarvan, Landévennec, Telgruc, Saint-Nic et Plomodiern. Jusqu'en 1887, l'unique bureau de poste de la presqu'île était au bourg d'Argol. Puis il fut transféré à Crozon.
La période concordataire
Les missions bretonnes sont rétablies en 1808. En 1829, une pétition émane de la municipalité et des principaux chefs de familles pour le maintien dans la commune d'Argol du quartier de Lomergat qu'il était question de rattacher à Telgruc ou à Landévennec. Au cours de ce siècle, Argol connaît à nouveau une période d'épidémies meurtrières : le choléra en 1836 (57 morts), la variole en 1856 (53 morts), la typhoïde en 1860 (69 morts).
La guerre de 1870
Un arrêté du sous-préfet de Châteaulin le 27 août 1870 prescrit d'établir dans toutes les communes, une garde sédentaire. Les officiers seront nommés par les citoyens. Lorsque celle-ci sera organisée, on distribuera des fusils aux hommes, on fixera les localités et des heures d'exercices obligatoires. Argol eut sa garde. Quelques-unes des paroisses furent mobilisées et rejoignirent le camp de Conlie dans la Sarthe. Quatre prêtres de Quimper y furent nommés aumôniers. Il ne semble pas qu'il y ait eu beaucoup de victimes dans la commune pendant "l'année terrible".
Le XXe siècle
Les premières années furent bien sombres pour l'église de France par la dénonciation du concordat. Le gouvernement français pratiquait une politique anticléricale. La loi du 1er juillet 1901 accordait la liberté à toutes les associations mais excluait les congrégations religieuses. Waldeck Rousseau n'avait pas exigé d'autorisation pour les écoles qui fonctionnaient déjà auparavant. Les élections de 1902 ayant donné la majorité à la gauche, son successeur, Émile Combes, se montra sectaire à l'égard des catholiques. 125 écoles ouvertes depuis le 1er juillet 1901 furent immédiatement fermées. 3 000 établissements du même genre, ouverts avant cette date seraient fermés dans les huit jours. Ces mesures soulevèrent l'indignation et provoquèrent l'agitation. Partout la résistance fut vive, surtout en Bretagne. Après la fermeture des écoles non autorisées, ce fut la dissolution des congrégations d'hommes, puis celles des femmes. Le 7 juillet 1904, ce fut la suppression de l'enseignement congréganiste. On vit alors beaucoup d'écoles se fermer et de couvents se vider. Quantité de frères et de sœurs prirent le chemin de l'exil. Le 7 janvier 1907, deux cents gendarmes et six cents soldats se présentent au séminaire de Quimper, route de Penhars pour en expulser par la force les séminaristes. C'est dans un climat orageux que l'abbé Quillévéré prit la direction de la paroisse d'Argol.
Le chemin de fer
La voie ferrée fut décidée en 1909. Puis, le 8 octobre 1911, l'expropriation des terrains eut lieu. Cette ligne fut l'objet de plusieurs sabotages durant la Seconde Guerre mondiale.
Argol pendant la Première Guerre mondiale et l'Entre-deux-guerres
Le 2 août 1914 à 17 heures, les cloches se mirent à sonner l'alarme. Cette guerre allait durer quatre ans. La mobilisation générale avait vidé les campagnes de ses hommes. Les femmes et les enfants ont remplacé leurs maris au travail de la terre. Malgré la rigueur de l'hiver 1917, les campagnes ont tenu et assuré la nourriture. L'armistice signé, la vie reprend son cours avec les problèmes d'après-guerre.
En 1923, pour la première fois, passe le petit train à la gare d'Argol. C'est vers cette date que fut commencée la construction du pont de Térénez.
En 1924, le climat politique n'était pas des plus sereins avec l'arrivée du cartel des gauches : des manifestations se produisent en Bretagne. La population craignait à nouveau les tracasseries du début du siècle. Mais il fallait empêcher que ne s'établisse en France l'école unique préconisée par certains politiciens. Les habitants d'Argol et de toute la presqu'île participent aux différentes manifestations à Quimper, Landerneau...
En 1933 est installé l'éclairage électrique à l'église et au presbytère d'Argol.
Argol pendant la Seconde Guerre mondiale
En septembre 1939, c'est de nouveau la guerre. Argol pouvait ravitailler les communes de l'ouest de la presqu'île grâce à l'ingéniosité de ses habitants.
Lors de l'évacuation de Brest et des combats de la Libération, Argol, accueille généreusement les réfugiés. Le 1er septembre 1944, les Allemands, poursuivis par les FFI, quittent la commune et celle de Telgruc et se dirigent vers Tal-Ar-Groas.
En 1945, le chanoine Grall décide un pèlerinage à Sainte-Anne-la-Palud en reconnaissance pour la presqu'île libérée de l'ennemi.
Argol pendant les Trente Glorieuses
Le 8 juillet 1950, le nouveau recteur décide d'électrifier les cloches de l'église. Cela coûtait 400 000 francs auxquels il fallait rajouter 140 000 francs pour l'horloge électrique. La kermesse, organisée le 3 avril de la même année, avait rapporté 250 000 francs. La mairie ajoutait 100 000 francs en juin. Les frais étaient alors pratiquement couverts.
Dans les domaines de la culture, de la construction et de l'aménagement d'habitations particulières, les méthodes changent et se modernisent. Malgré tout, beaucoup de jeunes quittent la campagne. Ceux qui restent achètent des tracteurs et s'adaptent aux nouvelles techniques qui facilitent le difficile travail de la terre. Plus tard, les agriculteurs se groupent entre eux pour former la CUMA (coopérative d'utilisation de matériel agricole).
Les ménages d'Argol se dotent de matériel électroménager dès qu'ils ont l'électricité. Au niveau des transports et communications, des cars réguliers relient la presqu'île à Quimper, puis à Brest dès l'achèvement des travaux de restauration du pont de Térénez. Les Argoliens, en attendant d'acheter une voiture, utilisent le train.
À l'initiative du docteur Jacquin, conseiller général du canton, fut fondé en 1950 le syndicat intercommunal en vue d'approvisionner en eau potable les communes de Crozon, Argol, Camaret, Lanvéoc, Roscanvel et Telgruc. En 1968, le syndicat de Crozon s'associe à d'autres communes pour fonder le syndicat mixte de l'Aulne en vue de l'utilisation des eaux de l'Aulne transformées.
En 1970, 14 % des exploitations du canton avaient une superficie de plus de 20 hectares. À Argol, on en comptait 33 % et 43 % en 1979.
Argol aujourd'hui
Mis à part l'église, le calvaire du cimetière, l'enclos paroissial et son arc de triomphe, la particularité de ce joli petit bourg, c'est le four à pain sur la route de Trégarvan. Datant de 1848, il sert, à la saison estivale, à confectionner ce bon pain d'antan lors des fêtes de quartier.
En juillet et août, Argol renoue avec la tradition en présentant, sous forme de théâtre, la légende de la ville d'Ys. À la tombée de la nuit, l'église et la place centrale sont illuminées.
Héraldique
Démographie
Évolution démographique
L'évolution du nombre d'habitants depuis 1793 est connue à travers les recensements de la population effectués à Argol depuis cette date :

Pyramide des âges
Patrimoine
Patrimoine religieux
- Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son enclos paroissial :
L’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 12 novembre 1914[7]. Elle a été construite aux XVIe et XVIIe siècles.
- Les fontaines :
- Fontaine Sainte-Agnès au village du Merdy (en direction de Trégarvan) ;
- Fontaine Sainte-Geneviève à la sortie du bourg ;
- Fontaine Notre-Dame de Rochemadou au village de Trovéoc.
- Les chapelles disparues :
Il existait une chapelle au village de Trémenez, depuis longtemps disparue. Une autre était au hameau de la Trinité : Notre-Dame de Rochemadou. En ruines en 1804, il ne reste plus qu'une statue, une fontaine et un champ appelé Park ar Chapel.
Autre patrimoine
- Statue monumentale du roi Gradlon :
Place de l'église, à droite de l'arc de triomphe, devant l'entrée de la cour de l'ancien presbytère, se trouve une statue monumentale en granit du roi Gradlon réalisée par Patrig Ar Goarnig, mesurant 3 m de long et pesant trois tonnes. Cette statue équestre raconte les deux versions (la chrétienne sur le côté droit et la païenne sur le côté gauche) de la légende de la ville d'Ys.
- Le four à chaux de Rozan : il date de l'époque gallo-romaine, mais plusieurs autres fours plus récents se trouvent à Roscanvel, Lanvéoc, Landévennec et Crozon, qui fonctionnaient aux XVIIIe et XIXe siècles, tirant profit de petits gisements calcaires locaux, mais aussi de coquilles d'huîtres, la production étant exportée principalement vers Brest par voie maritime.
Événements
- Marché de Noël
Troménie
Autrefois existait à Argol un grand pardon ou troménie qui avait lieu une fois l'an. Elle fut supprimée sous l'occupation allemande de 1940 à 1942. Elle eut lieu en 1943, puis de nouveau supprimée en 1958. La procession quittait l'église, prenait la direction de Landévennec et faisait plusieurs arrêts aux endroits où, il y a fort longtemps s'élevait une croix, puis revenait au bourg.
Musée des vieux métiers vivants
Situé à la ferme de Kerampran au cœur du village, le musée (ou maison) des vieux métiers vivants est un outil ludique et pédagogique qui permet aux enfants comme aux adultes de se familiariser avec les métiers et activités exercés jadis. Une quinzaine d'ateliers animés par des bénévoles de l'association Micherioù Kozh Ar Vro (Les vieux métiers du pays) permet une découverte d'objets insolites, témoins d'un patrimoine riche avec des métiers comme sabotier, vannier, potier, tisserand, fileuse de lin et de laine, brodeuse, cordier, tourneur sur bois, tailleur de pierre, forgeron, fabrication du miel, les métiers de la mer, etc.
La visite du musée est agréée par l'Éducation nationale pour ses nombreuses animations (fête du cidre, fête des fileuses, fête du pain, fête de la moisson, fête du cheval, cerclage des roues, promenades en calèche, tonte du mouton, fabrication du beurre, crêpes à l'ancienne, initiation aux danses bretonnes, lessive au lavoir, etc.) qu'il propose chaque année.
Maison du cidre de Bretagne
Située dans la ferme de Kermazin, route de Brest à Argol, la maison du cidre de Bretagne est un musée proposant 1 600 m2 d'exposition sur le cidre et la pomme. La maison offre des dégustations dans sa cave à cidre et une crêperie est ouverte à la ferme. La boutique du musée vend des produits locaux et régionaux, bio et authentiques, préparés selon la tradition.
Parc des jeux bretons
Juste derrière l'ancien presbytère, a été aménagé un espace ludique où enfants et adultes peuvent découvrir les jeux traditionnels bretons et s'y initier : jeux de quilles, de palets, galoche, boultenn, birinig, etc. Un bénévole est toujours présent pour expliquer les règles de jeux. Le parc est ouvert d'avril à septembre et son entrée est gratuite.
Administration
Maires
Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité 2008 Henri Le Pape retraité 2001 2008 François Godoc DVD Toutes les données ne sont pas encore connues. Jumelages
Intercommunalité
Parc Naturel
Tourisme
- Pays touristique du Ménez-Hom Atlantique
Cinéma
En 1969, sur la place centrale de la commune d'Argol, devant l'enclos paroissial, a été tournée la scène clé du film de Claude Chabrol Que la bête meure, où, au volant de sa Ford Mustang, Paul Decourt (Jean Yanne), un garagiste infect et haï de tous, écrase, un jeune garçon dont le père (Michel Duchaussoy) jurera de venger la mort.
Personnalités liées à la commune
- Ronan Barrot, peintre figuratif, situe régulièrement le lieu de sa naissance à Argol, le 13 février 1973
- Julien Gracq y situe l'action de son premier roman Au château d'Argol (1939). La bibliothèque municipale d'Argol porte son nom.
Notes et références
- Populations légales 2008 de la commune : Argol (Finistère) sur le site de l'Insee
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur site de l'École des hautes études en sciences sociales. Consulté le 31 juillet 2010
- Évolution et structure de la population (de 1968 à 2007) sur Insee. Consulté le 31 juillet 2010
- Recensement de la population au 1er janvier 2006 sur Insee. Consulté le 31 juillet 2010
- Évolution et structure de la population à Argol en 2007 sur le site de l'Insee. Consulté le 31 juillet 2010
- Résultats du recensement de la population du Finistère en 2007 sur le site de l'Insee. Consulté le 31 juillet 2010
- Ministère de la Culture, base Mérimée, « Notice no PA00089823 » sur www.culture.gouv.fr.
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
Wikimedia Foundation. 2010.