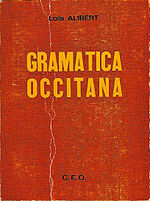- Louis Alibert
-
 Pour les articles homonymes, voir Alibert.
Pour les articles homonymes, voir Alibert.Louis Alibert (1884 - 1959) (en occitan Loís Alibèrt - graphie classique) est un linguiste français qui a notamment posé les bases de la norme classique de l'occitan.
Sommaire
Biographie[1]
Il est né à Bram dans l'Aude, en Lauragais, le 12 octobre 1884, dans une famille de paysans où l'on parlait occitan.
Il fait des études de pharmacie mais aussi de philologie et d'histoire[2].
En décembre 1912, il épouse Marie-Louise Latour, qui donne naissance l'année suivante à leur fils unique Henri, mort en 1943 en Allemagne. Il s'installe comme pharmacien à Montréal d'Aude, où il demeure de 1912 à 1942.
Il participe à la Première guerre mondiale, au cours de laquelle il est blessé et décoré.
Après la guerre, il se lance dans la vie politique locale et se présente sans succès aux élections municipales contre la liste du parti radical-socialiste. Lecteur de Maurice Barrès, il rejoint l’Action française.
L'oeuvre pour la langue occitane
Il adhère au Félibrige, à l'Escòla mondina puis à l'Escòla occitana. En 1928 il s'engage résolument dans la vie culturelle languedocienne en devenant secrétaire de la revue Terro d'Oc. Il publie Le lengadoucian literari (Toulouse 1928), Sèt elegios de Tibul et un article intitué « Poulitico d'abord » dans Terro d'Oc, auquel Pierre Azéma répond par un article « Poulitica Felibrenca ».
En 1929 il commence à collaborer à la revue Òc, par une rubrique, en avril, intitulée « Conversas filologicas ». C'est le début de son œuvre de réforme linguistique : il tente de concilier le système de Frédéric Mistral, basé sur la phonétique du provençal rhodanien du XIXe siècle et en partie sur les codes graphiques du français, celui d'Estieu et Perbosc, archaïsant, et celui de Pompeu Fabra, adapté au catalan[3].
En 1930 il fait partie des fondateurs de la Société d'études occitanes dont il devient secrétaire et dont il est la cheville ouvrière. Dans les années suivantes, il transforme Òc en publication de la SEO.
Il publie entre 1935 et 1937, à Barcelone, son œuvre majeure, la Grammaire occitane selon les parlers languedociens.
La période de Vichy
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Louis Alibert a 56 ans et, à l'instar de bon nombre de régionalistes, il accueille avec enthousiasme la Révolution nationale du Maréchal Pétain.
Il participe au numéro spécial des Cahiers du sud intitulé « Le génie d'oc et l'homme méditerranéen » et paru en février 1943 avec deux contributions remarquables de Simone Weil[4],[5] dans lequel il fait part de ses espoirs d'une politique favorable aux langues régionales du gouvernement de Vichy[6].
Alibert participe à la fondation de la section de Montréal de la Légion française des combattants, mais en est exclu car il veut en faire une "association de combat et de défense de la Révolution Nationale (ce qu'est aujourd'hui la milice)"[7]. Il est également adhérent au groupe "Collaboration" d'Alphonse de Châteaubriand[7].
En septembre 1943, il écrit au préfet de Région pour tenter d'obtenir la reconnaissance de la Société d'Études Occitanes et l'attribution d'une charge de cours d'occitan nouvellement créée à sa demande à la faculté de Montpellier[7].
Après la Libération
À la Libération, un interprète français de la gestapo déclare pendant un de ses interrogatoires que c'est la femme de Louis Alibert, Louise Latour, qui a dénoncé un résistant gaulliste, M. Balby, ingénieur des Ponts et Chaussées, mort en déportation. « Apparaissant comme un véritable génie du mal et comme douée par surcroit d'une redoutable perversité » elle est « condamnée à dix années de travaux forcés pour atteinte à la sûreté de l'État », et il est lui-même condamné à cinq ans de prison, sans que l'on sache ce qui lui était précisément reproché ; ils sont en outre condamnés à l’indignité nationale à vie[8].
Cette condamnation lui interdit de participer à l'émergence de l'occitanisme de l'après-guerre et de jouer un rôle dans la fondation de l'Institut d'études occitanes (IEO) en 1945, bien que la création de cet institut marque la consécration de son œuvre linguistique, puisque l'IEO adopte la norme classique, en se basant sur la grammaire d'Alibert de 1935[9]. Il participe toutefois à l'adaptation de cette norme au dialecte gascon en compagnie de Jean Bouzet et Pierre Bec.
Louis Alibert meurt à Montpellier le 16 avril 1959. Il est inhumé à Bram[10].
L'héritage d'Alibert
Un dictionnaire posthume et inachevé, le Dictionnaire occitan-français d'après les parlers languedociens, a été publié en 1966 grâce au travail de Robert Lafont, Raymond Chabbert et Pierre Bec sur ses manuscrits inédits. Il est d'une qualité inférieure à sa grammaire.
Œuvres
- Sept élégies de Tibulle traduites en languedocien, 1928
- Le lengadoucian literari, Toulouse, 1928
- Casemir Clotos, A la Clarou del calelh, pouesios lengodoucianos, amb un gloussèri de las paraulos laspus esguerrièras, per L. Alibert, Carcassoune, les impr. de Gabelle, 1932 (notice BNF)
- Gramatica Occitana segon los parlars lengadocians, 2 volumes, Societat d'estudis occitans, Tolosa, 1935, 1937 (notice BNF), 2nde édition en un volume, Centre d'estudis occitans, Montpelhièr, 1976 (notice BNF)
- Les Troubadours de l'Aude, 1941 (Revue Pyrénées n°2)
- Origine et destin de la langue d'Oc, 1942 (les Cahiers du Sud, numéro spécial "Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen")
- Sur quelques toponymes catalano-occitans dans l'Aude, 1956 (Revue internationale d'onomastique n° 2)
- Toponymes de l'Aude, 1957 (Revue internationale d'onomastique n° 4)
- Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens, Institut d'études occitanes, 1965 (posthume) (notice BNF), 2e édition 1977 (notice BNF), 5e édition 1993 (notice BNF)
- Proverbes de l'Aude (classés et mis en orthographe occitane par Raymond Chabbert), Vent Terral, Andouque, 1998, ISBN 2-85927-072-8 (notice BNF)
Notes et références
- (oc) Biographie par Jean Frédéric Brun
- Il est diplômé d'études supérieures méridionales et d'études supérieures d'histoire. J.-F. Brun, cf. supra
- Estimam qu'al punt de vista de la grafia, cal conciliar nòstras tradicions classicas, los resultats de l'estudi scientific de la lenga, la grafia mistralenca e la grafia catalana (Nous estimons que du point de vue de la graphie, il nous faut concilier les traditions classiques, les résultats de l'étude scientifique de la langue, la graphie mistralienne et la graphie catalane) dans l'introduction de la Gramatica occitana
- « L'agonie d'une civilisation vue à travers un poème épique » et « En quoi consiste l'inspiration occitanienne », ont été réédités dans Écrits historiques et politiques, Paris, 1960, Gallimard, pp. 67-89.
- Domenico Canciani, "Des textes dont le feu brûle encore... Simone Weil, les Cahiers du Sud et la civilisation occitanienne", Cahiers Simone Weil, 2002, vol. 25, no 2, pp. 89-131
- Il conclut ainsi son article sur la langue occitane : « Aujourd'hui, une nouvelle aurore se lève, qui promet de beaux jours à la langue d'Oc renaissante. Le gouvernement du maréchal Pétain vient de lui ouvrir la porte des écoles primaires et il nous promet la reconstitution de nos vieilles provinces. C'est le moment de répéter, à l'adresse de certains méridionaux et en guise de conclusion, ces vers d'un admirateur toulousain du poète Goudelin : Barbareus est istam nescit quicumque loquelam. »
- Lo Lugarn, n°71, printemps 2000
- Voir l'article paru dans « La Démocratie » du 11-03-46 où il désigné sous le nom d'Adrien Alibert, cité dans le Lo Lugarn, n°71, p. 9
- Il est l'auteur d'un ouvrage sans nom d'auteur, La réforme linguistique occitane et l'enseignement de la langue d'oc, qui décrit l'orthographe classique de l'occitan, édité par l'IEO en 1950.
- René Nelli, Éloge de Louis Alibert, Carcassonne, 1959
Liens externes
Catégories :- Linguiste occitan
- Linguiste français
- Action française
- Naissance en 1884
- Décès en 1959
- Naissance dans l'Aude
Wikimedia Foundation. 2010.