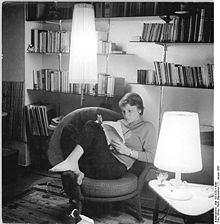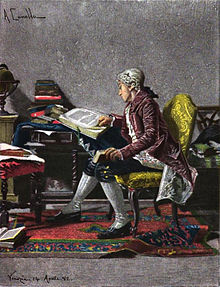- Lecture
-
La lecture est l’activité de compréhension d’une information écrite. Cette information est en général une représentation du langage sous forme des symboles identifiables par la vue, ou par le toucher (Braille). D’autres types de lecture s’appuient sur d'autres formes de langages, par exemple celle de partitions de musique ou de pictogrammes.
D’autres acceptions du nom « lecture » ou du verbe « lire » s’« entendent » dans un sens plus large : lire les signes des temps.
Sommaire
Histoire
On pourrait penser que l’histoire de la lecture est la même que celle de l’écriture : on peut estimer que les premiers hiéroglyphes furent dessinés il y a 5 000 ans, les alphabets phonétiques les plus anciens ont environ 3 500 ans.
Pourtant, l’évolution des supports a également eu une grande influence. Les premiers ouvrages étaient écrits sur des rouleaux de papyrus enroulés en volumen dans un cylindre. Ils n’autorisaient donc qu’une vision partielle du texte à lire.
Progressivement, entre le IIe et le IVe siècle, l’introduction du parchemin permet la rédaction des ouvrages en codex composés de feuilles pliées et cousues ensemble. Le livre ne subira alors pratiquement plus de modification de structure. Cette nouvelle présentation permet de consulter les ouvrages de façon moins linéaire : il devient possible de feuilleter pour accéder directement à un passage du texte.
Jusqu’aux environs du Xe siècle les mots étaient écrits les uns à la suite des autres, sans blancs ni ponctuation (scriptio continua) :
UNETELLEECRITURENEFAVORISEPASLADETECTIONRAPIDEDESMOT
SETOBLIGEAUNDECHIFFREMENTLABORIEUXLETTREALETTREDESOU
VRAGESLAVITESSEDELECTUREESTDONCTRESLENTELa lecture à haute voix était quasi systématique. Ce n'est qu'à partir du Xe siècle que des moines Irlandais souhaitant diffuser au plus grand nombre l'information biblique inventèrent les blancs dans l'écriture. Si des textes datant du Ve siècle av. J.‑C. attestent que la lecture silencieuse était pratiquée en Grèce, elle resta probablement exceptionnelle pendant de longs siècles. Dans ses Confessions, Augustin d'Hippone relate sa stupéfaction quand il voit Ambroise de Milan pratiquer la lecture silencieuse. La lecture demeure une activité collective dans les milieux bourgeois jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Parmi les ouvriers, le roman-feuilleton continue d’être lu à voix haute jusqu’au lendemain de la Première guerre mondiale. En Europe, la lecture orale, parfois chantée ou psalmodiée occupe une place centrale aujourd’hui encore dans les cérémonies des religions juive, chrétienne et musulmane. La vitesse de parole permet de lire environ 9 000 mots à l’heure. Un pratiquant moyen de la lecture rapide (et donc silencieuse) est environ trois fois plus rapide.
Au cours du XIXe siècle, la plupart des pays occidentaux s’engagent dans l’alphabétisation de la population. Elle se généralise un peu plus tôt dans les pays de religion protestante, où chacun doit être capable de lire la Bible.
Quant à la lecture sur écran (ou lecture numérique) dont nous vivons le déploiement dans le contexte de la société de l'information, celle-ci pose des problématiques nouvelles à l'étude.
L’apprentissage de la lecture
La lecture est un des apprentissages essentiels de l’école primaire avec l’écriture et les mathématiques, et le premier but de la scolarité obligatoire. L'enjeu étant de taille, les tenants des diverses méthodes s'affrontent.
"La méthode syllabique, la plus ancienne, fonctionne par association de lettres pour former des syllabes, puis par association de syllabes pour former des mots. On l’appelle aussi la méthode B et A, BA. La méthode globale, plus récente, propose au jeune enfant de “photographier” des mots entiers, d’en reconnaître le dessin complet et, seulement ensuite, de repérer d’un mot à l’autre des syllabes communes à utiliser dans de nouvelles combinaisons. Actuellement, la plupart des enseignants se servent d’un mélange des deux méthodes, qu’on appelle parfois méthode mixte et que Célestin Freinet appelait déjà la méthode “naturelle”. (...) L’essentiel de la méthode naturelle consiste à utiliser la motivation de l’enfant et ce qu’il connaît ou reconnaît déjà, qu’il s’agisse de lettres ou de mots entiers, souvent les deux. Pour cela, il faut des images qui le captivent, une histoire qui l’attire, une progression graduée qui ne le mette jamais en échec mais encourage sa confiance. Le principe est simple : en s’appuyant toujours sur les acquis précédents, on amène l’enfant à observer, à chercher des ressemblances, des différences, à mémoriser un bagage de mots, de lettres et de syllabes toujours plus grand, mais aussi à comprendre le principe de la combinatoire, pour pouvoir déchiffrer des mots nouveaux et aussi en écrire.
Pour entretenir la confiance de l’enfant et son plaisir de découvrir la lecture, on conseille généralement de :
• Attendre que l’enfant manifeste l’envie de lire et ne commencer que dans ce cas. Certains enfants n’apprennent qu’à 7, voire 8 ou 9 ans et ce n’est pas un problème. Bien entendu, dans le cadre d’une classe, la pression des parents et les nécessités du groupe obligent à plus ou moins uniformiser l’âge de l’apprentissage. Dans ce cas, la motivation joue encore plus son rôle de moteur.
• Partir d’histoires qui captivent l’enfant, de modes d’emploi de jeux, de recettes de cuisine à faire ensemble, pour souligner l’utilité de savoir lire. Ecrire les récits ou les phrases amusantes que dit l’enfant et les lire pour lui montrer que l’écriture et la lecture sont là pour conserver les paroles.
• Utiliser ensuite ces histoires comme supports d’exercices en faisant reconnaître des lettres, des syllabes, des sons. Montrer les premiers et laisser l’enfant en chercher d’autres.
• Lorsque l’enfant arrive à lire des phrases entières, commencer à souligner le rythme et la ponctuation pour pouvoir mettre le ton en lisant. Montrer d’abord les signes de ponctuation, puis comment la voix monte ou descend en fonction des signes."[1]
Techniques
Le repérage consiste à retrouver rapidement une information en se basant sur les ressources typographiques du texte. Il est particulièrement adapté aux ouvrages comme les dictionnaires ou les annuaires et aux textes avec un plan très hiérarchisé.
L'écrémage est lui utilisé quand la structure du texte n’est pas suffisamment marquée. Il consiste à lire le texte en diagonale en s’arrêtant sur les mots clefs porteur d’information.
La lecture rapide combine des stratégies appuyées sur la technique de l’« écrémage » et la lecture verticale de lignes entières saisies d’un seul coup d’œil chacune à leur tour. L’œil doit rester à une distance suffisante de la page.
La rapidité et la précision des mouvements de l’œil sont essentielles, c’est pourquoi l'oculométrie cognitive est utilisée pour l’étude des performances de lecteurs.
Une étude littéraire est un travail portant sur le domaine littéraire, que ce soit sur un ou plusieurs auteurs, d'œuvres, ou même d'un genre littéraire. Elle s'appuie en général sur un corpus bibliographique.
Un résumé est une version plus brève d'un texte de départ qui essaie néanmoins d'en restituer l'essentiel et d'en conserver la dynamique.
Illettrisme
Pendant longtemps, la lecture reste réservée à une élite. Pour l’UNESCO, l’analphabétisme est l’incapacité de lire et d’écrire des textes simples en rapport avec la vie quotidienne. En 1980 on estimait que 30% de la population mondiale était analphabète. Dans les pays industrialisés, environ 4% de la population souffre d’illettrisme: bien qu’ayant appris à lire, ces personnes en ont progressivement perdu l’habitude. Toutefois, de nombreuses polémiques existent sur les critères définissant ces populations. Les chiffres peuvent varier du simple au triple. On restera donc prudent sur les estimations quantitatives. Le terme d'« illettrisme » a été créé en 1978 par l’association ATD Quart Monde afin de décrire la situation des personnes qui ayant pourtant été scolarisées, n’ont pas la capacité d’utiliser l’écrit d’une manière aisée. Ce terme est en concurrence avec celui d’alphabétisation fonctionnelle que l’on trouve hors des frontières françaises. Le terme de « littératie » prend actuellement une place plus importante. Il pose de manière explicite la question des capacités à traiter l’écrit dans « une économie de la connaissance ». Si la question de l’alphabétisation est portée par l’UNESCO, celle de la littératie est portée par l’OCDE.
On estime entre 10 et 14% la proportion de personnes âgées de 18 à 65 ans en difficulté de lecture en France (enquête Information et Vie Quotidienne de l'Insee). Ce "taux d'illettrisme" est beaucoup plus élevé que ceux des enquêtes de l'Insee d'il y a une dizaine d'années.
La dyslexie est un trouble fonctionnel de l’apprentissage de la lecture.
Lecture dans la littérature
Un des chefs-d'œuvre de la littérature occidentale, Don Quichotte de Cervantès, est une réflexion critique sur la littérature. C'est la littérature elle-même, et non pas seulement les romans de chevalerie, qui pose problème et conduira Alonso Quijano à la folie et la mort. Annonciateur de la « mort de l'écriture », le récit de Cervantès montrerait la tension existant désormais, depuis la Renaissance, entre le texte et un contexte où « s'imposent les valeurs d'échange »; entre l'écrit ancien, sacré, qui épousait la « prose du monde », et la littérature, substitut profane de celui-ci[2].
Don Quichotte dessine le négatif du monde de la Renaissance; l'écriture a cessé d'être la prose du monde; les ressemblances et les signes ont dénoué leur vieille entente; les similitudes déçoivent, tournent à la vision et au délire; les choses demeurent obstinément dans leur identité ironique : elles ne sont plus que ce qu'elles sont; les mots errent à l'aventure, sans contenu, sans ressemblance pour les remplir; ils ne marquent plus les choses; ils dorment entre les feuillets des livres au milieu de la poussière. Michel Foucault, Les Mots et les Choses (1966).
Le bovarysme, du nom de Madame Bovary, comme le quichotisme (ou Don-quichotisme) est également attribué aux dangers de la lecture. Joseph Vebret estime que le procès du roman de Flaubert était celui de la lecture :
[Q]u’est-ce que le procès de Madame Bovary, au-delà de l’atteinte aux bonnes mœurs et des scènes jugées scabreuses par l’inénarrable procureur Pinard, si ce n’est le procès de la lecture ? Celui d’avoir mis en scène une femme qui trompe son mari ? Non, d’avoir mis en scène une femme qui lit trop et ne se contente plus de sa vie, de son gentil mari et de sa belle situation de notable de province, de tout ce qui est réputé rendre une femme heureuse; bref, c’est le procès du livre qui pervertit les esprits, pollue les relations et vient troubler l’ordre établi. Qu’on se le dise, notre société est anti-littéraire.[3]
Lecture en peinture
L’histoire de la lecture se lit aussi à travers les œuvres de peintres qui nous offrent des scènes différentes et suggestives de l’acte de lire. On a des scènes de lecture individuelle, collective, semi-collective. Des scènes de lecture publique et privée. Ces tableaux dessinent des portraits différents des lecteurs et de leurs modes de lire. On peut aussi y trouver des lectorats féminins, masculins, mixtes ou encore qui appartiennent à plusieurs âges. La lecture à haute voix y apparaît comme l’image opposée de celle de la lecture silencieuse. Il suffit, par exemple, d’observer les tableaux ci-dessous pour distinguer des représentations différentes des lectrices et des modes de lecture.
-
La Liseuse de romans Antoine Wiertz, 1853
Daniel S. Larangé considère que la lecture ouvre, au cours du XIXe siècle, un nouvel "espace" représenté généralement, en peinture par des "cadres". Cette “ouverture” ou “fenêtre” sur une dimension insoupçonnée se retrouve dans des tableaux où le sujet lisant est généralement associé à une “brèche” dans son enfermement. Dans le portrait d’« Arthur Fontaine lisant dans son salon », Édouard Vuillard, représente son ami plongé dans un livre, entouré de cadres (tableaux, porte et fenêtre à carreaux). Le personnage n’est pas vraiment le sujet du tableau : il occupe une place décentrée, dans l’angle inférieur droit, enfoncé dans un fauteuil. Les lignes de fuite des cadres des tableaux suspendus sur le mur de droite se rejoignent hors cadre, dans un point de fuite imaginaire, derrière la porte. Alors que le corps du peintre est présent dans la pièce, son esprit “a pris la porte” et est “sorti du cadre” de la représentation par le biais de la lecture. Une analyse identique est effectuée sur "La jeune femme au chevalet: lecture" de Georges Seurat, "La liseuse" de Renoir, "La lectrice" de Fantin-Latour et "Lecture d'un poème" de Daumier.
Notes et références
- Extrait de la préface de J'apprends à lire avec Pilou et Lalie. Françoise Demars et Sylvia Dorance / L'Ecole vivante
- « Miguel de Cervantes ». Magister.
- Vebret, Joseph (2009). Des dangers de la lecture... 14 septembre 2009
Annexes
Bibliographie
Lecture et neurosciences
- Dr Wettstein-Badour, LECTURE : LA RECHERCHE MEDICALE AU SECOURS DE LA PEDAGOGIE, prix ENSEIGNEMENT ET LIBERTE 1994, (ISBN 2-9507412-0-7)
- Dr Wettstein-Badour, POUR BIEN APPRENDRE A LIRE ET A ECRIRE AUX ENFANTS, nouvelle méthode alphabétique et plurisensorielle, 1996
Sociologie de la lecture
- Chantal Horellou-Lafarge et Monique Segré, Sociologie de la lecture, Paris, La Découverte, 2003 (2e éd. 2007), (ISBN 978-2-7071-5316-6)
- C. Baudelot, M. Cartier et Ch. Détrez, Et pourtant ils lisent..., Paris, Le Seuil, 1999
- A.-M. Chartier et J. Hébrard, Discours sur la lecture, Paris, Fayard, 2002
- N. Robine, Lire des livres en France des années 1930 à 2000, Paris, Cercle de la librairie, 2000
- Daniel S. Larangé, L'Esprit de la Lettre: Pour une représentation du spirituel dans la littérature française des XIXe et XXe siècles, Paris, L'Harmattan, 2009 (Ouverture philosophique), (ISBN 978-2-296-09271-6)
Essais
- Alberto Manguel, Une histoire de la lecture, Arles : Actes Sud, 1998, (ISBN 978-2-7427-2399-7)
- Émile Faguet, L’Art de lire, Collection des Muses, Hachette, 1923 (Wikisource)
Articles connexes
- Livre
- Lecture rapide
- Lecture à voix haute
- Lecture numérique
- Écriture
- Observatoire national de la lecture
- Les Neurones de la lecture, essai du neuropsychologue Stanislas Dehaene
Liens externes
- Apprendre à lire avec la méthode Fransya, une méthode pour TOUS les enfants quelles que soient leurs capacités
- Dr Wettstein-Badour
- Les difficultés en lecture, le goût de lire, l'apprentissage précoce: l'avis d'un orthopédagogue
- Oculométrie cognitive en lecture
- VoixHaute - Atelier de lecture et de pédagogie du français
- La méthode abc-de Haan, une méthode pour ré-apprendre à lire à l’enfant en difficulté
- Liste des livres français accessibles en ligne avec le projet Gutenberg
Wikimedia Foundation. 2010.