- Eudes Rigaud
-
Eudes Rigaud Archevêque de Rouen 
Naissance vers 1210 à Brie-Comte-Robert Évêque Archevêque de Rouen Décès 2 juillet 1275 à Gaillon 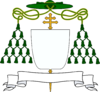
Eudes Rigaud (vers 1210 à Brie-Comte-Robert - 1275 à Rouen), membre de l'ordre franciscain, est archevêque de Rouen de 1248 à 1275.
Sommaire
Sa famille
Eudes Rigaud est né dans une famille qui possédait le fief de Courquetaine près de Brie-Comte-Robert[1]. Il a deux frères : Pierre, chevalier et Adam, franciscain[1]. Une de ses sœurs Marie est abbesse du Paraclet (1249-1266)[1]. Son neveu Adam Rigaud deviendra doyen du chapitre de Rouen[1].
Sa carrière
Déjà moine franciscain en 1236, il devient rapidement l'un des plus grands intellectuels de l'ordre[1]. Il est un des rédacteurs du commentaire officiel de la règle franciscaine en 1241, avec trois autres frères[1]. Il suit l'enseignement d'Alexandre de Halès, philosophe et théologien scholastique anglais, et reçoit sa maîtrise en théologie en 1242[1]. Il succède à Jean de La Rochelle comme maître régent à Paris en 1246[1]. Abbé du couvent Saint–Marc de Rouen, ce maître en théologie fut élu archevêque de ce diocèse en 1247. Il est sacré à Lyon en mars 1248 par Innocent IV et fait son entrée à Rouen le 19 avril 1248[1].
Il est connu pour son journal de visites pastorales dans le diocèse de Rouen, où il constate les insuffisances de la réforme des mœurs du clergé. Il consacre au cours de son archiépiscopat l'église du couvent des franciscains de Rouen en 1261 et aide ou multiplie de nombreuses fondations: les Templiers (vers 1250), la collégiale Notre-Dame de la Ronde (1255), les Trinitaires (1259), les Carmes (1260), les Dominicaines aux Emmurées (1261)[1]. Il effectue au cours de son archiépiscopat de nombreux voyages en France, en Angleterre ou en Italie[1].
Il acquiert au compte de l’archevêché de nombreuses propriétés foncières: la seigneurie de Pinterville, près de Louviers pour 3 200 livres en 1260, la forteresse et la seigneurie de Gaillon en 1262, propriété du roi Louis IX, en échange de 4 000 livres[1] et de moulins à Rouen. Ils deviennent la propriété perpétuelle des archevêques et leur résidence d'été. Il fait l'acquisition de moulins à Rouen et Déville, des étangs de Martainville près de Rouen, de nombreux terrains et maisons à Gaillon, Louviers et Dieppe[1].
En tant que conseiller et proche de Louis IX, le 12 mars 1268, il prêche la Croisade aux halles de la Vieille Tour. Il quitte Rouen pour rejoindre l'armée des Croisés le 15 mars 1270. Avant de mourir le 25 août, le roi Louis IX de France le désigne parmi ses exécuteurs testamentaires, et il devient membre du conseil de régence charger de gouverner la France[2]. Il est la première personne que le roi Philippe III le Hardi désigne pour composer un conseil dans le cas d'une régence, suivant un acte dressé à Carthage le 2 octobre 1270[1]. En 1274, après avoir dépouillé les rapports préparatoires avec l'évêque de Tripoli et Bonaventure de Bagnoregio, il prend part au Concile de Lyon où il représente les églises de France[1].
Il meurt le 2 juillet 1274 à Gaillon et est inhumé dans la chapelle de la Vierge de la cathédrale Notre-Dame de Rouen, sous un enfeu sans gisant[1].
Le théologien
Disciple d'Alexandre de Halès, son Commentaire sur les Sentences a influencé Bonaventure qui le copie parfois. Bien que méfiant à l'égard des philosophes, il incorpore des notions d'aristotélisme aux doctrines augustiniennes[3].
Ouvrage
- Regestrum visitationum archiepiscopi rothomagensis : journal des visites pastorales d'Eude Rigaud, archevêque de Rouen, A. Le Brument, Rouen, 1852, lire sur Gallica.
Eudes Rigaud est reconnu pour son carnet de voyage relatant avec précision ses journées et la vie en Normandie au XIIIe s., Regestrum visitationum archiepiscopi Rothomagensis.
« À tire-larigot »
Cette expression viendrait de ce qu'une des cloches suspendues dans la tour Saint-Romain de la cathédrale de Rouen se trouvait être celle offerte par le célèbre Archevêque de Rouen et conseiller de Saint Louis : Eudes Rigaud. Cette cloche, une des plus grosses de son temps, était si lourde et si difficile à mettre en branle, qu'on donnait à boire à ceux qui avaient la charge de la sonner. D'où l'expression : « Boire à tire la rigaud ».
En réalité, cette expression trouve plus vraisemblablement son origine dans le larigot, sorte de flûte[4].
Bibliographie
- Pierre Ouzoulias, Eudes Rigaud et le « vieux chemin » Paris-Rouen, lire en ligne.
Notes
- Vincent Tabbagh (préf. Hélène Millet), Fasti Ecclesiae Gallicanae 2 Diocèse de Rouen : Répertoire prosographique des évêques, dignitaires et chanoines des diocèses de France de 1200 à 1500, Turnhout, Brepols, 1998, 447 p. (ISBN 2-503-50638-0), p. 87-89
- René Herval, Histoire de Rouen, Maugard, 1947
- Cf. Dictionnaire des Philosophes, p. 2229, PUF, 1984
- Albert Dauzat, Jean Dubois, Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, éditions Larousse 1971. Plus probablement, il faut passer par le larigot comme jeu d'orgue (flûte aiguë au son perçant)pour comprendre cette expression : on ne "tire" pas une flûte, sauf sur cet instrument.
Lien externe
- Eudes Rigaud sur Wikitau, l'encyclopédie franciscaine.
Liens internes
Précédé par Eudes Rigaud Suivi par Eudes Clément Archevêque de Rouen 1248-1275 Guillaume de Flavacourt Catégories :- Archevêque de Rouen
- Homme croisé
- Histoire de Rouen
- Brie-Comte-Robert
- Franciscain
- Théologien français
- Philosophe français du XIIIe siècle
- Philosophe scolastique
- Date de naissance inconnue (XIIIe siècle)
- Décès en 1275
Wikimedia Foundation. 2010.
