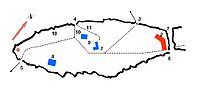- Camp celtique de la Bure
-
Site de hauteur installé sur un promontoire en grès, le camp celtique de la Bure, appelé « camp des Romains » par les populations paysannes d'autrefois, est un lieu d'observation remarquable des environs ou un point éminemment visible s'il est dénudé de couverture végétale. Il dominait la via salinatorum, ou voie des Saulniers, qui passait au nord en ligne droite d'Étival à Saales. Une statue d'un Jupiter à l'anguipède, sur un socle monumental, pouvait constituer une balise symbolique ou un phare allumé pour orienter le voyageur.
Le plateau aujourd'hui forestier est partagé entre la commune de Saint-Dié-des-Vosges et celle d'Hurbache. Les fouilles attestent l'habitation de ce site fortifié, occupé avant l’Antiquité jusqu'à l'aube de l'époque mérovingienne signalée par des traces de labour, entouré d'une muraille et en particulier sur sa face orientale d'un splendide murus gallicus. La découverte des deux plus grosses enclumes connues à l'époque en Europe et de nombreuses scories de forge attestent la présence d'une civilisation raffinée du fer au milieu du cadre verdoyant de la vallée de la Meurthe. Aussi des dilettantistes n'ont-ils pas manqué d'imaginer le modeste castellum gallo-romain en une belle et prospère « cité des Leuques ».
De belles stèles ainsi qu'une sélection parmi la multitude d'objets exhumés pendant plus de vingt années de fouilles archéologiques, menées par les équipes de la section archéologique de la Société philomatique vosgienne, sont exposées dans la salle Georges et Marcelle Tronquart au musée de Saint-Dié[1]. On peut y découvrir une maquette de l’ensemble du site.
Le camp celtique fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 6 août 1982[2]. le périmètre des versants et abords nord-est, aux lieudits Tête du Villé et Rein de Champ Cote, fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 5 avril 1993[2].
Situation d'un vieux camp des Romains
Le camp se situe au nord-ouest de Saint-Dié-des-Vosges, à 8 km environ du centre. Si plusieurs parcours permettent d’y accéder, l’automobiliste choisit souvent la route forestière qui mène d’abord au col de la Crenée[3]. De là, un sentier au départ abrupt, puis épousant une ligne de crête plus facile, conduit le promeneur-amateur d'archéologie jusqu’au bout du plateau en une vingtaine de minutes.
Entouré de rebords plus ou moins escarpés, le petit plateau aux formes molles s’étend sur 350 mètres de long et 120 mètres de large, à une altitude maximale de 583 m. Devant un panorama d’une telle ampleur, une table d’orientation en fonte érigée en 1992 facilite la mise en perspective de la vallée de la Meurthe, ainsi que l’identification des villages et sommets uniquement à l'occident.
Ces vestiges n'étaient pas inconnus des populations locales qui se réfugiaient autrefois en périodes d'insécurité dans ce lieu forestier. Elles pouvaient amasser leurs biens, observer de nouveaux arrivants, sécuriser les passes étroites et se défendre au besoin. Même si, sur le plateau, il n'y a jamais eu d'eau, les bûcherons continuaient de le nommer le camp des Romains. Des prospections judicieuses avaient été menées au XIXe siècle par Édouard Ferry (parent de Jules Ferry) qui voulaient prouver une antériorité – aujourd'hui évidente – d'occupation humaine avant la formation des grands bans, il était accompagné de Gaston Save, artiste dessinateur à la faconde créativité et l'imagination fertile. Le patient et prudent archéologue-amateur Paul Evrat, fils du maire de Saint-Dié, qui a aussi prospecté le site au cours des années trente, a déjà repéré parmi la dizaine de sites de hauteurs remarquables du secteur. Cette densité extraordinaire ne lui avait pas échappé.
Le chantier archéologique, l'abandon et la délicate restauration du site
Mais c'est surtout à partir des années soixante que des investigations systématiques ont été conduites, à l’initiative de la Société philomatique vosgienne, d’abord par une équipe d'amateurs au sein de laquelle a émergé l'assiduité de Georges Tronquart, professeur de lettres classiques au lycée Jules-Ferry de Saint-Dié-des-Vosges. Georges Trimouille, son président, également féru d'archéologie, a favorisé la poursuite des travaux. Le bibliothécaire Albert Ronsin, longtemps responsable du musée de la Société, a suivi les fouilles avec enthousiasme.
Le bibliophile a endossé au cours de voyages professionnels l'habit de représentant des fouilleurs et la charge de conférencier faisant part des découvertes et de l'avancée des travaux. Devenu conservateur d'un nouveau musée municipal en 1977, il a englobé les collections apportées par la fouille philomate dans la nouvelle section archéologique[4]. Devenu président de l'association, après la disparition subite de Georges Trimouille, Albert Ronsin a soutenu les chantiers. Malheureusement, les autorités de l'archéologie après 1986 déniaient aux bénévoles toute conduite de fouilles et de prospection. Le climat allait jusqu'au dénigrement systématique. Ainsi, les responsables de l'archéologie d'État ont déclaré vouloir interner le responsable bénévole des fouilles.
Le camp équipé d'une voie de portage et d'une cabane de chantier retourna à l'abandon. La Société philomatique vosgienne a longtemps payé l'assurance de la cabane de La Bure. La tempête de 1999 le dévasta déracinant maints grands arbres, mais épargna la robuste baraque. Des fouilleurs clandestins, utilisant des détecteurs de métaux, ont profité de la forêt dévastée. Les autorités locales ont réagi en affirmant pérenniser le site avec une instance de concertation. Le camp a été nettoyé et les visites ont repris, animée par le président de la Société philomatique vosgienne en personne. Les visites bénévoles n'ont jamais été considérées par l'office de tourisme. Cet organisme n'a jamais voulu former de guide suppléant, formation gratuite selon les vœux de la société. En 2006, la Société philomatique vosgienne a été déclarée non grata.
En 2007, une association a touché des subventions et obtenu les autorisations nécessaires des organismes compétents en la matière pour y consacrer des animations auprès d'un jeune public, animations qui ont permis de remettre le site en valeur. Ces chantiers de jeunes se sont poursuivis durant plusieurs années. Divers travaux ont été réalisés avec l'autorisation de la DRAC et du musée de Saint-Dié-des-Vosges.
Historique du camp celtique
Les pointes de flèche, grattoirs, lames et burins aujourd’hui déposés au musée constituent autant d'indices d’une vie humaine éparse sur cet éperon rocheux dès la fin du néolithique. En revanche, on ne trouve aucune trace de l’âge du bronze.
Il est hautement probable que le plateau ait servi de vaste carrière de taille. La forme général du plateau sécurisé provient d'un tel labeur de découpe rectangulaire, après avoir décapé la terre végétale. C'est avec ces pierres taillées que les bâtiments ont pu être appareillés à l'époque gallo-romaine, à l’aube du Ier millénaire. Les objets inhérents à cet habitat ont laissé une foule d'indices probants de présence continue.
On connaît au moins trois élaborations de remparts successifs. Le plus anciens est un murus gallicus gaulois. L'ensemble du rempart dont une partie était une palissade en bois a été ensuite agrandi et surélevé. Enfin, il a été déplacé et renforcé en de nombreux points en catastrophe avec des pierres de remblais provenant de stèles de sépulture. Les inscriptions ou postures révélatrices des stèles ainsi préservées du pillage, réalisées pendant cette deuxième période ou période gallo-romaine, dévoilent une population partiellement romanisée superficiellement. Les noms, telle Contessa, encore connu au XVIIIe siècle sont du gaulois romanisé et la langue gauloise, dont les derniers étymons sont repérés par les linguistes jusqu'au IXe siècle, semblent porter la culture des forgerons du lieu.
En dehors de la carrière, un intense travail de forge, signalé par d'abondantes scories, y a été réalisé. C’est ainsi qu’au IIe siècle, à la fin du règne de Marc-Aurèle, des enclumes massives et des outils précieux auraient été dissimulés à proximité du camp.
L'interprétation des fouilles est très délicate car le sol acide et lessivé ne permet aucune interprétation stratigraphique. Il n'empêche qu'une masse cumulée de petit objets métalliques, en cuivre, en bronze ou en fer, a été retrouvée. Parmi ces objets, des fibules non dégoupillées attestent un probable dépôt d'objets marchands fabriqués ailleurs, des clous de charpentiers de toute forme attestent au moins la réparation d'ouvrages en bois, de chariots et la construction de modestes baraques ou structures en bois. L'analyse des monnaies retrouvées permet de dater l'époque de l'activité optimale du camp gallo-romain.
Georges Tronquart a postulé que l'arrivée subite des Alamans au milieu du IVe siècle a mis fin à la vie du camp. Mais sa fonction de refuge en cas d'aléas n'a jamais cessé. La découverte d’un soc et de nombreuses rainures de charrue rappellent la présence de champs encore très proches au XIXe siècle. Seul le dôme de la Bure formait un chapeau forestier.
Les fouilles menées jusqu’ici n’ont pas permis d’établir une présence humaine suffisamment dense et permanente sur le site entre le Ve et le XVIIIe siècle, époque où on y érigea une croix. Un épieu de chasse et des éléments de haches ont été retrouvés, ainsi que des restes de harnachements mérovingiens. Le pillage en période de paix des pierres les plus aisées à manipuler ou bien taillées s'est poursuivi. Les paysans des Trois Villes y avaient coutume d'aller chercher en forêt leurs pierres de construction. Le camp de Romains constituait une solution de facilité.
Par contre, ce qui avait été pris à tort pour un Viereckenschanzen ou petit temple à la fin des dernières fouilles en 1986 trouve une signification dans les événements de 1914-1918. Il s'agit, après observation, d'une installation de l'ancêtre d'un mortier français.
Une modeste place-forte gallo-romaine et un toponyme de lieu de refuge
Dès le Ier siècle, le camp est entouré par un rempart continu en pierre, parfois coudé avec des épaisseurs exceptionnelles jusqu’à 6,80 m ou 7,50 m. Les constructeurs ont patiemment utilisé la roche de la montagne et les parties élevée d’une première enceinte comme carrière. Une partie orientale de ce rempart, plus ancienne près d’un accès principal, est construite selon la méthode du murus gallicus.
Jules César fait la description de cet ouvrage alliant les compétences de monteur de murs en pierre et de maître-charpentier dans la Guerre des Gaules. Deux parements de pierres sèches cadrent un blocage fait de sable, d’argiles et de blocs de pierre. Puis parement et blocage sont bridés par des lits de poutres en chêne posés en quadrillage et assemblés par de longs clous forgés d'environ vingt centimètres. Une portion de murus gallicus a été reconstitué in situ, elle permet la présentation en coupe afin de saisir la technique de construction.
Un nouveau rempart périphérique, inspiré de la technique gallo-romaine, fut élevé en 275 après J.-C. Une série de stèles funéraires y ont été découvertes. L’usage d’un tel matériau sommaire de réemploi, dont les motifs et reliefs n’ont souvent pas été effacés, dévoile l’urgence de la réfection. On ne connaît pas leur provenance, mais ils ont été pris dans un cimetière sur ou à côté du plateau de la Bure.
Des moulages de quelques stèles caractéristiques ont été dispersés près du sentier de visite sur le plateau. Les originaux, tels que la stèle dite du « Maître de forge » ou celle « à deux personnages », ont été mis en lieu sûr au musée de Saint-Dié.
L'oppidum comportait quatre portes. La base de la poterne nord (3) et plusieurs lits noyés sous les éboulis ont été retrouvés lors des fouilles de 1976. Sur la photographie ci-contre, au premier plan, on aperçoit un gros bloc mortaisé qui pouvait recevoir une poutre destinée à renforcer les battants de la porte, une fois celle-ci fermée (bras de force). Ici et là, des petites boules de granit ou de simples galets de la Meurthe rappellent la fonction défensive du camp. Un simple projectile jeté du haut du rempart mettait en fuite un groupe de rôdeurs.
Le chemin, qui a conservé une partie de son dallage, reliait le camp à une source, à la vallée et à la voie des Sauniers ou via salinatorum, qu’une probable erreur de copistes attribuent aux Sarmates (strata Sarmatorum) [5].
L’évolution et le maintien de toponyme Bure ont été influencés par quelques feux de bures, allumés au printemps par des jeunes montagnards sur une partie visible et défrichée du promontoire. Mais dès que le plateau était vraisemblablement couvert de forêts de chênes et de bouleaux, l’effet de signalement vis-à-vis des alentours était médiocre. L’étymon bure, encore écrit burre désigne pour les linguistes simplement les cabanes, les abris. Il est possible que des abris temporaires et précaires se soient maintenus près des amas de pierre des remparts et aient servi de lieux de refuge pour échapper aux brigandages et aux dévastations d'armées.
Il est exclu que le toponyme actuel Bure provienne du celte burrh, qui a laissé une trace chez les burough ou borough anglo-saxons[6]. Le roi anglais Alfred le Grand a multiplié lors la reconquête royale au IXe siècle ces dispositifs et les a transformés ensuite en place de commerce et d’échange, puis ses successeurs prospères en district administratif et en ville. Même s'il s’agit au départ d’un droit de protection derrière des remparts de cité en partie vides, en cas d’agression du peuple d’un district, les appellations anglaises ont fini par désigner une cité populeuse, ce que n'a assurément jamais été le camp de la Bure.
La tradition orale vosgienne rapporte néanmoins que les populations menacées se réfugiaient dans les vieux camps des Romains. Un droit local d'abri a pu être institué et maintenu. C’est pourquoi les ramasseurs paysans après le XVIIIe siècle ont été grosso modo respectueux des remparts enfouis. En prenant le tout-venant pierreux, ils étaient pourtant à la limite de la préservation de ce site refuge car ils fragilisaient les édifices qui s'éboulaient élément par élément.
La vie quotidienne
La population du camp à son apogée n’est pas connue. Certains modèles l’estiment à une centaine de personnes en temps de paix, et l’élèvent à plusieurs centaines en cas de menace. Les habitants permanents auraient vécu dans des maisons en bois, couvertes de toit de chaume et fermant à clé.
L’archéologue, scientifique prudent, se limite à l’activité d’un atelier de forge gallo-romain, c’est-à-dire à la famille du maître de forge, sa maison ou salla, ses dépendances agricoles ou cortis, bâtiment, four, pressoir, potager, arboretum et au-delà ses terres agricoles. La forge accueillait une clientèle habituelle ou de passage. En cas d’insécurité banale, le forgeron et ses aides n’avaient à déplacer l’équipement lourd. L’enceinte accueillait des réfugiés apeurés des collines et de la plaine voisine. Le maître de forge pouvait les équiper en outils, restaurer leurs armes et les rassurer.
En tout cas, une intense activité métallurgique est attestée par divers outils : couteaux, marteaux, gouges, pinces, haches, burins, et même deux enclumes parmi les plus lourdes du monde antique (11 et 23,5 kg) qui semblent avoir été cachés ou dérobés, puis oubliés, ainsi qu’une série de clous parfois incroyablement préservés entre les racines des arbres malgré l’acidité du sol.
La variété des objets retrouvées, vaisselle, faisselles, fusaïoles en céramique, des jeux et des pièces en bronze, des clarines pour les bêtes, des monnaies et de rares bijoux en or et en argent, et la représentation des personnages sur les stèles nous laissent imaginer un quotidien rustique, non dépourvu d’un certain raffinement. Les céramiques sont toutefois grossières et banales : l'inventaire récent des échantillons terreux opaques qui ont sali les mains des manipulateurs montrent des factures locales tout au long de la période d'occupation du site. Des paquets de fibules, non dégoupillées attestent la présence d'entrepôt temporaire d'objets métalliques. Voilà une preuve des échanges auxquels pourraient s'ajouter de dons cultuels dans des fosses sacrées, car un nombre important de monnaies soit 1 269, dont 346 gauloises contre 923 romaines, ont été mis au jour. À noter la part significative des potins leuques.
Sanctuaires religieux ou substructures d'habitat ?
Il existerait des sanctuaires vouées à différentes divinités, selon Georges Tronquart, qui admet un véritable syncrétisme des habitants du lieu, supposé en état d'isolement ou d'éloignement de centres romanisés.
En forme d'équerre (7), l'un de ces bassins cultuels serait consacré, selon Georges Tronquart, à Taranis/Jupiter, le dieu du ciel. Il peut constituer aussi une réserve d'eau, permettant en outre de laver le minerai. Les archéologues aujourd'hui sceptiques devant ces charmeuses interprétations considèrent ces formes rectangulaires comme provenant de l'extraction de la pierre, à partir de technique romaine privilégiant les formes en équerre. Les trous aujourd'hui inondés n'auraient eu aucune fonction de divination, mais aurait pu constituer de simples caves profondes sous une habitation haute.
Deux cavaliers à l'anguipède en grès rose (IIIe siècle), dont une tête remarquable par la finesse de ses traits, ont été retrouvés à proximité, aux côtés de vestiges de monnaies gauloises et étalons en plomb d'époque romaine. Les archéologues du service de la DRAC ont judicieusement proposé une grande statue balise orientant la voie des Saulniers au nord. Les sculptures auraient ainsi trôné sur un socle de colonne, quelques menus restes pierreux pourraient être des débris des colonnes effondrés.
L'autre bassin (8), celui dédié selon Georges Tronquart aux Déesses-mères/Dianes, est rectangulaire (6,60 m sur 5,10 m). Il est creusé dans la roche jusqu'à 65 cm de profondeur et entouré de deux marches. Un fragment de stèle votive portant l'inscription « Dianis » a été découvert près du bassin : une trouvaille assez rare, car le pluriel de la déesse Diane n'apparaît quasi-jamais durant l'Antiquité. Les meilleurs spécialistes de la période moderne identifient le terme dianis à des réunions de femmes sur les roches de hauteur, encore communes au milieu du seizième siècle[7]. Les femmes se réunissaient, partageaient le savoir de sage-femme et célébraient cette assemblée par des pratiques protectrices de magie blanche. L'église et l'autorité locale, méfiante vis-à-vis de ces anciennes pratiques assimilées à de la magie noire, ont interdit ces rituels et exorcisé de tel lieu en utilisant ce terme dianis qui signifie sorcières.
L'hypothèse d'une cave accessible sous une structure construite tient également. Dans cet autre modèle moins religieux, qui considère la montagne vosgienne au cœur d'une romanité gauloise tardive avant la vigoureuse, mais éphémère restauration au second empire, on remarque que les bâtiments aujourd'hui enlevés au site par des générations de paysans sont bâtis sur une ancienne carrière. Les fermes des Trois Villes ou d'Hurbache contiennent dans leurs murs sans doute de la pierre de la Bure, qui a pu être incorporée dans un rempart et reprise dans une structure d'habitation dans le camp ou inversement, avant d'être enlevée au site.
Témoignant du vieux monde gaulois et de la civilisation romaine, le castellum de la Bure n'a pas encore livré tous ses secrets. Des zones d'ombre subsistent, et les jeunes amateurs d'archéologie auront à prendre la relève des amateurs bénévoles de la Société philomatique vosgienne. Contrairement à des critiques acerbes, ces derniers n'ont pas démérité, ils ont bien souvent accompli une œuvre de longue haleine avec des moyens ridicules et l'aide généreuse et inopinée de personnes dévouées, souvent les plus humbles.
Notes et références
- Cet article a été complété en hommage à l'œuvre assidue de Georges et Marcelle Tronquart et des équipes bénévoles de fouilleurs philomates. Néanmoins, les hypothèses archéologiques ont évolué au cours des trente dernières années. Il en est tenu compte.
- Ministère de la Culture, base Mérimée, « Notice no PA00107274 » sur www.culture.gouv.fr.
- Pour l'étymologie de ce toponyme, lire l'article Ormont (montagne).
- Elles appartenaient de droit à la ville de Saint-Dié qui avait fait autoriser la fouille sur le sol
- Cela ne veut pas dire que l’Empire romain n’ait pas placé des populations déplacées arbitrairement d’Europe centrale, en particulier des Sarmates après le troisième siècle. Les soldats sous le second empire étaient surnommés barbari, ils étaient souvent des mercenaires étrangers à la civilisation de la basse latinité.
- Une étymologie totalement éradiquée pourrait être burrh huncrini, mentionnant la proximité de la Crenée ou Incrinnis. Le terme qualificatif de la forteresse qui rappellerait l'appartenance au massif primitif de l'Ormont aurait donné le nom du col au village disparu, La Crenée. Sur le flanc ouest du plateau de la Bure, il existe en tous cas un lieu-dit évocateur, le Chastel.
- Communication de Jean-Claude Diedler
Bibliographie
- Georges Tronquart, Le « Camp celtique » de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges, Le Chardon, 1989, 127 p.
- Le Camp celtique de la Bure, guide édité par la Société philomatique vosgienne, Saint-Dié-des-Vosges, 1997 (1re éd. 1984), 40 p.
- Comptes-rendus de l'état des travaux dans de nombreux numéros des Bulletins de la Société philomatique vosgienne depuis 1965 (en consultation à la médiathèque Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges).
Liens externes
Catégories :- Monument historique classé en 1982
- Monument historique inscrit en 1993
- Ville ou oppidum celtique
- Site archéologique de France
- Saint-Dié-des-Vosges
- Monument historique des Vosges
- Architecture militaire antique
- Éperon barré
Wikimedia Foundation. 2010.