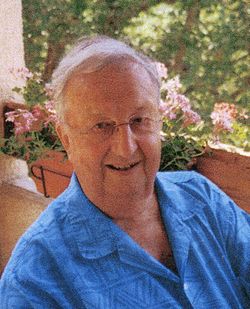- Jean-François Paillard
-
Jean-François Paillard Naissance 12 avril 1928
Vitry-le-FrançoisActivité principale Chef d'orchestre
Récompenses 29 grands prix du disque Distinctions honorifiques Chevalier de la légion d'honneur et de l'ordre national du mérite Jean-François Paillard est un chef d'orchestre français né le 12 avril 1928 à Vitry-le-François. Outre la définition d'une esthétique musicale reconnue par de nombreux musiciens, il a redécouvert une partie de la musique française écrite avant Berlioz.
Sommaire
Biographie
Jean-François Paillard a reçu sa formation musicale au Conservatoire de Paris et au Mozarteum de Salzbourg. Élève d'Igor Markevitch pour la direction d'orchestre et de Norbert Dufourcq pour la musicologie, il est également licencié ès-sciences.
Il a fondé, en 1953, l'Ensemble instrumental Jean-Marie Leclair (inspiré du nom de ce compositeur), qui devint, en 1959, l'Orchestre de chambre Jean-François Paillard. Son premier disque Musique française au XVIIIème siècle édité en juin 1953 a été révolutionnaire dans le domaine de l'interprétation de la musique baroque. Ont suivi quantités d'autres enregistrements qui ont rapidement imposé aux interprètes du monde entier de reconsidérer de fond en comble l'interprétation des pages européennes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Outre son activité discographique colossale, il a effectué pendant 50 ans des tournées sur les cinq continents, et en particulier en Europe, aux États-Unis et au Japon. Tous les grands festivals de la planète se sont disputés sa participation : c'est ainsi qu'il a dirigé en concert 1480 fois Les Quatre Saisons de Vivaldi.
Il a d'autre part longuement collaboré avec les plus grands instrumentistes français de son époque, que ce soit en concert ou sur disque. Il faut citer notamment le trompettiste Maurice André, les flûtistes Jean-Pierre Rampal et Maxence Larrieu, la harpiste Lily Laskine, les hautboïstes Pierre Pierlot et Jacques Chambon, le claveciniste Robert Veyron-Lacroix, l'organiste Marie-Claire Alain, le bassoniste Paul Hongne... Tous admiraient chez le maître la justesse des tempi, la richesse de la pâte sonore, la netteté de l'articulation et la largeur du geste.
Son orchestre comprenait 12 cordes et un clavecin. Le poste de premier violon a été confié à Huguette Fernandez jusqu'en 1969, puis à l'un des plus grands violonistes français du XXème siècle :Gérard Jarry.
Jean-François Paillard a aussi été invité à diriger d'autres orchestres (English Chamber Orchestra, Los Angeles Chamber Orchestra, Ottawa Chamber Orchestra, le Symphonique de Tokyo...) avec lesquels il a produit plusieurs enregistrements. Il a par ailleurs édité les séries Archives de la musique instrumentale et publié La Musique française classique en 1960.
En avril 2008, le Japon lui a réservé les plus grands honneurs à l'occasion de ses 80 ans. Les États-Unis viennent par ailleurs d'élire un de ses enregistrements dédiés aux mélodies baroques célèbres, « the best selling classical recording of all time ».
Son esthétique
Jean-François Paillard n'est pas un musicien « romantique » qui s'est converti au baroque. Parallèlement à sa direction d'orchestre, il a fouillé toutes les bibliothèques européennes à la recherche des traités d'exécution des musiques composées avant Mozart. Ainsi, dès avant 1960, il avait rassemblé la majeure partie des écrits encore existants. Par ses enregistrements (environ 10 par an dès 1956), il a pu faire connaitre à l'ensemble des conservatoires européens les résultats sonores et stylistiques de ses recherches. Au milieu des années 1960, plus aucun orchestre en Europe ne jouait « romantique » les pages du Baroque, contrairement à ce qui se faisait partout seulement 10 ans plus tôt[1].
Au milieu des années 1970, la révolution « baroqueuse » était en marche. Jean-François Paillard, n'a pas adhéré aux nouveaux partis esthétiques qui ont tenté de s'imposer en Europe au cours de la décennie suivante. Il a même refusé catégoriquement l'essentiel de ce qui a fait le succès du mouvement "baroqueux": instruments anciens, diapason 415, gonflement des notes, voix d'enfants dans la musique vocale... Sa probité en matière d'interprétation lui a, un temps, amené l'inimitié parfois sévère de certains critiques français. Mais elle lui a permis, depuis deux décennies maintenant, de montrer la voie juste et largement admise aujourd'hui entre les "romantiques" et les "baroqueux".
En ce début du XXIe siècle, l'esthétique de Jean François Paillard est peu ou prou adoptée par tous les conservatoires nationaux. C'est effectivement une belle synthèse entre le phrasé romantique et la vague baroqueuse. Cette esthétique est même tutélaire dans les conservatoires de certains pays, tels les pays asiatiques ou les États-Unis[2].
Discographie
Son activité discographique a été impressionnante : plus de 300 enregistrements récompensés par un palmarès à ce jour encore inégalé de 29 grands prix du disque. Ces enregistrements ont permis au public français de découvrir au cours des années 1960 les grandes pages de la musique baroque tels que le Canon de Pachelbel, Water Music de Haendel, les concertos pour trois et quatre clavecins de Bach, et la plus grande partie des œuvres instrumentales des compositeurs français des XVIIe et XVIIIe siècles. Il a enregistré nombre de pages en première mondiale, parmi lesquelles l'intégrale des 12 concertos de Jean-Marie Leclair (la seule enregistrée encore à ce jour).
Son premier enregistrement lança la firme française ERATO. Il a d'ailleurs été le musicien qui a assuré les plus gros succès de cette firme avec, entre autres, le concerto pour flûte et harpe de Mozart, le Canon de Pachelbel ou les Brandebourgeois de Bach. Sa collaboration avec ERATO durera 32 ans, et se terminera brutalement à la suite du départ de Philippe Loury, patron de la firme. J-F Paillard avait alors produit 235 enregistrements sous ce label. Deux années plus tard en 1986, il signait avec BMG, avec lequel il a collaboré jusqu'en 2002.
En 2010, Jean François Paillard avait vendu 9 millions de disques.
Quelques enregistrements historiques :
- J S Bach : Suite en si mineur, enregistrée en 1958 (avec Ch. Lardé) en 1962 (avec M. Larrieu) en 1968 (avec M. André) en 1971 (avec J P Rampal) en 1976 (avec A Marion) et en 1987 (avec Ph. Pierlot).
- J S Bach : Concerto en ré mineur pour clavier, enregistré en 1958 et en 1968 (avec R Veyron-Lacroix), en 1961 (avec G Sebök), en 1977 (avec M Cl Alain) et en 1993 (avec R. Siegel).
- J S Bach : l'intégrale des Brandebourgeois, enregistrée en 1973 (avec M André, J-P Rampal, A Marion, P Pierlot, J Chambon, P Hongne, G Jarry et A M Bekensteiner) et en 1990 (avec Th Caens, J J Justafré, M Larrieu, M Sanvoisin, Th Indermüle, G Jarry et R Siegel).
- Vivaldi/J S Bach : Concerto à 4. Version 4 violons en 58 (avec H Fernandez) en 70 et 89 (avec G Jarry). Version 4 claviers en 59 et 68 (avec R Veyron Lacroix), en 81 (avec A Queffelec).
- Vivaldi : Les Quatre Saisons, enregistrées en 1959 (avec H Fernandez) en 1976, 1988 et 1991 (avec G Jarry) en 2002 (avec S Kudo).
- Haendel : Water Music, enregistrée en 1960, 1973 et 1990.
- Albinoni : Adagio, enregistré en 1958, 1975, 1983, 1988, 1990 et 1996.
- Mozart : Petite musique de nuit, enregistrée en 1960, 1969, 1978 et 1987.
- Mozart : Concerto pour clarinette, enregistré en 1958 et 1963 (avec J Lancelot) et en 1991 (avec M. Arrignon).
Bibliographie
- Jean-François Paillard, La Musique française classique, coll. Que sais-je ?, no 878, PUF
- Thierry Merle, Le Miracle ERATO par les plus grands musiciens français et Jean-François Paillard, EME, 2004 (ISBN 2952141304)
- Benoit Duteurtre, « Raz-le-bol de la dictature des intégristes du baroque » in Marianne décembre 2000
Notes et références
- archives ERATO, Warner London
- Thierry Merle, Le miracle ERATO
Wikimedia Foundation. 2010.