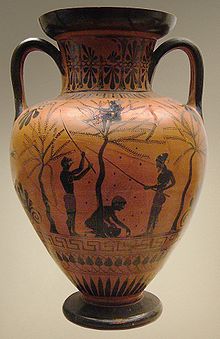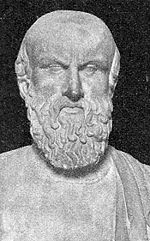- Histoire de l'homme occidental
-
L’histoire de l’homme occidental est l’étude des faits qui concernent l’identité culturelle de l’homme occidental à travers son histoire. Elle évacue toute composante événementielle dans le but d’illustrer comment ce dernier a évolué dans ses façons de penser et de vivre au quotidien, dans ses croyances et ses pratiques[1]. L'histoire de l'homme occidental se cadre dans l'approche de l'histoire culturelle, ou plutôt de l'histoire des mentalités, cette troisième génération de l'École des Annales aussi parfois appelée nouvelle histoire[2]. Pour ce faire, une division temporelle structurée autour d'époques historiques communément admises est nécessaire, ces dernières étant l’Antiquité grecque puis romaine, le Moyen Âge – Haut et Bas – puis l'époque moderne[3].
L’histoire de l’homme occidental se concentre sur des facteurs qui, dans sa vie, structurent son identité : son éducation, sa participation à la vie politique, sa religion, les façons et le sens qu’il donne à la guerre, la manière dont il parvient à satisfaire ses besoins en produisant, échangeant et consommant, sa vie domestique, sa vie publique et, surtout, sa conception de la vie bonne, du bien et du mal.
L’homme grec
 Ruines du temple d'Apollon à Delphes, qui comportait "connais-toi toi-même" sur son fronton.
Ruines du temple d'Apollon à Delphes, qui comportait "connais-toi toi-même" sur son fronton.
Comprendre l’homme grec nécessite, comme le souligne Vernant[4], « un style de présence au monde et de présence à soi que nous ne pouvons pas saisir sans un sérieux effort de distanciation méthodique, exigeant une véritable restitution archéologique[5] ». Simon cité par Vernant parle ici du concept de la vision chez l’homme grec, ou plutôt de son rapport à la connaissance, car vision et savoir sont deux formes verbales d’un même terme[6]. En apercevant le « connais-toi toi-même » à Delphes, le Grec n’allait pas procéder à une introspection individuelle; il allait reconnaître ses limites de mortel, inférieur aux dieux. C’est que l’identité grecque se constitue à travers l’autre, par son regard, dans l’ordre social, dans la communauté et dans l’ordre cosmique du divin[7]. Ces fondements identitaires aboutissent nécessairement à une éthique de la honte et de l’honneur, si constitutifs de l’homme grec, plutôt qu’à une morale de la faute et du devoir[7]. Il est assoiffé d’excellence et la reconnaissance est son gouvernail[8].
Devenir grec
«Quel est l’être à une seule voix qui marche tantôt à deux pattes, tantôt à trois, tantôt à quatre? » En répondant « l’homme », Œdipe avait résolu l’énigme du Sphinx qui illustre merveilleusement les trois âges de l’existence grecque. Les quatre pattes, symbolisant l’enfance, représentent le stade naturel[9]. Le stade pleinement humain est le stade culturel auquel parvient l’enfant qui aura surmonté un accouchement difficile, une alimentation souvent inappropriée et une mauvaise hygiène et qui aura une constitution normale, de sexe masculin et des parents citoyens ne l’ayant pas exposé[10]. Il va sans dire que les femmes étaient (en majorité) exclues du processus d’épanouissement culturel, politique et guerrier[11].
L’enfant devenait homme et citoyen, chez les Spartiates, à la fin d’un très long parcours[12]. Dès sept ans, son éducation, ou plus exactement son élevage, commençait alors qu’il était regroupé dans un agélai (troupeau à guider). On le soumettait à un entraînement par discipline où on lui inculquait obéissance et combativité. Sa tête était rasée, il avait les pieds nus, qu’un vêtement par saison et dormait directement sur des paillasses de roseaux. Peu nourri – il devait voler de la nourriture sans se faire prendre – on l’obligeait à s’exercer nu sous le soleil brûlant[13]. Un homme libre éduquait le troupeau en offrant récompenses et punitions et en organisant des compétitions pour dégager l’élite. On y enseignait la musique, le chant, la danse, les exercices gymnastiques ainsi qu’un minimum de lecture et d’écriture. Des batailles fictives étaient organisées. La cryptie était pratiquée par les élites et consistait à déposer le jeune Spartiate en plein air, seul, sans vêtements ni vivres et ne devant pas se faire voir le jour. Comme l’évoque Pierre Vidal-Naquet[14], la cryptie était l’exact opposé de l’hoplite, faisant partie d’un rite de passage nécessaire à l’intégration dans la vie guerrière. Toutefois, les détails entourant la cryptie sont contestés et débattus parmi les universitaires.
 Coupe de Douris.
Coupe de Douris.
Chez les Athéniens, l’initiation à la vie d’homme commençait bien plus tard[15],[16]. À compter de douze ans, le jeune Athénien pouvait commencer à fréquenter le gymnase sous la direction du pédotribe. Il s’exerçait intensément et nu (au moins à partir de la période classique)[17] à diverses disciplines : course, lancer, pancrace, lutte, saut, etc. Les relations homosexuelles, tout comme à Sparte, en Crête ou à Thèbes, se pratiquaient normalement entre un homme plus âgé et un adolescent imberbe. Le rôle actif, associé à la masculinité, au rang social et au monde de l’adulte était réservé au pédéraste tandis que le rôle passif appartenait au jeune éromène[18]. Ces relations particulières – pour préserver la dignité de l’adolescent, il n’y avait pas de pénétration, mais un coït intercrual[19] – avaient un caractère pédagogique et on les effectuait sûrement en public, au gymnase[20].
 Joueur d'aulos, lécythe attique à fond blanc, v. 480 av. J.-C., musée archéologique régional de Palerme
Joueur d'aulos, lécythe attique à fond blanc, v. 480 av. J.-C., musée archéologique régional de Palerme
L’instruction intellectuelle avait lieu au didaskalion, école où on devait payer, à la faveur de l’aristocratie, pour recevoir une instruction. On y apprenait à lire et à écrire en compagnie d’un esclave par enfant, le pédagogue, qui accompagnait et surveillait en tout temps le jeune. On apprenait par cœur Homère qui fut « toujours considéré comme un réservoir de valeurs et comme un point de repère sans égal fournissant des modèles de conduite[21] ». Les mathématiques étaient rares, mais les compétitions de lecture et de récitations étaient fréquentes, surtout à la période hellénistique. On y apprenait aussi la musique et le chant, deux disciplines d’importance capitale. Puis à dix-huit ans venait le temps de l’Éphébie, sorte de service militaire obligatoire de deux ans. Cette pratique, comme celle des didaskalion, était décelable dans une centaine de cités. Les éphèbes étaient instruits par deux pédotribes, un maître d’armes, un professeur de tir à l’arc, un de javelot et un dernier de catapulte. Suite à leur participation à la fête d’Artémis, ils recevaient de la cité une lance et un bouclier. Ils étaient maintenant hommes[22].
Le citoyen grec
Être citoyen à Athènes, c’était être né de père citoyen et de mère fille de citoyen, être libre et être un homme adulte[23]. À l’époque classique, il y avait à Athènes un citoyen pour quatre esclaves donc 120 000 esclaves pour 30 000 citoyens environ[24]. Le reste de la population était composé de femmes, d’enfants et de métèques. Le citoyen était également guerrier : il a longtemps dû s’armer à ses frais, excluant de la citoyenneté les indigents. Les guerres médiques contre les Perses et la nécessité d’une marine solide firent que les thètes, composant une bonne moitié du corps civique[25], devinrent citoyens malgré leur statut inférieur. L’empire maritime qui en découlait allait favoriser grandement l’élargissement de la démocratie. Les citoyens aisés finançaient pour une bonne part la cité : la construction de bateaux, les nombreuses fêtes et le théâtre vivaient de l’argent des riches qui donnaient aussi parfois nourriture et vêtements aux habitants de leur dème afin de s’attirer leur sympathie (tel fut le cas de Clisthène ou de Périclès). La « liturgie » leur était parfois exigée, cette contribution substantielle, plus ou moins spontanée. Arthur Rosenberg compare ces riches à une véritable vache à lait : « Le prolétaire athénien n’avait rien contre le fait qu’un fabricant, un commerçant ou un armateur gagnât le plus d’argent possible à l’étranger ; il aurait une somme d’autant plus grande à payer à l’État[26]. »
Toutefois, cette citoyenneté agrandie, bien qu’elle faisait l’affaire des démocrates, rendait furieuse les oligarques qui souhaitaient revenir à un élitisme oligarchique à la spartiate. Ils réussiront leur coup en 411 et en 404, mais jusqu’aux invasions macédoniennes, Athènes sera avant tout une démocratie.
De cette démocratie hors norme ou simplement de leur organisation politique en cité, ils étaient fiers. Les barbares des régions froides étaient courageux, mais dépourvus d’intelligence. Ils étaient libres, mais inaptes à s’organiser politiquement et à dominer les peuples environnants. L’opposé est vrai des barbares d’Asie, dotés d’une grande intelligence, mais dénué courage. Au milieu se trouvaient les Grecs, courageux et intelligents, forts et bien organisés. La démocratie entretenait, comme l’explique Canfora, une conception personnelle de l’État parce qu’elle était la somme de ses citoyens et parce que ses revenus étaient les revenus des individus qui le formaient. Thucydide qui cite Nicias l’exprime ainsi : « Ce sont les hommes qui font les villes et non les remparts ni les vaisseaux vides de défenseurs[27] ». Cette définition de la cité avait pour conséquence l’érection d’anti-États réclamant l’unique statut de cité légitime fondée sur une « constitution des ancêtres[28] ». La vision d’une cité où le dèmos était tout a aussi eu pour effet la notion de progrès, s’exprimant le mieux par l’évolution rapide des lois.
L’objectif n’est pas l’atteinte d’une tradition immémoriale, mais la recherche du bien et du juste, donnant du poids au résultat de leurs délibérations : « Les Grecs s’enorgueillissaient de n’avoir qu’un seul maître : la loi[29] ». Cette facette du politique grec, qui entretient d’étroites relations avec la rationalité, est unique et fonde la perception linéaire du progrès si cher à l’Occident.
Les privilèges de la citoyenneté sont harmonieusement équilibrés par les devoirs publics. En plus de participer à l’Assemblée, l’Ecclésia, tous les dix jours, il peut être tiré au sort pour faire partie de la Boulè, le conseil exécutif qui assure la conduite des affaires courantes ou il peut encore être tiré au sort pour être membre de l’Héliée, le tribunal populaire[30]. À cela s’ajoutent les pratiques religieuses, les cérémonies, les banquets et les fêtes, mais surtout le devoir le plus honorable et le plus grand : la guerre.
Le Grec et la guerre
La guerre est, avec la politique, l’unique sujet de préoccupation des historiens grecs et avec raison : l’Athènes classique est en guerre plus de deux ans sur trois et la paix ne dure jamais plus de dix ans. Les citoyens ont l’obligation d’être disponibles pour combattre de 19 ans à 49 ans et jusqu’à 59 ans pour la réserve. L’excellence du guerrier est proportionnelle au courage dont il fait preuve sur le champ de bataille ainsi qu’à son contrôle. On considère la mort au combat comme étant honorable, digne, voire belle. Cela ne signifie pas que l’homme grec est un animal sauvage, un barbare qui combat illégitimement. Au contraire, il répugne la guerre civile, analogue à un conflit familial, et il croit en théorie à de stricts principes de la guerre juste que sont la déclaration de la guerre, l’exécution des sacrifices appropriés, le respect des lieux et des personnes ainsi que des actes, la permission au vaincu de relever ses morts et, dans une certaine mesure, l’abstention de cruautés gratuites. On répugnait au moins dans la période archaïque l’action à distance, surtout celle des archers. À partir de la guerre du Péloponnèse, l’usage des peltastes armés d’un javelot et d’un léger bouclier sera nettement plus répandu et accepté dans de nombreuses circonstances.
Les charges militaires étaient inséparables de la citoyenneté et proportionnelles au statut. Les grands centres de décision se concentraient entre quelques mains au sommet de la hiérarchie sociale, politique et économique. Le grand maître n’était nul autre que le Stratège.
Si Athènes est de réputation et de fait belliqueux, il est malavisé de croire que les mille cités grecques se battaient à son rythme. L’histoire qui nous est surtout parvenue est celle des grandes puissances impérialistes, nécessairement combatives, tandis que la plupart des cités États ne se battaient que rarement et de façon limitée, et moins encore pendant la période archaïque que classique. L’attitude de l’homme grec envers la paix diffère aussi de ce que l’on peut s’attendre d’un peuple en guerre le deux tiers de son temps. Dans plusieurs textes comme ceux d’Aristote ou même d’Homère, la paix est louangée et associée à l’abondance, à la douceur, à la joie et aux jouissances alors que la guerre est décrite avec un registre plus exigeant. On associe le combat à l’abstinence, à l’effort, à la douleur et au chagrin. Il reste que, comme le souligne Garlan[31], la guerre est une chose respectable, moralement justifiable et même souhaitable. La paix est perçue non pas comme un état naturel délectable, mais comme l’aboutissement obligatoire des durs labeurs de la lutte armée.
Attaquer, c’est payant. Vaincre en territoire ennemi donne accès aux rançons versées contre des captifs de guerre, si ceux-ci ne sont pas vendus ou mis en esclavage, alors que le bétail ennemi est capturé de même que les récoltes et les objets précieux ou utilitaires. Une victoire signifie une appropriation territoriale et souvent le versement de tributs – sorte de paiement à la cité conquérante. Il va sans dire que les valeureux combattants recevaient une part de choix, généreuse et grasse tandis que les autres empochaient une solde et une répartition séduisante. On peut donc aisément saisir l’importance capitale de la défense des terres de sa propre cité – terres possédées entièrement par les citoyens – expliquant du même coup l’origine indissociable du citoyen-propriétaire guerrier. Faut-il ajouter que l’invasion n’impliquait pas que pillages et destruction : viols, massacres et traîtrise aggravaient une défaite déjà moralement écrasante.
À partir d’environ 650 av. J.-C., l’homme grec se bat de façon disciplinée et ordonnée, en unité que l’on nomme phalange. Il porte une armure lourde comprenant, sur le bras gauche, un bouclier circulaire de 85 cm de diamètre et dans la main droite une lance de 2,5 m. Cet équipement coûteux excluait les citoyens de la quatrième classe censitaire. Au même moment où Sun Tzu écrivait L’Art de la guerre en recommandant imprévisibilité, manigance et manipulation, les guerriers grecs se battaient face à face, sans surprise, 10 000 hommes enlignés par épaisseur de 8 hommes s’allongeant sur 2,5 km. L’issue du combat était déterminée par les ailes sauf s’il y avait rupture du front. On se battait souvent en temps de récolte, en matinée, et des esclaves aidaient à transporter les vivres et équipements. Les plus vieux occupaient la première ligne alors que ceux qui étaient les plus motivés par le combat prenaient le flanc droit. Le combat ordonné laissait place, au plus fort de la bataille, à des affrontements singuliers. Les pertes étaient généralement de 14% chez les perdants et de 5% chez les vainqueurs[32].
Par rapport au combat héroïque, la phalange grecque constituait une nette amélioration dans l’art de la guerre. Elle proposait cependant un rapport collectif laissant moins de jeu aux prouesses individuelles si chères à l’identité grecque fondée sur le regard des autres. Cette façon de se battre doit certainement être considérée parmi les causes de l’apparition des jeux athlétiques, comblant le vide créé par l’approche collective au combat. Il reste que la phalange grecque ne sera pas la plus puissante pour longtemps, dominée par la phalange macédonienne. Dans la période hellénistique, les bonnes vieilles méthodes de guerre changeront, laissant place à la ruse, la trahison, la surprise et l’habileté technique.
Garlan souligne une corrélation profonde entre le type d’armée et le régime politique qui se développe en réaction à celui-ci. Il associe une cavalerie dominante à une oligarchie, une démocratie modérée aux hoplites et des fantassins légers à une démocratie. Une autre corrélation est décelable entre la géographie et le type de régime. Une acropole va de pair avec une oligarchie ou une monarchie, un terrain plat est plus propice à la démocratie alors qu’une multitude de secteurs fortifiés convient à une aristocratie.
Le Grec et l’économie
 Laboureur. Coupe à bande attique à figures noires. vers 530 av. J.-C. Musée du Louvre
Laboureur. Coupe à bande attique à figures noires. vers 530 av. J.-C. Musée du Louvre
Le citoyen était au guerrier ce que le guerrier était à l’agriculteur propriétaire : « de toutes les conditions sociales prédisposant à l’activité militaire, la plus valorisée était celle d’agriculteur[33] ». Xénophon confirme son propos dans Économique (V) : « Ce que je te dis là, Critobule, c'est pour t'apprendre que même les plus heureux des mortels ne peuvent se passer de l'agriculture. En effet, les soins qu'on lui donne, en procurant des plaisirs purs, augmentent l'aisance, fortifient le corps, et mettent en état de remplir tous les devoirs de l'homme libre. (…) Comme elle semble offrir ses productions au premier venu, et qu'elle se laisse dépouiller par le plus fort, elle encourage aussi les cultivateurs à la défendre les armes à la main. Est-il un art qui forme mieux à courir, à sauter, à lancer le javelot, qui enrichisse plus ceux qui en font profession; qui offre à l'amateur des charmes plus touchants? Vous paraissez; aussitôt, vous tendant les bras, elle vous offre ses trésors, vous invite à choisir. Peut-on recevoir ses hôtes avec plus de munificence qu'elle [34]? »
Les auteurs grecs tels qu’Hésiode, Xénophon ou Aristophane décrivaient une campagne idéale, abondante et paisible. Bien que la réalité de ces descriptions soit contestée, il reste que le rôle de l’agriculture chez l’homme grec était capital. Une écrasante majorité (20 000 sur 25 000) de citoyens possédait la terre, la plupart de ceux-ci faisant partie de la petite ou de la moyenne paysannerie qui constituait le noyau des hoplites. Cette paysannerie était organisée en villages et les possessions du citoyen étaient gouvernées par plusieurs esclaves de confiance lorsque ces terres étaient parcellées et par un seul intendant – lui aussi esclave – lorsque les terres étaient réunies en un seul domaine. La gestion des terres procédait différemment chez les Spartiates qui assignaient absolument tout aux hilotes, leurs esclaves. Les métiers d’artisans étaient tenus en piètre estime. Ces travaux « ruinent le corps des ouvriers qui les exercent et de ceux qui les dirigent en les contraignant à une vie casanière, assis dans l’ombre de leur atelier, parfois même à passer toute la journée auprès du feu. Les corps ainsi amollis, les âmes aussi deviennent bien plus lâches[35]. » Ces gens passaient pour de mauvais défenseurs de la patrie et c’est pourquoi la plupart des artisans étaient esclaves ou métèques (étrangers). Les métiers se comptaient par dizaines : l’un pouvait être architecte (même si son salaire n’était que légèrement plus élevé que celui de travailleurs ordinaires), tailleur de pierre, sculpteur, charpentier, forgeron, menuisier, teinturier, doreur, ivoirier, peintre, tapissier, graveur, armurier, pilote, cordier, tanneur, mineur, parfumeur, cordonnier, etc.[36].
 Pesée de marchandises, amphore du Peintre de Taléidès, v. 540-530 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art
Pesée de marchandises, amphore du Peintre de Taléidès, v. 540-530 av. J.-C., Metropolitan Museum of Art
Une part substantielle de la main-d'œuvre n’avait pas le statut d’homme libre : les esclaves. Ceux-ci étaient très actifs dans les ateliers placés sous la gouverne de leur maître-artisan. Ils constituaient une part non négligeable de la main-d'œuvre nécessaire aux constructions publiques, recevant un salaire équivalent celui des ouvriers citoyens, mais qui était déversé en partie à leur maître. Certains d’entre eux appartenaient à l’État qui leur octroyait une indemnisation de nourriture. D’autres, malchanceux, étaient loués par des concessionnaires à qui l’État avait confié l’exploitation de mines moyennant une rente. Ils pouvaient travailler à l’extraction minière ou contribuer à la transformation des matières premières en travaillant dans des ateliers postés près des mines[37].
Un autre secteur florissant était celui de la construction d’armes. On employait dans l’atelier – qui servait également de magasin de vente – des métèques et des esclaves pour produire des casques, aigrettes, épées, piques et boucliers d’or, d’argent ou de cuivre. Les artisans étaient assez spécialisés et leur travail se résumait à de la gestion et du commandement. Ils étaient généralement riches, mais il ne faut pas exclure les petits artisans indépendants travaillant de leurs propres mains dans des boutiques entourant l’agora.
Alignement d'oliviers dans un champ de Thasos
Dès l’époque mycénienne, les vases grecs circulaient jusqu’en Orient ou en Italie témoignant des échanges qui avaient déjà lieu. Chez Homère, les commerçants sont les Phéniciens, car les Grecs n’avaient pas encore connu l’explosion commerciale du VIIIe siècle. L’instauration de colonies, même où les terres étaient de mauvaise qualité, renforce cette hypothèse. Les commerçants étaient soit endettés et ne pouvaient plus vivre de leur terre soit de riches propriétaires ayant un surplus à liquider. Généralement, les Grecs exportaient du vin et de l’huile, car ils étaient facilement entreposés dans d’énormes jarres et parce qu’ils se conservaient bien. Commercer, c’était partir à l’aventure sur une mer capricieuse qui abritait potentiellement des pirates, mais qui promettait des richesses inimaginables possibles par l’écart des prix relatifs dont tire profit tout échange commercial international[38]. Toutefois, les marchands professionnels ne pouvaient se vanter d’avoir une part intéressante des nouvelles richesses.
La monnaie, utilisée vers la fin du VIIe siècle, facilite les échanges et sera tellement utilisée vers le Ve siècle que les commerçants athéniens n’avaient pas besoin de rapporter une cargaison de l’étranger : la monnaie suffisait. C’est à ce moment qu’Athènes devient la plaque tournante des échanges : fer, cuivre, étoffes fines, parfums, épices, etc. L’État prenait sa part des bénéfices via une taxe à l’exportation et à l’importation et imposait une réglementation sur le prix du blé qui était déjà sous le joug des spéculateurs. L’activité commerciale n’est pas vraiment l’affaire des riches. Des métèques ou citoyens contractent des prêts afin de charger leur première cargaison sur un navire qui leur appartient parfois puis sont autonomes par la suite. Les risques de naufrage, de piratage ou de bigoterie sont l’exception au prélèvement de la garantie prévue par l’hypothèque : un commerçant perdant pour ces raisons sa cargaison n’avait pas à rembourser son prêt ce qui donna naissance à des naufrages frauduleux. Tout un droit se développa autour du commerce à Athènes comprenant tribunaux et législations précises qui rapportaient, en raison des frais exigés, d’importants revenus à la cité. Les activités connexes comme les services banquiers d’échange de devises ou de dépôts et prêts connurent aussi un essor remarquable[39].
La vie privée et la vie publique
S’il est si difficile de tracer un portrait détaillé de la vie domestique en Grèce Antique, ce n’est pas parce que nous savons peu des Grecs, mais parce que ceux-ci ne rédigeaient que ce qui était honorable ou du moins utile. L’absence dans les écrits de la vie domestique et ce que nous savons des Grecs nous permet de déduire que celle-ci était répudiée : on l’associait à une émotivité instable, antisociale et propice à de basses motivations. Elle était à l’abri de la rigueur morale qu’exigeait l’acte public soumis au regard tempérant d’autrui.
Contrairement à une foule d’autres peuples, les Grecs ne connaissaient aucune histoire d’amour avant Dysclos de Méandre rédigé en 316 av J.-C. Lorsqu’on incluait mariages et séduction, le but était, avant Méandre, toujours instrumental. L’ordre culturel fondé sur le mariage et la succession venait contrecarrer la nature égoïste de l’homme. Ce rôle n’était pas à proprement parler moral : fonder une famille faisait partie des responsabilités civiques du citoyen. Ce mariage reposait sur le transfert du contrôle de la femme de son père à son époux. Une dot était versée au mari qui la possédait recevait uniquement si le mariage ne fonctionnait pas. Il faut toutefois éviter de croire que les mariages étaient arrangés : l’homme négociait personnellement pour l’acquisition de sa femme et il était rare que son père la mariât à un homme sans obtenir l’avis de sa fille.
On attribue en partie l’absence d’amour dans le mariage aux portraits sombres que peint le théâtre de l’époque. Contrairement à ce qu’en témoignent les épopées, la tragédie n’offrait pas de modèle idéalisé du mariage qui aurait le potentiel de le rendre davantage attrayant. Marier une femme, c’était en quelque sorte céder à la tentation comme l’illustre si bien le mythe de Prométhée. Ce dernier, après avoir volé le feu que Zeus lui avait retiré, ne peut pas résister aux charmes de Pandore, la première femme du monde (envoyée par Zeus), qui apporte avec elle un vase qui, ouvert, libère la maladie, le travail et la discorde. Pour Hésiode, donc, le mariage est sacrifice. Il faut toutefois nuancer ces propos. Bien que cette opinion de la femme fût fort répandue, elle s’accompagnait du constat qu’elles nourrissaient, qu’elles faisaient vivre.
Pour James Redfield[40], l’évacuation de la vie privée peut être analysée comme étant une condition culturelle nécessaire à l’existence de la cité État qui mise tout sur la vie publique, d’où la formule d’Aristote voulant que l’homme soit un animal politique. Comme en témoignait son éducation, l’homme grec était un animal public sans cesse à la recherche de distinctions, d’inégalité et d’honneur. Le tribunal moral qu’était la vie publique excluait strictement les femmes. On les associait à l’instabilité émotionnelle et à l’irrationalité. « La maison était un lieu non de compétition, mais de coopération, non d’idées, mais d’objets, non d’honneurs, mais de biens, d’ornements, de meubles[41]. » À l’instar des Bororos décrits par Lévi-Strauss, l’espace privé et naturel était féminin alors que l’espace public et culturel des idées, des débats et des prouesses était masculin. Cette ascension vers un état de plus en plus culturel et donc public et masculin était perçue idéalement par nombre de Grecs qui s’avouaient jaloux de la part gargantuesque allouée à la vie publique chez les Spartiates. Leurs femmes étaient perçues comme étant fautives, responsables du désordre et du luxe de par leurs tendances antisociales et leurs basses motivations. Toutefois, cette femme n’était pas négligée. L’honneur de la famille en dépendait, donc des efforts particuliers étaient épuisés afin d’assurer pour elles une instruction respectable. Mais encore, c’est une affaire d’homme, l’honneur, qui en fut la condition d’existence.
La vie intellectuelle et artistique
La vie artistique athénienne était florissante, innovatrice et stimulante. Des historiens tels que Robin Osborne[42] y voient la cause déterminante qui permit le développement de la pensée philosophique et scientifique. D’autres comme Kelly L. Ross[38] attribuent la naissance de la philosophie à l’ascension sociale et économique d’une classe de commerçants qui exerçaient une pression massive sur le système politique qui eut pour conséquence la conception de la démocratie et le climat de questionnement, de débats et de rhétorique qui l’accompagne. Il attribue toutefois une importance capitale à la vie artistique qu’il voit comme la conséquence du système politique intellectuellement stimulant de par ses tribunaux et assemblées.
Les Grecs innovèrent en architecture, en sculpture, dans l’art de la céramique (vases) et en peinture[43]. Ils accordaient également une grande importance au chant, à la danse et à la musique qu’ils étudiaient intensivement. Ils inventèrent le théâtre – le drame et la comédie – et furent les créateurs de deux des plus grandes épopées du monde : L’Iliade et L’Odyssée. Les œuvres théâtrales et poétiques étaient riches en ce sens qu’elles projetaient l’idéal du vertueux citoyen[44], décrivaient la vie et l’origine des dieux[45], contenaient des images et symboles fracassants[46], exposaient l’auditeur ou le lecteur à des débats éthiques sans cesse redéfinis[47], bref, des éléments favorisant une réflexion essentielle sur le monde.
Avec le développement de la pensée philosophique, comme dans la tragédie, « la pensée et la vue pénètrent dans l’inconnu[48] », d’où la proximité entre le tribunal et le théâtre. Cette étape axiale dans l’histoire des idées fait de l’homme grec un être d’exception qui ne peut être séparé de sa vie artistique. « Les spectateurs d’Eschyle et de Sophocle sont devenus les lecteurs de Platon et d’Aristote[48]. »
La vie sociale
 Banqueteurs jouant au cottabe pendant qu'une musicienne joue de l'aulos, cratère en cloche du Peintre de Nicias, v. 420 av. J.-C., Musée national archéologique, Madrid
Banqueteurs jouant au cottabe pendant qu'une musicienne joue de l'aulos, cratère en cloche du Peintre de Nicias, v. 420 av. J.-C., Musée national archéologique, Madrid
La vie sociale était structurée autour des rites de commensalité (sacrifices, repas et autres activités). De tout temps, les femmes étaient exclues des banquets mis à part les esclaves qui amusaient les invités. À l’âge héroïque (avant la période archaïque), l’hôte invitait les membres de sa classe pour s’attirer honneur, autorité et prestige. Ces invités étaient nombreux et étaient assis pendant qu’on effectuait les sacrifices, qu’on mangeait, écoutait de la poésie, buvait, regardait des danses et écoutait des chants et de la musique. À l’âge archaïque, cette formule fut grandement modifiée. Les invités étaient couchés pendant le banquet en raison, explique Oswyn Murray, de l’isolement aristocratique face à l’ascension démocratique. Ils ornaient la pièce de vases, décorations, peintures, louches, pichets et coupes, ils chantaient la poésie sur un fond de musique, souvent la double flûte, la cithare ou la barbitos[49]. On parlait de guerre, d’exploits héroïques, d’amour homosexuel, de politique. Cette forme isolée de célébration sociale avait pour but non plus la prise en charge de la guerre extérieure dans un environnement stable comme ce fut le cas à l’âge héroïque, mais l’unification de membres privilégiés défendant leurs intérêts de classe en réponse au déclin de l’aristocratie[50].
La différenciation aristocratique passait dorénavant par le plaisir, le luxe, le confort, la poésie et une sexualité libertaire : acrobates, bouffons, flûtistes, mimes, artistes de la danse et du théâtre divertissaient les invités. Les femmes esclaves qui étaient présentes étaient presque nues et elles finissaient souvent – comme les garçons – dans le lit d’un invité. La relation avec le garçon se définissait par une intensité romantique entre deux hommes de même classe sociale tandis que l’amour pour les jeunes filles esclaves était désinvolte et celles-ci étaient traitées comme des objets sexuels[51].
Les comportements étaient strictement réglementés, ce qui n’empêchait pas les participants à s’adonner à des orgies, au vacarme et à des bagarres. En sortant d’un banquet, les convives ornés de guirlandes paradaient saouls dans les rues, dansaient sauvagement, criaient des injures aux passants et se bagarraient avec eux, endommageaient des biens dans une démonstration de puissance et de supériorité sociale.
 Banqueteur puisant dans un cratère grâce à une œnochoé pour remplir son kylix de vin, v. 490-480 av. J.-C., musée du Louvre
Banqueteur puisant dans un cratère grâce à une œnochoé pour remplir son kylix de vin, v. 490-480 av. J.-C., musée du Louvre
La période classique introduit un nouveau type de banquet, celui de l’élite politique dans un contexte démocratique. Ceux-ci se passaient au prytanée, le lieu central de la commensalité publique. Les archontes y recevaient leurs invités officiels et la présence à ces banquets n’était permise en permanence qu’à une petite élite. Dîner au prytanée était « le plus grand honneur que la cité démocratique puisse conférer, et c’est un honneur auquel aucun membre ordinaire du dèmos ne saurait prétendre[52]. » On invitait les ambassadeurs, les vainqueurs des jeux et autres citoyens que la cité souhaitait honorer. Le seul sujet de débat convenable était l’amour et on y parlait souvent des affreuses mœurs barbares[53]. De plus, les banquets de style archaïque avaient toujours lieu, surtout parmi les oligarques qui tentaient de reconquérir Athènes.
Pendant la période hellénique, l’effondrement de la démocratie s’accompagna d’une redéfinition de la citoyenneté : être citoyen voulait dire appartenir à une élite culturelle. Les banquets de cette élite étaient extraordinairement luxueux et les monarques s’attiraient l’assentiment du peuple par leurs nombreux actes de bienfaisance publique comme ce fut toujours le cas en Grèce Antique. Même les étrangers recevaient de leurs dons. C’est dire que son évacuation du politique se traduisit par ces dons massifs visant à acquérir honneur, gloire et sentiment public[54].
La vie religieuse
Les dieux sont omniprésents dans le quotidien des Grecs, mais leur culte n’est ni dogmatique ni accompagné d’institutions religieuses hiérarchiques. Il n’y avait ni révélation directe, ni prophètes, ni livre sacré. Il n’y avait pas non plus d’interprètes ou de fonctions sacerdotales permanentes et professionnelles et encore moins de dogmes imposés et vérifiés et la question de la vie après la mort est marginale. Il n’y avait pas de mot pour désigner « religion » et croire en dieu ne voulait pas dire « je crois en l’existence réelle des dieux ». Crédulité et incrédulité, crainte et désinvolture caractérise le rapport qu’ont les Grecs avec le divin[55].
 Poseidon, le dieu de la mer, Copenhague.
Poseidon, le dieu de la mer, Copenhague.
Les Grecs voyaient le sacré dans une multitude de choses : l’ordre de la nature, l’alternance des saisons, des récoltes, du jour et de la nuit, la vie sociale, le mariage, la naissance, la sépulture, la politique et le pouvoir. Parmi les rites propitiatoires figuraient les sacrifices, les invocations et les prières qui s’inséraient dans un calendrier rituel strict. Enfreindre les normes divines attirait la contamination, phénomène transcendant l’espace juridique et moral. Elle entraînait une vengeance divine s’appliquant autant à l’individu qu’à sa communauté et sa descendance. Avoir des plaies ou les mains tachées de sang montrait la souillure de l’individu qu’on bannissait de la communauté. Des rites prescrits par l’oracle venaient pallier certaines souillures plus graves[56].
La religion grecque était en quelque sorte le produit de la poésie épique et des représentations artistiques en général. L’Iliade vient durablement ordonner un chaos de légendes immémoriales, ce qui consolida grandement la religion grecque. Les dieux qui y sont décrits ont une personnalité, un caractère propre garni de vertus et de vices qui témoigne non seulement de leur imperfection, mais aussi des débats éthiques entourant leur conduite. La Théogonie d’Hésiode vient accomplir un rôle similaire, mais cantonné à la structure généalogique des dieux qui détermine le pouvoir et la position hiérarchique respective de ceux-ci[57].
 La rage d'Achilles de Giambattista Tiepolo.
La rage d'Achilles de Giambattista Tiepolo.
Une corrélation non négligeable subsistait entre l’élite aristocratique guerrière et les dieux à un point tel que les familles aristocratiques se réclamaient de descendances divines . Les dieux étaient beaux, intelligents, forts, vertueux, immortels et passionnés et leur présence était familière. Ces derniers ont plusieurs pouvoirs qui leur sont spécifiques. Les douze grandes divinités de l’Olympe sont Zeus, Héra, Poséidon, Athéna, Apollon, Dionysos, Artémis, Aphrodite, Déméter, Hermes, Héphaistos et Arès. On vénérait également plusieurs autres dieux secondaires comme Hadès, Hestia, Éros et Perséphone et on alla même jusqu’à intégrer d’autres dieux à l’époque classique comme Dikè, Eirènè, Tuchè[58].
Les dieux, comme les hommes, étaient appelés à servir dans la cité. En échange des pratiques ritualisées, on s’attirait leur service. Que ce soit la guerre, la colonisation, les lois, traités ou contrats, un dieu en assurait la protection. Comme les hommes, ils étaient citoyens : on érigeait des statues en leur hommage au centre de la cité. Les charges sacerdotales qu’on leur devait étaient effectuées par des citoyens élus ou tirés au sort qui n’avaient pas de compétence particulière dans le domaine. D’ailleurs, puisque les humains étaient condamnés par leur nature au travail, les dieux leur offraient en retour une centaine de journées de fête par année[59].
 Déméter remettant à Triptolème les graines sous les yeux de Coré, Musée national archéologique d'Athènes
Déméter remettant à Triptolème les graines sous les yeux de Coré, Musée national archéologique d'Athènes
Une facette secrète de la vie religieuse, même pratiquée par les femmes, les étrangers et les esclaves, subsistait dans l’ombre : les mystères d’Éleusis. Ces expériences profondes et individuelles réalisées la nuit dans un endroit caverneux orné de flambeaux promettaient un espoir de délivrance de la mort à travers le culte de Déméter et de Perséphone. Contrairement aux sectes savantes et religieuses, les mystères d’Éleusis étaient administrés par la cité. Les sectes savantes et religieuses telles que le mouvement orphique proposaient un contre-modèle à la cité et une vision altérée du divin et de ses origines. Le mouvement pythagoricien en est un autre[60].
Plusieurs philosophes critiqueront la religion grecque tels que Xénophane, Aristote et à peu près toutes les écoles philosophiques (stoïciens, épicuriens, platoniciens, pythagoriciens, sceptiques)[61].
L’homme romain
Végèce, écrivant un traité militaire environ un siècle avant la chute de Rome, dit des Romains qu’ils furent moins prolifiques que les Gaulois, « plus petits que les Germains, moins forts que les Espagnols, moins riches et moins rusés que les Africains, inférieurs aux Grecs dans les techniques et dans le raisonnement appliqué aux choses humaines[62] ». Toutefois, une supériorité décisive le distingua : la domination militaire assurée par l’exercice des armes, la discipline des camps et la manière d’utiliser l’armée. Évidemment, Cicéron dosait avec soin cette explication manichéenne du tout-puissant militaire. Il attribuait la grandeur de Rome à sa sagesse théologique, « l’observation scrupuleuse de la pietas et de la religio ». Ainsi, écrit-il, « Nous n’avons pas vaincu les Espagnols par notre nombre, ni les Gaulois par la force, ni les Carthaginois par la ruse, ni les Grecs par les techniques ». Mais il reste que la perception populaire contemporaine des Romains appartient davantage à la pensée – fausse – de Végèce. Cet homme serait moins cultivé que le Grec, plus petit que le Germain, mais un guerrier discipliné, efficace, valeureux et…organisé. Faut-il aussi ajouter les arènes couvertes de poussière et de sang, les gladiateurs exterminés, les chrétiens dévorés par les fauves et le prophète crucifié sur la croix.
Quelques données viennent vite relativiser les choses. Edward Gibbon dans sa célèbre Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain cite un cas qui frappe durement l’objectivité des thèses sanguinaires chez les Romains : « Si nous sommes obligés de nous en remettre à l’autorité de Grotius, il faudra convenir que le nombre des protestants qui furent exécutés dans une seule province et dans un seul règne dépasse de loin celui des premiers martyrs de tout l’Empire romain pendant une période de trois siècles[63]. »
L’homme romain n’est évidemment pas unique. La grande civilisation dans laquelle il s’épanouit dura plus de mille ans et il est faux de dire que l’homme romain sous les Tarquins est le même que l’homme romain sous Théodose, sans oublier les différences majeures issues de l’étendue géographique phénoménale de l’Empire. Malgré tout se dessine un homme romain avec sa façon de vivre une vie religieuse, sa façon de faire partie du politique, d’être esclave, une femme, un bandit, un affranchi, un juriste ou un marchand.
Le citoyen et le politique

Monarchie romaine
753 – 509 av. J.-C.
République romaine
509 – 27 av. J.-C.
Empire romain
27 av. J.-C. – 476
Empire byzantin
395 – 1453Magistratures ordinaires Consul
Proconsul
Préteur
PropréteurCenseur
Tribun
Édile
QuesteurMagistratures extraordinaires Dictateur
Maître de cavalerie
Tribun consulaireInterroi
Décemvir
TriumvirTitres et honneurs Empereur romain Auguste
César
Préfet du prétoire
Tétrarque
Dux
Magister militumPrinceps senatus
Pontifex maximus
Préfet de Rome
Imperator
Légat
LicteurInstitutions et lois Constitution romaine Sénat romain
Assemblées
Magistrats
Cursus honorum
AuctoritasDroit romain
Mos majorum
Citoyenneté
Imperium
PotestasSérie Rome antique La grandeur de Rome était généreuse chez les penseurs des Lumières, car ils l’assimilaient à l’égalité des droits, l’organisation, les mesures prises contre la pauvreté, les dettes, les secours publics et surtout la liberté tant glorifiée par Cicéron, Tite-Live, Plutarque voire Tacite dont les textes nous étant parvenus racontent la splendeur et la supériorité romaine. Les Romains, ce sont avant tout des citoyens gouvernés par des assemblées, des magistratures (pas plus de 36 au total) annuelles et un Sénat ou un Empereur. Être Romain, c’était avoir « droit de cité », c’est-à-dire être citoyen, et être citoyen, c’était être Romain, alors que l’ensemble des citoyens formait le peuple Romain. Les esclaves en étaient exclus contrairement aux affranchis. Dès les premières conquêtes de l’Italie qui s’achèvent en 272 av. J.-C., les Romains donnèrent droit de cité aux conquis quoique de façon très limitée (mais allant en augmentant) et parfois même sur une base individuelle. Il faut attendre la Guerre sociale de 90-89 pour que la citoyenneté soit étendue aux Italiens libres. Cependant, dans les faits, la population citoyenne ne sera qu’une minorité pour longtemps, même sous l’empire[64]. En l’an 212 après J.-C., l’ensemble de la population libre, masculine et adulte devenait citoyenne en vertu de la Constitution antonienne, quoique cette citoyenneté ne portât plus le poids qu’elle eût avant. Au fond, le concept de citoyenneté était juridique. Il signifiait que les relations personnelles, familiales, patrimoniales et commerciales allaient être réglées en vertu du droit romain. L’égalité de ce droit, tant vanté, n’a jamais existé dans la sphère politique et civique et n’a été véritable que pour une courte période (dernier siècle de la République) dans le droit privé, laissant place à une foule de privilèges juridictionnels, procéduraux et pénaux[65].
 La toge est l'apanage de la citoyenneté romaine. Les romaines et les habitants de l'Empire qui n'étaient pas citoyens ne pouvaient la porter.
La toge est l'apanage de la citoyenneté romaine. Les romaines et les habitants de l'Empire qui n'étaient pas citoyens ne pouvaient la porter.
La cité, pour les Romains, n’était pas une abstraction transcendante, mais une communauté d’intérêts. Solidarité instinctive et volonté de tirer profit des affaires communes s’affrontaient, occasionnant de fréquents bris du contrat par émigration, sécession, révolution ou guerre civile. Ces grands avantages avaient leur contrepartie : les devoirs du citoyen. Il devait premièrement offrir des prestations qui touchaient sa personne, ses biens et aussi ses conseils éclairés (obligations militaires, fiscales et politiques). Ces charges étaient antérieures à toute loi; rien ne devait les justifier. Elles étaient ancrées dans les fondements mêmes de la cité, avec le concept de l’équilibre des charges et des devoirs qui étaient assurés par les recensements quinquennaux. Le census (recensement) assignait une place précise et hiérarchisée à chacun des citoyens définissant ses responsabilités. Cette différenciation était le fondement du statut, la « condicio » ou « dignitas[66] ». Cette hiérarchie était vue comme étant proportionnelle à la valeur des individus (famille, âge, aptitude physique et morale, propriété, fortune). Les divisions étaient d’abord censitaires (5 classes), puis militaires (les 193 centuries) et géographiques (les tribus). Les plus pauvres composaient des centuries massivement plus nombreuses (plus de la moitié des citoyens dans la dernière) car chaque centurie devait fournir sa part des recettes publiques, sa part de sang et sa part de pouvoir politique lui donnant droit à 1/193 des votes[67]. Les riches étant moins nombreux, ils payaient plus lourdement en sang et en argent, mais disposaient proportionnellement de beaucoup plus de pouvoir aux comices centuriates, ces assemblées générales où chaque centurie déposait son unique vote. Il en va de même avec les tribus, où des 35, seules 4 étaient urbaines et le reste rustiques. Pour être inscrit aux tribus rustiques, il fallait posséder la terre. Les non-propriétaires, négociants et artisans étaient inscrits dans une tribu urbaine. Chaque tribu possédait un vote aux comices tributes même si beaucoup plus de citoyens peuplaient les tribus urbaines.
Les Romains participaient à des assemblées où un ordre du jour préparé par un magistrat structurait la rencontre. Le simple citoyen était dépourvu du droit de délibérer, mais il pouvait assister aux contiones pour recevoir informations et précisions auprès des magistrats et sénateurs qui débattaient. Il n’avait droit qu’à une réponse binaire (oui ou non) – qu’une majorité n’utilisait pas – face à ces enjeux qu’il ne choisissait pas et qu’il ne pouvait pas amender[68]. Jusqu’en 107 av. J.-C., le vote était fait oralement et devant tous (il devient secret et écrit après cette date), dans un ordre plus probablement hiérarchique qu’alphabétique. Les votes étaient fréquents et la présentation des projets de loi prenait beaucoup de temps, au moins 24 jours[69]. Puisqu’une telle activité requérait beaucoup de temps, il n’y avait probablement que très peu de citoyens qui participaient aux assemblées. De plus, le poids des tribus urbaines et des centuries populaires était supplanté par les tribus rustiques et les centuries équestres ou de première classe censitaire. Cependant, au premier siècle après J.-C. et pour diverses raisons, plusieurs habitants de Rome furent inscrits aux tribus rustiques sans toutefois pouvoir accéder à l’oligarchie des comices centuriates[70]. Même dans les tribus urbaines, comme le souligne Nicolet, « pour le vote, seuls comptaient les notables[71] » puisqu’avant 107 av. J.-C., le vote n’était pas secret et que la corruption et la fraude n’étaient pas rares, de même que les agitations et émeutes parfois extrêmement violentes ainsi que les groupes de gladiateurs et d’esclaves ou d’affranchis qui terrorisaient tels ou tels adversaires politiques dans les rues ou les contiones[72].
Le citoyen portait une grande attention aux décisions qui concernaient la loi agraire (meilleur partage des terres), la loi frumentaire (blé à prix réduit puis gratuit de 40 litres de blé par mois), la suppression des impôts, la loi sur les dettes et sur les taux d’intérêt et les lois garantissant une certaine liberté comme celles du vote secret[73]. En 58 av. J.-C., les lois frumentaires étaient financées par les conquêtes, mais coûtaient un cinquième du revenu de l’État (250 000 à 300 000 rationnaires de blé gratuit)[73]. À cette même époque, la première classe censitaire ne pouvait plus continuer à subir de lourds impôts de sang ; on abaissât probablement la barre censitaire puis on recrutât des paysans pauvres qui se portaient volontaires, augmentant ainsi leur influence au sein de l’appareil politique.
La classe politique, bien qu’exempte de limitations héréditaires, présentait un sérieux barrage censitaire. Pour être tribun militaire, il fallait un cens équestre ainsi que de l’expérience militaire et la pratique voulait qu’un magistrat ou un sénateur eût un père qui l’était également. Par contre, l’hérédité redevint nécessaire sous Auguste. Les charges politiques d’un individu ou d’une famille ne s’accompagnaient pas uniquement de privilèges juridiques, mais aussi d’un statut précisément hiérarchisé déterminant sa dignité et son honneur. La plus grande des vertus publiques de la classe politique était décidément l’art oratoire puisque celle-ci dépendait, au final, du suffrage du peuple[74]. À peu près aucune qualification théorique n’était nécessaire, donnant lieu à une gérontocratie puisque l’expérience vaut pour tout. Seul le tribunat de la plèbe ouvert aux jeunes hommes permettait une réelle initiative législative. La haute classe politique était très peu habile en administration ou en finances, mais toute une équipe d’esclaves, d’apprentis et de clients assurait la bonne gouvernance via des formations spécifiques qui apportaient un soutien considérable. Finalement, cette vie n’était pas le moins reposante; les magistrats et anciens sénateurs étaient d’abord des officiers et généraux qui ne furent pas épargnés par la guerre ou les assassinats politiques, d’où le refus d’ambitions personnelles de la part de plusieurs fils de sénateurs ou de chevaliers[75].
Le juriste
Toute l’histoire de Rome est pénétrée par la pratique du droit. Les juristes n’étaient pas seulement des spécialistes du droit, des savants ou connaisseurs. Ils créaient le droit, indépendamment du fait qu’ils recouvraient des charges publiques, et furent les seuls professionnels du droit de l’Antiquité[76].
Deux éléments majeurs de la mentalité romaine structuraient son identité et ses pratiques : la connaissance magique, sacrée et religieuse d’une part et le droit de l’autre, cette « construction lente et stratifiée d’un système de règles destiné à couvrir tous les comportements « sociaux » les plus importants des patres[77] ». De la même façon que la religion balisait strictement l’acceptable et l’inadmissible en plus de procurer un sentiment de singularité suprême, le droit indiquait la conduite gestuelle et verbale à adopter en vue d’atteindre les objectifs déterminés dans les relations avec les autres familles et les dieux. L’ius (droit) venait répondre à des problèmes immédiats et concrets, et cette réponse était au départ fournie par le pontife. La séparation du droit et de la religion est venue graduellement mais décisivement pendant la période républicaine au profit d’une proximité entre le droit et le politique. Le savoir juridique est quant à lui devenu la « grande et solitaire vocation intellectuelle de Rome[78] » au moment où son expansion se faisait au détriment du pouvoir magico-religieux. La connaissance du droit s’est ainsi mutée en une fonction de l’exercice du pouvoir dans la cité.
Créer le droit, c’était offrir une « responsa », une réponse qui devait d’abord s’appuyer sur les avis précédents. Dans ce contexte, l’innovation était pour le moins « un choix traumatisant[79] ». Même de plus en plus détachées de la pratique pontificale, ces responsa n’étaient pas justifiées. Elles s’appuyaient strictement sur des capacités ou habiletés secrètes. Toutefois, il est faux de croire qu’aucune aptitude particulière n’était nécessaire ; réservée à une élite aristocratique, la connaissance profonde des notions et doctrines du droit fondait la garantie de « vérité » de leurs responsa. D’autre part, le code juridique est longtemps resté oral, à la faveur des aristocrates, puisqu’on associait les lois écrites à une forme de démagogie populiste.
Le siècle précédant le passage à l’Empire fut témoin d’une profonde mutation du droit : un droit rationnel et formel a été pensé pour la première fois de façon abstraite avec des termes précisément juridiques. Était ainsi disloquée la proximité entre le droit et la politique, créant du même coup la classe des juristes professionnels ayant leurs propres motivations et intérêts. La fin de cette transition coïncida avec Auguste et elle fut suivie de deux siècles de perfectionnement et de complexification de même que d’une autonomie grandissante qui poussait le Prince à conclure des alliances et à faire des compromis avec les juristes[80]. Par contre, ces derniers, malgré leur fort consensus entourant les fondements, se divisaient pour les questions portant sur la spécialité technique et la politique du droit[81].
Leur autonomie a été perdue à la fin du IIe siècle après J.-C. lorsque fut conçue la machine d’État bureaucratique et centralisatrice. Une classe de hauts fonctionnaires intellectuels-bureaucrates autrefois juristes fut créée, intégrant dans l’appareil d’État la jurisprudence qui cessa pour de bon d’être indépendante au profit d’une approche ouvertement législative de production juridique. Même si cela offrait un pouvoir illimité à l’Empereur, l’instauration d’un légalisme généralisé venait l’atténuer. Même si cette transition ne se traduit pas par une application effective au sein de la société impériale, « il prépare la voie à toutes les récupérations actualisantes postérieures de la pensée juridique de l’Antiquité, de celle de Justinien à celles des juristes modernes. Sa fortune devait avoir une durée extraordinairement longue, jusqu’à presque s’identifier, sous de nombreux drapeaux, avec le destin de tout droit “rationnel’’[82]. »
La vie religieuse
 Le Pantheon d'Hadrien à Rome, destiné à Agrippa. Il comporte une mention M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT, signifiant Marcus Agrippa, fils de Lucius, Consul pour la troisième fois, le construisit.
Le Pantheon d'Hadrien à Rome, destiné à Agrippa. Il comporte une mention M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIVM·FECIT, signifiant Marcus Agrippa, fils de Lucius, Consul pour la troisième fois, le construisit.
À travers l’histoire des Romains, les situations religieuses sont multiformes de même que les compétences sacerdotales et le patrimoine religieux sans cesse gonflé de nouveaux dieux étrangers[83]. Ces nouveaux cultes signifiaient plus un élargissement du concept de romanité et un ajout à la religion romaine qu’une transformation des convictions religieuses. D’autre part, nous connaissons peu de choses de la vie religieuse privée des Romains. Leurs dieux étaient souvent issus des dieux grecs ou Orientaux et, comme les Grecs, des rituels familiaux cadraient la vie religieuse privée. À la différence de ces derniers, les Romains n’avaient pas de mythologie créative qui expliquait la généalogie du divin. Les Romains sont aussi reconnus pour leur superstition obsédante qui voyait l’action des dieux dans la nature et surtout dans le destin des familles et de la cité[84],[85]. Puisque peu de renseignements nous sont parvenus sur les pratiques privées, cette section portera sur le caractère public de la vie religieuse professée par les prêtres et les magistrats.
Bien que les femmes exerçaient un rôle religieux secondaire mais réel, pour exercer un acte sacerdotal, il fallait être un homme. Posséder la citoyenneté était une autre condition nécessaire à côté de l’essentiel statut social distingué puisque les cultes publics se pratiquaient au nom de la communauté. Par exemple, tous les magistrats devaient exécuter des tâches sacerdotales qui étaient exigeantes en temps et en moyens[86]. Ces tâches consistaient à assurer le déroulement de sacrifices ainsi que l’ordonnance du banquet sacrificiel, à dédier des sanctuaires aux dieux publics et à interroger les dieux (auspices). D’autres, les prêtres, étaient formés dans des collèges sacerdotaux et se distinguaient des magistrats par leurs compétences juridiques et le fait qu’ils étaient les uniques dépositaires du droit sacré. De plus, les magistrats étaient élus et étaient soumis à des critères censitaires et d’âge alors que les prêtres en étaient exempts, bien que les deux classes fussent normalement issues de l’élite sénatoriale. Les prêtres étaient sélectionnés à vie et bien qu’ils ne possédaient pas l’imperium et les autres charges de magistrature, ils pouvaient, en vertu des augures, ajourner les comices électoraux et ils exerçaient une forte influence sur la vie publique. Ce n’est qu’à partir du milieu du IIIe siècle av. J.‑C. que le Grand Pontife, autorité suprême du pouvoir religieux, fut élu par les tribus – quoique cette élection se faisait entre trois candidats proposés par le collège pontifical. Ce processus s’appliqua à l’ensemble des prêtres un siècle et demi plus tard[87]. Ces structures allaient grandement changer sous l’Empire, le Prince étant Grand Pontife et s’arrogeant une part écrasante du pouvoir décisionnel.
Ces prêtres remplissaient un rôle qui se limitait à la religion publique. Les rites domestiques étaient confiés aux paters familias, les pères de familles étendues (gens). Il y avait au maximum 400 prêtres; il est donc absurde de croire que ceux-ci pouvaient directement administrer la vie religieuse des 4 millions de citoyens du premier siècle[88]. Ces prêtres assuraient le bon fonctionnement des sacerdoces publics sans le moins du monde se soucier d’une pratique religieuse correcte chez les citoyens. Si une réprimande était nécessaire pour conduite religieuse inappropriée, c’était plutôt le magistrat qui intervenait.
Chez les Romains, la cité était conçue comme un lieu de cohabitation entre hommes et dieux, les derniers comme les premiers participant à la vie communautaire et visant le bien commun. Le dialogue régulier avec les dieux assurait leur bienveillance et ce dialogue se faisait justement au moyen des cultes publics assurés par les prêtres et les magistrats, ceux-ci étant les maîtres du droit public, et ceux-là, du droit religieux. Par exemple, si des augures négatifs se présentaient, une assemblée devait être ajournée. Même le consul ne pouvait s’y opposer[89].
Les fonctions sacerdotales étaient divisées en deux groupes : la célébration du culte et la représentation des fonctions divines. Dans le premier groupe figurait d’abord le sacrifice, accompagné de nombreux rituels secondaires. Hommages, paroles, gestes, sacrifices et banquets ponctuaient les rites sacrificiels. Ensuite, il y avait la prise d’auspice qu’on adressait surtout à Jupiter avant de prendre des décisions politiques. Vols d’oiseaux et mouvements de poulets sacrés étaient rigoureusement surveillés à cette fin. Ces fonctions dépersonnalisées se portaient garantes d’un rapport non pas d’un individu avec le divin, mais de la communauté entière avec les dieux[90]. De même, l’exécution des rites se faisait souvent non pas par les prêtres eux-mêmes, mais par d’humbles officiants, car c’est le geste sacré d’autorité qui définit le rôle sacerdotal et non la simple exécution matérielle du geste sacré.
La cité était née d’un pacte immémorial entre dieux et hommes. L’exécution de rites et d’auspices précis obligeait Jupiter à se soumettre aux décisions du magistrat à l’instar de Numa, successeur légendaire de Romulus[91]. Les auspices donnaient le rôle actif à Jupiter, ce dernier affichant au moyen de signes précis ses mécontentements (qui furent moins nombreux que ses assentiments). Des prêtres spécialisés étaient appelés à interpréter ces signes imprévus et, grâce aux prophéties et traditions, ils apportaient une solution au mécontentement divin. On transcrivait tous ces faits importants concernant les actes publics et religieux dans l’espoir de fonder un amas de recettes secrètes ou plutôt une solide jurisprudence sacrée. Cette pratique constitue les fondements du droit romain[92].
Le deuxième groupe de fonctions sacerdotales comportait la représentation des fonctions divines, incarnations de la puissance divine. Par exemple, les prêtres qui étaient flamines menaient une existence tout à fait particulière que Plutarque compare à une statue animée et sacrée. Le flamine de Jupiter, le plus prestigieux, devait vivre selon un code très précis. Il était en fonction tant qu’il restait marié. Il participait aux sacrifices de son dieu de même qu’aux cérémonies des plus grandioses et il était le seul parmi les prêtres à pouvoir siéger au Sénat. Il portait la toge curule, se déplaçait en char et tout travail devait cesser sur son chemin puisqu’il était en permanence férié. Il lui était interdit de toucher de la farine fermentée et de la viande crue comme il lui était interdit de dormir en dehors de Rome. Une foule d’autres règles lui sont prescrites, tel l’obligation de se raser avec un rasoir de bronze ou l’interdiction de manger des fèves, de voir un cadavre ou d’entendre de la musique funèbre. « Par ses conduites insolites, contrastant fortement avec la vie ordinaire, le flamine insérait dans l’univers de la cité le signe d’un au-delà que tout opposait au monde des hommes et à celui des morts[93] ». Il n’y avait pas que les flamines qui incarnaient le divin. Le triomphateur – orné de palmes, portant de la main droite un sceptre surmonté de l’aigle jovien, un esclave public tenant une lourde couronne d’or derrière sa tête et tiré dans un char par des chevaux blancs – ne représentait aux yeux des observateurs rien de moins que le divin[94].
Le soldat
Rome a inventé ce qui allait devenir les cadres universels de la vie et de l’organisation militaire contemporaine : « la vie de caserne et le tableau d’avancement, le clairon d’ordonnance et l’infirmerie de camp, le bureau des effectifs et les tours de service, le rapport matinal et le droit à la retraite, les prises d’armes et les permissions d’absence, ‘‘l’armée qui vous donne un métier’’, la commission de réforme, voire le théâtre aux armées[95]. » Plusieurs sources issues des hautes sphères du pouvoir politique romain nous documentent sur la vie du soldat, mais celles-ci sont plus la représentation idéologique du lien défait entre statut et prise d’armes qu’une description fidèle de la réalité guerrière sous l’Empire.
Comme chez les Grecs, les Romains ont longtemps été organisés (pendant la République) selon une symétrie quasi parfaite entre leur structure militaire et leur structure politique, le cens et la citoyenneté déterminant à la fois les charges militaires et politiques. On mobilisait ces citoyens en temps de guerre et ils voyaient en cette occasion un privilège ainsi qu’une opportunité de démonter leur grandeur. Or, l’expansion de Rome, la prolongation des guerres et l’essentiel maintien des troupes dans les provinces conquises rendaient impossible cette organisation symétrique. C’était le début de l’armée permanente, vers la fin de la République, où le recrutement s’étendit aux plus pauvres ce qui dissociait graduellement le port d’armes et le métier de citoyen.
Cette fracture a entraîné plusieurs discours d’inspiration néo-platonicienne erronés sur le soldat romain comme celui d’Horace voulant que le soldat romain fût privé d’otium, le loisir et la paix de l’âme. Un autre discours, comme celui de Cassius, prétend que le principe de l’utile l’emportait sur l’honnêteté : avec le soldat, l’argent passait avant la gloire. Bref, on y décrit un relâchement moral de la part du citoyen qui est davantage soldat-citoyen que citoyen-soldat. D’autres, comme Tacite ou Juvénal montrent un Soldat colérique ou soumis à des désirs pervers tels la jouissance, la fortune et le pouvoir qui portent atteinte au bien public[96].
 Statue d'Auguste.
Statue d'Auguste.
L’armée permanente instaurée par Auguste avait l’avantage d’éliminer une conscription qui devenait trop lourde ainsi que l’étroit recrutement italien (remplacé par un recrutement recouvrant l’Empire en entier). L’enrôlement se faisait sous base volontaire et même les pérégrins (non-citoyens) les plus éloignés de l’Empire pouvaient s’enrôler – les Égyptiens, par exemple. Ceux-ci devaient être hellénisés, citadins et petits ou moyens propriétaires. Le recrutement de cette classe dominante faisait officiellement d’eux, au terme de leur service, de nouveaux citoyens romains[97]. C’était donc avec la permanence de l’armée que les standards censitaires et physiques du recrutement c’étaient dans les faits élevés.
L’entrée dans l’armée devait être intéressante pour les enrôlés bien nantis. Elle garantissait donc un salaire intéressant et un gain de prestige et de statut. Si on manquait d’homme dans l’armée, ce n’était pas à cause d’une désaffection croissante mais à cause de conditions d’accès plus exigeantes. Au moment de leur démobilisation on leur offrait souvent des terres qu’ils s’empressaient à faire travailler par des ouvriers ou des esclaves.
Pendant son mandat, le soldat était posté, le plus souvent, en zone frontalière – les limes[98]. L’armée se mêlait avec les locaux et exerçait une grande influence culturelle sur eux de la même façon que les locaux influençaient (certes plus légèrement) les soldats. On nomme ce processus d’assimilation la romanisation[99]. Même si plusieurs soldats étaient en effet « romanisés », donc d’origine qu’on qualifiait de barbare, et même si ceux-ci étaient des professionnels dont la charge militaire était complètement dissociée des charges politiques, jamais ont-ils adopté des comportements de mercenaires. Ils font preuve de responsabilité civique. Cette responsabilité était sûrement due à leur distinction sociale et leur assimilation profonde dans la romanité : l’uniforme, l’usage limité du latin et les règles disciplinaires[100].
Les soldats non-mariés au moment de leur enrôlement ne pouvaient pas se marier pendant leur service. En revanche, il arrivait que ceux-ci concubinaient avec une femme qu’on appelait focaria. Même pérégrine, à la fin du service militaire et du mariage qui s’en suivait, on lui accordait à elle et à ses enfants la citoyenneté romaine[101]. Il arrivait même que cette femme était une esclave dont le conjoint prévoyait affranchir dans son testament. Le soldat n'est donc pas condamner à l'usage des services de prostituées.
 Légionnaires en formation de tortue, représentés sur la colonne Trajane
Légionnaires en formation de tortue, représentés sur la colonne Trajane
Les soldats recevaient un salaire élevé qu'enviait une majorité d'individus qui peinaient à subsister. Cette solde était immorale et permettait un luxe qui pourrait amollir le soldat - les thermes, par exemple. Le civil refusait l’élévation du soldat au rang de voluptas, ce dernier étant condamné au sudor, la sueur. La perception négative ne s'arrêtait pas là. Il était également vu comme un goinfre et un buveur aguerri. Un homme d'impulsion et d’appétit. Bref, on désolait chez les civils la prétendue disparition de la discipline et de l'esprit de sacrifice et on vitupérait le budget militaire qu'on jugeait excessif[102].
Il est vrai que le soldat mangeait à sa faim condiments, salaisons et charcuterie. Toutefois, son salaire n'était pas ajusté en temps de crise monétaire ce qui le frappait très durement. On déduisait une part de ses revenus pour la nourriture et pour les dépôts obligatoires dans la caisse de son unité qui lui étaient disponibles à la fin de son service. Au final, le soldat vivait très bien: la militia romaine était «une sorte de plan épargne, avec versement de primes périodiques en cours de contrat et constitution d'une capital économique à terme échu, accru d'intérêts sous forme de prestige social[103]. »
Enfin, ce soldat n'était pas ignare comme aimaient le prétendre certains civils, mais n'était pas non plus particulièrement cultivé. Les valeurs et pratiques romaines étaient solidement imbriquées en lui, malgré le fait que son savoir était davantage technique et organisationnel que philosophique et humaniste[104].
L’esclave et l'économie
L'esclave se définissait, pendant tout l'Antiquité, comme l'opposé du citoyen. Il ne pouvait se battre à la guerre, il était privé de loisir et de liberté, ne devait atteindre ni gloire ni honneurs et ne pouvait participer à la vie politique. Il était échangé et légué comme un objet et était souvent dépourvu de personnalité et d'initiative. «Comme un animal domestique, il travaille et mange ou dort pour reconstituer sa force de travail. Il s'identifie à sa fonction: il est au maître ce que le bœuf est au pauvre[105] ».
Une importante distinction concerne le lieu de travail de l'esclave. Souvent, en campagne, celui-ci était soumis à des tâches épuisantes et surveillées dans le cadre d'une réglementation stricte et sans merci. L'esclave urbain, quant à lui, pouvait s'occuper de la gestion d'une boutique ou d'une entreprise artisanale. C'est pourquoi il avait moins tendance à fuguer et à se révolter que l'esclave rural. De plus, les domestiques jouissaient de conditions généralement enviables pour des esclaves puisqu'une certaine intimité se liait entre eux et leur maître[106].
Le passage à l'Empire marqua un changement économique et juridique substantiel dont les esclaves allaient à la fois jouir et souffrir. L'augmentation massive de la quantité d'esclaves se traduisit par un virage à une économie encore davantage esclavagiste. «Désormais, l'esclave-marchandise est seul face aux libres. Il est ligoté par toute une idéologie, par des mesures juridiques précises, par des attitudes quotidiennes qui l'isolent, le coupent du reste de l'humanité au point même de l'en exclure. Il est vraiment devenu une chose ou un animal, et est traité comme tel par le droit[107]. »
Ceux qui souffraient étaient ceux qui furent affectés à des tâches comme celle de minur - qui leur garantissait une mort imminente. Ceux qui en jouirent étaient normalement des esclaves, civils comme ruraux, à qui on commençait à offrir des responsabilités et une autonomie surprenantes. Petit à petit, le droit s'adaptait à cette réalité en permettant l'acquisition d'un patrimoine par l'esclave. Ceci générait la possibilité, pour celui-ci, d'acheter sa propre liberté, ce que les plus chanceux firent. Certains recevaient même un appui de leur maître et acquéraient à leur tour des esclaves avant leur propre affranchissement[108].
Les affranchis jouissaient d'un statut quasiment identique à celui des autres citoyens et n'étaient pas économiquement marginalisés. Ils représentaient même le symbole de l'esprit entrepreneurial. Mais, comme les esclaves, les affranchis ne constituaient pas une classe sociale homogène. Certains s'en tiraient très bien, d'autres non. Il y avait toutefois une limite à leur acceptation sociale puisque les nobles et les chevaliers refusaient de les fréquenter à table. Cela ne les empêchait pas d'honorer les exploits de plusieurs affranchis[109].
Finalement, on fit de la trop grande dépendance à l'esclavagisme une des causes de la chute de l'Empire. Les conquêtes stoppées, il n'y avait plus d'importation d'esclaves assurant le maintien de la production nécessaire à la défense des limes. Ajouté à la répugnance des Romains pour le travail, l'économie connut un effondrement, ce qui entraîna, avec bien d'autres facteurs, la chute de Rome[110].
Le pain et les jeux et la marginalité
L'expression du poète Juvénal, "panem et circenses" est bien connue. Elle symbolise la dégénérescence de la vie publique et surtout le populisme et le contrôle. On appelait ces gens la plèbe otiosa et deses de Rome. Pour les gens de cette espèce, le Circus Maximusest tout: "Ils passent leur temps à parler des performances des conducteurs de char; puis, lorsque c'est le jour du spectacle, aux premières lueurs de l'aube ils se précipitent en masse au Cirque, plus rapides que les chars qui vont concourir[111]".
Cette plèbe de Rome avait également une obsession alimentaire symbolisée par la description que fait l'historien Ammien Macellin d'une foule regroupée, fixant d'un œil morbide un morceau de viande nauséabonde en cours de cuisson. Pauvres, souvent sans emploi, ils dépendaient du 40 litres de blé mensuel que l'État leur offrait, tout comme le divertissement, en échange d'un appui politique nécessaire du côté du concile plébéien et de leur pouvoir de manifestation populaire[112].
 Pollice verso ou Bas Les Pouces de Jean-Léon Gérôme, 1872. Vision romantique de la gladiature, le geste du pouce pour décider de la vie ou de la mort des gladiateurs n'a en fait jamais existé dans l'Antiquité.
Pollice verso ou Bas Les Pouces de Jean-Léon Gérôme, 1872. Vision romantique de la gladiature, le geste du pouce pour décider de la vie ou de la mort des gladiateurs n'a en fait jamais existé dans l'Antiquité.
Les combats de gladiateurs figuraient parmi "les jeux", offrant un combat sanguinaire aux spectateurs désinvestis de la vie publique. La plupart des gladiateurs étaient des esclaves entraînés à cette fin, bien que certains fussent volontaires. Les combats de gladiateurs ont traversé l'histoire de Rome et ont persisté même lorsque le Christianisme fut dominant.
 Banqueteur et une prostituée, fresque d'une maison d'Herculanum
Banqueteur et une prostituée, fresque d'une maison d'Herculanum
La prostitution est florissante à Rome. Elles oeuvrent dans des maisons conçues à cette fin, dans des auberges, des loges et peuvent solliciter dans la rue, devant les arcades ou la porte de leur propre domicile. Les esclaves pouvaient être soumises à des sévices sexuels, le droit romain ne les protégeant pas.
Un réseau de criminalité puissant vivait à Rome. Les bandits étaient présidés par un chef qui gouvernait la bande dans les activités illicites souvent violentes. Ils s'adonnaient à des raids locaux contre les villes, les villages, en montagne ou sur mer[113].
Le Haut Moyen Âge
Après la chute de l’Empire romain d’Occident en 476 suite aux invasions barbares, la société et l’homme occidental vivront une transition qui va du Ve siècle à l’an mil, époque de la constitution plus significative de la société féodale. L’héritage des anciens perdure dans l’Empire d’Orient, mais l’Europe occidentale est en proie à ce que plusieurs historiens qualifient d’âge sombre. Face à l’instabilité des nouvelles monarchies barbares, l’Église semble la seule institution capable d’assurer un semblant d’unité en Occident.
Il existe cependant, malgré la chute de l’Empire romain, une certaine continuité avec celui-ci. Les castes religieuses et guerrières du Haut Moyen Âge rêvent encore d’une nouvelle Pax Romana, de l’unification des peuples chrétiens d’Europe, pour la préservation de la paix et de la culture classique[114]. Ce rêve est illustré par les tentatives carolingiennes, la plus notable étant celle de Charlemagne, de réunifier l’Europe et de réaliser l’Ecclesia, l’union idéale de la société religieuse et civile. La conception romaine du pouvoir et de la justice subsiste encore pour le dirigeant du Haut Moyen Âge, qui ne se confond pas à l’État, et qui à l’exemple de Charlemagne dispose d’une administration substantielle.
Le rapport à la richesse
Une des caractéristiques qui distingue l’homme du Haut Moyen Âge d’avec l’homme moderne est son rapport à la richesse. La richesse n’est pas alors le principal critère d’évaluation de la valeur d’un homme, comme elle le sera plus tard. C’est le prestige qui dicte la condition sociale et hiérarchique. La richesse a comme rôle principal l’ostentation, qui conduit ensuite au prestige. L’homme médiéval, que ce soit du Haut ou du Bas Moyen Âge, ne voit pas comme un but en soi l’accumulation de biens matériels[115]. La richesse ne se suffit pas à elle-même, elle permet de tenir son rang dans la société, ou un homme peut ruiner les économies d’une année pour l’organisation d’un somptueux banquet[116]. De plus, ce n’est pas tant la possession de monnaie qui constitue la richesse au Moyen Âge que la possession de terres. Les métaux précieux sont devenus rares et la richesse restera longtemps surtout foncière.
La culture est également vue comme un facilitateur du prestige, en particulier au sein du clergé, car elle permet d’accéder à de hautes fonctions dans l’administration. La connaissance du droit romain constitue notamment un atout non négligeable. Cependant, les connaissances culturelles et juridiques sont surtout détenues par les clercs ou les fonctionnaires, le noble moyen s’y intéressant relativement peu et le paysan n’y ayant pas vraiment accès.
Les conditions de vie demeurent rudes au Haut Moyen Âge. On pratique l’agriculture de subsistance. L’espérance de vie chez les peuples germaniques de cette époque est relativement basse. La mortalité infantile est extrêmement élevée et l’espérance de vie d’un jeune enfant qui a franchi le seuil critique des premières années est d’à peine 14 ans, tandis que la majorité (60% à 75%) des adultes meurt aux alentours de 36 à 38 ans[117].
Une société «égalitaire»
Dans ce contexte, la position sociale est en quelque sorte une combinaison de richesse, de savoir, mais surtout de prestige. La société du Haut Moyen Âge n’est pas encore structurée en ordres, comme la société féodale le sera. La noblesse est alors surtout une question de faits et de position sociale. Cependant, on fait déjà la distinction entre Potentes (les puissants) et Pauperes (les hommes médiocres)[118].
Contrairement au clivage ouvrier/bourgeois constitutif du XIXe siècle, au Haut Moyen Âge, il n’y a pas de vrais pauvres. Bien que la stratification sociale augmente au Xe siècle, la majorité des paysans, et même dans une certaine mesure des hommes puissants, ont une existence à peu près semblable[119]. Les distinctions sociales étant moins marquées, l’homme du Haut Moyen Âge semble accepter plus facilement sa condition. La morale chrétienne qui affirme l’égalité des hommes devant Dieu, mais la nécessité de se soumettre à l’ordre politique temporel, est un allié non négligeable de la pérennité des structures sociales[120].
Les classes sociales
Dans le monde du Haut Moyen Âge, la principale caractéristique, du moins à l’origine, de la stratification sociale est le statut juridique de la liberté accordé à l’individu. L’homme libre trône au sommet de la hiérarchie[121]. Ancêtre de citoyen romain ou de guerrier barbare, il peut jouir de sa personne, accéder à la fonction publique et devenir clerc. En contrepartie, il doit se soumettre au service militaire. Ensuite vient le colon, qui est un homme libre, mais attaché à une terre et qui ne peut donc pas se déplacer à sa guise. Il échappe cependant au service militaire. Au bas de la hiérarchie sociale vient ensuite l’esclave, position encore commune au Haut Moyen Âge. Ces derniers auront tendance à devenir serfs. Le statut social est habituellement transmis à cette époque par la mère[122]. Des contrats passés entre différents individus organisaient également la structure sociale. Ces contrats pouvaient être passés d’homme à homme ou de familles à familles comme égaux dans un but commun d’entraide, on parle alors de pacte d’amitia. Il existe également des pactes de soumissions d’un homme à l’autre qui préfigurent la vassalité. Parmi eux, on note la gefolgscaft, héritée du monde germanique, qui constitue un contrat liant à un puissant des hommes d’armes qui constitueront sa suite[123]. Au sommet de la hiérarchie sociale se trouve le roi, souvent nommé par les grands dans le cadre d’une monarchie élective. Ce dernier distribue les charges importantes de l’État. Ces charges, même si elles sont distribuées selon le bon vouloir du prince, se retrouveront de plus en plus concentrées dans les mains des grandes familles avant de devenir héréditaires à la fin de la monarchie carolingienne.
L’appartenance et l’identité
Le concept d’appartenance et de nationalité est problématique au Haut Moyen Âge. Les barbares implantés dans les anciens territoires romains sont fortement minoritaires et auront tendance à se mêler avec les populations gallo-romaines. L’appartenance au peuple est donc assez sommaire. Comme l’indique l’historien Bruno Dumézil : «De plus, leur conscience ethnique paraît avoir été singulièrement faible : un nom générique («Francs», «Goths»…), l’obéissance à un chef unique et un mode de combat standardisé suffisaient à définir intuitivement la notion de peuple[124] ». Une autre distinction entre peuples se fait au niveau de la langue, mais surtout du droit. La loi salique prédomine chez les Francs[125], ou le code d’Euric chez les Wisigoths[126].
Le rapport à la religion
Un phénomène particulier se produit lors du démembrement de l’Empire romain. Les populations barbares, païennes ou ariennes, se convertissent à la religion des vaincus, le christianisme. Cette conversion constitua plus une habituation qu’une réelle révolution[127]. De nombreux éléments païens furent intégrés au christianisme, et d’authentiques pratiques païennes subsistèrent jusqu’à l’aube de l’an mil, surtout chez le bas peuple et la haute aristocratie[128]. À la vision riches/pauvres traditionnelle se juxtapose une autre vision qui marquera la société médiévale, la dichotomie laïcs/religieux. La christianisation, imposée par les élites religieuses et politiques, se charge de l’intériorisation des normes chrétiennes et de l’imposition de nouveaux rites qui se substituent aux anciennes coutumes païennes. La religion s’intègre souvent assez bien aux mœurs des barbares, et influence plusieurs aspects de leurs vies. La polygamie est proscrite et le mariage n’étant pas encore un sacrement[129] permet l’acceptation du divorce dans la société. De plus, l’entrée dans la vie n’est plus la naissance, mais le baptême, qui constitue la reconnaissance de l’individu au sein de la famille chrétienne[130].
Les premières formes de la conversion au christianisme furent surtout rattachées à des mouvements hérétiques, comme l’arianisme. Les nouveaux convertis, sortis tout récemment du paganisme, eurent besoin de points d’ancrage solides à leurs nouvelles croyances, d’un Dieu plus concret qu’abstrait, plus matériel que spirituel[131]. Cela explique probablement la répugnance de plusieurs peuples à vénérer pleinement le père (trop lointain) ou le Saint-Esprit (trop abstrait) et à se tourner vers le fils, qui dispose de la toute-puissance et qui est de surcroît matériel. Les doctrines de l’eucharistie de Pascale Radbert, qui prônaient la transformation du pain et du vin en chair et en sang du Christ, trouvèrent échos dans le peuple et même dans le clergé, qui se voyait attribuer, lors de la communion, «le plus grand des prodiges[132] ». Aux rites païens se substituent les sacrements chrétiens, qui encadrent la vie de la naissance à la mort, du baptême aux derniers sacrements.
À l’époque carolingienne, le clergé, à l’apogée de son pouvoir au Haut Moyen Âge, s’engage dans le faste et le luxe. Les orgues, introduits par Charlemagne, rythmes les chants sacrés[132]. Durant cette période se développe également le culte des reliques, très populaire du fait de l’héritage païen de la vénération des morts. Ces reliques, souvent à l’authenticité douteuse, sont pour la plupart des ossements (réels ou prétendus) de saints et de martyrs, des vêtements de saints ou encore des objets ayant joué un rôle majeur dans la chrétienté, comme le Saint-Suaire ou la colonne de flagellation du Christ. Les pèlerinages, les processions et les jours de fête du calendrier chrétien se multiplient.
Au IXe siècle se développe davantage la structure paroissiale, qui organise la vie religieuse de la population. L’aspect liturgique notamment devient plus sophistiqué, avec la multiplication des ordines[133], qui visent à décrire et à permettre l’accomplissement des rituels religieux. Le formalisme de l’Église se fait de plus en plus sentir. La messe est faite en latin, et les hymnes de langues vulgaires, apparues au IXe siècle en Angleterre et en Allemagne[134] ne parviennent jamais à s’imposer au clergé qui s’en tient à la langue sacrée. En effet, l’Église de l’époque ne cherche pas tant à convaincre et à instruire le fidèle qu’à frapper ses émotions et son imagination. Le culte de cette époque est encore teinté de paganisme. Malgré les nouvelles perspectives qu’offre Saint Augustin dans le rapport intérieur à Dieu[135], les prières faites au Seigneur sont dans la perspective de l’homme de cette époque plus des invocations visant à être entendues par Dieu qu’un dialogue intérieur permettant de changer sa nature. Les sacrements ont une portée plus utilitaire que symbolique et permettent de manière fonctionnelle d’assurer le salut.
Malgré la forte influence chrétienne sur la société du Haut Moyen Âge, l’univers de l’homme de cette époque reste profondément influencé par l’héritage païen. Les représentations du monde de l’individu d’alors sont peuplées de démons et de génies et s’inscrivent dans un cadre merveilleux[136]. L’influence du christianisme à bien des égards ne fera que sublimer cette conception païenne du monde. On ne vénère plus la nature comme chose, mais la divinité en elle. Pour s’approprier son environnement, l’homme doit imposer son sacré. Il peut par exemple planter un bâton dans la terre qu’il veut acquérir, ou marquer les arbres de la forêt pour se protéger des esprits[137].
L’existence en milieu rural hostile est perçue pour bien des hommes comme un combat entre Dieu et les malins génies. Les saints se substitueront progressivement à la présence des divinités de la nature, mais le cadre de la vie spirituelle de l’homme d’avant l’an mil demeure dans une perspective superstitieuse héritée du paganisme. Par exemple, en temps d’épidémie, on fait le tour des terres infectées avec une sainte relique. Le christianisme s’est donc adapté à la mentalité païenne plutôt que de l’éradiquer, les anciens rituels païens ayant trouvé leurs contreparties chrétiennes. La religion du Christ s’est substituée aux anciens signes des vieux cultes sans parvenir à modifier le cadre de perception du spirituel de l’homme du début du Moyen Âge[138].
L’homme de cette époque porte une attention accrue à ses vices et vertus, le salut dans la vie future étant plus que jamais lié à la vertu de l’homme, et non plus au simple respect des rites visant à honorer les dieux. Pour racheter ses fautes, il faut passer par la pénitence, procédé par lequel le pêcheur se repend de ses fautes et qui constitue le plus souvent en un jeune, une abstinence ou encore une donation charitable. À l’origine, elle s’effectue en public, mais elle prive le fidèle de la participation aux rites publics[139]. La confession, plus intime et populaire, se répandra à partir du VIe siècle. Plus basée sur le même principe de tarification des fautes que la pénitence publique, elle a l’attrait d’être privée et moins brutale dans ses conséquences.
La famille
La personne au Haut Moyen Âge est reconnue d’abord comme membre d’un groupe. Les marginaux sont peu nombreux et l’individu s’efface devant la communauté. Bien que le terme de famille comme l’usage d’aujourd’hui le conçoit n’apparaisse que tardivement (en Allemand, seulement au XVIe siècle)[140]), l’unité de base de la société est la famille nucléaire et patriarcale, formée le plus souvent du couple et des enfants non-maries, s’organisant autour du chef de famille, le pater familias[140].
Le jeune enfant de cette époque (l’âge adulte est généralement fixé à 14 ans) est totalement soumis, autant légalement que dans les faits, à son père. Ce dernier en contrepartie a le devoir d’assurer à son enfant «pain et bouillie suffisante[141] ». Le moment d’arriver à l’âge adulte est d’habitude marqué pour l’enfant par l’entrée dans la suite d’un seigneur ou par le mariage. La parenté médiévale est constituée de manière plus large des liens de sang et des liens d’alliances. Chez les puissants surtout, deux options s’offrent pour accroître la puissance familiale, le mariage exogamique (à l’extérieur du groupe) qui permet de joindre deux familles, ou le mariage endogamique (à l’intérieur du groupe) qui prévient le démembrement de la parenté et assure son unité[140]. La familia, ensemble d’individus étant dépendants d’une même maison, reste également une structure de base à cette époque. De manière plus large, les différentes unités familiales sont regroupées en Sippe, ensembles familiaux et réseaux de parentés formant une entité plus ou moins cohérente[142]. On assiste durant le Moyen Âge à une valorisation des rapports familiaux et conjugaux. Cette perception est en grande partie influencée par le modèle de la Sainte Famille chrétienne[140].
Les valeurs et l'éducation
Dans la société pré féodale, le travail est majoritairement perçu comme une occupation impure et inférieure. On lui préfère la guerre ou la contemplation de l’ordre divin. Le travail est en effet considéré par le corps clérical comme la punition de Dieu pour les fautes de l’homme[143]. Cette représentation associée au péché originel associe le travail à la dimension temporelle et imparfaite du monde, par opposition à la nature parfaite de la divinité. L’homme d’alors peut admirer malgré tout les prouesses techniques des artisans, mais avec toujours en arrière-fond un profond mépris pour le travailleur et le travail nécessaire aux réalisations techniques[144].
L’éducation de la fille est assurée par la mère, et ce jusqu’au mariage. Le jeune garçon est éduqué, au sortir de la prime enfance, par son père qui lui apprend les compétences à acquérir pour évoluer dans le monde des hommes comme le maniement des armes, le contrôle de soi ou encore un savoir plus fonctionnel lié au métier. Le fosterage, pratique consistant à placer le jeune homme chez un ami de la famille pour finaliser son entrée dans le monde adulte, est relativement répandu chez les classes sociales supérieures[145]. L’éducation classique, qui s’est effondrée à la suite des invasions barbares et de la chute de l’Empire romain, ne reprendra un peu d’importance que sous les Carolingiens. La société est également marquée par un analphabétisme généralisé, alors que les laïcs qui savent écrire leurs noms sont rarissimes[146]. Les religieux sont en effet les seuls détenteurs d’un peu d’éducation, et de par le fait même, habilités à la transmettre. L’enseignement des arts libéraux décroît de manière drastique suite à la chute de l’enseignement classique aux clercs. Le règne de Charlemagne voit cependant une amélioration au chapitre de la culture et de l’enseignement, alors qu’une multitude d’écoles sont construites dans l’empire carolingien. Ces écoles sont destinées à former les clercs. On y fait l’étude de certains classiques (Virgile, par exemple), y apprend à lire, écrire, chanter, calculer et on y enseigne également le latin, un peu de grammaire et des bases de droit[147]. Certains hommes s’efforcent également de préserver l’ancienne culture, comme Isidore de Séville (562-636) qui rédige les Étymologies, encyclopédie de 18 titres[148].
L’honneur, c’est-à-dire la valeur d’un homme aux yeux des autres, au Haut Moyen Âge est d’abord une affaire de famille. Cette dernière est détentrice d’un capital d’honneur qui peut fluctuer au gré des actions de ses membres. Dans un premier temps, l’honneur est associé au maintien correct de son rang, qui doit être tenu de manière appropriée sous peine de dépréciation du prestige individuel mais surtout familial[149]. Une insulte impunie faite à la famille, comme un meurtre ou un viol impuni, est également préjudiciable à l’honneur. Par contre, un cadeau fait à un puissant, l’obtention de terres et de charges publiques ou encore une mort honorable au combat, par exemple, servent à rehausser le prestige familial[149]. Une famille est plus ou moins honorable selon non seulement les actions de ses membres, mais également et surtout selon le prestige de ses ancêtres.
La justice au Haut Moyen Âge a essentiellement un caractère lucratif. Dans les tribus germaniques, celui qui s’acquitte d’une faute, d’un meurtre par exemple, doit payer le Wergeld, qui signifie littéralement le prix de l’homme[150]. Le Wergeld varie en fonction de l’âge et du statut social de la victime ainsi que de la nature de sa faute. Les meurtres et les blessures sont soigneusement tarifés. Un autre élément de la justice du Haut Moyen Âge est la faide, ou justice privée. Cette dernière constitue en l’autorisation par la collectivité à la vengeance en cas d’offense faite à un individu ou à un groupe. À l’époque des Carolingiens, on préfère le Wergeld à la faide en raison du désordre social que cette dernière entraîne[151].
La femme
Le point de vue sur les femmes de cette époque est relativement méconnu, et ce en raison de la provenance de la majorité de la littérature sur le sujet. Les clercs étant pratiquement les seuls dépositaires du savoir et les seuls producteurs de documents écrits, la majorité des témoignages sur la femme provient d’eux. Ces témoignages traduisent habituellement une vision négative de la femme, responsable du péché originel et tentatrice de l’homme[152]. Ces textes donnent majoritairement une image négative de la femme qui n’est qu’une copie imparfaite de l’homme. Sur le plan juridique, par contre, certains aspects indiquent une relative égalité par rapport à l’homme. Le Wergeld de la femme est dans la majorité des codes de lois égale à celui de l’homme, voire supérieur si elle est féconde ou enceinte[153]. Une des caractéristiques majeures de la condition féminine de cette époque est la présence du mundium. Cette institution juridique fait de la femme la propriété de l’homme de laquelle elle est dépendante, soit le père, le frère ou le mari[153]. Le mundium consiste en la propriété sur le corps et la capacité d’autorité sur la femme, en contrepartie d’un devoir d’assistance. Lors du mariage, le mundium de la femme est acheté par le mari à son précédent détenteur, l’union ne pouvant être validée que lors du paiement de la somme.
Autant avant qu’après la christianisation de la société, la morale sexuelle est extrêmement rude envers les femmes qui peuvent être punies de mort pour l’adultère[153]. De par sa capacité de posséder des biens et d’administrer le domaine, la situation de la femme du Haut Moyen Âge est cependant plus favorable que celle de la femme romaine ou celle de la femme du Bas Moyen Âge. Le statut de veuve consacrée et la possibilité, grâce au christianisme, d’entrer dans les ordres constituent également des possibilités de protection pour cette dernière[154].
Le Bas Moyen Âge
La société médiévale se transforme après l’ère carolingienne et les structures féodales s’organisent. L’Église, tout comme la civilisation européenne, traverse une crise de restructuration. Une nouvelle vision de la société pénètre l’être humain. L’effondrement des pouvoirs centraux remplacés par un nouvel ordre change le rapport des hommes au monde et des hommes entre eux.
Les structures hiérarchiques féodales
L’an mil marque un tournant dans l’organisation de la société médiévale. L’Empire carolingien s’effondre pour être remplacé, par exemple en France, par la dynastie capétienne beaucoup moins puissante que la dynastie précédente au sommet de son pouvoir. Hugues Capet, le premier représentant de cette lignée, n’est en effet ni le plus riche, ni le plus puissant des seigneurs féodaux français, bien que le sacre royal et l’hommage féodal lui donnent un certain prestige[155]. Les pouvoirs centraux jadis forts s’effritent et laissent place à la féodalité et à l’ordre seigneurial.
La noblesse se multiplie et s’accapare de nombreuses prérogatives appartenant autrefois à l’administration de l’empire de Charlemagne. Au sommet de la hiérarchie trônent les princes, grands du royaume, qui détiennent les pouvoirs de justice et de battage de monnaie, entre autres[156]. Les seigneurs de moyenne et de petite noblesse suivent. Ces derniers tiennent une terre en fief pour un seigneur plus puissant. Plus bas dans la hiérarchie on retrouve les chevaliers, guerriers sans domaines importants, souvent cadets de familles nobles. Ce corps relativement hétérogène constitue la noblesse, qui est cependant unifiée par le système de vassalité et de transmissions du fief[157]. Ce lien d’homme à homme que constitue la vassalité cimente et organise la société médiévale. L’hommage rendu au seigneur au sein du lien vassalique est progressivement limité aux aristocrates, alors que sous Charlemagne, tout homme libre de plus de 12 ans doit faire hommage[158].
Le fief, terre tenue par un vassal au nom de son suzerain, est l’une des caractéristiques majeures de la composition de la société féodale. Il est inaliénable et se transmet non plus par le roi, mais par héritage. Sa confiscation est permise, mais seulement en cas d’offense au suzerain[159]. Il ne représente pas pour celui qui le tient un signe de soumission et d’infériorité face au seigneur, bien que cet aspect ne soit pas totalement absent, mais plutôt une garantie de la noblesse et du pouvoir[160]. L’homme féodal dans ce contexte est un être profondément impliqué et imbriqué dans une chaîne d’hommages et de contrats, toujours servant ou commandant dans la pyramide des liens vassaliques.
Au plus bas de l’échelle sociale, on retrouve le serf. Ancien esclave ou colon du Haut Moyen Âge, il est lié par le seigneur à sa terre, qu’il doit exploiter et dont il n’est pas propriétaire. En relative périphérie bien que dans une position de pouvoir non négligeable, on retrouve le clergé qui dispose de grands domaines et d’une grande puissance, autant au niveau spirituel que temporel (6 pairs ecclésiastiques sur 12 en France) et d’une indépendance judiciaire et fiscale, ne payant pas ou peu d’impôts séculiers. L’image classique de la société médiévale en est une d’unité ou les trois ordres, Laboratores, bellatores et oratores (ceux qui travaillent, se battent et prient) cohabitent et se servent l’un l’autre, remplissant chacun une fonction définie[161].
La notion d’État organisé étant tombée en désuétude après la dislocation de l’Empire carolingien, l’unité administrative de base de la société devient la seigneurie[162]. C’est en son sein que le seigneur noble exerce son pouvoir sur les paysans. Le seigneur dispose à l’endroit de sa seigneurie et des serfs qui y habitent d’une multitude de prérogatives, dont le Bannum (le droit de commander et de punir), les droits de lever des impôts pour financer la défense de la seigneurie[163], de récolter les droits de péages[164] et d’imposer des corvées. Le seigneur est également propriétaire de sa terre.
Le noble
La noblesse du Bas Moyen Âge est essentiellement issue de celle de l’époque carolingienne[165]. La nouveauté de l’époque est que la noblesse passe maintenant par le sang et n’est plus dépendante des offices et des charges donnés par le roi[164]. L’aristocratie est par essence attachée à la fonction guerrière et le noble se voit comme étant le détenteur par le sang de caractéristiques telles que le courage et la générosité qui lui donnent le droit d’accéder aux plus hautes charges publiques et de gouverner le peuple[166]. En temps de paix, l’aristocrate s’adonne à la chasse, aux tournois ou aux échecs, seul jeu jugé valable du fait de sa similarité avec la guerre. L’arrivée du printemps est synonyme pour le seigneur de reprise de l’activité guerrière, dont il voit l’exercice régulier comme utile à l’entretien de son honneur. La noblesse privilégie à partir des environs de l’an mil la passation de l’héritage de manière verticale plutôt qu’horizontale et la favorisation du fils aîné au détriment des cadets, ce qui permet d’éviter la division du patrimoine familial[167].
Le bourgeois et l’artisan
Le développement des villes lors du Moyen Âge classique permet à une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, d’émerger. Cette dernière concentre entre ses mains, à partir du XIIe siècle, un fort pouvoir économique. Le mouvement communal permet de plus sa relative émancipation de la tutelle féodale. La docilité du bourgeois face à l’autorité monarchique, comparativement à la noblesse turbulente, amène l’autorité royale, soucieuse d’affirmer son pouvoir, à promouvoir les membres de cette classe à des postes importants dans la hiérarchie publique comme ce fut le cas d’Enguerrand de Marigny qui devint l’un des principaux conseillers de Philippe IV de France au début du XIVe siècle[168].
Dans les villes, l’artisanat et le commerce se développent autour du phénomène des foires, qui permettent aux marchands et artisans de l’Europe occidentale d’échanger leurs produits. La notion de profit, bien que présente à cette époque, ne bénéficie pas de la même opinion positive que chez les modernes. Le commerçant et l’artisan doivent pouvoir gagner de quoi vivre, mais la recherche excessive du profit de leur part est connotée de manière très négative en raison de l’influence de la religion chrétienne[169]. De plus, le prêt à intérêt, interdit aux chrétiens, est monopolisé par les juifs.
Le paysan
Le paysan du Moyen Âge classique est essentiellement un ancien esclave agricole ou un ancien colon de l’époque carolingienne. La société en générale nourrit peu d’estime pour cette classe sociale, qui constitue cependant la majorité de la population[170]. Son statut juridique reste flou, mais le paysan se trouve en majorité dans une position de servage[171]. Attaché à la terre de son seigneur, il lui doit impôts et corvées, mais bénéficie en retour de la protection de ce dernier. Le statut du serf n’est cependant pas figé . Il peut gagner sa liberté suite à un acte d'affranchissement de la part de son seigneur, mais il s’expose alors à une relative insécurité puisqu'il est hors de la protection de la noblesse.
Malgré la dureté des travaux saisonniers, le paysan peut jouir d’une relative sécurité alimentaire alors que la disette se fait rare entre les XIe et XIIIe siècles. Au XIVe et XVe siècle, la situation se détériore dans les campagnes qui sont accablées par les épidémies, la famine et les chevauchées incessantes de l’ennemi. Les soulèvements paysans se multiplient alors, car aucune autorité suffisamment puissante ne peut écraser les mouvements de révolte dans l’œuf[172].
L’Église et la religion
La chute des pouvoirs centraux dans la sphère politique qu’entraîne l’éclatement de l’Empire carolingien affecte également la sphère religieuse et l’Église. Le fonctionnement de l’institution suit alors sensiblement le même chemin que le reste de la société et se féodalise. L’Église entre dans une crise de restructuration et d’adaptation au nouveau monde féodal. Ce désordre qu’elle traverse se manifeste par la généralisation de la simonie (on commence de plus en plus à vendre les offices et les charges ecclésiastiques)[173], et la violation de plusieurs interdits, dont une plus large pratique du nicolaïsme[174]. Ce déclin moral suscite la désapprobation d’une partie du corps religieux qui développe en parallèle des institutions monarchistes. Le monastère de Cluny demeure au Moyen Âge l’emblème de ce renouveau religieux[175]. En effet, l’institution se dérobe au système vassalique ce qui assure son indépendance, et impose à ses membres la règle Bénédictine, qui implique une grande austérité et une dévotion complète aux devoirs spirituels. Ce mouvement, en réponse à la décadence qui sévit dans l’Église, tente par ses prières de sauver la société pécheresse.
Du fait de l’insertion plus significative de l’Église dans la sphère temporelle, les querelles avec les pouvoirs publics se multiplient. En Angleterre, un conflit au sujet de l’indépendance du clergé face à la monarchie oppose le roi Henri II à Thomas Beckett, Archevêque de Cantorbéry, et aboutit à l’assassinat de ce dernier. La querelle la plus représentative de ce conflit demeure cependant celle des investitures, qui oppose le pouvoir papal à l’autorité politique du Saint-Empire germanique, au sujet de la nomination du clergé, que la réforme grégorienne voulait soustraire au pouvoir temporel des princes[176].
Malgré la crise qu’elle traverse, l’Église demeure plus que jamais présente dans la société chrétienne, qui passe à cette époque de la communauté des fidèles du Christ à une véritable unité spatio-temporelle. Guidée par l’utopie universaliste, l’Église se voit comme la garante de l’ordre spirituel sur terre et voit dans sa mission la christianisation du monde. Les croisades, au niveau idéologique du moins, furent fortement teintées de ce mode pensée.
L’Église Chrétienne tentera de contrôler la classe guerrière. La trêve de Dieu est instaurée en 1030[177], le mariage devient un sacrement au XIIe siècle et l’adoubement, qui est une cérémonie profane jusqu’alors, prend une dimension religieuse. Sous l’influence de la religion, le modèle du chevalier passe de la bête guerrière au défenseur très chrétien de la veuve et de l’orphelin[178]. De plus, une multitude d’ordres militaires, dont les chevaliers du temple, se développent sous l’impulsion des croisades. Ces différents ordres servent à stabiliser la société en apportant une place et une occupation aux cadets de familles nobles, souvent sans terres, désœuvrés et violents.
Le rapport au sacre demeure essentiel dans cette phase du Moyen Âge. En tête de liste, le monastère demeure le lieu saint par excellence dans la société[179]. En effet, il abrite souvent la relique d’un saint, encourageant le pèlerinage local au détriment du pèlerinage plus lointain, comme le voyage en terre sainte[180]. Les guerres incessantes qui ravagèrent le Moyen Âge tardif furent la cause de la destruction d’un grand nombre de ces monastères. Pour reconstruire ces derniers, l’Église fait appel à la donation populaire et accorde des réductions de pénitence aux généreux donateurs, ce qui contribue à la banalisation du pardon et au système des indulgences, qui se généralisera par la suite. Les seigneurs de cette époque, comme le reste de la population d’ailleurs, sont très soucieux de leur salut dans la vie future et contribuent de manière massive aux œuvres religieuses. L’apparition du purgatoire, qui se constitue comme lieu de la chrétienté entre le IIIe et le XIIe siècle, renforce ce sentiment de charité envers l’Église, alors qu’une forte donation envers celle-ci est perçue comme l’occasion de racheter ses fautes et d’y éviter un séjour prolongé[181].
L’homme de cette époque, malgré les troubles que traverse l’Église, demeure un être profondément croyant. La multiplicité des bâtiments religieux, qui témoignent du règne de Dieu sur la terre, ainsi que l’intériorisation profonde des normes religieuses et de la morale chrétienne assurent la fondation, pour le paysan comme pour le seigneur du Moyen Âge, d’une ontologie morale qui à bien des égards se veut aussi solide que la réalité matérielle[182]. L’homme de ce temps vit alors dans la crainte du châtiment éternel dû a ses péchés, mais également avec la certitude de la signification morale du monde qui l’entoure[182].
L’homme et son corps
Le corps n’est pas tant une entité physique qu’une projection sociale et culturelle dont disposent les hommes de chaque époque[183]. Cette projection et ce rapport permettent à l’homme d’habiter son corps comme un univers familier et cohérent[184].
Alors que dans l’Antiquité, une grande importance était accordée à la beauté et à l’esthétique du corps, l’homme du Moyen Âge, et en particulier le religieux, semble accorder une moins grande valeur à l’apparence physique. Pour le clerc de l’époque, la beauté véritable, celle qui importe, est une catégorie dont l’accès n’est disponible que par l’intellect[185]. L’âme est en effet vue comme le siège de la beauté, beauté divine, car la beauté physique est elle considérée comme impure, l’incarnation matérielle étant le châtiment de Dieu envers l’homme. Il existe en contrepartie une fascination pour la beauté corporelle, qui même si elle est considérée comme inférieure à la beauté spirituelle, est néanmoins perçue de manière a priori par tous. Cette beauté représente dans l’imaginaire collectif, mais surtout dans la pensée de l’intellectuel, le péché, et est associée à l’image d’Ève la tentatrice[186].
L’homme médiéval ne semble pas accorder une grande importance à l’âge[187]. Les fonctions de conseiller et les hautes charges sont souvent accordées à des aînés, ou encore a des individus très jeunes, la position qu’occupe l’homme dans l’échelle sociale important beaucoup plus que son âge. La vieillesse est cependant crainte et connotée de manière négative, comme en témoigne la multiplicité des mythes de l’éternelle jeunesse comme la fontaine de jouvence ou l’île ou on ne vieillit pas[188]. Le respect qu’on accorde à l’aîné varie beaucoup en fonction de sa classe sociale. On respecte le vieux chevalier encore vigoureux, ou le prélat âgé qui fait figure d’homme sage, mais un paysan dont l’âge est avancé se retrouve à la merci de sa famille et souvent voit son autonomie restreinte[189]. La vieillesse est rare dans la société médiévale et l’espérance de vie relativement courte limite le nombre de gens âgés présents dans la population. Après les épidémies de pestes qui ravagent l’Europe au XIVe et XVe siècle, la population de vieillards connaît cependant une forte croissance[190].
Le geste dans la société médiévale relève d’un code rigoureux qui rend compte des honneurs et de la position sociale de l’individu[191]. Le geste concrétise et atteste la hiérarchie. L’homme médiéval, quelle que soit sa position sociale, est néanmoins encouragé à la sobriété dans ses attitudes et à la retenue dans la manifestation corporelle de ses émotions. Le rire, même s’il est relativement mal vu (le concile de Nantes (1431) demande aux ecclésiastiques de demeurer sobres et contenus lors de la messe)[192] est cependant utilisé par certains prédicateurs, qui y voient une manière efficace de passer le message religieux.
Le vêtement, presque autant que le nom ou le signe (armoiries, emblème, devise) est une manière d’afficher son statut social. «Dans le vêtement médiéval, en effet, tout est signifiant: les tissues, les pièces et les formes, les couleurs, le travail de coupe et d’assemblage, les dimensions, les accessoires et, bien sur, la façon de porter le vêtement[193] ». Le vêtement dans ce contexte est un véhicule de l’identité sociale. Il est fortement mal vu dans la société médiévale de se vêtir de manière inappropriée à son rang[194].
L’Alimentation
Pour l’homme médiéval, quelquefois sa condition, le pain et la nourriture à base de céréales, le panagium, constitue la base de l’alimentation[195]. Des différences existent cependant en ce qui a trait au reste du menu. Les plaisirs de la table croissent avec le statut. En Provence en 1338, nourrir un laboureur coûte du tiers à la moitie moins cher qu’un frère[196]. Comme pour l’individu de la société médiéval, l’aliment est classé selon qu’il convient mieux à l’aristocrate ou au roturier. Le classement des aliments varie néanmoins d’un endroit à l’autre. Par exemple, à Toulouse, la volaille est destinée à la roture, mais à la noblesse à Tours. Avec le mouton, c’est l’inverse alors qu’il est consommé par la roture à Tours, mais par la noblesse à Toulouse[195]. Au chapitre de la boisson, le noble dispose du vin, alors que le paysan doit se contenter la majorité du temps de lait, d’eau ou de bière. Malgré cette disparité entre les menus des diverses classes sociales, la relative pauvreté de la diversité alimentaire ainsi que le prix aléatoire et fluctuant de certains produits, le Bas Moyen Âge ignore les pénuries généralisées d’aliments, ce qui diminue fortement l’occurrence de la disette ou de la famine.
L’Amour
L’amour passionnel existe au Moyen Âge, mais il est contraint par les exigences sociales, qui imposent les mariages d’alliance parmi la noblesse et des unions ayant souvent pour but le recoupement des terres dans la classe paysanne. L’amour courtois, idéal littéraire de l’époque, n’a d’autre réalité que dans l’imaginaire, alors que les mœurs sexuelles sont souvent rudes. L’homme d’Église de cette époque, influencé par des idéaux ascétiques, traque le sexe jusque dans la confession[197]. Pour le clerc médiéval, le célibat est préférable au mariage, même si celui-ci demeure nécessaire. Le rapport sexuel hors mariage est vu comme un péché et est sévèrement réprimé lorsqu’il concerne la femme. Même lorsqu’il est effectué dans le cadre de l’union officielle, l’acte charnel porte la trace du péché originel et demeure impur aux yeux de la majorité des théologiens. Cependant, certains théologiens modérés, dont Saint Tomas d’Aquin, acceptent le plaisir charnel dans le cadre du mariage à condition qu’il ne soit pas recherché systématiquement, mais accompagné de la volonté reproductrice[198]. De manière générale néanmoins, on condamne l’activité charnelle et la recherche du plaisir qui y est associé.
Le célibat d’une partie de la population trouve de plus son utilité pour la société de l’époque, où il est préférable qu’une partie de la population reste sans progéniture, et ce, pour des considérations d’héritage, d’espace ou de capacité à nourrir, une surpopulation pouvant engendrer la disette.
Le rapport au travail
Dévalorisé lors du Haut Moyen Âge, le travail est l’objet d’une relative revalorisation à partir du XIIe siècle. Initialement associé à la chute d’Adam et Êve du paradis, le travail commence à être célébré par les moines du Bas Moyen Âge[199]. Suite à la réforme monastique, ces derniers sont confrontés à des tâches manuelles plus régulières, ce qui n’est pas étranger à un changement dans la conception cléricale du labor. L’interdépendance que reconnaît la société d’ordre entre ses trois classes constituantes, Bellatore, oratores et laboratores est un acquis indéniable en faveur d’une nouvelle conception du travail. On assiste également à une mise en valeur du travail de l’artisan, qui est vu comme le prolongement de l’étincelle créatrice de Dieu[200]. Les tabous, initialement nombreux au sujet de l’activité laborieuse sont progressivement levés, mais un grand nombre subsiste, ce qui empêche une promotion complète du monde du travail dans la sphère des activités honorables. Ces tabous renvoient, selon l’historien Jacques Legoff, aux interdits préchrétiens du Sang, de l’argent, de la saleté ainsi qu’aux condamnations des activités liées aux sept péchés capitaux[201].
L’homme et le pouvoir
L’homme médiéval est encouragé par l’Église et les structures en place à accepter son état[202]. En effet, la société terrestre se réclame de l’ordre voulu par Dieu. Dans la conception chrétienne, même si toutes les âmes humaines ont le même poids devant le Seigneur, les individus sont tenus d’obéir dans le monde temporel à l’autorité. De plus, la promesse d’une récompense céleste promise par la religion aide à détourner l’homme de possibles contestations pour améliorer sa situation terrestre et mortelle. La société médiévale offre de plus à l’homme un monde représentationnel confortable où il peut exactement se situer dans la pyramide sociale et connaître à la perfection le rôle qu’on attend de lui[203].
Les représentations sociales et politiques du Bas Moyen Âge s’articulent autour de la figure du roi et de l’autorité monarchique. Chaque monarchie doit, si elle veut se légitimer, se distinguer par l’emploi d’un sacré qui lui est propre (sacre du roi de France à Reims par exemple) et adopter ses propres institutions et sa propre propagande, véhiculée par la valorisation de la dynastie, sa représentation en images et en monument ainsi que le rappel de ses devoirs d’obéissance à la population[204]. Le roi, qui trône au sommet du système, se présente comme le chef spirituel et temporel de son royaume, le lieutenant de dieu sur terre, le garant de l’ordre et des coutumes, le détenteur de la justice suprême, le chef des pouvoirs militaires ainsi que le bon père du peuple, qui peut se montrer ferme, mais toujours dans un souci de justice[205].
L’homme face à la mort
Dans un monde où la mort peut survenir à tout moment en raison des guerres, de la famine ou des épidémies, l’Église conforte l’homme médiéval face à son destin inéluctable. Les rituels religieux, du baptême à l’extrême onction, donnent à l’individu de cette époque un cadre de sécurité où la mort, même si elle garde son aura inquiétante, est relativement apprivoisée[206].
Les rites funèbres restent à peu près les mêmes pour tous jusqu’au XIIIe siècle. Par la suite, une disparité plus accentuée s’affiche. Les pauvres sont pris en charge par les confréries de piété alors que les notables bénéficient de grands enterrements et de gisants[207]. La mort est peu discutée jusqu’au Moyen Âge tardif, mais les épidémies de peste, vues comme un châtiment de Dieu, qui emportent le tiers de la population de l’Europe (25 millions de morts) et l’état de guerre incessant dans lequel la population du XIVe et du XVe siècle est plongée ramènent la mort au-devant de la scène. L’homme éprouve alors une vive terreur devant les cavaliers de l’apocalypse et la mort par la faim ou la peste qui s’abattent sur lui plus que jamais. Une réflexion plus intense sur la mort s’effectue. C’est l’époque de la danse macabre, qui fauche toute la population sans distinction de rang[208].
L’art et la littérature
Après la renaissance culturelle carolingienne, l’art du Bas Moyen Âge se développe dans une relation étroite avec l’Église. Les clercs étant les principaux dépositaires de la culture, c’est d’eux que nous vient la majorité des documents littéraires. Les travaux de nature artistique sont surtout entrepris à la gloire de Dieu, le plus illustre exemple de ce paradigme étant la cathédrale. L’art médiéval de cette époque constitue une synthèse entre la tradition romaine, chrétienne primitive et barbare.
L’homme médiéval n’entretient pas le même rapport aux œuvres artistiques que le moderne. La conception médiévale de l’art se rapproche en effet plus de l’idée platonicienne des formes. Il n’est donc pas anormal de voir la vierge Marie vêtue sur certaines gravures à la manière d’une aristocrate du Moyen Âge. Les représentations de cette époque rendent compte en effet de vérités intemporelles, qui s’inscrivent dans le logos[209].
La guerre
La guerre au Moyen Âge est essentiellement vue comme une activité noble. La pratique guerrière est pour l’homme et surtout l’aristocrate du Moyen Âge le lieu par excellence pour démontrer sa bravoure et son honneur. Le combat constitue alors une épreuve de force et de courage, reléguant au second plan la stratégie militaire[210].
On ne se bat pas pour son pays, mais pour son seigneur ou son roi. Le sentiment national à cette époque est peu développé. C’est la structure vassalique qui dicte les camps, et non pas les enjeux nationaux. Les batailles sont violentes, mais on y meurt peu. La pratique du rançonnage des prisonniers, qui rend la guerre lucrative est alors préférée à l’exécution de l’ennemi[211]. Le seigneur du champ de bataille médiéval est à cette période le chevalier, mais l’introduction d’armes de jet plus puissantes et d’arcs plus efficaces oblige l’armure à évoluer. Elle devient alors plus lourde et plus coûteuse. Le développement de la tactique militaire et l’introduction d’armes améliorées coûteront au chevalier médiéval sa place de guerrier invincible. De plus, les échecs répétés de la chevalerie française lors de la guerre de Cent Ans face aux archers anglais à Crécy, Poitiers et Azincourt annonceront le déclin de la chevalerie en Occident[212]. La professionnalisation des armées et le recours massif aux mercenaires par les États contribueront également au déclin du mode d’organisation militaire féodal.
Renaissance et époque moderne
L’évolution de la pensée au cours de la renaissance et de l’époque moderne se caractérise par un renversement majeur du rapport de l’homme à la morale. C’est désormais l’homme qui est au centre du monde et qui donne sa substance morale à ce dernier. L’ordre éthique n’est plus inscrit dans l’univers lui-même, mais dans la dimension intérieure de l’homme. On passe alors d’une conception ancienne de l’existence et la morale au sein de l’univers à une conception moderne et désenchantée du monde[213].
Désenchantement du monde et valorisation de la rationalité
Lors de la Renaissance, un changement significatif dans la perception du monde et de la relation de l’homme avec le cosmos et Dieu s’amorce. Le siège de l’ordre et de la signification du monde passe de l’extérieur à l’intérieur[214]. Le cogito cartésien pose un nouveau paradigme quant à la relation de l’homme avec le monde. Le lieu d’émanation de la signification du morale de l’univers n’est plus le monde lui-même, mais l`homme. C’est en effet l’homme qui donne à présent au cosmos son sens, qui ordonne sa signification et qui est responsable de la disposition de son logos[215]. Ce changement dans la perception générale de la nature ontologique de la morale est influencé notamment par les travaux sur la mécanique de Galilée et de Newton, qui expliquent les événements du monde dans une perspective mécanique et causale dépourvue de sens intrinsèque[216]. Le XVIIe siècle effectue la transition entre une image de la rationalité ancienne et platonicienne qui se définit comme la contemplation juste de l’ordre des choses et une rationalité moderne et procédurale qui devient l’instrument de la vie bonne[217]. C’est à cette époque qu’on commence à introduire la notion de rationalité de l’homme comme source fondamentale de sa dignité, concept amené par Descartes et repris par Kant[218].
On assiste dans la pensée occidentale du XVIIIe siècle à une valorisation accrue de la raison par rapport à la foi. Dans le milieu intellectuel, on privilégie le développement rationnel de la pensée à la tradition. Pour les penseurs de cette époque, avec comme figure de proue John Locke, l’individu rationnel dispose de la possibilité de se dégager de son héritage culturel qui est jugé subjectif pour embrasser une vision rationnelle du monde et ainsi analyser et juger ses comportements de manière impartiale et objective. La conscience rationnelle est maintenant vue comme la principale caractéristique de la nature humaine. Cette conscience peut, dans une perspective lockéenne, se détacher de son incarnation pour entrer dans un mode de jugement rationnel et objectif de ses comportements. L’homme est alors vu comme ayant la possibilité de critiquer grâce à sa raison autonome les pratiques sociales de sa société de manière impartiale et désengagée[217].
Ces nouvelles perspectives en science et en philosophie contribuent au processus de désenchantement du monde, qui est dépouillé de son aspect normatif, la morale n’étant plus inscrite dans l’ordre cosmique, mais projetée par l’homme. Cette nouvelle vision qui tend à s’installer n’est cependant pas synonyme alors de subjectivisme moral, le concept de nature rationnelle objective étant sauvegardé. À cette vision universaliste de la raison humaine s’oppose un autre courant incarné par Montaigne, qui prône contrairement aux cartésiens affirmant la possibilité d’une connaissance objective par l’introspection rationnelle, une connaissance particulière du soi et de sa nature spécifique[219]. L’introspection ne joue plus alors le rôle de véhicule vers l’universel et l’objectif, mais constitue la voie de découverte vers un univers de significations intimes propres à l’individu, préfigurant le courant expressiviste qui se développera au XIXe siècle[220].
Crise de légitimité du pouvoir
La chute de la signification morale intrinsèque au monde (logos ontique) engendre une perte de légitimité et de repères sur lesquels se fondaient les sociétés occidentales pré-modernes pour fonctionner[221]. En effet, à l’époque médiévale, la structure de la société constituée des bellatores, oratores et laboratores était justifiée par la correspondance à l’ordre divin[217]. Il était alors tout à fait légitime que le roi et la noblesse exercent le pouvoir, car ce dernier émanait de l’ordre même du cosmos. Le désenchantement du monde qui a lieu de manière progressive du XVIe au XVIIIe siècle entraîne une fragilisation considérable de ce rapport entre la structure de la société et l’ordre moral. De plus, la structure sociale subit des changements majeurs lors de la fin du Moyen Âge. La structure féodale se désagrège au profit d’un régime monarchique et un renforcement du pouvoir royal. La guerre de Cent Ans en France et la guerre des Deux Roses en Angleterre transforment profondément le paysage politique des deux royaumes avec l’affaiblissement considérable de l’ancienne noblesse et le renforcement significatif de la monarchie, qui avec les règnes de François Ier et d’Henri VIII tend à se diriger vers l’absolutisme.
La réforme qui se propage à travers l’Europe à partir du XVIe siècle met ensuite à mal l’autorité de l’Église et de la nouvelle monarchie fortifiée, qui est perçue par les réformés comme illégitime ou au mieux intolérante. Les guerres de religions en France, civiles en Angleterre et les guerres de 80 ans (1568-1648) et de 30 ans (1618-1648) dans l’Empire des Habsbourg ont toutes des motifs en partie religieux et sont livrées contre un pouvoir jugé oppresseur. La structure de gouvernance doit donc dans ce contexte être justifiée à l’aide de nouvelles théories politiques. L'alternative qui apparait pour faire face à cette problématique est :
- La monarchie absolue de droit divin : qui se fonde sur le pouvoir absolu de Dieu ou sur la raison d’État et donne au monarque tous les pouvoirs, que ce soit exécutifs, judiciaires ou législatifs[222]. Le roi ne doit se justifier que devant Dieu et a autorité sur tous les aspects du royaume. Ce type de monarchie fut surtout développé en France et connut son apogée sous Louis XIV. Des tentatives eurent lieu sous les Tudors et les Stuarts en Angleterre.
- La monarchie constitutionnelle : la monarchie constitutionnelle, à la britannique, est inspirée des théories du contrat social, qui prônent la libre adhésion de l’individu à la société. Très influencée par Locke, l’idée de contrat social pose les bases d’une société libérale et atomistique, qui est vue plus comme un instrument visant à optimiser les intérêts de la population qu’un lieu de réalisation humain[221](conception grecque).
Ces théories tentent de se substituer à l’ancienne vision de la société ordonnée. Le roi, dans la perspective absolutiste ne tient plus son pouvoir de l’ordre du monde, mais d’un décret divin, qui vient ordonner celui-ci. La théorie du contrat social, incitée par John Locke, pose les bases quant à elle d’un gouvernement non plus fondé sur l’obéissance stricte à l’autorité, mais sur le libre consentement des individus.
Transformation des valeurs et Réforme
À partir du XVIIe siècle, les anciennes valeurs de l’éthique de l’honneur et de la participation à la vie publique comme sphère de réalisation et de la contemplation de l’ordre ontologique moral se perdent au profit de la valorisation de la vie ordinaire, de la science utile et de la famille. Le commerce se substitue à la guerre, le premier étant vu comme utile, le deuxième comme vain. L’introduction de la réforme au XVIe siècle contribue également à la propagation de cette valorisation de la vie ordinaire. En niant un certain sacré, la foi réformée consacre de manière plus évidente la présence de Dieu en toutes choses, et donc en toute activité. Dans cette perspective, la vie simple est revalorisée. Le travail, la famille et la simple production, dévalorisée durant le Moyen Âge et la période antique, sont réintroduits dans la dimension des activités signifiantes et désirables[221].
Décadence de l’Église
L’Église de la Renaissance, même si elle est au sommet de son influence artistique et de sa magnificence, est plus que jamais décadente moralement[223]. Les papes de cette époque sont alors plus des hommes d’États soucieux de la puissance temporelle de Rome et de leur richesse personnelle que de la gloire de Dieu et des affaires spirituelles. Le pape Paul III, par exemple, dira sa première messe 26 ans après avoir été nommé cardinal[224]. Rome est alors vue comme la nouvelle Babylone. Prés de 5 assassinats y ont lieu chaque nuit[225]et la richesse ainsi que la luxure sont la norme plutôt que l’exception parmi les hauts dignitaires de l’Église. Le népotisme est de plus très présent dans les hautes sphères de l’Église. On nomme souvent ses parents à des postes clés dans la hiérarchie ecclésiastique, comme le pape Alexandre VI, qui nomma son fils César Borgia, alors âgé de 17 ans, Cardinal de Valence.
L’ostentation des richesses de l’Église est très grande, et de multiples œuvres artistiques et architecturales, comme la Chapelle Sixtine ou la Basilique Saint-Pierre de Rome sont entreprises à cette époque. La cour papale est en effet l’un des principaux, sinon le principal centre de mécénat en Italie et en Europe. Le cardinal de cette époque doit, pour maintenir le train de vie propre à son rang, faire face à des dépenses considérables. Le revenue annuel d’un cardinal, au début du XVIe siècle est de minimalement de 4000 ducats par année, alors que celui d’un artisan ne dépasse pas quelques dizaines de ducats[226].
La décadence des mœurs du clergé provoque alors un malaise croissant dans la population chrétienne, soucieuse de gagner son paradis. Pour certains, dont Martin Luther, l’Église Catholique, de par sa dépravation, n’est plus en mesure d’assumer son rôle de guide spirituel pour l’humanité. La réforme trouve donc dans ce contexte une grande réceptivité auprès de la population chrétienne désabusée.
La révolution scientifique
La Renaissance fut une époque d’avancées scientifiques considérables. La révolution copernicienne des sciences ainsi que la découverte du Nouveau Monde bouleversent profondément la manière dont on perçoit le monde ainsi que la place de l’homme au sein de celui-ci. On passe en effet d’une représentation géocentrique de l’univers à un modèle héliocentrique, où la terre n’occupe plus le centre de l’univers. Les avancées scientifiques sont considérables, en mathématiques, en astronomie, en médecine et dans le monde des sciences expérimentales. Au XVIIe siècle, William Harvey découvre les mécanismes de la circulation sanguine et Antoine van Leeuwenhoek, grâce à l’invention du microscope, fait la découverte des micro-organismes, ouvrant ainsi le regard de l’homme à l’infiniment petit. L’invention de l’imprimerie au XVe permet la prolifération des livres et du savoir, ce qui engendre un engouement généralisé pur la connaissance et l’accroissement de la communauté intellectuelle d’Europe. On abandonne progressivement le latin au profit de la langue populaire pour diffuser le savoir[227]. En raison de la fermeture de l'Église de cette époque aux avancées scientifiques qui ébranlent profondément ses dogmes (l’affaire Galilée aura de grandes répercussions dans le milieu intellectuel), le savant est tiraillé entre la foi ainsi que la volonté de rester dans les bonnes grâces de l’Église et la quête de la connaissance[228]. L’incapacité de l’autorité religieuse à s’adapter à cette vague de savoir et sa fermeture par rapport aux nouvelles percées de la connaissance discréditera par la suite l’Église catholique dans le monde intellectuel[229].
Le renouveau des Arts
La Renaissance est une période d’effervescence pour l’art. Initié en Italie et encouragé par l’Église, le mécénat se généralise à l’ensemble de l’Europe au XVIe siècle. Le renouveau de l’art à cette époque est paradoxalement associé à un néoplatonisme qui prend ses racines à Florence[230]. L’artiste de cette époque voit en effet ses œuvres comme les représentations des formes divines. Les genres se multiplient et le roman côtoie le conte héroïque au XVI siècle. L’art, qui avait été au Moyen Âge l’apanage du religieux, s’en distance progressivement et commence à s’intéresser, surtout dans le domaine de la peinture, à la vie quotidienne même s’il faut attendre les mouvements réaliste et naturaliste du XIXe siècle avant que les représentations artistiques de ce type soient courantes. Au XVIIe siècle, l’art est surtout associé au classicisme plus rigide initié par la monarchie absolue. L’expression artistique comme le reste de la société est subordonnée à la volonté royale et devient le véhicule de la morale absolutiste, qui représente ce qui doit être et non pas la réalité des mœurs de l’époque. La France rayonne sur le monde, ainsi que ses artistes. Des codes rigides d’unité se développent, mais sont mis de côté à la mort de louis XIV pour laisser place à des manifestations artistiques plus frivoles. On assiste à un retour vers la simplicité, la nature et les valeurs civiques de l’Antiquité grecque.
La campagne et la ville
La vie à la campagne comme à la ville de l’homme du XVIe siècle au XVIIIe siècle est marquée par l’omniprésence de la puanteur et de la saleté[231]. Les bains à cette époque sont rares, car on croit que l’eau est le véhicule des maladies. À la campagne, le manque d’hygiène est généralisé, et les paysans sont vus par les élites comme des bêtes sauvages[231].
Depuis près de mille ans, la condition de vie du paysan dans la campagne, à l’exception de la diminution de la disette et de la famine, a peu évoluée, et les rares avancées techniques dans le domaine agricole sont trop dispersées dans le temps pour que l’espoir du progrès pénètre dans les mentalités. Dans les villages ruraux, les points de rencontre où s’articulent la vie communautaire de la population sont la taverne et l’Église[232]. Ces deux établissements antagonistes, figures du vice et de la vertu, rythmes la vie paysanne de l’époque. En ville, à partir de la seconde moitie du XVIIe siècle, les cafés se multiplient. Les élites y discutent alors d’art et de philosophie. En campagne, la situation de la femme se dégrade suite à la popularisation de la chasse aux sorcières au XVIe siècle[233].
La famille
La famille nucléaire à la Renaissance et lors des siècles subséquents est traditionnellement vue comme l’unité de base de la société. Au fil du temps, le rôle du père comme chef de famille prend de l’importance, et le rôle de la mère, surtout dans la haute société, se limite à la reproduction ainsi qu’à l’éducation des jeunes enfants et des filles. La femme de la haute société donne généralement naissance à plus d’enfants en raison de l’impératif de la descendance masculine pour la transmission du patrimoine familial[234]. Le rôle du père reste limité malgré l’accroissement de son autorité lors du XVIIe siècle. Ce dernier ne s’occupe dans l’éducation des enfants que de l’encadrement des mœurs sexuelles de ses filles. Le jeune garçon reçoit lui son éducation d’homme en majorité de la collectivité dans laquelle il vit. Son apprentissage se déroule dans la sphère publique plutôt que dans le privé[235]. La durée du célibat s’allongeant sous l’impulsion de l’Église soucieuse d’épurer les mœurs de la population, la période de l’adolescence, âge entre l’enfance et l’age adulte où l’individu est marié, apparaît.
La stratification sociale
Au XVIIe siècle, la volonté de la monarchie absolue de tout ordonner dans la société entraîne une définition plus nette des classes sociales. La noblesse, qui était au Moyen Âge un état de fait, devient un véritable statut juridique. Cependant, les frontières sociales de la société de d'ancien régime sont plus perméables que l’image de l’époque ne revoit traditionnellement. À l’époque de Louis XIV, comme le bourgeois Gentilhomme de Molière, le caricature, le noble désargenté, recherche souvent l’alliance du riche bourgeois. La descendance commune des deux parties peut alors bénéficier de la fortune de l’un et du nom de l’autre. Le clivage est plus marqué entre les membres de la haute société (riche bourgeoisie et noblesse) et le peuple. Les premiers ont en effet développé des conceptions morales différentes des seconds du fait de la purification des mœurs qui a lieu dans la haute société à partir du XVIIe siècle. Cette différence de comportements et d’attitudes, autrefois moins marquée, engendre un fossé culturel plus grand entre les deux sphères de la société[236]. L’image du paysan barbare et le concept de masse populaire se voient renforcés dans les représentations collectives[237].
Le rapport à la justice
Au début du XVIe siècle, la violence, répandue de manière générale dans toutes les classes de la société, est vue comme un élément banale[238]. L’homicide est alors perçu comme un crime parmi tant d’autres, et le roi accorde même souvent son pardon aux affaires de vengeance. Ces dernières sont cependant soumises à une codification implicite stricte. Il est en effet très mal vu de se venger de manière inappropriée. Il règne alors un équilibre parfois fragile entre la justice du plus fort et la justice des institutions. La situation change au XVIIe siècle, en particulier sous le règne de Louis XIII en France. L’État français doit à l’époque trouver des moyens de financer ses dépenses militaires croissantes. Un contrôle des populations plus étroit est alors développé, et ce dans un but majoritairement fiscal[239]. Le développement de l’administration publique et de la police assure un encadrement plus efficace de l’homme de cette période, qui est sommé de se soumettre à l’autorité du roi et de l’État absolutiste. L’édit contre les duels promulgué par le cardinal de Richelieu en 1626 s’inscrit dans le projet de la domestication de l’aristocratie frondeuse et de sa soumission à l’autorité royale, soumission qui atteindra son paroxysme sous le règne de Louis XIV. La justice alors se développe et se codifie de plus en plus. À Lille, en 1713, cracher à la figure d’un homme de loi vaut automatiquement un passage devant le tribunal criminel[240]. Tout acte de contestation est vu comme une opposition directe au roi et comme crime de lèse-majesté.
La Civilisation des mœurs
À la fin du XVe siècle, et même durant le XVIe, les mœurs autant de la noblesse que du peuple sont extrêmement rudes. La violence est omniprésente dans la vie de la population, l’hygiène est presque absente et les pratiques sexuelles sont beaucoup plus libres qu’elles ne le deviendront lors du XVIIe siècle. À titre d’exemple, vers la fin du Moyen Âge, 50% des Dijonnais ont participé au moins une fois à un viol[241]. La pudeur, particulièrement en ce qui a trait à l’hygiène intime, est ignorée. On n’éprouve alors aucune honte à déféquer ou à uriner en public. La gêne, autant à la campagne qu’à la cour du roi, est absente, au point même d’incommoder certains membres de la haute aristocratie dont Henri III qui se plaint de la promiscuité de la vie à la cour. C’est au sein de celle-ci que s’opérera en premier le raffinement des mœurs. Elle servira d’exemple à la population du XVIe au XVIIIe siècle comme idéal et modèle des comportements à adopter.
L’Église, à partir du XVII siècle, initiera un mouvement de redressement des mœurs en étant plus sévère au sujet notamment de l’ivrognerie et des comportements sexuels. Cette purification des mœurs a surtout une résonance dans les milieux bourgeois aisés et dans l’aristocratie, mais ne peut pénétrer de manière efficace les couches populaires[242]. Un clivage se forme alors entre les mœurs de la haute société et celles du peuple, clivage qui était de moindre importance dans les siècles précédents où la majorité de la société partageait les mêmes mœurs. Le changement d’attitude de la part de la haute société est particulièrement présent dans la codification des comportements qui se développent à la cour, avec comme exemple type l’étiquette de Versailles sous Louis XIV. La mode également se transforme sous l’influence de la volonté d’élégance dans les mœurs. Les bijoux se multiplient dans le vêtement et les parfums sont désormais l’objet d’un usage généralisé. Le mouchoir et le gant, popularisés à partir de la seconde moitie du XVIIe siècle, expriment le nouveau tabou du contact corporel absent jusqu’alors[243]. L’introduction du corset témoigne également d’une volonté de maîtrise du soi exprimée par le maintien rigide du corps, vu comme l’objet par excellence de dépravation. La chevelure n’échappe pas à la tendance, surtout chez les femmes. Le chapeau, dans toutes les classes sociales devient primordial, l’échevelée étant considérée comme une sorcière ou une prostituée[244]. Cette rigidité dans la mode rejoint la volonté de sobriété dans les émotions, qui sont à partir de l’époque du Roi-Soleil de plus en plus intériorisées. L’élégance devient la norme principale à respecter. L’image du courtisan raffiné supplante alors chez la noblesse la figure virile du guerrier en armure.
L’Homme et le pouvoir
Le prince de la renaissance quitte progressivement le système vassalique caractéristique du Moyen Âge pour entrer dans l’époque moderne. Les relations de pouvoir qui marquent la Renaissance et l’époque moderne se transforment. Le prince de cette époque n’en est plus un lié par des liens de fidélités envers son seigneur, mais est mû par la raison d’État et la recherche du pouvoir[245]. L’homme politique est alors perçu comme un être cruel, sans pitié, froid, calculateur et égoïste. Représentatif du tournant qui s’effectue à cette époque, l’ouvrage de Machiavel, Le Prince, annonce la naissance de la science politique comme étude du pouvoir seul, et non plus comme volonté d’organiser une société juste, à la manière de la République de Platon. Le XVIe siècle marque également un tournant dans l’évolution de la structure de l’État et de sa conception en Europe occidentale. Les grandes monarchies comme l’Angleterre, la France et l’Espagne se définissent. Le sentiment national, presque absent jusqu’alors, se développe. En raison de l’escalade des dépenses militaires dues à la nécessite pour les monarques d’entretenir des armées permanentes, l’administration et la structure bureaucratique de l’État prennent également de l’expansion. La conception de royaume et d’État passe progressivement de propriété du prince comme c’était le cas au Moyen Âge à une entité distincte du souverain.
Dès le XIVe siècle, un conflit se dessine entre la monarchie qui tente de se solidifier et l’aristocratie, jalouse de ses privilèges. Souvent méfiant à l’endroit de la haute noblesse, le roi préfère s’entourer d’hommes de plus basse extraction qu’il anoblit ou de seigneurs de moyenne noblesse, ses favoris qu’il couvre de privilèges et de terres, tels les mignons d’Henri III. Décimée par la peste, les guerres sont concurrencées par la bourgeoisie qui accumule les charges d’État, la noblesse en venant finalement à être relativement réduite au silence comme en témoigne sa domestication à Versailles.
Le rapport à la Guerre
À partir du XVe siècle, la guerre prend un nouveau visage. L’introduction de l’arme à feu, d’abord peu performante, la popularisation de l’arc et le perfectionnement de l’art de la fortification (structures en bastion) changent le rapport de l’homme à la guerre. Le mode de combat chevaleresque et féodal décline au profit de la professionnalisation de la guerre et du mercenariat, encouragé par la volonté des États de constituer des armées permanentes. La tactique se substitute à la volonté d’exprimer son courage sur le champ de bataille. La mort du chevalier Bayard, tué par un coup d’escopette, annonce la fin de l’ère chevaleresque dans la guerre. L’infanterie devient au détriment de la cavalerie la principale unité tactique de l’armée. L’introduction de l’artillerie révolutionne également l’art de la guerre. Le condottiere, chef de compagnies mercenaires italiennes, qui voit dans la guerre une opportunité d’ascension sociale et d’accumulation de richesses plus qu’une occasion de prouver sa valeur au combat, reste une figure marquante de cette époque[246].
Les lutes, essentiellement de nature territoriale lors du Moyen Âge se transforment durant la Renaissance en querelles dynastiques pour l’hégémonie en Europe. Le duel entre Valois-Bourbons et Habsbourg pour la prédominance sur le continent marquera le XVIe et le XVIIe siècle. On assiste également à la multiplication des guerres civiles, principalement en raison de l’introduction de la Réforme, qui divise les classes dirigeantes en Europe, et du duel entre la monarchie et la noblesse en France et la monarchie et le parlement en Angleterre. Les guerres de religions en France (1562-1598), de 80 ans aux Pays-Bas (1568-1648), de 30 ans dans l’Empire germanique (1618-1648) ainsi que les tensions politiques et religieuses constantes dans l’Angleterre des Tudors et des Stuarts témoignent de la polarisation de la société entre catholiques et protestants. Ces guerres ont un caractère particulièrement sauvage du fait de leur division religieuse. Les saccages des campagnes et les pillages, relativement moins nombreux avant le XIVe siècle, se développent sur le modèle des chevauchées effectuées part l’armée anglaise en sol français lors de la guerre de Cent Ans.
La période qui va du traité de Westphalie à la Révolution française inaugure une nouvelle ère dans la pratique guerrière. Le concept d’armée nationale se répand à travers l’Europe. Les forces militaires sont alors constituées majoritairement de professionnels et non plus de troupes mercenaires. La guerre est alors plus que jamais assujettie aux objectifs politiques des différents États. C’est l’époque de la guerre de cabinet.
La guerre, même si elle n’est plus l’apanage de la chevalerie et de la noblesse, ne perd pas son pouvoir d’attrait. Les monarques et l’aristocratie la considèrent encore comme un lieu de réalisation et de prouesses ainsi que la voie royale d’acquisition d’honneur et de prestige. L’ardeur d’un monarque comme Louis XIV à accumuler les victoires militaires démontre bien la place encore centrale que la lutte armée occupe dans les valeurs de l’homme de l’époque.
La sensibilité des lumières
Le mouvement des lumières est marqué d’une part par une valorisation accrue de la raison au détriment de la coutume et par la volonté de l’homme à retourner vers la nature ainsi qu’une mise en avant de l’émotivité. L’amour de l’enfant et la vie familiale comme sphère de réalisation sont mis de l’avant. Le mariage d’amour, même s’il n’est toujours pas la norme, devient plus populaire. L’exaltation des émotions devient plus présente dans les représentations culturelles de la société. Les romans La nouvelle Héloïse ou Clarissa[247], qui mettent de l’avant l’émotivité et la mélancolie, obtiennent un grand succès. Un retour à la nature (le jardin anglais gagne en popularité) et aux valeurs de bonté primitive (Jean-Jacques Rousseau) marque également l’époque[248].
On assiste au cours du XVIIIe siècle à un recul de la pratique du christianisme, même si la dimension religieuse reste encore très présente dans la vie en société. Le milieu intellectuel lui se détourne progressivement de conceptions chrétiennes traditionnelles pour embrasser le déisme (Shaftesbury, Hutcheson, Locke) ou l’athéisme (David Hume). Les sources morales dans cette perspective sont progressivement détournées de Dieu pour situer leur fondation en l’homme. Pour les penseurs de ce temps, honorer Dieu n’est plus la priorité, c’est le bonheur de l’homme qui suffit. Cette conception de l’homme comme le centre du monde moral représente un déplacement significatif des sources morales, qui se situent maintenant dans la personne humaine[249].
Références
- Philippe Poirrier (dir.), L’Histoire culturelle : un «tournant mondial» dans l’historiographie?, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2008.
- Philippe Poirrier, Les enjeux de l'histoire culturelle, Paris, Seuil, 2004.
- George Langlois et Gilles Villemure, George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.3.
- Jean-Pierre Vernant, Introduction dans "L'Homme grec", Paris, Seuil, 2000, p.7-33.
- Gérard Simon, "L'âme du monde, le temps de la réflexion, no10, 1989, p.123.
- Jean-Pierre Vernant, Introduction dans "L'Homme grec", Paris, Seuil, 2000, p.22.
- Jean-Pierre Vernant, Introduction dans "L'Homme grec", Paris, Seuil, 2000, p.29.
- Jean-Pierre Vernant, Introduction dans "L'Homme grec", Paris, Seuil, 2000, p.30.
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.121.
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.122-124.
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.129-135.
- James Guillaume, Éducation chez les Spartiates, http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3655
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.136-140.
- Pierre Vidal-Naquet, Le Chasseur noir. Formes de pensée et formes de société dans le monde grec, Paris, La Découverte, 1991, p.162.
- James Guillaume, L'éducation chez les Athéniens, http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=2117
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.142-153.
- http://internetbiblecollege.net/Lessons/Ancient%20Pagan%20Greek%20Attitudes%20to%20Nudity.pdf
- Thomas R. Scott, Education and Pederasty in Ancient Greece, http://www.truthtree.com/pederasty.shtml
- Ferrari, Gloria. Figures of Speech: Men and Maidens in Ancient Greece, University of Chicago Press, 2002, p.145.
- PhD. Hein Van Dolen, http://www.livius.org/ho-hz/homosexuality/homosexuality.html
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.150-151.
- Guissepe Cambiano, Devenir homme dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.148-153.
- http://www.cndp.fr/musagora/citoyennete/citoyennetefr/quiestcitoyen.htm
- George Langlois et Gilles Villemure, George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.33.
- Yvon Garlan, L’homme et la guerre dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.98.
- Arthur Rosenberg cité par Luciano Canfora, Le citoyen dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.185.
- http://remacle.org/bloodwolf/historiens/thucydide/livre7.htm
- Luciano Canfora, Le citoyen dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.191.
- Jean-Marc Piotte, Les neuf clés de la modernité, Montréal, Québec Amérique, 2007, p.47.
- George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.32.
- Yvon Garland, L’homme et la guerre dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.79.
- Yvon Garlan, L’homme et la guerre dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.75-119.
- Yvon Garlan, L’homme et la guerre dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.105.
- Xénophon, économique, chapitre V, http://remacle.org/bloodwolf/historiens/xenophon/economique.htm
- Xénophon, économique, chapitre IV.
- Luciano Canfora, Le citoyen dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.190.
- Claude Mossé, l’homme et l’économie dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.46-51.
- Kelley L. Ross, The Origin of Philosophy: Why the Greeks?, http://www.friesian.com/greek.htm
- Claude Mossé, l’homme et l’économie dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.56-73.
- James Redfield, Homo domesticus dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.219-231.
- James Redfield, Homo domesticus dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.241.
- Robin Osborne, The Polis and its Culture dans The Routledge History of Philosophy: From the Beginning to Plato, London, Routledge, 2003, p.9-47.
- Paul Cloché, Le siècle de Périclès, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? », 1963, p.12-23; 58-71.
- Charles Sagal, L’Homme grec, spectateur et auditeur dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.285-291.
- Hésiode, Théogonie.
- Charles Sagal, L’Homme grec, spectateur et auditeur dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.297-303.
- Charles Sagal, L’Homme grec, spectateur et auditeur dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.309-312.
- Charles Sagal, L’Homme grec, spectateur et auditeur dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.323.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.337-338.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.340-343.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.343-346.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.353.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.361.
- Oswyn Murray, L’homme grec et les formes de socialité dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.363-371.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.377-382.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.382-387.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.388-389.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.392-397.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.398-401.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.402-410.
- Mario Vegetti, L’homme et les dieux dans « L’homme grec », Points histoire, Paris, Seuil, 2000, p.411-419.
- Giardina, Andrea, L’Homme Romain, Points histoire, Paris, Seuil, 2002, p.7.
- Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l’Empire romain, Paris, 1970, chapitre 16.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.31.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.33.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.40.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.41.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.49-50.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.52.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.53-55.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.55.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.57-60.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.62.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.64-68.
- Claude Nicolet, Le citoyen et le politique dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.70-71.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.111-112.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.113.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.117.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.119.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.121-123.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.125.
- Aldo Schiavone, Le juriste dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.128.
- George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.64-65.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.73-108.
- George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.65.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.78.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.82-83.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.87-88.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.92-93.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.96-97.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.94 et p.98.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.99.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.102.
- John Scheid, Le prêtre dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.106-107.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.131.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.136-137.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.139-140.
- Limes dans l’encyclopédie Larousse, http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/limes/65954
- George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.63-63.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.144-145.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.148.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.152-155.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.158.
- Jean-Michel Carrier, Le soldat dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.168.
- Yvon Thébert, L'esclave dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.180.
- Yvon Thébert, L'esclave dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.183-185.
- Yvon Thébert, L'esclave dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.197.
- Yvon Thébert, L'esclave dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.205-206.
- Jean Andreau, L'affranchi dans « L’Homme romain », Point histoire, Paris, Seuil, 2002, p.227-247.
- George Langlois et Gilles Villemure, George Langlois et Gilles Villemure, Histoire de la civilisation occidentale, Montréal, Beauchemin, 2005, p.56.
- Andrea Giardina, L'homme romain, Paris, Seuil, 2002, p.14.
- Charles Richard Whittaker, Le pauvre dans "L'homme romain", Paris, Seuil, 2002, p.374.
- Brent D. Shaw, Le bandit dans "L'homme romain", Paris, Seuil, 2002, p.385,405.
- Claude Lepelley, pierre Riché, Michel Sot, Haut Moyen Âge : culture, éducation et société, Éditions Publidix, Nanterre, 1990, p.33.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, pp.35-40.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, pp.39-40.
- Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, 1995, pp.41-50.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.39.
- Jean-Louis Goglin, Les misérables dans l'Occident médiéval, Éditions du seuil, Paris, 1976, p.215
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.29-35.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.29-30.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.31.
- Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, 1995, p.342-343.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.15.
- Guillaume Bernard, Introduction à l’histoire du droit et des institutions, Studyrama, Paris, 2004, p.75-80.
- Jean-François Gerkens, Droit privé comparé, Larcier, Bruxelles, 2007, p.72.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.55-60.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.68-69.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.63-64.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.63.
- Étienne Louis Chastel, Le christianisme et l’Église au Moyen Âge, J. Cherbuliez, Paris, 1859, p.157-158.
- Étienne Louis Chastel, Le christianisme et l’Église au Moyen Âge, J. Cherbuliez, Paris, 1859, p.159.
- Étienne Louis Chastel, Le christianisme et l’Église au Moyen Âge, J. Cherbuliez, Paris, 1859, p.175.
- Étienne Louis Chastel, Le christianisme et l’Église au Moyen Âge, J. Cherbuliez, Paris, 1859, p.179.
- Charles Taylor, Les sources du moi, Éditions du Seuil, Paris, 1998, Chs.7-8.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.4.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.5.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.4-7.
- Michel Rouche, Histoire du Moyen Âge : VIIe-Xe siècle, Éditions Complexe, Bruxelles, 2005, p.130-140.
- Georges Duby, Henri Bresc, La famille occidentale au Moyen Âge, Éditions Complexe, Paris, 2005, Ch. I.
- Georges Duby, Henri Bresc, La famille occidentale au Moyen Âge, Éditions Complexe, Paris, 2005, p.57.
- Jean Claude Schmitt et Gerhard Otto Oexle, Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p.448-451.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.91.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.92-93.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.35-40.
- Michel Kaplan, Christophe picard, Michel Zimmermann, Le Moyen Âge, IVe-Xe siècle, Éditions Boréal, Paris, 1994, p.353.
- Michel Kaplan, Christophe picard, Michel Zimmermann, Le Moyen Âge, IVe-Xe siècle, Éditions Boréal, Paris, 1994, p. 350-355.
- Michel Kaplan, Christophe picard, Michel Zimmermann, Le Moyen Âge, IVe-Xe siècle, Éditions Boréal, Paris, 1994, p.350-360.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.49-52.
- Amadou Madougou, Du droit de la guerre, Éditions l’Harmattan, Paris, 2003, p.31.
- Régine Le Jan, Famille et pouvoir dans le monde franc (VIIe-Xe siècle), Publications de la Sorbonne, Paris, 1995, p.91-95.
- Jean Verdon, La femme au Moyen Âge, J-P. Gisserot, Paris, 1999, p.2-4.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.46.
- Jean Verdon, La femme au Moyen Âge, J-P. Gisserot, Paris, 1999, pp.48-50.
- Sebastien Dussourd, 100 hommes qui ont fait le monde, Jeunes Editions Studyrama, Paris, 2005, pp.74-75.
- Dominique Ancelet-Netter, La dette, la dîme et le denier : une analyse sémantique du vocabulaire économique et financier au Moyen Âge, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2010, p.85-90.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.76-85.
- Le processus de feodalisation, disponible en ligne au http://www.univ-ag.fr/modules/resources/download/default/doc. (Date d’acces 2 mai 2011)
- Norbert Rouland, L'État français et le pluralisme : histoire politique des institutions publiques de 476 à 1792, O. Jacob, Paris, 1995,p.121-124.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.78-79.
- Sophie Cassagnes-Brouquet, Culture, artistes et société dans la France médiévale, Ophrys, Paris, 1998, p.68.
- Agnes Blanc, La langue du roi est le français, L’Harmattan, Paris, 2010, p.123-124.
- Histoire des provinces de France, Vol. 2, Nathan F., Paris, 1982, p.48.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.85.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.75-76.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.78-80.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.79-81
- Voir dans Maurice Druon, Le roi de Fer, LGF, Paris, 2002, 249p.
- Pierre Riché, Guy Lobrichon, Le Moyen Âge et la Bible, Éditions Beauchesne, Paris, 1984, p.570-575.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.107.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.109.
- Jean-Louis Goglin, Les misérables dans l'Occident médiéval, Éditions du seuil, Paris, 1976, p.208.
- Michel Kaplan, Patrick Boucheron, Le Moyen Âge, XIe-XVE siècle, Éditions Boréal, Paris, 1994, p.125-130.
- Michel Kaplan, Patrick Boucheron, Le Moyen Âge, XIe-XVE siècle, Editions Boréal, Paris, 1994, p.130.
- Denise Riche, L’ordre de Cluny à la fin du Moyen Âge, Presses de l’université de Saint-Etienne, 2000, pp.27-33.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.96.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.95.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.98.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.9-14.
- Georges Provost, La fête et le sacré, Editions du Cerf, Paris, 1998, Ch.IV.
- Jacques Legoff, L’imaginaire médiévale, Editions Gallimard, Paris, 1985, p.84.
- Charles Taylor, Les sources du moi, Editions du Seuil, Paris, 1998, Chs.11-13.
- David Lebreton, Corps et sociétés, Librairie des Méridiens, Paris, 1985, p.11-15.
- David Lebreton, Corps et sociétés, Librairie des Méridiens, Paris, 1985, p.9.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.46.
- Herve Martin, Les femmes du Moyen Âge entre symboles et réalités, dans A. Croix, Femmes de Bretagne. Images et histoire, Rennes, 1998, p.25.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.70.
- Georges Minois, Histoire de la vieillesse en Occident de l'Antiquité à la Renaissance, Fayard, Paris, 1987, p.302.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.70-71.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.71.
- Jean Claude Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, Gallimard, paris, 1990, p.225.
- Jean Claude Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, Gallimard, paris, 1990, p.278-281.
- Jean Claude Schmitt, Gerhard Otto Oexle, Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p.605.
- Jean Claude Schmitt, Gerhard Otto Oexle, Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, publications de la Sorbonne, Paris, 2003, p.605-606.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.50.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.52.
- T.N. Tentler, Sin and Confession on the Eve of the Reformation, Princeton, 1977.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.57.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.92.
- Ch. Wenin, Saint Bonaventure et le travail manuel, p.141-155.
- voir L’imaginaire médiéval de Jacques Legoff.
- Jean-Louis Goglin, Les misérables dans l'Occident médiéval,Editions du seuil, Paris, 1976, p.194.
- Voir les explications de Charles Taylor dans Les sources du moi ainsi que :Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.126-127.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, p.136-138.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, Ch. IV.
- Voir les explications sur la mort dans : Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006.
- Herve Martin, Mentalités Médiévales II, Presses universitaires de France, Paris, 2001, Ch. III.
- Bruno Dumezil, La société médiévale en occident, Ellipses, Paris, 2006, p.144-153.
- Charles Taylor, Les sources du moi, Editions du Seuil, Paris, 1998, Chs.21-23.
- Anne-Marie Capdeboscq, Luis Fe Canto, La chevalerie Castillane au XVe Siècle, Presses universitaires de Limoges, 2000, p.7-30.
- Anne-Marie Capdeboscq, Luis Fe Canto, La chevalerie Castillane au XVe Siècle, Presses universitaires de Limoges, 2000, p.15-20.
- Andres Wiedermann, Les chevaliers français à la bataille d’Azincourt, GRIN Verlag, 2010, p.9-10
- Pour de plus amples informations et une analyse plus poussée, voir ;Charles Taylor, Les sources du moi, Éditions du Seuil, Paris, 1998, 712p.
- Charles Taylor, Les sources du moi, Éditions du Seuil, Paris, 1998, Ch. 8.
- Charles Taylor, Les sources du moi, Editions du Seuil, Paris, 1998, Ch. 9.
- Jacques Van Rilaer, Psychologie de la vie quotidienne, Odile Jacob, Bruxelles, 2003, pp.40-42.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, ch.9.
- Voir Kant dans Fondation de la métaphysique des mœurs, Première section.
- Voir Montaigne, Les essais, livre II ch. 18.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, chs. 20-22.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, ch.11.
- Voir dans La théorie de l'absolutisme au XVIIe siècle [archive].
- Massimo Firpo, Le Cardinal, dans « L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, pp.101-105.
- Massimo Firpo, Le Cardinal, dans « L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, p.126.
- Massimo Firpo, Le Cardinal, dans « L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, p.84.
- Massimo Firpo, Le Cardinal, dans « L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, pp.96-97.
- Ariane Boltanski, Aliocha Maldavsky, La Renaissance des années 1470 aux années 1560, Editions Breal, Paris, 2002, pp.85-89.
- Paul Oskar Kristeller, Huit philosophes de la renaissance italienne, Droz, Genève, 1975, pp.83-89.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, chs.19-20.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.127.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.42-43.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.106.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.341.
- Margaret L. King, La femme de la Renaissance dans « L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, p.284.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.296-297.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.149-150.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.140-155.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.17-30.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.135.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.170.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.303.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, pp.270-280.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.393.
- Robert Muchembled, L’invention de l’homme moderne, Fayard, Paris, 1994, p.224.
- John Law, Le prince de la Renaissance, dans« L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, pp. 20-27.
- Michael Mallet, Le condottiere, dans« L’homme de la Renaissance », Points histoire, Paris, Seuil, 1990, p.48-56.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, ch.17.
- Charles Taylor,Les sources du moi : la formation de l’identité moderne, Éditions du Seuil, 1998, chs. 19-20.
- Pour plus d’approfondissement, voir Les sources du moi.
Wikimedia Foundation. 2010.