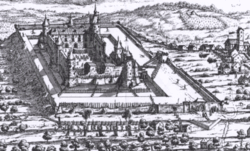- Moyen (Meurthe-et-Moselle)
-
Moyen Administration Pays France Région Lorraine Département Meurthe-et-Moselle Arrondissement Arrondissement de Lunéville Canton Canton de Gerbéviller Code commune 54393 Code postal 54118 Maire
Mandat en coursFrancis Villaume
2008 - 2014Intercommunalité Communauté de communes de la Mortagne Démographie Population 502 hab. (1999) Densité 21 hab./km² Géographie Coordonnées Altitudes mini. 236 m — maxi. 347 m Superficie 23,57 km2 Moyen est une commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
Sommaire
Géographie
Histoire
L'histoire de Moyen est pour beaucoup liée à l'histoire de son château. Carrefour d'importantes luttes d'influence, la destinée du village s'est forgée au rythme des siècles de conquêtes.
- Époque gallo-romaine
- À cette époque, Moyen était probablement déjà un lieu fortifié. Son nom Medium Castrum le laisse supposer.
- XIIe siècle
- Période mal connue, le nom de Moyen apparaît dans de nombreux documents comme un lieu fortifié. Dom Calmet attribue la propriété du village en bloc à l'abbaye de Senones
- 1224
- Jean d'Apremont, évêque de Metz achète à l'abbaye de Senones tous les biens que celle-ci possède à Moyen, sauf les dîmes et le droit de patronage.
- 1224 - milieu du XVe siècle
- Les successeurs de Jean d'Apremont continuent à acquérir les biens que possèdent divers seigneurs et abbayes. Ils deviennent les seuls maîtres du pays. Moyen devient donc une châtellerie importante qui comprend Vathiménil, Chenevières, Saint-Clément, Laronxe et le prieuré de Mervaville. La garde de la châtellerie est confiée à un châtelain.
- 1444
- L'évêque de Metz, Conrad Bayer de Boppart fait raser l'ancien château pour construire une puissante forteresse à Moyen. La maison seigneuriale, la chapelle, le palais épiscopal et les remparts sont édifiés. C'est à cette époque que le château prend le nom de Qui Qu'en Grogne. Pourquoi ? Dom Calmet rapporte que l'évêque de Metz y faisait travailler les bourgeois d'Épinal qui étaient ses sujets. Les seigneurs des environs en auraient pris ombrage et se mirent à grogner. Conrad Bayer de Boppart n'en tint pas compte, et pour marquer son mépris, nomma son château Qui-qu'en-grogne. Moyen devint alors une des plus belles places de l'évêché de Metz.
- 1555
- Le Cardinal Robert de Lenoncourt, alors évêque de Metz (serviteur du roi de France) obtient une garnison française pour Moyen.
Passage probable des protestants de France et d'Allemagne à Moyen.
- 1582
- Passage des Bourguignons.
- 1591
- Les Espagnols saccagent la forteresse.
- 1597
- Les reîtres font probablement les plus gros dégâts au château. Battus à Thiébauménil, ils brûlent le village et le château. Le château sera reconstruit et c'est sans doute à cette époque que sont apparues les fenêtres à meneaux qu'on voit en diverses parties du bâtiment.
- 1635
- Le château, alors français, est capturé par les Lorrains (Charles IV duc de Lorraine). Commandée par Jean d'Arbois de Xaffévillers, la garnison alors mise en place, ne résiste que peu de temps au maréchal de La Force, commandant des troupes françaises (5 jours). C'est le manque d'eau (18 septembre) qui fera tomber le château et qui donnera l'idée de creuser le puits.
- 1636
- Le duc de Lorraine, Charles IV, demande aux Lorrains de reprendre le château, ce qu'ils font.
- 1639
- Richelieu fait mettre le siège devant le château de Moyen. C'est François du Hallier, gouverneur de Nancy, qui se charge de la besogne en compagnie, dit-on, de 4000 hommes. Antoine Thouvenin et une centaine d'hommes tiennent alors le château. Ils répondent par des sorties audacieuses aux salves d'artillerie. Finalement, le 15 septembre une capitulation est signée.
Richelieu fait, par la suite, démanteler le château.
- XVIIIe siècle
- À la Révolution, le château est vendu comme bien national. La propriété est morcelée, les pierres de la forteresse de Moyen servent aux villageois pour bâtir leurs maisons. Le quartier du Raymont en témoigne.
- De nos jours
- Le château est maintenant classé monument historique, il fait l'objet de travaux de restauration qui, chaque année, contribuent à lui redonner son aspect d'origine.
Administration
Liste des maires successifs Période Identité Étiquette Qualité mars 2008 Francis Villaume mars 2001 André Herique PS Toutes les données ne sont pas encore connues. Démographie
Évolution démographique (Source : INSEE[1]) 1962 1968 1975 1982 1990 1999 467 525 508 506 550 502 Nombre retenu à partir de 1968 : Population sans doubles comptes Lieux et monuments
- Château Qui qu'en grogne XVe siècle et XVIe siècle, classé monument historique. Château mentionné au XIIe siècle ; acquis au XIIIe siècle par les évêques de Metz qui lui donnèrent le nom de Qui-Qu'en-Grogne en le reconstruisant au XVe siècle ; pris en 1597 par le duc de Bouillon, et en 1653 par les Français qui le démantelèrent en 1639. Un seul bâtiment a survécu jusqu'en 1956 (incendie), maison dite "des Abbés", tour de la prison, salle des gardes, ancienne chapelle, vestiges de deux enceintes, puits.
- Faïencerie Chambrette, puis Curé Lacroix construite en 1763 pour Gabriel chambrette, fils de Jacques chambrette (1705 ; 1758) fondateur de la faïencerie de Lunéville. Le bâtiment est établi à proximité d'un petit ruisseau, alimenté par un puits (?) du château, dont l'eau sert au pétrissage de la terre. Commence à produire dans le courant de l'année 1765 des pièces de table semblables à celles fabriquées à Lunéville. L'usine est acquise en 1780 par Curé Lacroix, propriétaire de la faïencerie de Rambervillers, puis revendue en 1783. Cesse de fonctionner en 1791, ou peu après. Une tradition locale, vraisemblablement erronée assigne au bâtiment une reconversion en filature dans les premières années du XIXe siècle. Utilisée comme maison par la suite, l'usine est presque totalement détruite entre 1983 et 1986.
- Moulin, puis cartonnerie Sainte-Marguerite (2e moitié XVIIIe siècle ; 3e quart XIXe siècle ; 1er quart XXe siècle). Appartenait à la mense épiscopale de Metz. Vendu comme bien national le 30 avril 1791. Possédait en 1858 six paires de meules dont quatre étaient entraînées par une roue hydraulique et deux par une turbine. Agrandissement dans le courant du 3e quart XIXe siècle. Usine réglementée en 1835, 1862 et 1866. Transformation en cartonnerie en 1923 pour Marcel et Paul Jacquemin de Saint Die et, construction de bâtiments supplémentaires à cette occasion (ateliers de fabrication, chaufferie, cheminée d'usine, dite alors cartonnerie sainte Marguerite, elle-même désaffectée en 1936.
- Pont médiéval sur la Mortagne.
Édifice religieux
- L'église Saint-Martin XIVe siècle tour latérale, avec son lustre en Cristal moulé de Baccarat (seconde moitié du XIXe siècle) et la partie instrumentale de l'orgue attribuée à Blesi Jean (facteur d'orgues) du XVIIIe siècle
Musée
Petit musée du château de Qui-Qu'en-Grogne : classe 1900 reconstituée, petit musée agricole, salle d'archéologie, salle avec miniatures de châteaux forts.
Personnalités liées à la commune
Voir aussi
Notes et références
Lien externe
Wikimedia Foundation. 2010.